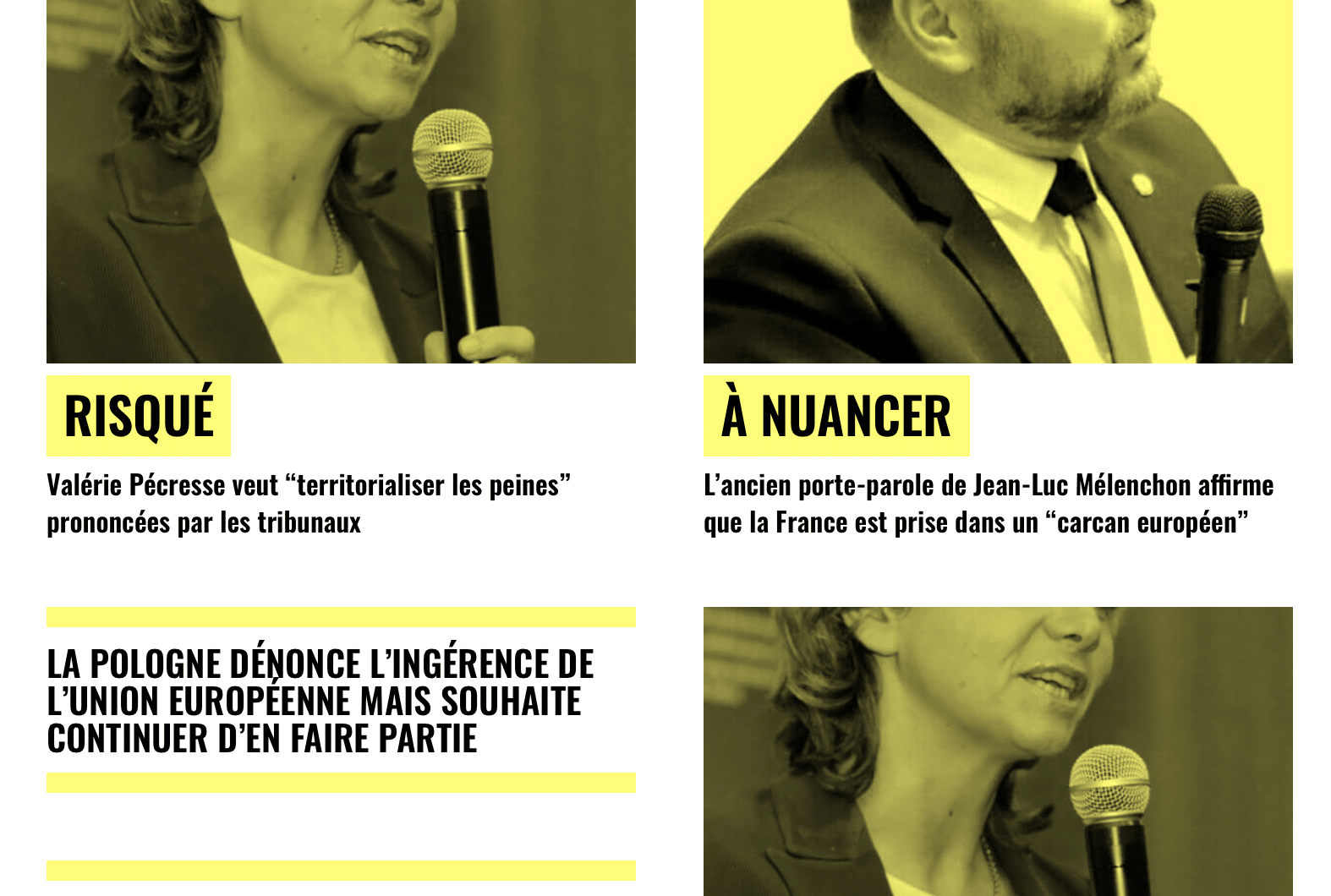Cette semaine chez les Surligneurs : JL Mélenchon se trompe sur le vote de confiance
Contrairement à ce que semble penser Jean-Luc Mélenchon, le vote de confiance n’est pas obligatoire. Les gouvernements Cresson et Rocard s’en étaient passé. Les Surligneurs nuancent également une affirmation d’Emmanuel Macron selon laquelle tous les français auraient le droit à l’erreur administrative. Enfin, on découvre cette semaine qu’il peut y avoir des sexangulaires lors des élections. Cela s’est produit une fois, on vous révèle où en fin d’article.
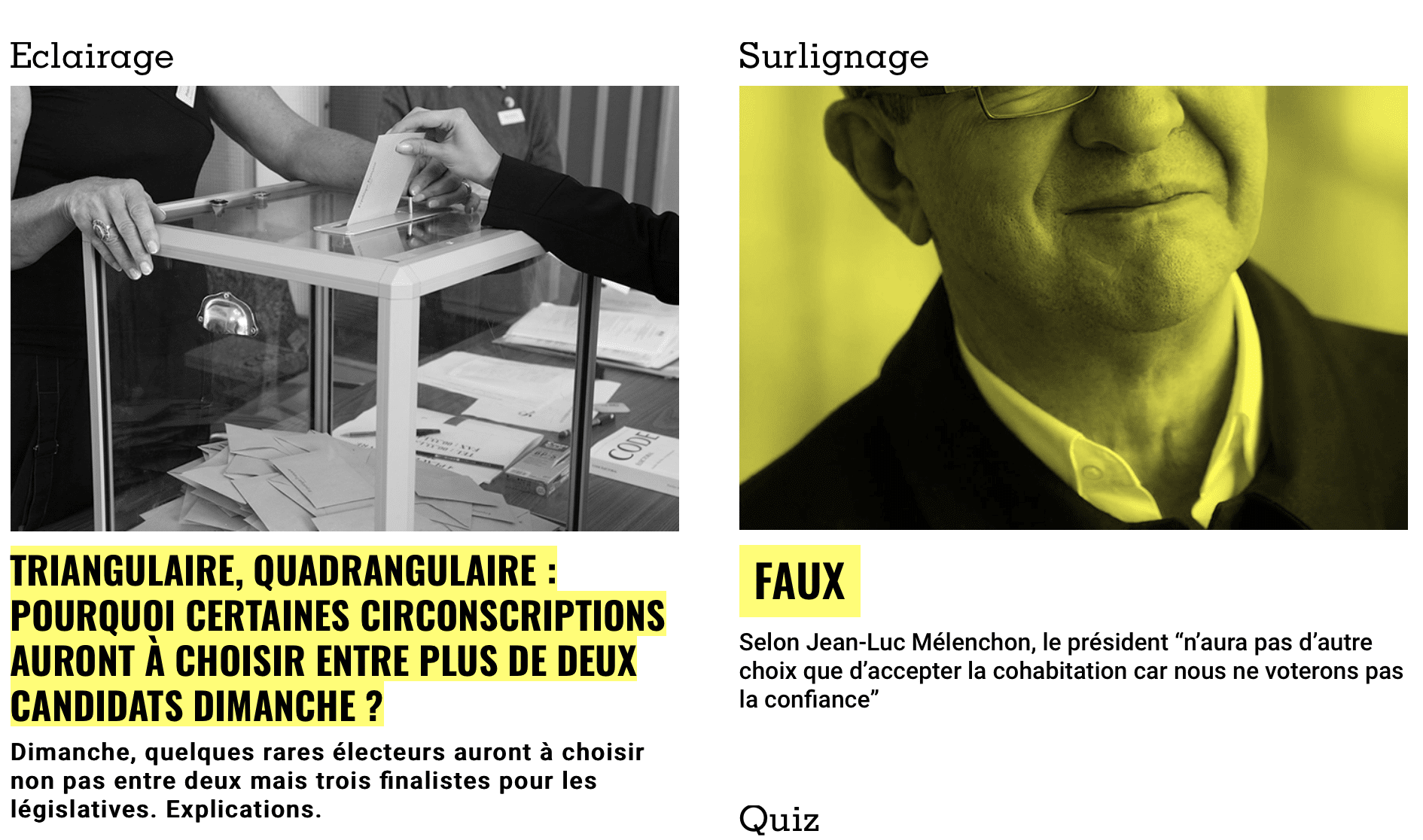
Jean-Luc Mélenchon affirme que NUPES ne votera pas la confiance dans le nouveau gouvernement s’il n’est pas Premier ministre, mais le vote de confiance n’est pas obligatoire
Les élections législatives vont permettre de désigner la nouvelle Assemblée nationale et avec elle une majorité politique. Si l’alliance NUPES arrive en tête, le Président de la République devrait en tenir compte dans sa désignation d’un Premier ministre. L’article 20 de la Constitution prévoit que le Président nomme le Premier ministre qui va conduire la politique de la nation, et pour cela il a besoin d’une majorité parlementaire. Si le Premier ministre ne peut pas compter sur cette majorité, l’Assemblée nationale peut décider de renverser le gouvernement, conformément à l’article 49 de la Constitution.
La solution la plus évidente est donc de nommer un Premier ministre de la même couleur politique que la majorité parlementaire. À défaut, Jean-Luc Mélenchon indique qu’il ne votera pas la confiance. Toutefois, si l’article 49 indique que le Premier ministre vient exposer son projet politique devant l’Assemblée qui lui donne sa confiance par vote, ce n’est pas une obligation. Cette simple faculté est devenue plus systématique pour les derniers gouvernements investis mais le gouvernement Cresson ou Rocard s’en était passé. De plus, l’alliance NUPES espère obtenir une majorité relative et non absolue comme il le faudrait pour dicter leur politique. Pour renverser le gouvernement, une motion de censure doit recueillir la “majorité des membres composant l’Assemblée”, c’est-à-dire la majorité “absolue” de 289 députés sur 577.
Ainsi, si “Ensemble !” n’obtient pas une majorité absolue à l’Assemblée nationale, la couleur politique du Président pourrait s’appuyer sur une coalition lui permettant de nommer le Premier ministre de son choix.
En savoir plus ? Cliquer ici.
Le Président de la République ne peut pas affirmer que tous les français ont le droit à l’erreur sur leurs déclarations à l’administration
L’affirmation dans le programme “Ensemble !” est trop générale pour être valable. Certaines erreurs de bonne foi sont par exemple exclues de la possibilité de se tromper. La loi ESSOC de 2018, pour un État au service d’une société de confiance, a bien instauré un droit à l’erreur (article L123-1 du Code des relations entre le public et l’administration) ou plus exactement “un droit à la régularisation en cas d’erreur”.
La loi prévoit une possibilité de se tromper, de bonne foi, pour la première déclaration devant une administration. Cependant, sont exclues les erreurs si grossières qu’elles ne peuvent avoir été commises de bonne foi et celles qui ne peuvent pas être régularisées, telles que les omissions ou les retards dans la déclaration. Pour ces dernières il ne s’agit pas d’erreur mais de négligence.
Enfin, certaines erreurs de bonne foi sont exclues, notamment celles qui relèvent du droit de l’Union européenne pour obtenir des subventions européennes. Ce sont aussi toutes les erreurs dans l’exécution d’un contrat avec l’administration, ou dans le respect de la réglementation économique, ce qui fait un large champ d’erreurs potentielles, exclu du droit à l’erreur.
En savoir plus ? Cliquer ici.
L’intervention de l’État face à la hausse des prix de l’énergie interroge sur le plan du droit européen
Face à la hausse soudaine des prix de l’énergie et de l’électricité, observée depuis plusieurs mois, le Gouvernement a annoncé des mesures pour bloquer cette hausse. Mais l’État peut-il imposer à une entreprise publique des contraintes qu’un actionnaire “traditionnel” n’aurait pas pu imposer à une entreprise “traditionnelle” ? EDF est une entreprise publique, détenue à 84% par l’État, ce qui lui offre une grande marge de manœuvre pour nommer les dirigeants d’EDF, orienter la stratégie et la gestion de l’entreprise. Dans le même temps, l’État, au titre de régulateur du marché de l’électricité, peut prendre des mesures réglementaires qui s’imposent à EDF selon l’article L336-10 du Code de l’énergie. Ces deux rôles, “État actionnaire” et “État régulateur” ne se confondent pas, même si la frontière est fine, ce qui nourrit un certain nombre de difficultés juridiques.
Ce qui pose des difficultés c’est le respect du droit de la concurrence et particulièrement les aides d’État qui peuvent fausser le jeu de la concurrence (article 103 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Une réduction tarifaire, comme celle décidée pour EDF, peut être considérée comme une subvention publique. De plus, le ministre de l’économie a annoncé des mesures de soutien – notamment une recapitalisation à hauteur de 2,5 milliards d’euros – pour pallier la chute du cours de l’action de l’entreprise et rassurer les marchés. Le Gouvernement pourrait se défendre en considérant qu’il a agi comme simple “investisseur avisé en économie de marché”, exception admise par la Commission européenne : l’annonce des mesures de soutien a bien favorisé EDF, mais il s’agissait d’une action nécessaire à la vie de l’entreprise, qui ne dépend pas du statut de l’État.
La réduction annoncée va également entraîner une perte de 8 millions d’euros de l’excédent brut d’exploitation pour 2022. Plusieurs recours sont intentés à ce sujet, des syndicats ont par exemple déclenché une procédure de droit d’alerte économique ; les fonds d’actionnariat salariés, s’estimant lésés par l’extension temporaire du mécanisme Arenh, ont saisi la justice ; dernièrement, le PDG d’EDF a formulé un “recours gracieux” auprès du ministre de l’Économie, première étape avant de saisir la justice si sa demande venait à être rejetée.
Le mécanisme Arenh (Accès régulé à l’électricité nucléaire historique) permet aux concurrents d’EDF (Engie, Total, etc.) de pouvoir acheter à un prix fixé par les pouvoirs publics une certaine quantité d’électricité produite par EDF. L’objectif est notamment d’éviter des potentiels abus de positions dominantes. En février 2022, l’Autorité de la concurrence a condamné EDF à 300 millions d’euros d’amende pour avoir exploité abusivement sa position commerciale.
L’utilisation du mécanisme contraint EDF à vendre davantage à ses concurrents, à un tarif très compétitif malgré les difficultés techniques rencontrées par l’entreprise, l’obligeant probablement à acheter de l’électricité sur les marchés et à les revendre à ses concurrents.
En savoir plus ? Cliquer ici.
La forte abstention réduit le nombre de triangulaires
Lors du second tour des élections législatives, il arrive régulièrement que 3 ou 4 candidats soient encore en concurrence. C’est le cas actuellement de Philippe Juvin dans les Hauts-de-Seine, Alexandre Freschi dans le Lot-et-Garonne et Jean-Pierre Cubertafon en Dordogne.
Selon l’article L162 du Code électoral, le seuil de maintien pour les élections est fixé à 12,5% des électeurs inscrits dans une circonscription. Un seuil difficile à atteindre en raison du fort taux d’abstention, qui a également réduit le nombre de triangulaires (8 pour ces élections). Le même article précise que si aucun candidat n’atteint ce seuil, seuls les deux candidats arrivés en tête se maintiennent au second tour. Des quadrangulaires se sont produites de temps à autre pour des élections municipales ou départementales. Il y eut même une sexangulaire pour le cas de la municipale de Taiarapu-Est Faaone (Tahiti) en 2014.
En cas de triangulaire, des retraits peuvent également avoir lieu, si par exemple l’un des concurrents estime qu’il ou elle n’a aucune chance de l’emporter au regard des reports de voix.
En savoir plus ? Cliquer ici.
Référence : AJU300028