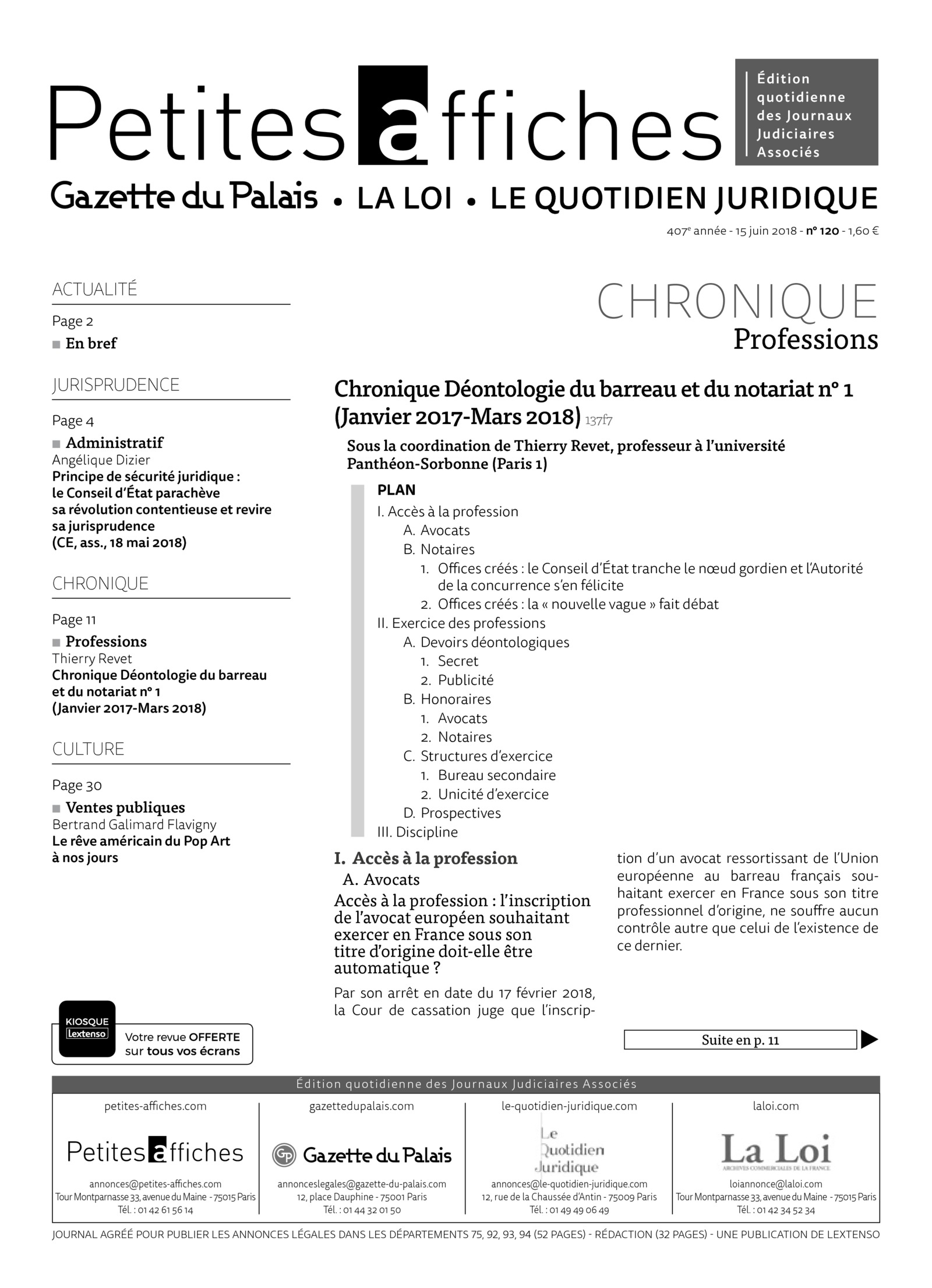Chronique Déontologie du barreau et du notariat n° 1(Janvier 2017-Mars 2018)
I – Accès à la profession
A – Avocats
Accès à la profession : l’inscription de l’avocat européen souhaitant exercer en France sous son titre d’origine doit-elle être automatique ?
Par son arrêt en date du 17 février 20181, la Cour de cassation juge que l’inscription d’un avocat ressortissant de l’Union européenne au barreau français souhaitant exercer en France sous son titre professionnel d’origine, ne souffre aucun contrôle autre que celui de l’existence de ce dernier2.
Rappelons qu’un avocat qui ne remplit pas la condition de nationalité exigée à l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et qui souhaite exercer la profession d’avocat en France bénéficie de plusieurs voies d’accès dérogatoires à la profession. Parmi celles-ci, les articles 83 et 84 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, prévoient qu’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne3 peut exercer à titre permanent dans un autre État membre sous son titre professionnel d’origine. À cette fin, il doit s’inscrire sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix, sur production d’une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État membre de l’Union européenne auprès de laquelle il est déjà inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre.
L’ensemble de ce dispositif résulte de la transposition par la loi n° 2004-130 du 11 février 20044 (modifiant celle du 31 décembre 1971) de la directive n° 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, visant « à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise ». Cette directive sectorielle se situe naturellement dans le cadre plus général de libre circulation des personnes et des services poursuivis par les traités. L’avocat « européen » peut ainsi très facilement exercer sa profession au sein de l’Union européenne. Il doit cependant être inscrit sur une liste ad hoc sous son titre « national » d’origine, cette inscription garantissant la bonne information des consommateurs afin de leur permettre de distinguer les avocats exerçant sous un titre européen.
L’article 84 de la loi du 31 décembre 1971 précitée dispose que cette inscription est « de droit ». Mais permet-elle de s’affranchir, à ce stade, des conditions de moralité, de probité et d’honneur qui conditionnent en principe l’inscription de droit commun des avocats au barreau français ? Oui, selon la haute juridiction.
En l’espèce, un avocat au barreau de Luxembourg souhaitant accéder à la profession d’avocat en France, sollicite son inscription au barreau de Lyon. Sa demande ayant été rejetée par le conseil de l’ordre, il réitère cette demande en appel, à titre principal, et réclame, à titre subsidiaire, son inscription sous son titre professionnel d’origine (sous lequel il exerce au barreau du Grand-Duché du Luxembourg). Pour rejeter sa demande, la cour d’appel5 avait retenu que la remise par celui-ci d’une fausse attestation sur l’honneur indiquant qu’il n’a jamais présenté de demandes d’inscription auprès d’autres barreaux (ce qu’il avait fait) caractérisait une méconnaissance des principes essentiels de la profession, car elle portait atteinte aux principes de probité, de moralité et d’honneur.
L’arrêt est censuré au visa des articles 83 et 84 de la loi du 31 décembre 1971. Pour la haute juridiction, « seule est requise la production de l’attestation mentionnée à l’article 84 », de sorte que la cour d’appel, en approuvant le refus d’inscription prononcé sur le fondement d’une fausse déclaration, avait ajouté aux textes susvisés une condition qu’ils ne comportaient pas, les violant ainsi par fausse application.
La cour d’appel de Lyon fondait son refus sur la déclaration sur l’honneur mensongère produite par l’avocat attestant qu’il n’avait jamais présenté de demandes d’inscription auprès d’autres barreaux. Il est clair qu’un tel mensonge est constitutif d’un manquement au principe essentiel de la profession d’honneur (puisqu’il consiste à mentir sur son honneur) mais aussi, sans doute, de ceux de probité et plus généralement de moralité6. Or, l’on sait que la Cour de cassation a déjà approuvé des cours d’appel d’avoir jugé que le respect de ces principes suppose une obligation de loyauté concernant les renseignements que le candidat délivre au moment de la procédure d’admission7 ; la probité et la moralité d’un candidat-avocat peuvent donc s’apprécier avant son inscription aux fins de rejeter celle-ci. Cette jurisprudence a été récemment confortée par la Cour européenne des droits de l’Homme8. Il ressort par conséquent de l’arrêt commenté que le contrôle du respect des principes essentiels à la profession d’avocat ante inscription n’est pas applicable au cas de l’avocat ressortissant européen sollicitant d’exercer sous son titre d’origine.
Une telle solution nous semble critiquable. Certes, d’un côté, l’article 84 de la loi de 1971 dispose que l’inscription « est de droit » (sous réserve bien entendu de pouvoir produire une attestation permettant d’établir le titre d’avocat d’origine), formulation suggérant effectivement que le contrôle de l’inscription par les barreaux d’accueil doit s’exercer a minima. Cette interprétation est au demeurant conforme à l’objectif général de liberté d’exercice de la profession au sein de l’Union européenne et, au-delà, à l’idée de reconnaissance mutuelle entre barreaux. Sans doute, également, l’avocat européen ayant passé les fourches caudines de son barreau d’origine doit-il bénéficier d’une sorte de présomption de compatibilité déontologique avec les règles du barreau d’accueil. Autre argument parfois invoqué : l’idée selon laquelle l’avocat inscrit reste surtout rattaché à son barreau d’origine, le barreau d’accueil ne servant que d’autorité de « rattachement ». D’un autre côté, toutefois, il nous semble qu’une interprétation aussi « mécanique » de l’article 84 est excessive : la logique d’harmonisation européenne nécessite-t-elle d’exclure tout contrôle d’opportunité de la part des barreaux d’accueil ? D’abord, on aboutit à cette situation paradoxale que l’avocat ressortissant européen se trouve moins sévèrement traité que l’avocat national ou l’avocat étranger (européen ou non) souhaitant pleinement s’intégrer au barreau français en exerçant sous le titre d’avocat français, alors même que cette période d’exercice sous le titre professionnel d’origine est pensée comme un sas ouvrant ensuite sur une pleine intégration au barreau français9. Ensuite, et surtout, il est douteux que cette interprétation de l’article 84 soit parfaitement conforme à la directive n° 98/5 l’ayant inspiré. Rappelons en effet que parmi les motifs invoqués par le Parlement européen et le Conseil européen, il est avancé qu’il convient de soumettre les avocats visés à l’obligation de s’inscrire auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil « afin que celle-ci puisse s’assurer qu’ils respectent les règles professionnelles et déontologiques de l’État membre d’accueil ». À cet égard, l’article 6.1 de ladite directive dispose qu’« indépendamment des règles professionnelles et déontologiques auxquelles il est soumis dans son État membre d’origine, l’avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine est soumis aux mêmes règles professionnelles et déontologiques que les avocats exerçant sous le titre professionnel approprié de l’État membre d’accueil pour toutes les activités qu’il exerce sur le territoire de celui-ci ». De sorte que tout en étant rattaché à son barreau d’origine, l’avocat inscrit sous son titre professionnel fait pleinement partie du barreau auprès duquel il candidate10. Il prête d’ailleurs à ce titre serment11. Il s’agit donc d’une double appartenance12. N’est-il pas, dès lors, paradoxal de ne pas appliquer à ces candidats à l’inscription les règles déontologiques premières – car ayant un caractère prophylactique – qui conditionnent l’accès à la profession ? On ne voit pas ce qui justifie une telle différence de traitement.
Le barreau d’accueil contraint à l’inscription n’est toutefois pas totalement dépourvu de moyens d’action. Une fois inscrit, l’avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d’origine est soumis à la discipline du barreau d’accueil13. Il est donc théoriquement possible de diligenter une procédure disciplinaire contre l’avocat inscrit « automatiquement » pour sanctionner un manquement qui aurait pu justifier ab initio le refus de l’inscription d’un avocat « national ». Vous avez dit harmonisation ?
Julien LAURENT
B – Notaires
1 – Offices créés : le Conseil d’État tranche le nœud gordien et l’Autorité de la concurrence s’en félicite
C’est peu dire que les dispositions de la loi dite Macron14 et de ses textes d’application créant de nouveaux offices notariaux par « tirage au sort » (sur recommandation de l’Autorité de la concurrence)15 avaient déclenché l’ire de la profession… Plusieurs requérants, dont le Conseil supérieur du notariat, avaient ipso facto introduit un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du ministre de l’Économie et des Finances et du ministre de la Justice du 16 septembre 2016 relatif à l’installation des nouveaux notaires. La position du Conseil supérieur du notariat était, à cet égard, plus que délicate (voire schizophrénique) car il était, d’une part, chargé du bon accueil de la nouvelle génération et d’autre part partie à cette action… Un recours concernait également le décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 (lequel permit in extremis aux SCP de notaires d’être titulaires de plusieurs offices et donc de candidater à la création d’un office).
Aux termes d’une décision du 16 octobre 2017, le Conseil d’État tranche sans équivoque en faveur de la « dérégulation » en rejetant tous les moyens développés par les différents requérants. Le premier grief soulevé concernait le nombre d’offices à créer, sur lequel l’Autorité de la concurrence ne se serait pas prononcée. Le Conseil d’État relève que celle-ci a bien, dans son avis du 9 juin 2016, proposé « la création d’un nombre d’offices permettant l’installation libérale de 1650 notaires à l’horizon 2018 » et recommandé, pour chaque zone d’installation libre, « la création d’un nombre d’offices permettant l’installation libérale d’un nombre donné de nouveaux notaires ». Les parties discutaient, également, de la contradiction entre l’article 2-6 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d’offices de notaire (qui autorisa la délimitation des zones d’installation dans le ressort de plusieurs chambres départementales) et l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. Sur ce point, le Conseil d’État décide que les ministres de la Justice et de l’Économie ont pu retenir les « zones d’emploi » définies par l’Insee comme référence pertinente pour délimiter les zones d’installation et que la délimitation de zones d’installation inscrites dans le ressort de plusieurs chambres départementales ne méconnaît pas les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance. Sur le nombre d’office créés, la haute juridiction retient que l’autorité administrative n’est pas tenue de prendre en considération tous les critères prévus par le décret n° 2016-216 du 26 février 2016 pour identifier les zones où l’implantation d’offices apparaît utile si ceux retenus lui permettent de satisfaire aux objectifs prévus par la loi ; l’arrêté a, ainsi, pu légalement ne pas prendre en compte le critère tiré du nombre de notaires salariés. Par ailleurs, il relève que la carte des zones d’installation libre et les recommandations de créations d’offices sont fondées sur une estimation du potentiel d’installation de nouveaux notaires jusqu’en 2024, combinant une hypothèse de chiffre d’affaires futur par notaire libéral de 450 000 €, et une contrainte tenant à ce que l’installation de nouveaux professionnels n’entraîne pas une réduction du chiffre d’affaires moyen par office de plus de 35 %. Selon les hauts magistrats, considérant l’actuel chiffre d’affaires moyen par notaire libéral, ainsi que les seuils définis par les instances représentatives pour alerter de la viabilité d’un office ou pour encourager une association et, considérant, enfin, la période sur laquelle la création d’offices est envisagée, ces chiffres ne sont pas entachés d’une erreur manifeste d’appréciation. C’est également sans erreur manifeste d’appréciation que l’arrêté a pu fixer des recommandations tendant à la création de 1002 offices pour un objectif de 1650 nouveaux professionnels pour une période de 2 ans en considération du potentiel d’installation de 3500 à 4000 notaires identifié jusqu’en 2024. Enfin, sur le grief de l’ouverture tardive du tirage au sort aux SCP existantes (reproche formulé par les partisans de la loi Macron), les juges administratifs ont rejeté le recours exercé contre le décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016. Le Conseil d’État précise (cela dit) qu’avant l’expiration du délai de 2 ans, si besoin, un nouvel arrêté des ministres de l’Économie et de la Justice pourra ordonner la création d’offices supplémentaires en fonction des attributions d’offices nouvellement créés et du nombre de nouveaux professionnels nommés.
C’est donc une victoire sans équivoque pour l’Autorité de la concurrence qui n’a pas tardé à réagir ! Dans un communiqué du 23 novembre 2017, elle fait le bilan de la procédure de nomination dans les zones « vertes » et des avis rendus sur des demandes de création d’offices en zones « orange ». L’Autorité précise qu’elle continuera d’être vigilante au calendrier de mise en œuvre de la réforme et qu’elle envisage d’entamer ses travaux de révision de la carte au premier semestre 2018. À cet effet, elle a lancé le 9 avril 2018 une vaste consultation publique, à laquelle toutes les personnes remplissant les conditions d’exercice de la profession sont invitées à participer, ainsi que les instances représentatives de la profession16. Enfin, elle procédera à un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de la première carte, en vue d’améliorer le dispositif sur la période 2018-2020. Nous sommes donc au début du commencement !
Laure GASCHIGNARD
2 – Offices créés : la « nouvelle vague » fait débat
Rép. min. n° 02903 : JOAN 6 mars 2018, p. 1955 – Blein. « L’incertitude est de tous les tourments le plus difficile à supporter », dit-on ! Dans cette ligne, le député Blein s’est récemment ému du sort des diplômés notaires concernés par la seconde vague de création d’offices de notaires qui démarra à compter du bilan commencé le 16 novembre 2017 en application de l’arrêté Carte du 16 septembre 2016, pris en application de la loi Macron. En effet, les diplômés notaires tirés au sort en rang utile dans cette seconde vague sont justement en proie à l’incertitude, dans la mesure où il leur est actuellement impossible de déterminer avec certitude si leur candidature sera instruite par les services du ministère de la Justice. Un décompte du nombre de professionnels installés dans les 1002 offices créés au 16 novembre 2017 devait permettre de déterminer le nombre d’offices supplémentaires à créer au titre de la seconde vague de créations afin d’arriver à l’objectif de 1650 nouveaux professionnels, avant que l’Autorité de la concurrence ne commence l’instruction de la nouvelle cartographie pour la session de créations 2018-2020.
La question du décompte était donc posée : fallait-il exclure les notaires salariés et les associations qui interviendraient dans les nouveaux offices individuels ? Par ailleurs, les offices attribués aux sociétés civiles professionnelles existantes sont-ils pris en compte pour le calcul des 1650 professionnels en ce qu’elles ne permettent pas l’installation d’un nouveau professionnel ?
Le ministre répond sans concessions que fin novembre 2017, la Chancellerie a déjà indiqué sur son site internet la méthode de comptabilisation des 1650 nominations. Doivent être comptabilisés les notaires libéraux nouvellement nommés dans la zone, c’est-à-dire les notaires dont la nomination vient accroître, conformément à la loi du 6 août 2015 et à l’avis de l’Autorité de la concurrence, le nombre total de personnes physiques exerçant les fonctions de notaire libéral dans la zone (qu’il s’agisse de notaires primo-installants ou de notaires déjà installés mais qui exerçaient auparavant dans une autre zone) : ne sont pas comptabilisés, en revanche, les notaires nommés dans un office créé qui exerçaient déjà les fonctions de notaire libéral dans la zone de création de l’office. En outre, seules les nominations dans un office créé opérées au moment de la création de l’office sont comptabilisées à l’exclusion des nominations intervenant postérieurement à la création, ni les nominations dans un office préexistant (lesquelles permettront seulement d’apprécier l’offre notariale au stade de l’élaboration de la prochaine carte). Ne sont pas davantage prises en compte les nominations de notaires salariés, ce qui semble couler de source… Relevons, à cet égard, que la Chancellerie a mis en ligne sur son site internet un calendrier prévisionnel des nominations restant à venir, lequel fait apparaître, zone par zone, et dans l’ordre des tirages au sort, le nombre de notaires libéraux restant à nommer. Rien n’a été laissé au hasard, ou presque !
Laure GASCHIGNARD
II – Exercice des professions
A – Devoirs déontologiques
1 – Secret
Le droit de la concurrence confère aux enquêteurs de l’Autorité de la concurrence des pouvoirs particulièrement étendus. Parmi ceux-là, l’article L. 450-4 du Code de commerce autorise à procéder à des visites et saisies de documents. La possibilité qu’ouvre ce texte interroge au regard des règles déontologiques de la profession d’avocat, notamment s’agissant de la protection du secret professionnel lorsque les documents appréhendés contiennent des échanges avocat-client. Deux décisions récentes illustrent ces difficultés.
I. Confirmation de la conventionnalité de la saisie intégrale des messageries électroniques
En matière de saisies de messageries électroniques, la Cour de cassation valide la pratique des enquêteurs de l’Autorité de la concurrence, consistant à saisir l’intégralité de ces messageries. Si la messagerie contient des correspondances couvertes par le secret professionnel, la saisie de ces dernières est nulle au jour de leur appréhension17. Toutefois, cette nullité ne rejaillit pas sur l’ensemble de la saisie, et notamment celle des échanges non couverts par le secret professionnel18, qui n’est donc pas invalidée.
L’arrêt rapporté19, permet de confronter une nouvelle fois la position de la Cour de cassation exposée précédemment à la protection conventionnelle des droits et libertés fondamentaux. En l’espèce, l’Autorité de la concurrence saisit entre autres documents, des messageries électroniques de salariés d’une société. La société requérante invoque notamment l’article 6 § 1 de la Convention EDH en combinaison avec l’article 8 de la même convention pour se plaindre d’une atteinte au secret des correspondances avocat-client. La Cour profite tout d’abord de cette décision pour rappeler qu’elle est « maîtresse de la qualification juridique des faits »20, et n’examine en conséquence la requête que sous l’angle de l’article 8 de la Convention EDH. Au sujet des messageries électroniques, la Cour, s’appuie ensuite sur son précédent arrêt en la matière Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services21. Par cette décision, la CEDH avait rappelé que la fouille et la saisie de documents électroniques constituent une ingérence dans les droits protégés par l’article 8 de la Convention EDH et plus spécifiquement dans le droit au respect de la vie privée et de la « correspondance »22. Cette ingérence est prévue par la loi, mais la Cour relève qu’« à défaut de pouvoir prévenir la saisie de documents étrangers à l’objet de l’enquête et a fortiori de ceux relevant de la confidentialité qui s’attache aux relations entre un avocat et son client, les requérantes devaient pouvoir faire apprécier a posteriori et de manière concrète et effective leur régularité »23. Or, précisément dans l’arrêt Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services, pour conclure à la disproportion de l’atteinte et condamner la France, la Cour avait constaté que si les requérantes ont exercé le recours que la loi leur ménageait devant le juge des libertés et de la détention (JLD), ce dernier, tout en envisageant la présence d’une correspondance émanant d’un avocat parmi les documents retenus par les enquêteurs, s’était contenté d’apprécier la régularité du cadre formel des saisies litigieuses, sans procéder à l’examen concret qui s’imposait24. Dans l’espèce commentée dans la présente chronique, la Cour réaffirme que s’il y a une ingérence dans les droits garantis par l’article 8 de la Convention EDH, elle est prévue par la loi et nécessaire. En ce qui concerne l’exigence de proportionnalité, la Cour, pour valider la décision nationale25, relève qu’à « la différence de l’affaire Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services (précitée), le juge interne, après avoir prononcé l’annulation de la saisie de trois fichiers (…) s’est effectivement livré à un contrôle de proportionnalité tel qu’exigé par les dispositions de l’article 8 de la Convention EDH, d’une part, tandis que la requérante ne l’a pas saisi d’allégations selon lesquelles des documents, précisément identifiés par elles, auraient été appréhendés à tort, d’autre part. En outre, elle constate que la requérante conservait la possibilité d’identifier les documents litigieux pour ensuite en réclamer la restitution à l’Administration, le juge ayant même donné acte à cette dernière de son accord à cette fin »26. Ainsi, prenant en compte la marge d’appréciation de l’État en la matière, la Cour estime que l’ingérence n’est pas disproportionnée et qu’un juste équilibre a été réalisé27. La jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation précédemment rappelée s’en trouve clairement confortée28. Pourtant, ce modus operandi n’est pas exempt de critiques à un double point de vue : en premier lieu de celui de sa justification technique ; en second lieu de celui de son impact sur les règles déontologiques.
L’appréhension intégrale des messageries techniquement contestable. La saisie in globo des messageries électroniques s’appuie à la fois sur le caractère insécable de ces dernières, ce qui constitue une raison plus technique que juridique29, et sur l’objectif de préservation de l’authenticité des contenus, que seule remplirait une saisie en bloc des messages30. La solution semble ignorer que si certains logiciels regroupent bien en un seul fichier l’intégralité des messages31, d’autres, à l’image des messageries webmails très répandues que sont gmail ou encore hotmail, attribuent à chaque courriel un fichier spécifique32, ce qui permet une saisie individualisée fichier par fichier et donc message par message. La Cour de cassation occulte ces subtilités en la matière, se retranchant derrière l’appréciation souveraine des juges du fond : elle approuve par exemple une juridiction d’appel d’avoir « souverainement constaté que les pièces appréhendées entraient dans le secteur d’activité et que les messages électroniques avaient dû être saisis globalement en raison de contraintes techniques qu’il n’était pas tenu de détailler »33. On se demande par ailleurs si eu égard à cette solution, l’admission a posteriori de la nullité de la saisie des seuls documents couverts par le secret professionnel n’est pas une reconnaissance – paradoxale34 – du caractère divisible des messageries.
La jurisprudence de la Cour de cassation en matière de saisie de messages électroniques se trouve donc parfaitement validée par l’arrêt de la CEDH ici commenté. Cette position tranche cependant avec la pratique de la Commission européenne validée par la CJUE, qui toujours dans le cadre du droit de la concurrence, recourt en sens contraire à un logiciel spécialisé, dénommé Forensic et procède sur place et de manière contradictoire à la sélection des éléments de messagerie pertinents en vertu d’une recherche par mots clés sans que soit affectée l’intégrité des messages35.
L’appréhension intégrale des messageries déontologiquement contestable. La CEDH se contente d’apprécier la réalité de la protection a posteriori du secret des correspondances36. Ainsi qu’elle le relève, « la requérante conservait la possibilité d’identifier les documents litigieux pour réclamer ensuite la restitution à l’Administration, le juge ayant même donné acte à cette dernière de son accord à cette fin ». Faut-il s’en satisfaire ? On peut sérieusement en douter eu égard d’une part aux vertus limitées des mesures curatives37 – protection du secret a posteriori – et d’autre part de la nature du secret professionnel. Bien qu’il n’ait pas valeur constitutionnelle38, il est protégé par l’article 8 de la Convention EDH et différents textes légaux et réglementaires. Fondé à la fois sur l’intérêt public39 et sur le droit de la défense du client40, il est, en vertu de l’article 2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN), d’ordre public, général, absolu et illimité dans le temps. En considération de cette impériosité, ne faudrait-il pas exiger que les documents ne soient pas saisis du tout, et non pas d’abord saisis et simplement écartés de la procédure ensuite41. Ne faudrait-il pas estimer que l’appréhension de l’ensemble d’une messagerie est illicite et ainsi ménager un placement sous scellés de la messagerie afin que soient expurgés sur décision du JLD les éléments confidentiels ?42 Ce mode opératoire permettrait d’appliquer aux nouvelles technologies, la protection dont le secret professionnel bénéficie en matière de documents papiers.
II. Extension de la portée du secret professionnel aux courriers internes à l’entreprise reprenant la stratégie de défense élaborée avec l’avocat
En l’espèce43, le juge des libertés et de la détention (JLD) avait autorisé l’Autorité de la concurrence à procéder à des visites et saisies prévues par l’article L. 450-4 du Code de commerce dans les locaux de diverses sociétés. Ces dernières étaient soupçonnées de s’être livrées, « à des actions concertées et conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, pratiques qui aurait eu pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, en limitant l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises et en limitant ou contrôlant l’entrée aux marchés »44. Suite aux visites et saisies domiciliaires dans les locaux de la société requérante, cette dernière forma un recours qui était notamment fondé sur la violation de la confidentialité des échanges avocat-client. Il était ainsi reproché aux agents de l’Autorité de la concurrence, d’avoir appréhendé parmi l’ensemble des pièces45 différentes correspondances, dont un message qui faisait suivre un autre courriel par lequel était transféré à la fois le rapport d’analyse du cabinet d’avocats et de la réunion d’analyse qui s’en était suivie ainsi que des courriels résumant l’avis du cabinet d’avocats consulté.
Après avoir repris les termes de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, le premier président de la cour d’appel de Paris affirme que la confidentialité des échanges avocat-client « n’est pas un principe absolu et souffre de plusieurs exceptions ». À titre d’exemple, le juge du fond rappelle qu’il ne peut être admis que les échanges entre deux correspondants avec en copie jointe un avocat puissent bénéficier de la protection légale relative à la confidentialité des « échanges avocat-client sauf à dénaturer cette protection légale ». Le juge énonce dans un premier temps que, du fait des autres procédures dont les différentes sociétés ont fait l’objet, la société requérante « s’attendait à être visitée, ce qui l’a incité à anticiper la préparation de sa défense, ce qui ne peut lui être reproché ». Ce contexte de l’intervention de l’avocat rappelé, le juge se livre, selon une méthode répétée pour chaque pièce, à une appréciation in concreto du courriel saisi et constate s’il n’émanait pas ou n’était pas adressé à un avocat. Ce dernier reprenait la stratégie de défense mise en place par le cabinet d’avocats consulté. Cette solution contribue à délimiter le champ d’application du secret professionnel en s’appuyant sur le contenu des courriels saisis et non sur la qualité des expéditeurs et destinataires46 et élargit ainsi son domaine objectif. Si l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 précitée47 vise les consultations adressées par un avocat à son client ainsi que les correspondances échangées entre ces derniers, cette décision nous enseigne que cette notion de correspondance est entendue largement. N’est pas seulement couverte par le secret la correspondance principale – celle entre l’avocat et son ou ses interlocuteurs directs – mais également les correspondances échangées en interne reprenant sur le fond l’avis de l’avocat. Ces dernières ont pour support48 la correspondance principale49 et en épousent donc la qualification, ce qui pourrait constituer une nouvelle application de l’adage accessorium sequitur principale. Cette solution est heureuse puisque si la personne morale est le seul client50 de l’avocat, ses différents organes et salariés qui interviennent en son nom doivent pouvoir agir pour préparer au mieux sa défense.
Charles BOËRIO
2 – Publicité
Nous avions relaté, en d’autres lieux, l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant condamné une société commerciale pour avoir exploité un site de comparateurs entre avocats sous le nom de domaine « avocat.net »51. Deux pourvois avaient été formés contre cette décision. Un pourvoi principal par la société condamnée et un pourvoi incident par le CNB dont nous retiendrons les éléments les plus saillants. La Cour de cassation accueille diversement ces moyens dans une décision vouée à la plus grande diffusion52.
Deux points méritent notamment l’attention. En premier lieu, la Cour de cassation décide que « les tiers ne sont pas tenus par les règles déontologiques de la profession ». L’affirmation relève de l’évidence, mais elle est riche de conséquences. En refusant d’appliquer l’article 10.2 du RIN qui prohibe les mentions comparatives entre avocats53, la cour valide le principe même de la notation d’avocat lorsqu’elle est l’œuvre d’un tiers. La profession d’avocat s’inscrit ainsi dans le mouvement global des notations des professionnels popularisé sur internet. Bien que la Cour de cassation conditionne l’exploitation d’un tel site à la délivrance d’une « information loyale, claire et transparente », on ne peut que s’interroger sur la pertinence d’une telle avancée. En la matière, la garantie de la véracité des commentaires est loin d’être effective54. En revanche, la Cour de cassation confirme l’interdiction de l’utilisation du nom de domaine « avocat.net », ce qui se justifie car l’appellation prêtait à confusion en suggérant que l’ensemble des services émanait d’avocats, alors que certaines prestations étaient l’œuvre de tiers. Il y avait donc « une confusion sur la qualité » des interlocuteurs, ce qui constitue, en soit, une pratique trompeuse et déloyale au sens de la directive n° 2005/29/CE du 11 mai 200555.
S’agissant, en deuxième lieu, de la rémunération de l’exploitant du site, le CNB faisait notamment grief à l’arrêt d’appel (deuxième moyen du pourvoi incident), de rejeter sa demande tendant à interdire à la société de se faire rémunérer par devis proposés aux avocats référencés. Un tel système constituait, selon le demandeur, une contravention à l’interdiction de la rémunération des apports d’affaire entre avocats56. L’argument est rejeté. Ici encore, la Cour de cassation considère que l’application d’une règle déontologique propre à la profession d’avocat ne peut pas être opposée à des tiers étrangers à cette profession.
La solution paraît fondée à maints égards mais elle laisse un goût amer. Comme le notent certains commentateurs avisés57, le refus d’appliquer des règles déontologiques à des tiers ne se discute pas. Reste que d’un point de vue pratique, cette décision autorise les membres du barreau à contourner des interdictions professionnelles parfaitement justifiées en ayant recours aux services d’un tiers. Certes, les avocats ne pourront pas exploiter ce type de sites, mais rien ne les empêche de s’y inscrire et de violer ainsi les règles auxquelles ils sont soumis par l’intermédiaire du site. Dans ces conditions, à défaut de considérer que l’exploitant du site commet une faute civile, la sanction pourrait bien être déportée sur les avocats. Aux termes des articles 15 du décret du 12 juillet 2005 et 10.3 du RIN la publicité et la sollicitation personnalisée sont permises « si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession ». À cet égard, rappelons que la dignité est une attitude générale de l’avocat qui suppose une attitude respectable et la délicatesse un principe qui lui impose de ne jamais enfreindre de règle éthique58. Or, en ayant recours au service d’un site irrespectueux des règles déontologiques propres à sa profession, l’avocat ne méconnaît-il pas ces principes ?
Benoît CHAFFOIS
B – Honoraires
1 – Avocats
Les honoraires sont assurément l’une des sources principales de contentieux en matière déontologique. Trois thèmes retiendront l’attention : les honoraires de résultat, la contestation des honoraires et la prescription de l’action en paiement des honoraires.
S’agissant des honoraires de résultat, lorsqu’un avocat succède à un confrère, la difficulté est de déterminer si l’honoraire peut être partagé entre eux. On comprend que l’avocat ayant fourni un travail dans un dossier dont il était initialement saisi désire appréhender une partie des honoraires obtenus par son successeur. Aux termes de l’article 19 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 « le nouvel avocat s’efforce d’obtenir de son client qu’il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier ». À défaut de dispositions légales ou réglementaires complémentaires, la pratique a développé des clauses dites de dessaisissement, prévoyant le versement de l’honoraire de résultat dans sa totalité au profit de l’avocat initialement saisi du dossier59. Malgré les hésitations que peut susciter ce type de clause à l’égard d’un honoraire de résultat dont l’existence est incertaine au jour du dessaisissement, la jurisprudence vient d’entériner cette pratique60. En l’absence de ces clauses, la récente modification du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 devrait aussi permettre à l’avocat dessaisi d’obtenir un honoraire de résultat61. L’article 10 dudit décret dispose désormais que : « Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client ». À notre opinion, la formulation est assez explicite pour admettre un partage d’honoraires de résultat au prorata du travail fourni.
Dans un domaine proche, celui des honoraires dus à l’avocat consulté dans un dossier dont il n’a pas la charge, la cour vient ici aussi de suggérer la possibilité d’un partage de l’honoraire de résultat62. En l’espèce, il s’agissait de déterminer si l’avocat consulté dans un dossier dont il n’a pas la charge, pouvait prétendre au versement d’une partie de l’honoraire de résultat perçu par son confrère. La cour rejette cette prétention au motif que l’avocat ne démontre pas avoir accompli d’autres diligences que celles figurant sur sa note d’honoraires, ce qui laisse penser qu’a contrario le partage de l’honoraire de résultat sera accepté si l’avocat démontre avoir fourni un travail supplémentaire.
S’agissant de la contestation des honoraires par le client, on sait que le juge peut user de son pouvoir modérateur pour les réduire lorsqu’ils apparaissent exagérés au regard du service rendu63. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les articles 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du Code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, interdisent d’user de cette prérogative lorsque le principe et le montant des honoraires ont été acceptés par le client après service rendu64. À cet égard, la Cour vient de rejeter une question prioritaire de constitutionnalité portant spécifiquement sur cette interprétation jurisprudentielle65, notamment au regard du droit à recours juridictionnel effectif. Selon la Cour de cassation, ce droit est préservé puisque le client peut toujours saisir le juge de l’honoraire « qui a le pouvoir de contrôler que l’accord sur les honoraires n’est affecté d’aucun vice du consentement et qu’il a été précédé d’une information autorisant un consentement éclairé ».
La règle selon laquelle les honoraires ne peuvent plus être contestés lorsqu’ils ont été acceptés après service rendu reçoit toutefois une dérogation, selon les conditions dans lesquelles ces honoraires sont facturés. Si les factures n’indiquent pas suffisamment les diligences effectuées, le juge de l’honoraire peut à nouveau user de son pouvoir modérateur, quand bien même ces factures seraient complétées par des éléments extrinsèques66. La même solution s’applique lorsque les factures réglées par un client sont soit provisionnelles, soit antérieures aux prestations qu’elles visent, de sorte que le paiement n’est de fait pas intervenu après service rendu67. On ne peut qu’approuver ces décisions dès lors que ce type de factures empêche le client d’apprécier les diligences effectuées au moment où il paye.
S’agissant de la prescription de l’action en paiement des honoraires des avocats, si l’application du délai biennal de prescription du Code de la consommation est désormais acquise68, des hésitations subsistent quant à son point de départ. Pour ce qui est des honoraires de résultat, la Cour de cassation69 considère que ce délai commence à courir à partir de leur exigibilité, ce qui, en l’espèce, correspond à la date à laquelle le client avait reçu les sommes qu’il réclamait et non à la date du jugement y ouvrant droit. Concernant les honoraires de diligences, il est au contraire d’usage de retenir la date de la fin du mandat70. Il reste à déterminer ce qu’il faut entendre par fin du mandat. Schématiquement, deux positions s’opposent. D’une part, dans une vision restreinte au contentieux, il est avancé que le prononcé de la décision que l’avocat a été chargé d’obtenir met fin au mandat. D’autre part, dans une approche extensive de la notion de fin de mandat, en dehors des cas où l’extinction du mandat résulte de la volonté d’une des parties, c’est la date à laquelle l’avocat ne doit plus effectuer de missions en rapport avec le dossier dont il est saisi qui est retenue. La première position est difficilement soutenable puisque la mission de l’avocat ne s’arrête pas au prononcé de la décision : il doit en effet s’assurer des suites du jugement et, a minima, conseiller son client sur d’éventuelles voies de recours. Aussi, on approuvera pleinement l’arrêt par lequel la Cour de cassation juge que « la décision que l’avocat a été chargé d’obtenir n’a pas pour effet de mettre fin au mandat »71.
Benoît CHAFFOIS
2 – Notaires
Dans un tourment inévitable, le notariat avait crié haro sur la réforme du tarif des notaires initiée par la loi Macron, et les nouvelles mesures d’écrêtement et de remises des émoluments entérinées aux termes de quatre décrets, et cinq arrêtés, et première étape du processus de régulation économique de ce secteur d’activité72, tous publiés au Journal officiel le 28 février dernier.
La loi Macron avait, en effet, pour objectif de fixer un tarif prenant en compte une rémunération « raisonnable » et le « coût pertinent » du service rendu, concepts on ne peut plus abstraits.
Les notaires devaient, ainsi, se recentrer sur l’efficacité et la satisfaction du client, tout en maintenant la qualité du service public d’authentification des actes qu’ils fournissent !
La profession, échaudée par cette première étape du processus de régulation économique, et par une vague sans précédent d’offices créés au cours des derniers mois, attendait avec d’autant plus d’effervescence la date de « révision biennale » du tarif (article 12 du décret)…
On sait pourtant que le dispositif d’écrêtement et de remise n’a que sensiblement modifié la rémunération des études (sauf peut-être dans les communes rurales), les notaires titulaires ou associés ne pratiquant que peu les remises… Cela dit, l’avènement d’une nouvelle génération de notaires (offices créés dits « Macron »), bouleversera sans doute les pratiques. Il reste que 2 ans plus tard, un arrêté du 27 février 2018, publié le 28 au Journal officiel, vient de reconduire sans aucune modification le tarif des notaires pour la période du 1er mars 2018 au 29 février 202073. Il convient donc de continuer à se référer, tant pour les taux applicables aux différentes prestations que pour les remises, à l’arrêté du 26 février 2016.
Laure GASCHIGNARD
C – Structures d’exercice
1 – Bureau secondaire
Bureau secondaire en entreprise, une idée mort-née. Réprouvé par certains, espéré par d’autres, l’exercice en entreprise porte les stigmates de la controverse perpétuelle à laquelle est confrontée la profession d’avocat, sans cesse tiraillée entre tradition et renouveau. Après s’être prononcée, à une très large majorité, contre l’implantation du cabinet principal dans les locaux d’une entreprise, l’assemblée générale du conseil national des barreaux (CNB) a finalement décidé, à une voix près, de permettre aux seuls bureaux secondaires d’être installés dans de tels locaux74. L’article 15.2.2 du RIN, modifié par la décision à caractère normatif de l’assemblée générale du CNB n° 2016-001 des 1er et 2 juillet 2016, prévoyait alors en son ultime alinéa que « Le bureau secondaire, qui peut être situé dans les locaux d’une entreprise, doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif et aux règles de la profession notamment en ce qui concerne le secret professionnel. L’entreprise au sein de laquelle le cabinet est situé ne doit pas exercer une activité s’inscrivant dans le cadre d’une interprofessionnalité avec un avocat ». Le CNB a ainsi permis aux cabinets d’avocats de domicilier de façon permanente et effective une partie de leur activité dans les locaux d’une entreprise, qui peut être leur cliente.
Ce faisant, l’institution sui generis a manifestement outrepassé son pouvoir normatif borné par le législateur à l’unification des règles et usages de la profession d’avocat75, comme l’affirme, à juste titre, le Conseil d’État dans sa décision du 29 janvier 201876. Le pouvoir dont est investi le CNB trouve en effet sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l’exercice de la profession. Ainsi, le CNB ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n’auraient aucun fondement dans les règles législatives et réglementaires, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d’une règle figurant au nombre des traditions de la profession77. Or, les dispositions de l’article 15.2.2 du RIN permettent l’exercice de la profession dans des conditions qui ne correspondent pas à des règles et usages des barreaux et doivent ainsi être regardées comme instituant des règles nouvelles. Et pour cause, l’évolution entreprise par le CNB ne repose sur aucun fondement légal ou réglementaire et ne peut être analysée comme une conséquence nécessaire d’une règle issue des traditions de la profession. Au demeurant, elle est susceptible de placer les avocats concernés dans une situation de dépendance matérielle et fonctionnelle vis-à-vis de l’entreprise qui les héberge et met ainsi en cause les principes essentiels d’indépendance et de respect du secret professionnel. Fort logiquement, la haute juridiction administrative a annulé la décision des 1er et 2 juillet 2016 du CNB en tant qu’elle modifie l’article 15.2.2 du RIN.
L’exercice en entreprise affecte la nature même de la profession d’avocat, libérale et indépendante78. Autoriser un tel exercice ne pourra se faire que par une refonte en profondeur des principes qui régissent la profession. Sous cet aspect, le cantonnement de l’exercice en entreprise aux seuls bureaux secondaires ne se justifie guère et la décision du Palais Royal mérite, selon nous, entière approbation. Du reste, si l’objectif poursuivi par le CNB était de rapprocher les avocats des entreprises (et plus particulièrement des PME), force est d’admettre que la formule n’a séduit ni les premiers, ni les secondes, puisqu’aucune ouverture de bureaux secondaires n’a été recensée avant l’annulation du texte79. À ce compte-là, il est permis de se demander si la réforme du CNB était véritablement nécessaire. La pratique du détachement révèle par ailleurs que les avocats désireux d’exercer en entreprise n’ont pas attendu qu’on « légifère » sur la question pour pénétrer les locaux de leurs clients, même s’il convient de reconnaître qu’à l’aune de la décision commentée, cette pratique dépourvue de tout encadrement, apparaît pour le moins hétérodoxe.
2 – Unicité d’exercice
L’unicité d’exercice n’est pas morte ! À n’en point douter, le principe de l’unicité d’exercice n’a pas été inhumé par les récentes réformes qui ont affecté la profession d’avocat ainsi que le martèle la Cour de cassation dans son arrêt en date du 14 février 201880. Dans cette affaire, un avocat a été engagé en qualité de salarié au sein d’une société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), avant d’être coopté associé, près de 5 années plus tard. À l’occasion d’une restructuration intervenue au cours de l’année 2011, la SELAFA a été transformée en société de participation financière de profession libérale (SPFPL) et son fonds libéral a été apporté à une société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) qui a agréé l’avocat en qualité d’associé. D’un commun accord, les parties ont mis fin au contrat de travail qui les liait. Dans le même temps, l’avocat a conclu avec la SPFPL, un mutuum portant sur des actions de la SELAS et un contrat d’exercice professionnel avec cette dernière. Par la suite, le directoire de la SELAS a décidé d’interrompre provisoirement l’exercice de son activité au sein de la société en raison de son attitude à l’encontre de diverses personnes.
Saisi sur le fondement des articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991 relatifs au règlement des litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Albi a reconnu l’existence d’un contrat de travail entre l’avocat et la SELAS, en dépit de sa qualité d’associé. Faisant grief à l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse de rejeter sa demande tendant à la confirmation de la décision du bâtonnier, l’avocat a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rejette son pourvoi en retenant qu’après avoir, d’une part, mentionné les dispositions de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 20 du décret du 25 mars 1993 dont il résulte qu’un avocat associé exerçant au sein d’une SEL ne peut exercer sa profession à titre individuel, en qualité de membre d’une autre société, quelle qu’en soit la forme, ou en qualité d’avocat salarié, et d’autre part, constaté que l’avocat avait la qualité d’associé de la SELAS par l’effet du prêt de consommation d’actions à lui consenti, la cour d’appel a exactement déduit qu’il ne pouvait pas être salarié au sein de cette société.
Individuels, collectifs ou liés, les modes d’exercice de la profession d’avocat, à l’instar des structures d’exercice, n’ont eu de cesse de se développer au cours de ces dernières décennies. Cet accroissement pose inévitablement la question de leur cumul. En ce qui concerne les associés des SEL, la question était réglée par l’article 20 du décret du 25 mars 1993 repris in extenso dans l’attendu conclusif de l’arrêt rapporté. Nonobstant son abrogation par le décret n° 2016-878 du 29 juin 2016, ce texte demeure pleinement applicable aux associés des SEL d’avocats constituées avant le 1er août 2016, sauf modification statutaire81. À cette aune, la solution commentée n’a, pour ainsi dire, rien de surprenant. Devenu propriétaire des actions d’une SELAS constituée avant le 1er août 2016, par l’effet d’un mutuum82, l’emprunteur bénéficiait indiscutablement de la qualité d’associé, ce dont il fallait naturellement déduire que la prescription édictée à l’article 20 du décret précité lui était parfaitement applicable. Ainsi que nous l’avons déjà souligné83, le décret du 29 juin 2016 n’a, en définitive, pas totalement sonné le glas de la règle de l’unicité d’exercice dans les SEL.
Kévin MOYA
D – Prospectives
L’introspection de la profession d’avocat, entre réalisme et ambiguïtés – À propos du rapport Les quatre défis de l’avocat français du XXIe siècle (CREA et IHEJ, oct. 2017).
Sous l’impulsion principale du CNB, le Centre de recherche et d’étude des avocats (CREA) et l’Institut des hautes études sur la justice (IHEJ) ont présenté un rapport intitulé Les quatre défis de l’avocat français du XXIe siècle, à l’occasion de la convention nationale des avocats qui s’est tenue à Bordeaux le 19 octobre 2017.
Ce rapport constitue le résultat de nombreux travaux en ateliers, ayant rassemblé des professionnels du droit de tous horizons.
Il ne s’agit bien sûr pas de la première étude à dimension prospective sur la profession d’avocat en particulier, ou le monde de la justice en général. Mais l’objet de ce rapport, ainsi que la méthode adoptée, invitent à une analyse détaillée du contenu de cet ambitieux travail.
Toutefois, les lignes qui suivent ne peuvent prétendre à l’exhaustivité. Il s’agira dès lors seulement de présenter les grandes lignes et les traits saillants de ce rapport, afin d’apporter une pierre à un édifice dont il semble que la construction soit de nature quasi perpétuelle.
Prolégomènes. Le rapport se donne pour objectif d’évaluer l’impact de la mondialisation sur le marché du droit en général, et la profession d’avocat en particulier. Plus précisément, ses auteurs expliquent que le passage à une société de marché fait de l’économie un objet déconnecté des autres relations sociales pour former un tout, pratiquement indépendant.
Tout, même le droit, devient une marchandise, objet d’échange et de valorisation. Les services juridiques sont clairement devenus un marché, que la qualité d’auxiliaire de justice de ceux qui les rendent ne peut occulter. Le rapport explique que pour faire fructifier ce secteur, la libéralisation (au sens de l’accroissement de la concurrence) et l’innovation technique sont encouragées.
Le constat qui en découle est net : la structure traditionnelle du marché du droit n’est plus adaptée aux conditions actuelles de la concurrence, interne et internationale. Les modes de fourniture de services juridiques (et notamment les modalités de facturation d’honoraires) ne permettent plus de maintenir la qualité nécessaire. Il va donc devenir nécessaire, selon le rapport, de permettre aux avocats recourir aux capitaux et à l’investissement, ce qui a entraîné la mise en place de l’interprofessionnalité.
Le rapport ambitionne, de manière générale, d’ausculter les choix devant lesquels la profession d’avocat doit être placée, qu’il s’agisse du mode d’exercice (individuel ou collectif), de la possibilité d’exercer des activités commerciales accessoires.
De manière très juste, le rapport que les positions qui seront prises face à ces choix auront nécessairement un impact sur le financement de la formation des jeunes avocats (p. 7, § 4).
La numérisation. Au rang de ces évolutions et de ces choix, le rapport met bien sûr l’accent sur la numérisation et la dématérialisation de la justice, et donc de la profession d’avocat. Parmi les nombreux débats que suscite ce mouvement, dont il est permis de penser qu’il est inéluctable (comment toucherait-il l’ensemble des services mais pas le marché du droit ?), les auteurs du rapport mettent en exergue les difficultés posées par une éventuelle justice prédictive. Dès la page 7 (§ 5), le constat est clairement méfiant : « trop de facteurs sont impliqués pour qu’une prédiction soit fiable », et il est trop difficile de mesurer « la capacité d’un algorithme à exécuter une tâche aujourd’hui effectuée par un juriste, et donc à le remplacer ».
Le cadre de la présente chronique est trop restreint pour entrer dans cette controverse importante. Mais il n’est pas certain que la justice prédictive soit forcément faillible et déficiente. Tout dépend certainement de la manière dont elle est mise au service de l’humain.
Toujours au rang des modifications induites par la numérisation, le rapport pointe l’augmentation des plates-formes mettant en relation l’avocat et le client, en questionnant la possibilité pour l’avocat de garder la maîtrise de son exercice professionnel.
Une perspective comparatiste aux résultats exagérés. Enfin, dans une courte « introduction », qui succède donc à 9 pages, les auteurs du rapport évoquent les différences économiques qui existent entre les systèmes français et américain, en reconnaissant courageusement que « les deux modèles sont en crise » : « Les deux professions américaine et française incarnent chacune le point extrême de ces deux composantes financières et symboliques : d’un côté de l’Atlantique, le barreau mise sur le marché dans un pays où l’argent est un véritable régulateur de la société américaine, mais dans lequel il voit aussi le signe d’une élection morale (et pas uniquement sociale). De l’autre, dans nos terres plus catholiques, l’avocat se distingue par le désintéressement, par un savoir expert, par ses attributs symboliques comme la robe et par un statut social » (p. 11).
Il est possible, dès ce stade, de noter une ambiguïté, s’agissant du caractère symbolique de la justice. En effet, le rapport précise qu’« au fur et à mesure que nos sociétés se laïcisent, le droit devient le conservatoire d’une dimension symbolique indispensable à la vie sociale, c’est-à-dire d’une reconnaissance mutuelle, de la mémoire de nos pactes fondateurs, de la sublimation de la violence » (p. 10). Mais quelques lignes plus tard, il est indiqué que « ce n’est certainement pas en revendiquant ses attributs symboliques passés (…), bref en se berçant d’illusions, que l’avocat relèvera ces défis » (p. 11). L’embarras est compréhensible, tant la question recèle de nombreux aspects clivants : à quel point l’avocat doit-il renoncer à son modèle traditionnel ? Au-delà, à quel point la justice doit-elle se transformer et quitter son écrin originel ?
À cet égard, il est possible de remarquer que les propositions récemment émises par la garde des Sceaux en vue d’une loi de programmation 2018-2022 contiennent, pour certaines procédures, la suppression possible des audiences « présentielles », alors qu’il s’agit là d’une dimension symbolique importante de la justice. Il n’est pas certain qu’il faille le déplorer. En revanche, il ne peut être question de dépouiller la justice de l’intégralité de ses oripeaux symboliques. Il conviendrait dès lors de mener une réflexion approfondie, non pas sur la pertinence des symboles, mais sur leur sens, et leur aptitude à être décryptés et compris par les justiciables.
Une fois ces débats posés à titre liminaire, le rapport se structure, sans surprise au regard de son titre, autour de 4 défis à relever impérativement. Il apparaît que, dans l’esprit des rédacteurs, les 4 défis revêtent une importance égale. Cependant, le premier chapitre couvre des discussions d’ordre général, qui traversent la profession d’avocat, tandis que les 3 autres chapitres s’avèrent plus ciblés. L’essentiel du commentaire concerna donc le premier de ces 4 développements.
I. Quel avocat pour quel procès ?
Dans un premier chapitre, intitulé « Gagner en crédibilité », les auteurs pointent l’insuffisance d’un statut et de règles déontologiques pour conserver la confiance du public (et donc éviter que ce dernier soit tenté de faire appel à d’autres professionnels). Le mot est lâché : les avocats ne seraient plus suffisamment crédibles.
Une ambiguïté peut liminairement être relevée : après avoir mis en lumière le peu de crédibilité que les juges accordent aux écritures et au comportement des avocats, le rapport mentionne « l’amélioration de la qualité du barreau qui est également et très souvent dans certaines matières bien supérieure au niveau de formation des juges » (p. 17)…
Quoi qu’il en soit, le rapport pose les questions qui sont au cours de la définition du rôle et de l’activité actuels de l’avocat. Les pistes de réponse proposées apparaissent, en revanche, discutables, qu’il s’agisse de l’office de l’avocat (A), du rapport de l’avocat avec la vérité (B), de l’intervention du jury (C), ou de la réhabilitation de l’audience (D).
A. L’avocat doit-il se préoccuper davantage du fait que du droit ?
Le rapport questionne d’abord la crédibilité de l’avocat dans sa sphère originelle, à savoir le système judiciaire. Il invite ainsi à « retrouver le “sérieux” du procès ». Les règles procédurales ne permettraient pas à l’avocat de garder et de cultiver sa crédibilité, car il ne peut pas vraiment participer à l’établissement des faits (au pénal), ou est bridé par « la prééminence des questions de droit sur les questions de fait » (au civil) (p. 14).
Qu’il soit ici permis de douter de ce que ce constat soit critiquable. En effet, il repose sur ce que les auteurs du rapport cherchent à éviter, à savoir une analyse fondée sur le modèle traditionnel de l’avocat. Pour le dire de manière concise et certainement trop peu nuancée : l’avocat est sûrement moins un plaideur qu’un juriste. Il doit moins proposer une version favorable des faits que manipuler une règle de droit qui est la même pour tous. Au surplus, le rapport dénonce lui-même le fait que les écritures des avocats ne sont pas toujours fiables (ce qui entraîne, ou est induit par, le fait que les juges ne leur prêtent pas l’attention nécessaire). Il est probable que si l’office de l’avocat était encore davantage « juri-centré », les relations avec les magistrats s’en trouveraient améliorées.
Le rapport lui-même qualifie la crédibilité des écritures de l’avocat de « question clé » (p. 17). Comment dès lors remettre en cause la prééminence de l’élément juridique sur l’élément factuel ?
S’agissant de la procédure pénale, il paraît en outre délicat de remettre en cause le rôle central des autorités de police lato sensu (et donc le trop faible rôle dévolu à l’avocat), pour ensuite déplorer l’augmentation du coût de la justice : si l’avocat doit participer de manière plus active à la phase d’enquête (et/ou d’instruction), il est inéluctable que ses services devront devenir bien plus coûteux.
B. L’avocat français, la vérité et la fonction du procès
En tout état de cause, et en lien avec ce qui précède, les auteurs émettent une critique assez franche sur le rapport « relâché » que l’avocat entretiendrait avec la vérité (ce qui induirait une faible confiance dans sa production). Ils expliquent que les contre-vérités ne sont pas vraiment stigmatisées en France, contrairement aux États-Unis où le mensonge subirait l’opprobre de la communauté des juristes. Le rapport à la vérité y serait en outre « sécurisé » (p. 16) par l’intervention du jury.
La question des liens entre l’avocat et la vérité renvoie nécessairement à la fonction que l’on souhaite assigner à la justice. Or, de ce point de vue, il est sûrement délicat d’assimiler le procès pénal et le procès civil.
Il est possible de considérer que le but du procès pénal est d’aboutir à l’établissement de la vérité, et ainsi à la disculpation de l’innocent et à la condamnation du coupable. Néanmoins, cette vérité ne pourra émerger après qu’une enquête menée dans des conditions permettant de ne porter que des atteintes raisonnées aux libertés individuelles aura pu être menée. Plus que l’objectif de vérité (qui en soi est difficilement contestable), c’est la place de l’avocat dans la recherche de cette dernière qui est en jeu. Et là encore, il ne faut pas raisonner sans prendre en compte la dimension financière, économique de l’intervention de l’avocat.
Le procès civil, quant à lui, n’est pas fait pour établir à tout prix la vérité. Duel probatoire opposant des intérêts privés, il doit déboucher sur une décision acceptable socialement, c’est-à-dire collectivement. Centrer le procès civil sur la manifestation de la vérité nécessiterait d’augmenter de manière extrêmement importante les moyens mis à la disposition du service public de la justice, car il faudrait alors que le procès civil évolue vers un modèle purement inquisitoire et que le juge prête une main très active à l’établissement des faits.
De manière générale, le rapport n’explique pas vraiment pourquoi les relations entre les juges et les avocats sont empreintes de défiance. À cet égard, il aurait pu être intéressant de revenir sur un vieux serpent de mer : la formation professionnelle commune, qui permettrait de générer la communauté de juristes que les auteurs du rapport appellent de leurs vœux (et sur laquelle nous reviendrons lors de l’analyse du chapitre 4 du rapport).
C. Le jury garantit-il une justice crédible ?
Quant à l’intervention du jury, gage de sérieux selon le rapport, bien des contre-arguments peuvent être soulevés. Le gouvernement lui-même semble en avoir heureusement pris la mesure, qui va expérimenter, sous couvert de création d’un « tribunal criminel départemental », la suppression du jury populaire pour certains crimes considérés comme de moindre importance que d’autres.
Pour s’en tenir aux termes du débat soulevé par le rapport commenté, l’intervention d’un jury n’est pas gage de vérité, mais d’expression d’une intime conviction collective, sur la base des preuves et arguments examinés. Point n’est besoin de rappeler qu’à ce jour, le jury ne connaît du dossier que ce qu’il en entend à l’audience, c’est-à-dire une part faible. Ainsi, ce que l’on recherche en faisant intervenir un jury, c’est bien un verdict qui sera accepté par la société, que le jury est censé incarner. C’est donc bien de paix sociale, plus que de vérité, qu’il est question.
D. réhabilitation de l’audience et dimension symbolique de la justice.
Pour restaurer le « sérieux » de la justice et des avocats, les auteurs du rapport préconisent ensuite une « réhabilitation de l’audience » (p. 18). Ils plaident pour un retour à l’oralité et une réduction du domaine des voies de recours : l’appel ne serait ainsi qu’un jugement du jugement, c’est-à-dire une appel-réformation plutôt qu’un appel-achèvement du litige.
Les auteurs proposent des solutions radicales : présence obligatoire des parties pendant toutes les audiences, présence des experts pour répondre aux questions de tous les protagonistes, allongement du temps des audiences (tout en réclamant en page 19 un « encadrement du procès dans des délais stricts »)…
On retrouve ici la dimension symbolique de la justice. L’audience est censée figurer le théâtre symbolique et fictif d’une violence réelle, exutoire cathartique pour une société dans laquelle la vie en collectivité repose sur une renonciation à la violence et à la vengeance privées.
La déjudiciarisation, qui est à l’œuvre depuis plusieurs années déjà, se situe évidemment à contre-courant de cette conception, et repose sur des tentatives plus ou moins réussies de rationalisation de moyens trop faibles.
Peut-on encore rétablir le lustre et l’intérêt de l’audience (sachant qu’il semble que les rédacteurs du rapport, sans vraiment le préciser, raisonnent sur l’audience civile) ? Une réponse affirmative passerait par des transformations bien plus profondes.
L’audience devrait être un lieu de dialogue entre les avocats (voire les justiciables) et le juge. Pour ce faire, l’avocat devrait accepter de ne pas réciter ou improviser un discours oral, mais plutôt d’échanger avec le juge sur la base de questions ou d’interpellations. L’avocat présent à l’audience devra donc connaître parfaitement son dossier (ce qui implique la fin des « substitutions » purement artificielles et représentatives). Mais ce devra également être le cas du juge. De ce dernier point de vue, il serait très salutaire (mais politiquement très difficile) de généraliser la mise en état avant l’audience de plaidoirie, et ce quelle que soit la procédure. Mais qui osera généraliser une représentation obligatoire par avocat obligatoire et une procédure écrite ; qui osera juguler les dépôts de dossiers…
On peut rejoindre les auteurs du rapport sur les vertus de la comparution personnelle, qui contribue à responsabiliser tous les acteurs du procès. Elle contribuerait aussi à rendre la justice plus intelligible pour ses « usagers ».
Mais tout ceci ne sera envisageable que si les moyens (humains, techniques, financiers) suivent, car la rationalisation de l’existant a des limites qui sont certainement proches.
S’agissant enfin de la limitation du domaine des voies de recours, une telle solution, parfaitement concevable en soi, ne peut cependant pas être déconnectée du fonctionnement général du système judiciaire. Concrètement, limiter la compétence de la cour d’appel aux éléments qui ont été invoqués lors de la première instance contribuera certes à accélérer le cours de la justice. Mais en contrepartie, la paix sociale sera clairement remise en question, et ce à au moins deux égards : d’une part, le contentieux ne sera pas nécessairement tari entre les parties (même si l’obligation jurisprudentielle de concentration de moyens fermera souvent l’accès aux prétoires) ; d’autre part, si la justice de première instance n’est pas satisfaisante, il serait proprement injuste de limiter l’instance d’appel (est-il besoin de s’appesantir sur les failles, pour dire le moins, de la justice prud’homale…).
II. La numérisation de la justice
Dans un deuxième chapitre, intitulé « Réussir la transition numérique », les auteurs du rapport évoquent un thème souvent abordé dans cette chronique, celui des legaltech. Ils questionnent de manière générale la révolution numérique de la justice.
Ce chapitre énonce divers constats, dont le caractère inéluctable de la révolution en question, avec lesquels le lecteur sera certainement en phase, et qui ne nécessitent donc pas ici d’approfondissements. Toutefois, l’un des développements attire tout spécialement l’attention. En page 33, il est ainsi indiqué que « le numérique augmente la capacité de chacun », et qu’elle aura pour effet « de rééquilibrer la relation nouée entre le client et son avocat ». Selon le rapport, « la double asymétrie dont souffrait la relation entre un particulier et un professionnel du droit se (trouvera) en partie ainsi corrigée : l’asymétrie d’information, d’une part, par la mise à disposition d’informations précises et déjà adaptées à une situation, et, de l’autre, l’asymétrie relationnelle puisque le possible regroupement des utilisateurs modifie le rapport de force (nombre de plates-formes proposant à ceux qui les consultent de les mettre en rapport avec les personnes ayant fait des requêtes identiques) ».
Cependant, l’asymétrie d’information mérite-t-elle vraiment d’être corrigée ? Est-il possible, voire nécessaire, que les usagers du droit disposent d’informations qu’ils ne seront jamais à même de comprendre pleinement ? Il est, à vrai dire, curieux que de tels raisonnements, menés à propos du marché du droit, ne soient pas conduits dans d’autres secteurs, comme celui de la santé : qui penserait à déplorer l’asymétrie d’information, pourtant réelle, entre le médecin et son patient ? Qui prône l’automédication ? Que le numérique augmente l’offre de droit pour le justiciable (ou le consommateur de droit plus largement), certes. Mais il faut que cela s’opère sur des bases qui lui seront profitables, et non pas en l’inondant d’informations dont il ne pourra pas savoir que faire (à moins de considérer que le juriste n’est qu’une base de données, auquel cas, sa fin sous forme humaine est proche !).
En revanche, on ne peut qu’abonder dans le sens du rapporteur quand est préconisée la formation des avocats au codage, à la maîtrise de l’algorithme (p. 36-37), pour pouvoir utiliser les nouveaux instruments de manière pertinente et dans l’intérêt de ses clients.
III. La modélisation économique de l’avocature
Le troisième chapitre invite l’avocat à « transformer son modèle économique ». Au-delà d’une incitation à la diversification des activités, et à la modification des « stratégies tarifaires » (p. 45), le rapport s’interroge sur le modèle actuel de l’avocature, qu’il considère comme étant « à bout de souffle » (p. 42). Et d’aborder un « tabou français » (p. 44) : l’exercice individuel (ou isolé) de la profession, contrairement à un phénomène de concentration observé dans les années 1990, ou encore aujourd’hui dans l’immense majorité des pays occidentaux. L’invitation est clairement formulée de la manière suivante : « se regrouper pour perdurer » (p. 45).
Il est difficile de ne pas adhérer à cette préconisation, tant l’exercice individuel, artisanal (au sens le plus noble du terme de la profession) paraît proche de sa fin. Cependant, s’agissant des modalités de sa mise en œuvre, il faudrait raisonner sur deux problématiques connexes et difficilement sécables : d’une part, le statut de l’avocat (on pense notamment à la question du salariat, ou plus généralement à la possibilité de développer une clientèle propre) ; d’autre part, la spécialisation de l’avocat.
De ce dernier point de vue, il est tout à fait possible de concevoir un modèle d’exercice regroupé sur un mode spécialisé, ou au contraire selon des modalités généralistes. Il est permis de penser que même quand la profession d’avocat s’exercera de manière nécessairement collective, les avocats gagneront à laisser coexister en leur sein des généralistes et des spécialistes. Ne serait-ce qu’en province, il est difficile d’imaginer la création de grosses structures ultra-spécialisées : la plupart de celles qui existent déjà diversifient d’ailleurs leurs « départements ».
IV. Communauté de juristes et fragmentation de la représentation de la profession d’avocat
Le dernier chapitre, enfin, pousse à « construire la communauté des juristes ».
Avant même d’aborder le contenu des propositions formulées, il convient d’indiquer que ces dernières seront difficilement applicables dans le contexte fragmenté, atomisé, de la régulation de la profession d’avocat.
Sans entrer dans le détail84, rappelons que la France est l’un des très rares pays européens dans lequel il n’existe pas d’ordre professionnel des avocats. La multiplicité, et parfois la disparité, des institutions censément représentatives des avocats empêchent le plus souvent de porter efficacement des propositions ou des colères auprès des pouvoirs publics, qui peinent à identifier un interlocuteur fédérateur.
Le rapport invite d’abord à un « test de comparaison internationale » (p. 52 et s.). Les questions soulevées sont indubitablement au cœur de notre actualité, et certainement de notre futur proche. Mais la lecture de ces développements laisse un sentiment mitigé.
Certains constats s’imposent : la pratique de l’avocat anglo-saxon diffère largement de celle de son homologue européen continental. Les droits anglo-saxons sont bien plus business friendly que les droits de source romano-germanique. Les pays correspondant à cette dernière tradition n’ont jamais pu considérer le droit à la fois comme un outil d’organisation sociale et un objet économique, pouvant répondre aux lois du marché.
Cependant, d’autres affirmations suscitent davantage de prudence. Ainsi, selon les auteurs du rapport, « même si l’on peut s’interroger sur la pertinence des critères utilisés pour la mise en place des rapports Doing Business de la banque mondiale, la réticence des pays de droit civil à jouer le jeu de cette compétition est un signe fort » (p. 53).
Ici de nouveau, le rapport entretient une certaine ambivalence de nature à nuire à la force du message. Si les critères retenus dans les études Doing Business sont contestables (et ils le sont assurément, tant leur subjectivité et leur ancrage anglo-saxon rend leur universalisation illusoire et artificielle), il paraît difficile de reprocher aux pays de droit civil de ne pas jouer à un jeu dont les règles semblent faussées.
C’est en réalité, en des termes voilés, le débat récurrent de l’attractivité du système juridique français qui ressurgit ici. Que la structure du droit français ne soit pas forcément lisible (le rapport mentionne un Code civil à côté duquel fleurissent d’autres codes, comme celui de la consommation), soit. Qu’un effort de simplification soit nécessaire, soit encore. Mais il ne devrait pas être question que le système juridique et judiciaire français se fasse évaluer à l’aune de critères préétablis pour valider tel modèle (anglo-saxon en l’espèce) et rejeter tel autre. Pour ne prendre qu’un exemple : peut-on vraiment juger l’efficacité d’un système judiciaire à l’aune de sa rapidité, sans prendre en compte les garanties de procédure et de libertés fondamentales que certains délais légaux vont peut-être contribuer à maintenir ?
Pas plus que le législateur, les avocats ne doivent tomber dans le piège des sirènes de l’efficience à l’anglo-saxonne. Au rang des affirmations dont il est possible de s’éloigner, figurent celles relatives à notre système d’administration de la preuve. Le rapport explique que « pour le juriste anglais ou américain la solution est dans le fait plus que dans le droit, c’est-à-dire dans les catégories juridiques. Le fait circule beaucoup plus aisément et réunit plus facilement un consensus autour des méthodes pour le trouver que les catégories juridiques » (p. 53). À l’inverse, la procédure civile française ne serait pas centrée sur la culture de la preuve, et les outils de collecte ou de conservation de ladite preuve seraient insuffisants. Or les résultats décrits s’agissant du monde anglo-saxon, même s’ils devaient être considérés comme souhaitables, ne peuvent être atteints, ce que le rapport reconnaît lui-même, qu’à l’issue d’un procès nécessairement très coûteux. De plus, même dans notre modèle classique du procès civil, le fondement du duel judiciaire est bien probatoire. Il est ainsi étonnant de lire que la France devrait développer un droit de la preuve (p. 53)…
En outre, le rapport passe sous silence le fait que notre système judiciaire a amorcé, même de manière restreinte, une mue dans une optique d’attractivité internationale. C’est ainsi que le tribunal de commerce de Paris, à l’instar d’autres juridictions européennes, a annoncé la création en son sein d’une chambre spécifiquement dédiée au contentieux international, avec notamment la possibilité de voir l’instance se dérouler en langue anglaise.
Il est en revanche possible de rejoindre pleinement les auteurs du rapport quand ils indiquent que l’avocat français vise davantage à « garder l’amour de ses pairs » qu’à être forcément le plus efficace (p. 54). Et de prôner, de manière très logique, une plus grande porosité entre toutes les professions du droit, notamment entre avocats et juges (p. 57 et s.).
Enfin, dans ce dernier chapitre, les auteurs du rapport envisagent la mobilité géographique comme moyen d’avancement des avocats : « la mobilité géographique est signe de maturité et d’avancement de leur carrière » (p. 55). Comment contester cette affirmation…
Dans la même veine, il est préconisé une meilleure maîtrise des langues étrangères, comme condition essentielle de la fluidité de la pratique professionnelle de l’avocat (p. 55). Il faut tout de même rapprocher ce vœu (pieux ?) des modalités, récemment réformées, de l’examen d’entrée dans les CRFPA : il faut en effet savoir qu’à partir de 2021, les candidats ne pourront que subir une épreuve d’anglais dans le cadre de l’épreuve (d’admission) de langue. Est-ce vraiment là la conception de l’ouverture à l’étranger, qui consisterait à tourner le dos au monde non anglo-saxon ?
Conclusion
La profession d’avocat s’interroge sur les conditions de sa survie. Une plus grande ouverture est prônée, de même qu’un éloignement de l’apparent confort d’un statut traditionnel. Le renforcement de la déontologie devrait accompagner ces changements.
Le rapport s’achève sur une note d’optimisme. Il convient toutefois de nuancer cette dernière d’une bonne dose de réalisme : les avocats existeront toujours, mais sous quelle(s) forme(s) ?
Michel ATTAL
III – Discipline
L’impartialité des acteurs de la procédure disciplinaire. Poursuivi et jugé par ses pairs, l’avocat suspecté d’avoir commis une infraction déontologique peut légitimement douter de l’impartialité des différents acteurs de la procédure disciplinaire85, comme l’illustrent les arrêts rendus le 5 juillet 2017 et le 5 janvier 2017 par la Cour de cassation.
Dans la première occurrence susmentionnée86, la suspicion de l’avocat pouvait paraître exacerbée étant donné que la plupart des protagonistes de la procédure disciplinaire étaient accusés de partialité. L’avocat en question avait fait l’objet de poursuites disciplinaires initiées par le bâtonnier, pour plusieurs manquements à ses obligations déontologiques. Lui étaient reprochés des retards de paiement d’impôts et de plusieurs cotisations ordinales, des refus ou réticences à transmettre les dossiers des clients aux confrères lui succédant, un refus de paiement des honoraires de postulation et une attitude discourtoise à l’endroit du bâtonnier. Condamné pour ces faits par la juridiction disciplinaire, puis par la cour d’appel de Nancy, l’avocat avait formé un pourvoi mettant notamment en cause l’impartialité de plusieurs acteurs de la procédure disciplinaire initiée contre lui. Après avoir détricoté méticuleusement l’ensemble de son argumentaire, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
L’arrêt écarte en premier lieu le grief d’impartialité du président du conseil de discipline au motif que celui-ci s’est borné à proroger le délai accordé aux rapporteurs en raison de l’indisponibilité de l’un d’eux, sans aucun examen de l’affaire au fond. Il précise au passage que la notification de cette décision n’est pas soumise au délai de 8 jours prévu à l’article 196 du décret du 27 novembre 1991.
La Cour de cassation énonce ensuite que la désignation des rapporteurs ne porte pas atteinte, à elle seule, en l’absence de tout autre élément de nature à faire douter de leur impartialité, à l’exigence d’une instruction objective, contradictoire et impartiale et ce, malgré une précédente nomination pour instruire d’autres plaintes dirigées contre l’avocat poursuivi ; d’autant que ce dernier ne les a pas récusés. L’arrêt retient dans le même sens que la participation des membres du conseil de l’ordre à une délibération en vue de pourvoir au remplacement du rapporteur, indisponible, ne porte pas atteinte à l’exigence d’un procès équitable, bien que l’un d’eux ait pu être concerné par l’un des dossiers visés par la poursuite, dès lors que la désignation d’un rapporteur est de nature administrative et qu’aucune faute disciplinaire n’a été retenue à l’encontre de l’avocat poursuivi pour les faits relatifs à ce dossier.
Enfin, la Cour de cassation considère que les relations conflictuelles que le bâtonnier peut avoir entretenues avec l’avocat poursuivi ne sont pas de nature à remettre en cause l’impartialité du conseil de discipline dans la mesure où il intervient en matière disciplinaire comme autorité de poursuite, qui ne participe ni à l’instruction de l’affaire ni à la délibération du conseil de discipline. C’est d’ailleurs cette raison qui a conduit la haute juridiction à juger dans une autre affaire récente que le bâtonnier ne peut être récusé87.
Traduction du principe de neutralité88, l’exigence d’impartialité a un domaine d’application circonscrit comme le rappelle à juste raison la Cour de cassation dans l’arrêt commenté. Quant aux personnes d’abord, dans la mesure où seules celles qui participent à la prise de décision, en ce compris les rapporteurs89, peuvent voir leur impartialité mise en cause. Quant aux actes ensuite, puisque les décisions de nature administrative et celles ne donnant pas lieu à un examen de l’affaire au fond ne peuvent fonder une entorse au droit à un tribunal impartial.
Pierre angulaire du droit au procès équitable90, l’exigence d’impartialité est d’autant plus grande au plan disciplinaire eu égard à la nature spécifique de la juridiction. On se souvient en effet que les impératifs européens en matière de procès équitable ont justifié le remplacement des conseils de l’ordre par les conseils de discipline en tant que juridiction disciplinaire91, sauf dans la capitale92. Cette réforme a ainsi instauré une stricte séparation des autorités de poursuites, d’instruction et de jugement93. Pour autant, force est de constater que les suspicions de partialité à l’endroit des juges disciplinaires n’ont pas été totalement résorbées puisque le contentieux y relatif demeure considérable.
Kévin MOYA
La seconde espèce94 donne au juge l’occasion d’adapter les notions juridiques aux technologies modernes. Un avocat, objet d’une procédure disciplinaire, avait soulevé le lien d’amitiés existant sur un réseau social entre les membres de la commission disciplinaire, l’autorité de poursuite et la plaignante95. Invoquant l’interprétation souveraine des causes de récusation par les juges du fond, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir « retenu que le terme d’ »ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et l’existence de contacts entre ces différentes personnes sur le web ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession ».
Cette décision reflète parfaitement la finalité poursuivie par les dispositions légales96. Ainsi, ce n’est pas l’amitié qui est blâmable en droit mais le risque de défaut d’impartialité du juge97 et par la même, son défaut de neutralité dans l’exercice de sa fonction. L’impartialité, attribut du procès équitable98, est déterminée par rapport à la mission du juge99. En conséquence, est partial un juge qui rend sa décision en se fondant sur des éléments étrangers à sa mission tels que ses intérêts personnels à l’affaire ou encore ses relations privilégiées avec l’une des parties100. L’espèce rapportée est relative à l’impartialité dite subjective, par opposition à l’impartialité fonctionnelle. La partialité, c’est-à-dire le parti pris101, est subjective lorsqu’elle se fonde sur des critères tirés de la personne même du juge102. Admettre que la seule connexion sur des réseaux sociaux, qualifiés par la jurisprudence de réseau de communication, permettent de fonder l’impartialité du juge disciplinaire, témoignerait d’une vision extensive de la notion d’amitié. L’amitié réprouvée est celle qui est susceptible d’influencer le processus décisionnel du juge, aussi est-il heureux que les magistrats en écartent une conception purement formelle.
Charles BOËRIO
Notes de bas de pages
-
1.
Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 16-22868.
-
2.
V. déjà en ce sens : Cass. 1re civ., 28 juin 2012, n° 11-15370.
-
3.
Depuis que l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 a (enfin) remplacé les mots de « Communauté européenne » par ceux d’« Union européenne » !
-
4.
L. n° 2004-130, 11 févr. 2004, réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.
-
5.
CA Lyon, 27 juill. 2016, n° 15/07832.
-
6.
V. Laurent J., Chaffois B., Boërio C., Moya K. et Revet T. (dir.), Déontologie de la profession d’avocat, 2018, LGDJ-EFB, La bibliothèque de l’avocat, nos 62 et s.
-
7.
Cass. 1re civ., 19 janv. 1994, n° 92-10260.
-
8.
CEDH, 4e sect., 27 juin 2017, n° 50446/09, Jankauskas c/ Lituanie (en anglais).
-
9.
Sur toutes ces voies d’accès, v. Laurent J., Chaffois B., Boërio C., Moya K. et Revet T. (dir.), Déontologie de la profession d’avocat, 2018, LGDJ-EFB, La bibliothèque de l’avocat, nos 49 et s.
-
10.
Dir. n° 98/5 du PE et du Cons., art. 84, al. 2.
-
11.
D. n° 91-1197, art. 93-1.
-
12.
Comp. Piau D., Dalloz actualité, 2 févr. 2018.
-
13.
Dir. n° 98/5 du PE et du Cons., art. 6-1.
-
14.
L. n° 2015-990, 6 août 2015.
-
15.
Dans le cadre des compétences que lui a confiées la loi du 6 août 2015, l’Autorité de la concurrence avait proposé le 9 juin 2016 une carte qui définissait : d’une part, les zones dans lesquelles l’installation des notaires est libre (247 zones dites « vertes » dans lesquelles 1650 professionnels pourront s’installer d’ici 2018) ; d’autre part, les zones dans lesquelles elle fait l’objet d’une régulation a priori de la part de la Chancellerie (60 zones « orange » ou « d’installation contrôlée »). Un arrêté conjoint des ministres de la Justice et de l’Économie avait entériné la proposition de carte de l’Autorité le 16 septembre 2016.
-
16.
Les questions concernent notamment l’appréciation du dispositif de tirage au sort mis en place par la Chancellerie, la qualité de l’accompagnement par les différents acteurs (instances, chambres, Conseil supérieur du notariat, etc.), les perspectives données par la loi sur les modes d’exercice professionnel (interprofessionnalité notamment) et le développement de la publicité. Il est vrai que le tirage au sort avait laissé certains candidats perplexes, les discours tenus par la Chancellerie et les instances de la profession n’étant parfois guère lisibles, voire contradictoires. Une foire aux questions sur le site d’OPM (Chancellerie) avait même vu le jour pour répondre aux questions des candidats, de même qu’une cellule « assistance » au Conseil supérieur du notariat. Il faut espérer que la nouvelle génération verra ses débuts facilités par des améliorations du dispositif (ordre de priorité entre les zones, encadrement des transferts, publicité du mode opératoire précis requis par la Chancellerie en cas d’association…). Des interrogations, souvent sans réponse claire ou exprimée publiquement, avaient vu le jour pour les créateurs (dont la majorité avait candidaté en individuel) : comment valoriser précisément son droit d’installation ? Est-il possible d’apporter le passif souscrit en office individuel à une SEL ?
-
17.
Cass. crim., 24 avr. 2013, n° 12-80331 ; Cass. crim., 24 avr. 2013, n° 12-80336 ; Cass. crim., 24 avr. 2013, n° 12-80332.
-
18.
Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-81041 ; Cass. crim., 27 nov. 2013, n° 12-85830.
-
19.
CEDH, 21 mars 2017, n° 33931/12, Janssen CILAG SAS c/ France.
-
20.
CEDH, Janssen Cilag SAS c/France, préc., § 13.
-
21.
CEDH, 2 avr. 2015, nos 63629/10 et 60567/10, Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services c/France ; obs. B. Chaffois , Dr. & patr., sept. 2015, n° 250, p. 66 et s., spéc. p. 71 et s.
-
22.
CEDH, Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services c/ France, préc., § 63, citant not. CEDH, 27 sept. 2005, n° 50882/99, Sallinen et a. c/ Finlande, § 71 ; CEDH, 29 juin 2006, n° 54934/00, Weber et Saravia c/ Allemagne, § 77 ; CEDH, 16 oct. 2007, n° 74336/01, Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c/ Autriche, § 43 ; CEDH, 3 juill. 2012, n° 30457/06, Robathin c/ Autriche, § 39.
-
23.
CEDH, Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services c/ France, préc., § 78.
-
24.
Ibid., § 79.
-
25.
Recours rejeté par la Cour de cassation par un arrêt de la chambre criminelle en date du 30 novembre 2011, n° 10-81748.
-
26.
Arrêt Janssen Cilag SAS c/France, préc. § 23.
-
27.
Ibid.
-
28.
L’arrêt Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services précité avait validé la saisie globale mais prononcé une violation de l’article 8 de la Convention EDH en raison de l’absence d’examen sérieux des saisies par le juge appréciant le recours.
-
29.
Saenko L., « Les saisies globales en droit de la concurrence : perspectives nouvelles », JCP E 2013, 1453, n° 5.
-
30.
Ibid. V. argumentation de l’AMF dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt CA Paris, 5-5, 25 oct. 2011, n° 09/14568.
-
31.
Il en va ainsi de Microsoft Exchange ou Outlook.
-
32.
Roskis D. et Dorémus C.-M., « Saisies informatiques par les autorités françaises de concurrence : quelle compatibilité avec les droits de la défense ? », RLDA 1er févr. 2012, n° 68.
-
33.
Cass. crim., 8 mars 2017, n° 15-87010.
-
34.
Buy B., « Le point sur les vises domiciliaires : la fin d’un espoir ? », RLC 1er juill. 2017, n° 63.
-
35.
V. Torck S., « Droit de la communication des enquêteurs de l’AMF : la chambre commerciale au secours du secret des correspondances entre l’avocat et son client ? », Dr. sociétés avr. 2013, n° 4, comm. 68.
-
36.
V. déjà CEDH, Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services c/ France, préc. ; obs. Chaffois B., Dr. & patr., sept. 2015, n° 250, p. 66 et s., spéc. p. 71 et s.
-
37.
Chaffois B., « Avers et envers du statut de professionnel du droit », chron. janv.-juill. 2017 Revet T. (dir.), Dr. & patr., oct. 2013, n° 229, p. 88 et s., spéc. p. 95.
-
38.
Cons. const., 24 juill. 2015, n° 2015-478 QPC, assoc. French Data Network et a. : « aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats et un droit au secret des sources des journalistes ». V. Laurent J., « La spécificité de la profession d’avocat en question », chron. Revet T. (dir.), Dr. & patr., mars 2016, n° 256, p. 78 et s., spéc. p. 84 et s.
-
39.
Martin D. et Françon M., « Correspondances d’avocat : la cour d’appel de Paris en état de récidive », D. 2012, p. 204, s’appuyant sur le TIPCE, 17 sept. 2007, n° T-125/03 ; D. 2007, p. 2467, où les juges communautaires retinrent que « cette protection vise à garantir l’intérêt public d’une bonne administration de la justice consistant à assurer que tout client a la liberté de s’adresser à son avocat sans craindre que les confidences dont il ferait état puissent être ultérieurement divulgués ». Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi rejeté par la CJUE, 14 sept. 2010, n° C-550/07 : D. 2010, p. 2149. V. égal. Ader H. et Damien A., Règles de la profession d’avocat, 15e éd., actualisé par Bortoluzzi S., Piau D. et Wickers T., Dalloz Action 2016/2017, n° 411.14, p. 492.
-
40.
Ader H. et Damien A., Règles de la profession d’avocat, op. cit., n° 411.13, p. 492.
-
41.
Roskis D. et Dorémus C.-M., « Saisies informatiques par les autorités françaises de concurrence : quelle compatibilité avec les droits de la défense ? », RLDA 1er févr. 2012, n° 68.
-
42.
Chaffois B., « Avers et envers du statut de professionnel du droit », op. cit., p. 88 et s., spéc. p. 95.
-
43.
CA Paris, 8 nov. 2017, n° 14/13384, ord. du président.
-
44.
Pratiques prohibées par les articles L. 420-1, 1°, 2° et 3° du Code de commerce et 101-1, a) et b) du TFUE.
-
45.
Parmi les moyens non étudiés figurait un grief tiré du caractère massif de la saisie (moyen rejeté).
-
46.
Mayoux C., « Secret des correspondances avocat/client : application aux courriels internes de l’entreprise », AJ Pénal 2018, p. 49.
-
47.
V. égal. RIN, art. 2.
-
48.
Mayoux C., « Secret des correspondances avocat/client : application aux courriels internes de l’entreprise », op. cit.
-
49.
Du latin princeps, principalis, originaire, principal, qui a trait au prince : Cornu G., Vocabulaire juridique, 12e éd., 2018, assoc. Capitant-PUF, V° Principal.
-
50.
Nous ne pensons pas qu’il faille interpréter cette décision comme un élargissement de la notion de client. Contra v. Mayoux C., préc., pour lequel « cette décision a des répercussions sur la notion de client/personne morale : chaque personne physique, membre de la société, voire du groupe, qui reprend les éléments confidentiels initialement transmis par l’avocat, se trouve protégée par le secret dont bénéficie l’entreprise, personne morale ».
-
51.
CA Paris, 5-2, 18 déc. 2015, n° 15/03732 : Dr. & patr. 2016, n° 256, obs. Chaffois B.
-
52.
Huet J., RDC 2017, n° 114k7, p. 449, obs. sous Cass. 1re civ., 11 mai 2017, n° 16-13669.
-
53.
V. aussi D. n° 2005-790, 12 juill. 2005, art. 15.
-
54.
Pour un exemple de manipulations du système de notations sur le site www.tripadvisor.com au sein duquel un restaurant, qui n’existait pas, s’est retrouvé en tête du classement des restaurants londoniens pendant plusieurs semaines : http://fortune.com/2017/12/10/tripadvisor-london-shed-fake-restaurant/
-
55.
Lecourt A., Dalloz IP/IT 2017, 410, obs. sous Cass. 1re civ., 11 mai 2017, n° 16-13669.
-
56.
D. n° 2005-790, 12 juill. 2005, art. 10, al. 4.
-
57.
Landry D. et Villacèque J., « À propos des comparateurs d’avocats : un système biaisé », Gaz. Pal. 5 déc. 2017, n° 307w1, p. 19.
-
58.
Laurent J., Chaffois B., Boërio C., Moya K. et Revet T. (dir.), Déontologie de la profession d’avocat, 2018, LGDJ-EFB, La bibliothèque de l’avocat, nos 118 et s., n° 219.
-
59.
V. déjà Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 14-23960 ; Dr. & patr. 2015, n° 261, obs. Chaffois B.
-
60.
Cass. 2e civ., 6 juill. 2017, n° 16-15299 ; Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-19083.
-
61.
D. n° 2017-1226, 2 août 2017, portant diverses dispositions relatives à la profession d’avocat.
-
62.
Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-18294.
-
63.
V. sur cette question, Laurent J., Chaffois B., Boërio C., Moya K. et Revet T. (dir.), Déontologie de la profession d’avocat, 2018, LGDJ-EFB, La bibliothèque de l’avocat, n° 796.
-
64.
Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-10815 ; Cass. 2e civ., 2 juill. 2015, n° 14-22.177 ; Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, n° 14-11947 ; Cass. 2e civ., 6 mars 2014, n° 13-14922.
-
65.
Cass. 2e civ., 11 janv. 2018, n° 17-20259.
-
66.
Cass. 2e civ., 6 juill. 2017, n° 16-19354.
-
67.
Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-24043.
-
68.
Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-11599 ; Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-15013 ; Dr. & patr. 2015, n° 250, obs. Laurent J.
-
69.
Sur la distinction entre la date du fait générateur de la créance d’honoraires de résultat et sa date d’exigibilité : Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-21701. V. égal. Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-25120.
-
70.
Laurent J., Chaffois B., Boërio C., Moya K. et Revet T. (dir.), Déontologie de la profession d’avocat, 2018, LGDJ-EFB, La bibliothèque de l’avocat, n° 794.
-
71.
Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-23599.
-
72.
D. n° 2016-230, 26 févr. 2016 ; D. n° 2016-217, 26 févr. 2016 ; D. n° 2016-216, 26 févr. 2016 ; D. n° 2016-215, 26 févr. 2016, et arrêtés du 26 février 2016.
-
73.
C. com., ann. 4-7, tableaux 5 et 5-1.
-
74.
RIN, art. 15.2.2 modifié par la décision à caractère normatif de l’assemblée générale du conseil national des barreaux n° 2016-001 des 1er et 2 juillet 2016.
-
75.
L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 21-1.
-
76.
CE, 29 janv. 2018, n° 403101, publié au Lebon.
-
77.
CE, 17 nov. 2004, n° 268075, publié au Lebon ; CE, 19 oct. 2012, n° 354613 ; CE, 28 avr. 2017, n° 400832.
-
78.
L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 1 ; Laurent J., Chaffois B., Boërio C., Moya K. et Revet T. (dir.), Déontologie de la profession d’avocat, 2018, LGDJ-EFB, La bibliothèque de l’avocat, nos 258 et s.
-
79.
Dufour O., « Introuvables bureaux secondaires en entreprise… », LJA mars-avr. 2017, p. 11 et s.
-
80.
Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 17-13159.
-
81.
D. n° 2016-878, 29 juin 2016, art. 3.
-
82.
C. civ., art. 1893 : « Par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c’est pour lui qu’elle périt, de quelque manière que cette perte arrive ».
-
83.
Moya K., « La suppression de la règle de l’unicité d’exercice dans les sociétés d’exercice libéral », Dr. & patr., mars 2017, n° 267, p. 97-98 ; Laurent J., Chaffois B., Boërio C., Moya K. et Revet T. (dir.), Déontologie de la profession d’avocat, 2018, LGDJ-EFB, La bibliothèque de l’avocat, n° 820.
-
84.
V. not. Attal M., Culture judiciaire, 4e éd., 2017, Larcier, Métiers-Paradigme, chap. « Les avocats ».
-
85.
La Cour de cassation a rappelé par deux arrêts (Cass. 1re civ., 5 oct. 1999, n° 96-19291 et Cass. 1re civ., 5 oct. 1999, n° 97-15277) que cette exigence s’applique à la procédure disciplinaire.
-
86.
Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-21768.
-
87.
Cass. 2e civ., 28 sept. 2017, n° 16-17583.
-
88.
Guinchard S. (dir.), Droit et pratique de la procédure civile, 2018, Dalloz action, n° 211.110.
-
89.
Cass. 1re civ., 2 avr. 2009, n° 08-12246, P.
-
90.
CJCE, 1er juill. 2008, n° C-6341/06 P et C-342/06 P, Chronopost et La Poste c/UFEX et a., § 46.
-
91.
L. n° 2004-130, 11 févr. 2004, art. 28.
-
92.
Lesdites exigences européennes ont toutefois été intégrées dans la procédure parisienne (RIBP, art. P.72.3).
-
93.
L. n° 2004-130, 11 févr. 2004 ; D. n° 2005-531, 24 mai 2005.
-
94.
Cass. 2e civ., 5 janv. 2017, n° 16-12394.
-
95.
CA Paris, 2-1, 17 déc. 2015, n° 15/23692.
-
96.
Par renvoi de l’article 341 du Code de procédure civile à l’article L. 111-6 du Code de l’organisation judiciaire, la récusation pour cause de suspicion légitime peut être demandée s’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties.
-
97.
Gautier P.-Y., « L’amitié en droit : Montaigne à la Cour de cassation », D. 2017, p. 208.
-
98.
Fircéro N., Dictionnaire de la justice, Cadiet L. (dir.), 2004, PUF, V° Impartialité, spéc. p. 607.
-
99.
Ibid.
-
100.
Ibid.
-
101.
Cadiet L., Normand J. et Amrani Mekki S., Théorie générale du procès, 2e éd., 2010, PUF, n° 161, p. 602.
-
102.
Fircéro N., Dictionnaire de la justice, Cadiet L. (dir.), 2004, PUF, V° Impartialité, spéc. p. 607.