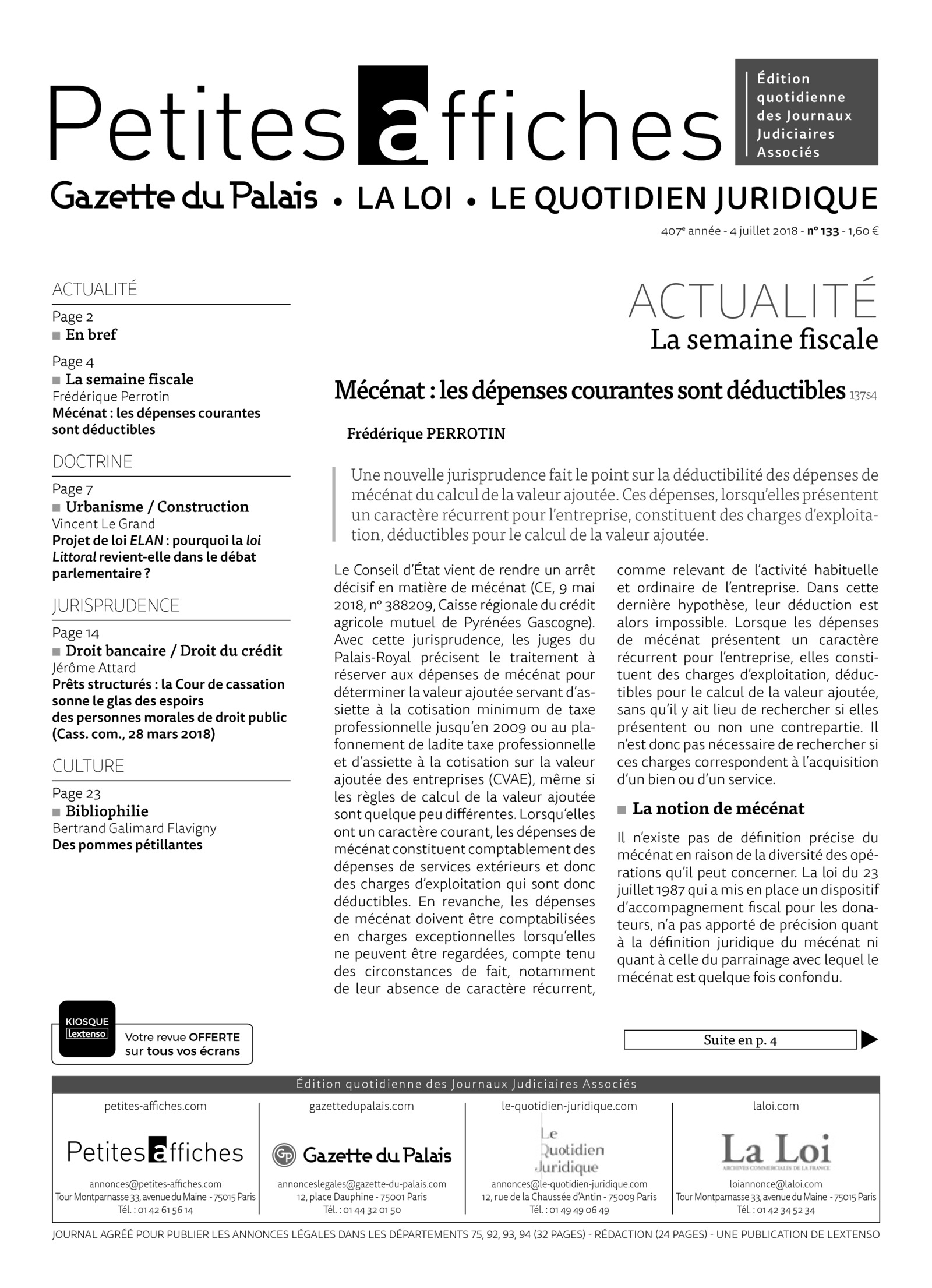Prêts structurés : la Cour de cassation sonne le glas des espoirs des personnes morales de droit public
Premier arrêt rendu par la Cour de cassation à propos des prêts structurés contractés par les personnes morales de droit public : il ne s’agit en principe pas d’instruments financiers qui auraient été conclus à des fins spéculatives ; la haute juridiction précise les critères de la qualification d’emprunteur non averti, seul autorisé à invoquer un manquement de la banque à un éventuel devoir de mise en garde.
Cass. com., 28 mars 2018, no 16-26210
La loi n° 82-213 du 2 mars 19821 a conféré aux collectivités territoriales, la liberté de contracter des emprunts auprès des banques pour financer leurs investissements. Ces contrats qui relèvent du droit privé, sont devenus une source d’autant plus régulière de financement que les banques ont vu dans ces opérations, le moyen de conquérir une nouvelle clientèle, alors, réputée solvable2. C’est dans ces conditions, que nombre de ces collectivités se sont vues proposer des montages apparaissant comme attractifs en raison de leur découpage en minimum deux phases : une première conduisant à l’application d’un taux fixe, inférieur à ceux habituellement pratiqués, une deuxième beaucoup plus longue, laissant la place à l’application d’un taux variable assis sur un indice sous-jacent fluctuant en fonction des évolutions des marchés financiers. La charte Gissler3 a classifié les indices utilisés, mettant en évidence leur degré de dangerosité. Nombre d’entre eux, se sont révélés très volatils, mais leurs risques n’ont pas toujours été appréhendés par les personnes publiques les ayant acceptés. Un rapport du gouvernement, se basant sur l’année 2014, pour faire un état des lieux, a mis en évidence, qu’à cette date, 1191 d’entre elles avaient contracté des emprunts désormais considérés comme « toxiques » pour un total de 8,6 milliards d’euros4. Devant le refus des banques de renégocier les prêts consentis, nombre d’emprunteurs ont opté pour la voie judiciaire : c’est dans ce cadre que s’inscrit l’arrêt rapporté qui constitue le premier rendu par la Cour de cassation en la matière. En l’espèce, la commune de Saint Leu la forêt avait contracté deux prêts auprès de la banque Dexia. Les deux contrats prévoyaient différentes phases, répondant au schéma précédemment décrit. Pour la seconde, au cœur du litige, était stipulé, dans l’hypothèse où le cours de l’euro, en franc suisse, était inférieur au cours pivot de 1,45 franc suisse pour un euro, que les intérêts seraient calculés en considération d’un taux variable composé de la somme d’un taux fixe et de 50 % du taux de variation du cours de change et de l’euro en franc suisse. La commune avait développé plusieurs arguments pour contester la licéité de ce contrat, ou engager la responsabilité de la banque prêteuse. Certains relevaient du droit financier. À ce titre, elle faisait valoir que l’opération de financement incluait une double relation contractuelle : une fondée sur un prêt et l’autre, en raison de la stipulation de taux, sur un contrat d’option. L’intérêt était double : un tel contrat est un instrument financier au sens de l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier ce qui aurait généré l’application des règles de bonne conduite qui s’imposent au prestataire de services d’investissement. Par ailleurs et surtout, la conclusion d’un tel contrat poursuit le plus souvent une fin spéculative qui en aurait justifié l’annulation en l’espèce : en effet, la liberté contractuelle d’une collectivité territoriale est limitée par une mission d’intérêt général, incompatible avec un tel objectif5. Au-delà des arguments fondés sur le droit financier, un autre reposait sur le droit bancaire, plus précisément sur celui relatif au prêt d’argent. La commune soutenait, à ce titre, que la banque avait manqué à un devoir de mise en garde qui s’est développé dans les opérations de prêt lorsque le risque de non remboursement est probable et à condition que l’emprunteur n’en soit pas averti. Enfin, un troisième argument mêlait droit bancaire et droit fondamentaux. En effet, la commune avait, devant les juges du fond, sollicité l’annulation de la stipulation d’intérêt : elle la considérait comme contraire aux dispositions des articles L. 313-4 du Code monétaire et financier et L. 313-2 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’époque des faits. Ces textes imposent que la stipulation de taux figure dans tout contrat de prêt. Le TGI de Nanterre6 avait répondu favorablement à sa demande, avant que la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 valide les stipulations litigieuses7 et que le Conseil constitutionnel considère cette disposition comme conforme à la constitution8. Cette évolution avait conduit la cour d’appel de Versailles à infirmer le jugement du TGI sur ce point9. Dans son pourvoi, la commune contestait cette loi qu’elle prétendait contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et à l’article 1er du protocole additionnel de cette dernière : faute de motif impérieux d’intérêt général pouvant la justifier, la commune dénonçait l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice ce qui portait atteinte au droit à un procès équitable. Cet argument posait la question de l’invocabilité de la Convention EDH et de son protocole additionnel, par une collectivité territoriale dans le cadre d’un litige relevant du droit privé. La Cour de cassation rejette tous les moyens du pourvoi formé par la commune10. S’agissant du droit financier, elle refuse de voir dans la stipulation de prêt, un contrat d’option et donc un instrument financier qui aurait eu un caractère spéculatif. Elle rejette par ailleurs, tout devoir de mise en garde à la charge du banquier prêteur, en approuvant les juges du fond d’avoir considéré l’emprunteur comme averti des risques auxquels il s’était exposé. Elle refuse, enfin, à une collectivité territoriale la possibilité d’invoquer la Convention EDH et son protocole additionnel y compris dans le cadre d’un litige relevant du droit privé. C’est sous ces différents angles que son arrêt mérite d’être analysé.
I – Analyse des prêts structurés au regard du droit financier : précisions quant aux notions de contrat d’option et d’opération spéculative
La commune soutenait que le financement, au cœur du litige, reposait sur deux contrats indissociables : un prêt et une vente d’option avec, pour prix de cette dernière, le taux d’intérêt bonifié nécessairement appliqué pendant la première phase du prêt. Pour la commune cette notion de vente d’option, ne se limitait donc pas à l’hypothèse d’un contrat conférant une faculté d’acheter, ou de vendre, un actif déterminé, mais incluait, comme en l’espèce, celle d’un contrat qui, portant sur un produit dérivé, contenait des options à « exercice automatique ». Cette démonstration avait plusieurs objectifs.
En premier lieu, un contrat d’option est un instrument financier au sens de l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier. Cette qualification aurait donc permis à la commune de se prévaloir des règles de bonne conduite imposées par le Code monétaire et financier au prestataire de service d’investissement qui doit, dans le cadre d’un conseil en investissement, réaliser un test d’adéquation, afin de recommander à son client, les instruments financiers adaptés à sa situation, l’article 533-4 dans sa rédaction applicable au premier contrat, imposant également, de manière expresse, de communiquer de manière appropriée, les informations utiles à ce dernier.
Cette qualification de contrat d’option présentait un autre intérêt : ce type d’opération est régulièrement mené à des fins spéculatives ce qui aurait pu avoir deux conséquences. En matière de service d’investissement, une telle reconnaissance aurait permis d’invoquer le devoir de mise en garde, destiné à protéger l’opérateur contre des risques dont celui-ci ne serait pas averti. Ce point était, toutefois, secondaire ici, puisqu’en matière contractuelle, la liberté d’une collectivité territoriale est limitée à la satisfaction de l’intérêt public local à sa charge. En concluant des opérations spéculatives, le maire de la commune aurait donc agi en dehors de son domaine de compétence, ce qui aurait justifié l’annulation des contrats conclus. De ce point de vue, le pourvoi conduisait à s’interroger sur la signification de ce terme de spéculation. La commune invitait à ce titre, à retenir un critère objectif, en soutenant qu’un produit pouvait être spéculatif, indépendamment de l’intention des parties, dès lors qu’il comprend des options dont l’exercice soumet son souscripteur à un risque illimité. Certaines juridictions du fond avaient adopté cette position. On citera à titre d’exemple, un jugement du tribunal de commerce de Paris jugeant que le contrat était spéculatif dès lors qu’il ne permettait pas de connaître la charge maximale des intérêts et de se prémunir contre une hausse incontrôlée du taux stipulé11. La question se posait donc de savoir si la spéculation, se limitait à un critère objectif, ou si elle n’impliquait pas un élément intentionnel. Certains auteurs, invitaient à retenir cette seconde analyse. C’est notamment le cas d’Antoine Gaudemet, pour lequel la spéculation nécessite qu’une personne mette ses ressources en péril dans l’unique but de s’enrichir12.
La chambre commerciale de la Cour de cassation était donc invitée à se prononcer sur ces notions de contrat d’option et de spéculation afin de déterminer à la fois la validité même des contrats litigieux et les obligations du banquier les ayant proposés à la commune.
Elle rejette, à ce titre, les arguments développés par cette dernière. Elle juge que si le taux d’intérêt, variable dans la seconde phase de remboursement des prêts, n’était pas fixé lors de leur conclusion, son mode de calcul n’en était pas moins précisément défini : une nouvelle manifestation de volonté n’étant pas nécessaire, l’existence d’une option était exclue. Autrement dit, le contrat d’option implique l’existence d’une faculté, incompatible avec l’application automatique d’un taux d’intérêt dont les modalités de calcul sont déterminées à la conclusion du contrat. Il n’y avait en l’espèce aucun instrument financier, même si cette qualification n’est évidemment pas à écarter dans d’autres situations, comme celles où un swap de taux accompagnera la convention de prêt : il s’agira alors d’un contrat d’échange visé par l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier précité.
Au-delà de ce premier point, la haute juridiction précise également les critères de la spéculation. Elle considère que celle-ci ne saurait résulter de seuls critères objectifs, liés à l’existence d’un aléa et d’un risque illimité. Elle exige, au contraire, une intention qui faisait défaut en l’espèce : en effet, la commune a cherché, non pas à s’enrichir, mais à refinancer des investissements réalisés dans l’intérêt général, à des conditions de taux, les plus avantageuses possible. La solution a sans doute un caractère général : elle vaudra pour d’autres montages comme, notamment, ceux intégrant un swap de taux, lequel sera présumé être un simple instrument de gestion de sa dette par la collectivité13. Les dispositions de l’autorisation de l’organe délibérant à l’exécutif, ou celles du contrat conclu entre les parties, pourraient d’ailleurs confirmer cette analyse dans la pratique14.
Ainsi, le caractère spéculatif de l’opération mise en place dans le cadre de leurs financements, par les collectivités publiques, devrait rester exceptionnel : il sera donc difficile, à ces dernières, d’en obtenir l’annulation en raison de leur défaut de conformité à l’intérêt général15. Le droit financier pourra être appliqué dans le cadre de certaines opérations comme celles de swap ce qui générera l’application des règles de bonne conduite, imposées au prestataire de services d’investissement, mais l’absence de caractère spéculatif écartera tout devoir de mise en garde au regard du droit financier. En l’espèce, à défaut de voir dans la stipulation d’intérêt, un contrat d’option, seules les règles relatives au prêt d’argent pouvaient être appliquées.
II – La responsabilité de la banque en matière de prêt : application de son devoir de mise en garde ?
L’octroi d’un prêt structuré à une collectivité territoriale est-elle de nature à justifier un devoir de mise en garde à la charge du prêteur ? L’exécution d’un tel devoir impose un refus de contracter dès lors qu’il porte sur un risque probable ou certain de défaillance de l’emprunteur. Le prêteur professionnel qui y aurait manqué, engage sa responsabilité et doit à ce titre, réparer la perte de chance subie par son client, qui mieux averti, n’aurait pas contracté l’opération conclue.
L’argument est régulièrement développé pour invoquer la responsabilité des banques ayant distribué des prêts structurés aux collectivités territoriales et autres personnes publiques. Il convient pour autant, de rappeler qu’en matière de prêt, le devoir de mise en garde ne s’impose qu’à deux conditions. La première est la certitude, ou au moins, la forte probabilité de non-remboursement du prêt consenti. Dans l’affaire commentée, la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, avait jugé que la commune ne rapportait pas la preuve que le montant du prêt l’exposait à un risque manifeste d’endettement excessif, ou à des difficultés à faire face à ses obligations de remboursement. La seule complexité des modalités de calcul de l’endettement ne saurait donc suffire en la matière.
La deuxième limite à l’existence d’un devoir de mise en garde, est liée à l’incompétence de l’emprunteur qui, pour s’en prévaloir, doit être considéré comme « non averti » du risque auquel l’opération l’expose. L’arrêt commenté apporte un certain nombre d’éléments d’appréciation à ce titre. Le premier est la taille de la collectivité emprunteuse : la haute juridiction rappelle que la commune était d’une certaine importance puisqu’elle comptait 15 000 habitants. Le deuxième critère tient aux compétences des organes ayant négocié, ou, autorisé le recours au financement litigieux. Dans l’affaire rapportée, la Cour met en évidence la formation du maire, « diplômé de sciences de gestion » et sa qualité de Trésorier de l’association des maires d’île de France. Dans l’affaire relative au financement du port de Cast le Guildo, la cour d’appel de Versailles16 avait déjà justifié la qualité d’emprunteur averti de la commune, par la compétence de son maire qui, directeur d’une agence bancaire, « même peu importante », était en mesure d’apprécier les risques du prêt. D’autres critères peuvent également révéler cette compétence, comme la contribution apportée par le responsable de service de gestion financière de la collectivité, à un ouvrage en rapport direct avec les opérations litigieuses, le recours à une société de conseil spécialisée17, ou comme dans l’affaire commentée, l’existence d’une commission des finances. Dans un précédent arrêt, la cour d’appel de Versailles avait décidé que si la maire n’avait « pas de compétences particulières en matière financière, elle n’en était pas moins assistée d’un conseil municipal “aguerri” à la passation des prêts18. L’attitude des organes de la collectivité débitrice est également parfois prise en considération. Ainsi, dans cette dernière espèce, la cour d’appel a-t-elle souligné que « la commune n’avait pas jugé nécessaire d’avoir recours aux services spécialisés de la préfecture destinés à conseiller les communes en la matière ». Enfin, l’expérience des organes de l’emprunteur est un élément d’appréciation qui ne saurait être négligé : dans l’affaire rapportée, l’arrêt commenté met en évidence que la commune a conclu une vingtaine d’emprunts en trente ans dont plusieurs à taux variables représentant 40 % du total de l’endettement de la commune. Le fait que ces opérations aient été conclues dans le cadre d’une gestion active de la dette décidée par la collectivité, depuis plusieurs années, ne peut que renforcer son caractère d’emprunteur averti. On notera pour conclure ce point que l’expérience et les connaissances des organes de l’emprunteur importeront peu si la banque a connaissance d’informations légitimement ignorées par son cocontractant, même si l’’existence d’un tel déséquilibre d’accès à l’information paraît peu probable dans la pratique. Un autre argument développé par le pourvoi, se situait quant à lui, à mi-chemin entre le droit du prêt d’argent et celui des libertés fondamentales : il s’agissait de contester la conformité, au regard de la CEDH, de la loi du 29 juillet 2014 ayant permis de valider les contrats dépourvus de TEG.
III – Possibilité pour la commune de contester, au regard de la Convention EDH, la loi du 29 juillet 2014 ayant validé les contrats de prêts dépourvus de TEG
Devant les juges du fond, la commune avait soutenu que l’un des prêts, contrairement aux dispositions des articles L. 313-4 du Code monétaire et financier et de l’article L. 313-2 du Code de la consommation19, ne contenait pas la mention impérative du TEG. Le TGI de Nanterre, se fondant sur le caractère consensuel du prêt consenti par un professionnel du crédit, avait répondu favorablement à sa demande20 : la télécopie transmise par la banque à sa cliente, comprenait toutes les caractéristiques d’un prêt ce qui imposait cette qualification21. Or ce document ne contenait aucune mention répondant aux exigences des articles précités. Peu important que celui signé ultérieurement soit conforme à ces textes puisqu’il n’était destiné qu’à formaliser et établir la preuve d’un contrat déjà conclu. La validation de la stipulation litigieuse par la loi n° 2014-844 du 29 juillet 201422 avait conduit la cour d’appel de Versailles à infirmer ce point du jugement23. Dans son pourvoi, la commune contestait la loi précitée en soutenant qu’elle était contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et à l’article 1er de son protocole additionnel. Elle rappelait que si une loi de validation peut être adoptée, c’est à la condition qu’elle réponde à un motif impérieux d’intérêt général ce qui n’est pas le cas lorsqu’un risque financier est en cause comme c’était le cas en l’espèce : en l’absence de motif impérieux d’intérêt général, elle invoquait le droit à un procès équitable, en dénonçant l’intervention du législateur dans l’administration de la justice, destiné selon elle, à influer sur le dénouement des litiges en cours24. Ces arguments ne manquaient pas de pertinence, encore fallait-il s’interroger sur l’invocabilité de ces textes par une personne publique. En effet, l’article 34 de la convention n’autorise pas la saisine de la Cour européenne des droits de l’Homme par une organisation gouvernementale. La commune faisait néanmoins valoir que cet article ne lui interdisait pas d’invoquer les dispositions de la Convention EDH devant un juge national. Certains arrêts pouvaient être cités à l’appui de sa position. La chambre criminelle de la Cour de cassation avait notamment jugé que toutes les personnes morales, y compris celles de droit public, avaient droit à un procès équitable25. Le Conseil d’État avait également admis, au profit de ces personnes, le bénéfice de la Convention EDH, dès lors qu’aucune prérogative de puissance publique n’était en cause26, avant de dénier au final, aux collectivités territoriales, le droit de se prévaloir de l’ensemble des droits consacrés par la Convention EDH27. Pour la commune, il convenait de distinguer les rapports de la puissance publique entre l’État et les collectivités territoriales de ceux relatifs aux droits et obligations à caractère civil : rien ne lui interdisait, à ce dernier propos, d’invoquer la Convention EDH et son protocole additionnel, dans le cadre, d’un litige de droit privé, l’opposant à un établissement bancaire, devant un juge national. La chambre commerciale de la Cour de cassation rejette cette analyse : elle considère qu’une commune n’est pas assimilée à un organisme non gouvernemental au sens de l’article 34 de la Convention EDH, dans la mesure où elle exerce une partie de la puissance publique ; elle ne peut ni saisir la Cour européenne des droits de l’Homme, ni même invoquer utilement devant une juridiction nationale, les stipulations de la convention ou l’article 1er de son protocole additionnel, quelle que soit la nature du litige.
Ainsi, la Cour de cassation, par sa décision, rejette-t-elle l’essentiel des arguments jusqu’alors proposés afin, soit de permettre l’annulation des prêts structurés contractés par les personnes morales de droit public, soit d’engager la responsabilité des banques, souvent accusées d’avoir manqué de bonne foi, en ne mettant pas en garde leurs clients contre les risques générés par ces financements28. Son arrêt pourrait mettre un terme aux espoirs des collectivités ayant opté pour la voie judiciaire plutôt que pour l’adhésion au fonds de soutien mis en place par la loi de finance pour 201429. On restera néanmoins prudent en la matière. Par un arrêt du 7 février 2018, la chambre commerciale a en effet, considéré que la banque pouvait être tenue d’un devoir de conseil lorsqu’elle a pris l’initiative du montage à l’origine du litige30 : pourrait alors se poser la question de savoir si les prêts proposés correspondaient à la situation et aux objectifs des collectivités qui les ont contractés. Il y a sans doute là une nouvelle réflexion que ces dernières ne manqueront pas d’engager.
Notes de bas de pages
-
1.
L. n° 82-213, 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, départements et régions.
-
2.
Notamment à partir des années 1990 où les sollicitations du secteur privé pour financer des investissements diminuaient : Klopfer M., « Gestion de dette et de trésorerie », JCl. Collectivités territoriales, fasc. n° 2700.
-
3.
Charte du 7 déc. 2009 entre les établissements bancaires et les collectivités territoriales.
-
4.
Rapport du gouvernement sur les emprunts structurés des collectivités territoriales et organismes publics, oct. 2016, p. 11.
-
5.
Martin J., « Personnes publiques : il ne faut pas prendre les collectivités territoriales pour des profanes et les emprunts structurés pour des produits spéculatifs », RD bancaire et fin. mars 2013, étude 5.
-
6.
TGI Nanterre, 6e ch., 6 juin 2014, n° 12-06135.
-
7.
Loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public.
-
8.
Cons. const., 24 juill. 2014, n° 2014-695 DC.
-
9.
CA Versailles, 16e ch., 21 sept. 2016, n° 14/06388.
-
10.
Pour un autre commentaire : Mathey N., LEDB mai 2018, n° 111h0, p. 1.
-
11.
T. com., 8 déc. 2009, n° 2007-034564 : Banque juin 2011, obs. Morard F.
-
12.
Gaudemet A., Synvet H. préf., « Les dérivés », Economica 2008, n° 281.
-
13.
Cass. com., 19 juin 2007 : D. 2007, p. 1952, obs. Delpech X. ; JCP E et A 2007, 2259, spéc. n° 42, obs. Bonneau T. – CA Paris, 5-11, 9 sept. 2016, n° 13/20854. Voir toutefois CA Paris, 4 juill. 2012, n° 11/55520 : LEDB sept. 2012, n° 122, obs. Routier R.
-
14.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt précité de la cour d’appel de Paris en date du 9 septembre 2016, l’opération était présentée comme un moyen de gestion de la dette et du risque de taux, tandis que dans l’affaire rapportée, la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 21 sept. 2016, n° 14/06388) avait souligné que le conseil municipal, dans sa délibération avait donné au maire « l’autorisation de procéder… aux opérations utiles à la gestion des emprunts y compris les opérations de couverture de risques de taux… ».
-
15.
Voir également sur la question, Martin J., art. préc.
-
16.
CA Versailles, 16e ch., 21 sept. 2016, n° 15/07046. Cet arrêt avait infirmé le jugement du TGI de Nanterre du 26 juin 2015 (n° 11-07236) qui avait condamné la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, AJCT 2015, p. 594.
-
17.
TGI Metz, 6 mai 2010, n° I 2110/07 : JCP A 2012, 2177, obs. Huet G. et Goujon R.
-
18.
CA Versailles, 16e ch., 21 sept. 2016, n° 15/04767 : BJB déc. 2016, n° 116k0, p. 523, obs. Lasserre-Capdeville J.
-
19.
Dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce.
-
20.
TGI Nanterre, 6e ch., 6 juin 2014, n° 12-06135.
-
21.
Notamment le montant du prêt, sa durée, les dates d’échéance, du mode d’amortissement, les différentes phases du prêt et les modalités de remboursement anticipé.
-
22.
Loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public.
-
23.
CA Versailles, 16e ch., 21 sept. 2016, n° 14/06388.
-
24.
CEDH, 28 oct. 1999, nos 24846/94, 34165/96, 34173/96, Zielinski, Pradal, Gonzales et a. c/ France req. : RFDA 2000, p. 289, note Mathieu B.
-
25.
Cass. crim., 17 févr. 2004, n° 03-82149 : RSC 2004, p. 368, obs. Commaret D. N.
-
26.
CE, 29 janv. 2003, n° 247909, ville d’Annecy : AJDA 2003, p. 613, concl. Vallée.
-
27.
CE, 25 mai 2007, n° 288378, Dpt des Landes : AJDA 2008, p. 1036, note Dupré de boulois X.
-
28.
V. not. « Emprunts toxiques », dossier spécial Lamy collectivités territoriales oct. 2012 ; Lasserre-Capdeville J., « Crédits consentis aux collectivités territoriales : quelle action contre les banques ? », AJCT 2012, p. 73.
-
29.
Pour rappel l’article 92, I, al. 5, de la loi n° 2013-1278 du 29 déc. 2013 a subordonné le versement de l’aide prévue au titre de ce fonds, à la conclusion préalable d’une transaction entre l’emprunteur et l’établissement prêteur.
-
30.
Cass. com., 7 févr. 2018, n° 16-12808 : RTD com. 2018, p. 175, obs. Legeais D.