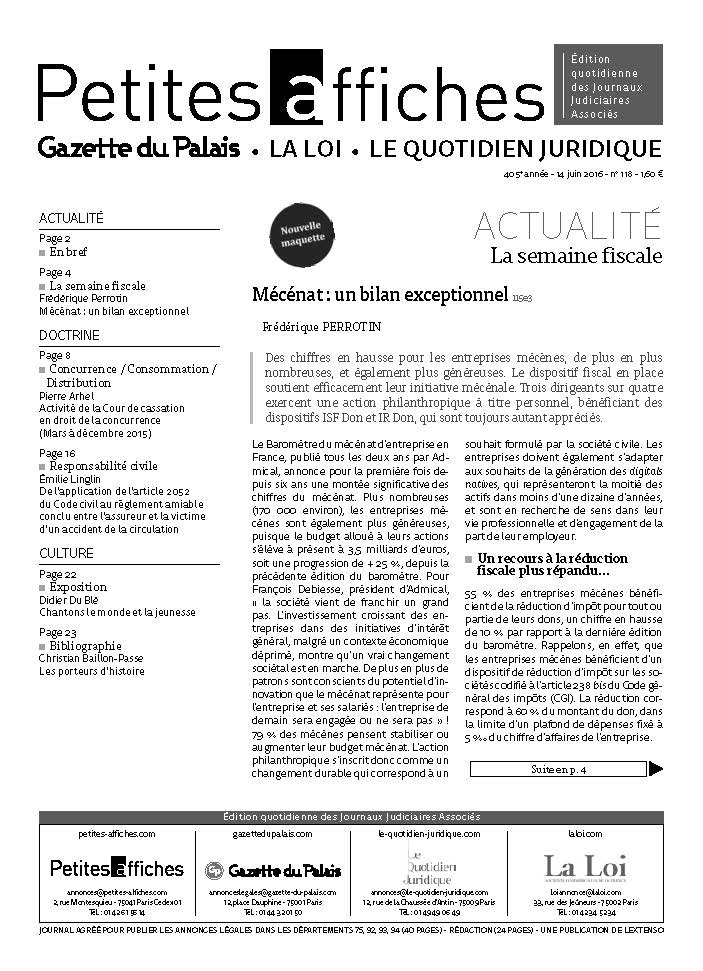Activité de la Cour de cassation en droit de la concurrence (Mars à décembre 2015)
La présente étude porte sur les arrêts rendus par la Cour de cassation en droit de la concurrence au sens du livre IV du Code de commerce. Plusieurs domaines sont théoriquement concernés. La haute juridiction judiciaire se prononce d’abord sur les arrêts que la cour d’appel de Paris rend lorsqu’elle est saisie d’un recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence (ancien Conseil de la concurrence) ; elle est également saisie des arrêts rendus par les cours d’appel en matière de « transparence », « pratiques restrictives de concurrence » et « autres pratiques prohibées », au sens du titre IV du livre IV du Code de commerce ; elle est aussi compétente en matière de visite et de saisies opérées sur le fondement de l’article L. 450-4 du Code de commerce ; enfin, elle se prononce sur les décisions rendues dans le cadre de litiges entre opérateurs économiques. L’étude porte sur la période de mars à décembre 2015.
I – Questions préjudicielles posées à la Cour de justice de l’Union sur l’application du droit de la concurrence au secteur agricole
On se souvient que, dans l’affaire du cartel des endives, l’Autorité de la concurrence avait condamné une série d’actions, mises en place par une dizaine d’organisations de producteurs et sept organisations représentatives de ce secteur, qui s’inscrivaient dans un plan global de fixation des prix de vente minima des endives : fixation collective de prix minimum, coordination dans le temps des offres promotionnelles, concertations portant sur les quantités d’endives mises sur le marché et échange illicite d’informations relatives aux prix.
Pour sa part, la cour d’appel de Paris était cependant parvenue à la conclusion qu’il n’était pas indiscutablement démontré que les organisations mises en cause sont sorties des limites des missions légales qui, dans le cadre général de la politique agricole commune, leur sont attribuées par la réglementation OCM (organisation commune des marchés) ainsi que par les dispositions du droit interne afin d’opérer une gestion adéquate de l’offre des légumes en cause, au moyen, tant d’une régularisation des prix que de la mise sur le marché des quantités d’endives.
Cette analyse de la cour d’appel n’est pas partagée par l’Autorité de la concurrence. Dans son pourvoi, celle-ci soutient qu’en dehors des trois dérogations prévues par les articles 2, paragraphe 1, des règlements n° 26 et n° 1184/2006 et 176, paragraphe 1, du règlement n° 1234/2007, les règles de concurrence s’appliquent à l’ensemble des accords, décisions et pratiques qui se rapportent à la production ou au commerce des produits agricoles et ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Selon l’Autorité, ces règlements ne prévoyant pas la non-application des règles de concurrence aux activités des OP (organisation professionnelles) ou des AOP (association d’organisations de producteurs), l’objectif de régularisation des prix à la production qui les anime et la possibilité qu’ils ont de mettre en place des prix de retrait s’entendent nécessairement comme des activités soumises au respect des dispositions de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Elle considère que le seul fait que les pratiques litigieuses pouvaient être rattachées aux missions dévolues à ces organisations, dans le cadre de l’organisation commune des marchés, n’est pas de nature à exclure leur caractère anticoncurrentiel.
L’Autorité bénéficie ici du soutien de la Commission qui, dans les observations qu’elle a formulées devant la Cour de cassation en application de l’article 15, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, a observé que, s’il doit être tenu compte des « dérogations spécifiques » à certaines interdictions des règles de concurrence, susceptibles de découler des dispositions relatives aux OP et AOP, contenues dans les différents règlements portant organisation commune des marchés, lesquelles « chargent ces organisations, actives dans le domaine de la production et la commercialisation des fruits et légumes, de certaines tâches particulières qui seraient normalement susceptibles de tomber sous les interdictions des règles de concurrence », et si par conséquent, certains comportements spécifiques, qui pourraient normalement être considérés comme étant anticoncurrentiels, peuvent relever de ces dérogations spécifiques pour échapper à l’interdiction, en revanche, les principaux comportements en cause dans la présente espèce se situent en dehors des tâches spécifiques prévues par l’organisation commune du marché et ne peuvent pas être considérés comme couverts par ces « dérogations spécifiques ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle d’abord que la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 36 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 42 TFUE, établit le principe de l’applicabilité des règles de concurrence communautaires dans le secteur agricole et que le maintien d’une concurrence effective sur les marchés des produits agricoles fait partie des objectifs de la politique agricole commune ; elle a également jugé que, même en ce qui concerne les règles du traité en matière de concurrence, l’article 36 CE accorde la primauté aux objectifs de la politique agricole commune sur ceux de la politique en matière de concurrence.
La chambre commerciale observe cependant que la Cour de justice ne semble pas avoir rendu de décision reconnaissant l’existence des « dérogations spécifiques » aux règles de concurrence dont fait état la Commission européenne, susceptibles de découler des tâches et missions attribuées aux OP et AOP dans le cadre des règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et précisant, le cas échéant, leur articulation avec celles, plus « générales », énoncées par les règlements portant application des règles de concurrence dans le secteur agricole ; elle ne s’est pas prononcée sur les contours des missions attribuées aux OP et AOP par les règlements (CE) nos 2200/96, 1182/2007 et 1234/2007, notamment, celle de régulariser les prix à la production, ni sur la question de savoir dans quelle mesure l’exercice de cette mission pourrait relever des « dérogations spécifiques » aux règles de concurrence.
Le litige pose dès lors une difficulté sérieuse quant à l’interprétation des règlements portant organisation commune des marchés, dans ce secteur, et l’étendue des dérogations « spécifiques » aux règles de concurrence qu’ils sont susceptibles de contenir dans leurs dispositions relatives aux OP et AOP, notamment au regard de l’objectif de régularisation des prix à la production assigné à ces organisations et la possibilité qu’ont ces organismes de mettre en place des prix de retrait.
La Cour de cassation décide en conséquence de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice les deux questions suivantes.
– Des accords, décisions ou pratiques d’organisations de producteurs, d’associations d’organisations de producteurs et d’organisations professionnelles, qui pourraient être qualifiés d’anticoncurrentiels au regard de l’article 101 TFUE, peuvent-ils échapper à la prohibition prévue par cet article du seul fait qu’ils pourraient être rattachés aux missions dévolues à ces organisations dans le cadre de l’organisation commune du marché et ce, alors même qu’ils ne relèveraient d’aucune des dérogations générales prévues successivement par l’article 2 des règlements (CEE) n° 26 du 4 avril 1962 et (CE) n° 1184/2006 du 24 juillet 2006 et par l’article 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 ?
– Dans l’affirmative, les articles 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/1996, 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1182/2007, et 122, alinéa 1er, du règlement (CE) n° 1234/2007, qui fixent, parmi les objectifs assignés aux organisations de producteurs et leurs associations, celui de régulariser les prix à la production et celui d’adapter la production à la demande, notamment en quantité, doivent-ils être interprétés en ce sens que des pratiques de fixation collective d’un prix minimum, de concertation sur les quantités mises sur le marché ou d’échange d’informations stratégiques, mises en œuvre par ces organisations ou leurs associations, échappent à la prohibition des ententes anticoncurrentielles, en tant qu’elles tendent à la réalisation de ces objectifs1 ?
II – Questions prioritaires de constitutionnalité
La chambre commerciale a été invitée à renvoyer au Conseil constitutionnel diverses questions prioritaires de constitutionnalité. Elle a refusé d’accéder à une telle demande dans l’affaire des « commodités chimiques » mais a renvoyé les questions posées dans l’affaire de la « télétransmission de données fiscales et comptables » et dans celle du « cartel des farines ».
A – Refus de renvoi de QPC (affaire des « commodités chimiques »)
La Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité posées dans le cadre de l’affaire des « commodités chimiques » et visant la procédure de clémence.
Rappelons que cette procédure permet aux entreprises ayant participé à une entente d’obtenir une réduction totale ou partielle de la sanction qu’elles encourent en coopérant avec l’Autorité.
Les questions des sociétés du groupe Brenntag portaient sur la conformité à la constitution des dispositions de l’article L. 464-2, I et IV du Code de commerce auxquelles il était reproché de ne pas préciser les conditions et critères d’octroi de l’exonération de sanction dont peut bénéficier la personne poursuivie ayant sollicité le bénéfice de la procédure de clémence, et de ne pas déterminer le taux de cette exonération, et à tout le moins les éléments objectifs et susceptibles de contrôle juridictionnel, à prendre en compte par l’Autorité de la concurrence pour déterminer ce taux.
Il était également reproché au texte de ne pas prévoir un contrôle juridictionnel des conditions dans lesquelles est mise en œuvre la procédure de clémence et consentie une réduction de sanctions par l’Autorité de la concurrence. En tout état de cause, il ne permettrait pas au juge du recours de procéder à une évaluation du caractère proportionné de la réduction accordée.
Selon la Cour, les questions posées ne présentent pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s’attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués, à savoir, entre autres, le principe de légalité des délits et des peines ainsi que celui de l’égalité devant la loi. En effet, en permettant à l’Autorité de la concurrence d’accorder une exonération totale ou partielle de sanctions pécuniaires aux entreprises ou organismes, ayant participé à une entente, qui en dénoncent l’existence et contribuent à l’établissement de l’infraction et à l’identification de ses auteurs, en apportant des éléments d’information dont l’Autorité ou l’Administration ne disposaient pas antérieurement, les dispositions contestées ont pour objectif, dans l’intérêt de l’ordre public économique, de faciliter la détection des ententes et de les faire cesser plus rapidement. Par ailleurs, ces dispositions définissent les conditions d’octroi de l’exonération et confient à l’Autorité de la concurrence, dans l’exercice de son pouvoir de sanction, l’appréciation, à l’issue d’une procédure contradictoire, et par une décision motivée soumise au contrôle du juge, de l’étendue de l’exonération à accorder au demandeur de clémence, sur la base de critères objectifs, liés à la nature et à l’importance de la contribution apportée par celui-ci à l’établissement de l’infraction et en considération des données individuelles propres à chaque entreprise ou organisme, conformément au principe d’individualisation de la peine.
La Cour estime également que les dispositions critiquées ne portent pas, en elles-mêmes, atteinte aux droits au respect de la vie privée et à la dignité2.
B – Renvoi de QPC
1 – Affaire de la « télétransmission de données fiscales et comptables »
À l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 février 2015, l’association Expert Comptable Médias Association a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant le pouvoir de sanction de l’Autorité de la concurrence et portant plus précisément sur le quatrième alinéa du paragraphe I de l’article L. 464-2 du Code de commerce. Estimant que la question posée présentait un caractère sérieux, la chambre commerciale3 a renvoyé la question au Conseil constitutionnel qui, dans sa décision du 7 janvier 20164, a déclaré conforme à la Constitution la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 464-2-I du Code de commerce qui dispose que « Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d’euros ».
La requérante faisait un double reproche à cette disposition : en prévoyant un maximum de la sanction pécuniaire en valeur absolue lorsque la personne qui a commis l’infraction n’est pas une entreprise, alors que ce maximum est fixé en pourcentage du chiffre d’affaires lorsque cette personne est une entreprise, elle créerait une différence de traitement injustifiée en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi. Par ailleurs, la définition insuffisante de l’entreprise au sens et pour l’application du texte porterait atteinte au principe de légalité des peines.
Le Conseil constitutionnel rejette d’abord le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité en observant que le législateur a entendu distinguer les personnes condamnées en fonction de la nature de leurs facultés contributives respectives, le critère permettant de distinguer les entreprises des autres opérateurs économiques étant la poursuite d’un but lucratif : « Considérant qu’au stade de la détermination du montant de la sanction pécuniaire infligée et pour son individualisation, le législateur a, en se référant à la notion d’entreprise, entendu distinguer les personnes condamnées en fonction de la nature de leurs facultés contributives respectives ; qu’il a ainsi fixé un montant maximum de la sanction pécuniaire proportionné au montant du chiffre d’affaires pour celles qui sont constituées selon l’un des statuts ou formes juridiques propres à la poursuite d’un but lucratif et fixé en valeur absolue le montant de ladite sanction pour les autres contrevenants ; que la différence de traitement résultant des dispositions contestées est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; que le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté » (considérant 7).
Il rejette également le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des peines en observant qu’en différenciant, pour fixer le montant maximum de la sanction, les contrevenants qui sont constitués sous l’un des statuts ou formes juridiques propres à la poursuite d’un but lucratif et les autres, le législateur s’est référé à des catégories juridiques précises permettant de déterminer la peine encourue avec une certitude suffisante (considérant 9).
2 – Affaire du « cartel des farines »
À l’occasion des pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 novembre 2014, rendu dans l’affaire du « cartel des farines », les sociétés Grands Moulins de Strasbourg et Axiane meunerie ont demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité concernant la saisine d’office et le pouvoir de sanction du Conseil de la concurrence et portant plus spécifiquement sur les dispositions de l’article L. 462-5 ancien du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la concurrence, et les dispositions de l’article L. 464-2 I du Code de commerce.
Estimant que les questions posées présentaient un caractère sérieux, la chambre commerciale5 les a renvoyées au Conseil constitutionnel qui, dans sa décision du 14 octobre 20156, a déclaré conforme à la Constitution les mots « se saisir d’office ou » figurant à l’article L. 462-5 du Code de commerce dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de commerce et les deuxième et troisième phrases du quatrième alinéa de l’article L. 464-2 du Code de commerce.
En ce qui concerne la question de la saisine d’office, le Conseil constitutionnel observe que « si, en vertu des dispositions de l’article L. 462-5 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence peut décider de se saisir d’office de certaines pratiques anticoncurrentielles, cette décision par laquelle le Conseil exerce sa mission de contrôle du bon fonctionnement des marchés n’a ni pour objet ni pour effet d’imputer une pratique à une entreprise déterminée ; que, dès lors, elle ne le conduit pas à préjuger la réalité des pratiques susceptibles de donner lieu au prononcé de sanctions ; que l’instruction de l’affaire est ensuite assurée sous la seule direction du rapporteur général dans les conditions et selon les garanties prévues par les articles L. 463-1 et L. 463-2 dudit code ; que le collège est, pour sa part, compétent pour se prononcer, selon les modalités prévues par l’article L. 463-7 du même code, sur les griefs notifiés par le rapporteur général et, le cas échéant, infliger des sanctions ; que, compte tenu de ces garanties légales, dont il appartient à la juridiction compétente de contrôler le respect, la décision du Conseil de la concurrence de se saisir d’office n’opère pas de confusion entre, d’une part, les fonctions de poursuite et d’instruction et, d’autre part, les pouvoirs de sanction » (considérant 7).
S’agissant du pouvoir de sanction du Conseil de la concurrence, la société Axiane Meunerie SAS soutenait qu’en fixant le plafond de la sanction pécuniaire par référence au chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par le groupe auquel appartient l’entreprise à laquelle la sanction est infligée, les dispositions des deuxième et troisième phrases du quatrième alinéa de l’article L. 464-2 retiennent des critères de fixation du maximum de la sanction encourue sans rapport avec l’objectif poursuivi par la répression des pratiques anticoncurrentielles ; il en résulterait une méconnaissance du principe de légalité des peines ainsi que des principes de nécessité et de proportionnalité des peines ; dans la mesure où ces dispositions permettent de prendre en considération le chiffre d’affaires consolidé d’un groupe alors même qu’il est étranger à l’infraction commise par l’entreprise, soit qu’aucune autre entreprise de ce groupe n’a contribué à l’infraction, soit que l’entreprise ayant commis l’infraction a intégré le groupe postérieurement à la commission de celle-ci, elles méconnaîtraient également les principes d’individualisation et de personnalité des peines.
Le Conseil constitutionnel observe à cet égard qu’en instituant une sanction pécuniaire destinée à réprimer les pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par des entreprises, le législateur a poursuivi l’objectif de préservation de l’ordre public économique ; qu’un tel objectif implique que le montant des sanctions fixées par la loi soit suffisamment dissuasif pour remplir la fonction de prévention des infractions assignée à la punition (considérant 14).
En prévoyant de réprimer les pratiques anticoncurrentielles d’une entreprise au moyen d’une sanction pécuniaire dont le montant maximum correspond à 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, le législateur n’a pas institué une peine manifestement disproportionnée au regard, d’une part, de la nature des agissements réprimés et, d’autre part, du fait qu’ils ont pu et peuvent encore, alors même qu’ils ont cessé, continuer de procurer des gains illicites à l’entreprise ; il en résulte que les dispositions de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 464-2 du Code de commerce ne méconnaissent pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines (considérant 15).
En outre, en prévoyant que le chiffre d’affaires pris en compte pour calculer le maximum de la sanction encourue est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante, le législateur a entendu prévenir des stratégies consistant à réduire, par des restructurations du capital des sociétés, le chiffre d’affaires des entreprises se livrant à des pratiques anticoncurrentielles afin de minorer le maximum de la sanction encourue dans l’hypothèse où ces pratiques seraient sanctionnées ; cette disposition vise en outre à prendre en compte la taille et les capacités financières de l’entreprise visée dans l’appréciation du montant maximal de la sanction ; eu égard à l’objectif ainsi poursuivi, les dispositions de la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 464-2 du Code de commerce ne méconnaissent pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines (considérant 16).
III – Légalité du communiqué « Sanctions » de l’Autorité de la concurrence
La Cour de cassation a confirmé en tous points l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 10 octobre 2013 dans l’affaire des aliments pour chiens et chats, arrêt par lequel les juges du fond avaient rejeté divers moyens qui contestaient la légalité du communiqué « Sanctions » de l’Autorité de la concurrence.
Elle conclut ainsi à l’absence de violation des principes de légalité des peines, de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et de sécurité juridique : « attendu qu’ayant relevé que le communiqué de l’Autorité de la concurrence du 16 mai 2011, relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, s’inscrit dans le cadre légal existant, qu’il ne modifie pas, et se borne à expliciter, à droit constant, la méthode suivie par l’Autorité pour mettre en œuvre les critères de proportionnalité et d’individualisation des sanctions fixées par l’article L. 464-2, I, du Code de commerce, et justement retenu que ce communiqué, qui n’institue pas un barème mécanique permettant d’anticiper le montant précis des sanctions et soumet son application à l’examen concret des circonstances propres à chaque cas d’espèce, ne permet pas de postuler qu’une aggravation des sanctions découle automatiquement de sa mise en œuvre, la cour d’appel, qui a fait ressortir que ce communiqué ne marquait pas une rupture brutale et imprévisible avec la pratique antérieure a retenu à bon droit que les moyens tirés de la violation des principes de légalité des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère n’étaient pas fondés et que les parties ne pouvaient pas davantage invoquer une atteinte au principe de sécurité juridique ».
C’est également à bon droit que la cour d’appel a écarté les violations alléguées des principes de confiance légitime et de loyauté et des droits de la défense : « attendu qu’après avoir relevé que le communiqué de 2011 se borne à préciser, dans un souci de transparence, les modalités concrètes selon lesquelles l’Autorité fait usage du pouvoir d’appréciation qui lui a été confié par la loi et qu’il repose sur une méthode exclusivement fondée sur les éléments énoncés par le Code de commerce, dont il ne fait qu’expliciter la mise en œuvre, et justement retenu que les parties qui ont été mises en mesure de formuler des observations sur les éléments susceptibles d’influer sur la détermination de la sanction comme sur l’application de ce communiqué, ne peuvent se prévaloir de la pratique décisionnelle antérieure de l’Autorité pour contester le quantum de la sanction qui leur est appliquée, a écarté à bon droit et sans méconnaître le droit à un procès équitable, les violations alléguées des principes de confiance légitime et de loyauté ainsi que des droits de la défense ».
Est également validée l’application d’un coefficient multiplicateur au titre de la durée des pratiques : « attendu qu’ayant relevé, s’agissant de l’application d’un coefficient multiplicateur au titre de la durée des pratiques que le communiqué se borne à décrire la méthode suivie par l’Autorité, à droit constant, et à expliciter les critères fixés par le code et retenu à bon droit que le troisième alinéa de l’article L. 464-2, I, du Code de commerce, qui prévoit que les sanctions sont proportionnées à la gravité des faits et à l’importance du dommage qu’ils ont causé à l’économie, ne fait pas obstacle à ce que la durée des pratiques, facteur pertinent pour apprécier ces deux éléments, soit prise en considération à ce double titre, la cour d’appel a légalement justifié sa décision »7.
IV – Procédure d’engagement
On se souvient que l’opérateur de télécommunications américain Cogent avait saisi l’Autorité de la concurrence, reprochant à France Télécom de remettre en cause le système de « peering » (échange gratuit des flux entre deux réseaux internet) existant entre opérateurs de transit, en demandant à être rémunérée pour l’ouverture de capacités techniques supplémentaires d’accès aux abonnés d’Orange.
La question soumise à l’Autorité était de savoir si les opérateurs de réseau sont en droit de facturer l’ouverture de capacités complémentaires. Pour elle, compte tenu du caractère très asymétrique des échanges de trafic entre France Télécom et Cogent, cette demande de facturation ne constituait pas en l’état une pratique anticoncurrentielle.
En revanche, l’Autorité avait observé qu’en l’absence d’une facturation interne formalisée entre Orange et Open transit (l’opérateur de transit du Groupe France Télécom) pour l’accès aux abonnés d’Orange, il ne pouvait être exclu, compte tenu notamment du prix de gros exigé par France Télécom pour acheminer les contenus jusqu’à ses abonnés Orange, que Cogent ne dispose pas de l’espace économique suffisant pour proposer à des fournisseurs de contenu une offre compétitive (effet de ciseau tarifaire).
Pour éviter cet effet de ciseau potentiel, France Télécom a pris un certain nombre d’engagements qui ont été acceptés par l’Autorité.
Non satisfaite de cette solution, Cogent a, devant la cour d’appel de Paris, invoqué une violation des articles L. 462-8 et L. 464-6 du Code de commerce en faisant valoir que la décision de l’Autorité constitue une décision « mixte » « en ce sens qu’elle ne se contente pas d’accepter un engagement, mais prononce un non-lieu à poursuivre la procédure en ce qui concerne certaines des pratiques dénoncées par Cogent et déclare expressément les autres pratiques dénoncées comme insusceptibles de caractériser un abus de position dominante ».
La cour d’appel de Paris avait rejeté le recours de Cogent. Le pourvoi en cassation n’a pas eu plus de succès : « Mais attendu qu’après avoir énoncé que l’ADLC, qui a pour mission de garantir le bon fonctionnement de la concurrence sur les marchés et de défendre l’ordre public économique, est habilitée à rendre des décisions pour remédier aux situations susceptibles d’être préjudiciables à la concurrence qu’elle identifie au terme d’une instruction allégée, et que l’évaluation préliminaire à laquelle se livre le rapporteur à cette fin n’a pas pour objet de prouver ou d’écarter la réalité et l’imputabilité d’infractions au droit de la concurrence en vue de les sanctionner, l’arrêt examine, à l’instar de l’ADLC, chacune des pratiques dénoncées dans l’acte de saisine, les motifs pour lesquels six d’entre elles n’apparaissent pas susceptibles de recevoir de qualification et ceux qui ont conduit l’ADLC à limiter les préoccupations de concurrence à d’éventuelles pratiques de ciseau tarifaire ; qu’en cet état, la cour d’appel, ayant fait ressortir que l’ADLC avait, au terme d’une procédure autonome, épuisé sa saisine, a, sans méconnaître les exigences des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 5 du règlement (CE) n° 1/2003, justement retenu que la décision critiquée n’était pas constitutive d’un non-lieu partiel et ne s’inscrivait pas dans le champ d’application des articles L. 462-8 et L. 464-6 du Code de commerce ; que le moyen n’est pas fondé »8.
V – Accès aux communications échangées avec la Commission
Dans l’affaire des prestations payantes d’interconnexion internet (v. aussi supra), la cour d’appel de Paris avait rejeté un moyen de la plaignante Cogent qui reprochait à l’Autorité de ne pas lui avoir donné accès aux communications et aux correspondances intervenues avec la Commission. Les juges du fond soulignaient à cet égard que si les droits de la défense des parties concernées doivent être pleinement assurés dans le déroulement de la procédure d’engagements, aucune disposition du Code de commerce ou du règlement 1/2003 ne prévoit que le droit des parties d’accès au dossier de l’Autorité s’étend aux documents internes de la Commission ou des autorités de concurrence des États membres et, en particulier, à la correspondance qui a pu être échangée entre la Commission et les autorités nationales de concurrence ou entre ces dernières en application de l’article 11 dudit règlement.
Cette solution est approuvée par la Cour de cassation : « Mais attendu qu’ayant relevé que les sociétés Cogent avaient été mises en mesure de consulter le dossier avant la séance du collège de l’ADLC et que les échanges institutionnels entre cette dernière et la Commission européenne, relevant de documents internes, n’avaient pas été utilisés par les services d’instruction ni opposés aux parties concernées par l’affaire, la cour d’appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à d’autre recherche, que le défaut de communication de tels échanges ne portait pas atteinte aux intérêts des sociétés Cogent ; que le moyen n’est pas fondé »9.
VI – Droit d’être entendu par les intervenants volontaires devant la cour d’appel de Paris
La Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, dans l’affaire du crédit interbancaire. Elle a remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
On se souvient que le Conseil de la concurrence s’était saisi d’office de la situation de la concurrence concernant les tarifs et les conditions liées appliqués par les banques et les établissements financiers pour le traitement des chèques remis aux fins d’encaissement. Par décision du 20 septembre 2010, l’Autorité a jugé que les banques avaient enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du Code de commerce et celles de l’article 81 du traité CE, devenu l’article 101 § 1 TFUE, leur a infligé des sanctions pécuniaires et a prononcé des injonctions. Les banques ont formé un recours contre cette décision et les associations UFC-Que Choisir et ADUMPE sont intervenues volontairement à l’instance devant la cour d’appel.
Cependant, après avoir jugé que l’Autorité de la concurrence n’avait établi ni un objet ni des effets anticoncurrentiels et réformé en conséquence la décision attaquée en toutes ses dispositions, la cour d’appel a retenu qu’il suffisait de constater que, par suite de la réformation de la décision de l’Autorité découlant de la mise hors de cause des banques, les interventions des associations UFC-Que Choisir et ADUMPE étaient sans objet.
Pour la haute juridiction judiciaire, en statuant ainsi, sans examiner les moyens des parties intervenantes, la cour d’appel, qui les a privées du droit d’être effectivement entendues, a violé les articles 6 paragraphe 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et 554 du Code de procédure civile10.
VII – Action en réparation
Un nouvel épisode judiciaire vient de s’ajouter à l’affaire JCB. On se souvient que, se plaignant du refus de vente opposé par des concessionnaires britanniques et irlandais de la société de droit anglais JCB Service, qui commercialise des engins et équipements de chantiers, la société française Central Parts, non agréée en France pour la distribution de ces produits, a saisi, en février 1996, la Commission de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par cette société. Par décision du 21 décembre 2000, la Commission a dit que la société JCB Service et ses filiales avaient enfreint les dispositions de l’article 81 du traité CE, en concluant avec des concessionnaires des accords ou des pratiques concertées dont l’objet était de restreindre la concurrence à l’intérieur du marché commun afin de cloisonner les marchés nationaux et d’assurer une protection absolue sur des territoires exclusifs en dehors desquels les concessionnaires étaient empêchés de réaliser des ventes actives, et qui avaient notamment consisté en des restrictions des ventes passives des concessionnaires établis au Royaume-Uni, en Irlande, en France et en Italie, qui comprenaient les ventes aux revendeurs non agréés, aux utilisateurs finals ou aux concessionnaires établis en dehors des territoires exclusifs, et notamment dans d’autres États membres. En conséquence, la Commission a infligé une sanction pécuniaire à la société JCB Service et lui a enjoint de cesser ces pratiques. Cette décision a été confirmée sur ce point par un arrêt du Tribunal de première instance du 13 janvier 2004 et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de justice le 21 septembre 2006. À la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal, la société Central Parts a assigné les sociétés JCB Service, JCB Sales Ltd, JCB Finance Ltd et JC Bramford Excavators Ltd en paiement de dommages-intérêts.
La cour d’appel de Paris, saisie sur renvoi après cassation, s’est appuyée sur les dispositions de l’article 16 du règlement CE n° 1/2003 en énonçant que les infractions en cause constituent des fautes civiles en droit français. Elle a également considéré que les pratiques anticoncurrentielles qui ont eu pour effet d’empêcher le jeu de la concurrence ont nécessairement causé un trouble commercial à Central Parts, et que celle-ci a pu devoir engager des frais pour se fournir en produits JCB en raison des difficultés qu’elle rencontrait et souffrir un manque à gagner. En revanche, ne s’estimant pas en mesure de chiffrer le préjudice, la cour d’appel a ordonné une expertise.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi qui est rejeté dans son ensemble. La Cour de cassation écarte notamment un moyen qui reprochait à la cour d’appel d’avoir retenu la responsabilité des sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators alors qu’elles n’avaient pas été condamnées par la Commission, seule la société JCB Service l’ayant été.
Pour la chambre commerciale, « ayant relevé que les juridictions communautaires avaient confirmé la décision de la Commission du 21 décembre 2000 dont le dispositif énonçait, dans son article 1, que la société JCB Service et ses filiales avaient enfreint les dispositions de l’article 81 du traité CE, et retenu que les sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators étaient les sociétés d’exploitation principales visées en tant que filiales de JCB Service par les décisions communautaires, c’est sans méconnaître le droit au procès équitable, le principe de la primauté du droit communautaire et l’effet relatif qui s’attache à l’autorité de la chose jugée par les juridictions communautaires que la cour d’appel a retenu que le fait qu’elles ne soient pas condamnées par les décisions communautaires n’interdit pas à la juridiction nationale d’apprécier, au regard des éléments qui lui sont soumis, notamment des décisions communautaires, les éléments de leur comportement constitutifs d’une faute ».
Les requérantes reprochaient également à la cour d’appel d’avoir ordonné avant dire droit une expertise sur l’étendue du préjudice de la société Central Parts, mais le moyen est également écarté : « Mais attendu qu’après avoir identifié les fautes respectives des sociétés JCB Service, JCB Sales et JC Bramford Excavators, l’arrêt relève qu’il n’est pas contesté que la société Central Parts, revendeur non agréé établi en France, s’est vu refuser tout approvisionnement en machines et pièces détachées par les distributeurs agréés anglais et irlandais en produits JCB ; qu’il retient que les pratiques anticoncurrentielles dénoncées par la société Central Parts ont eu pour effet d’empêcher le jeu de la concurrence et ont nécessairement causé un trouble commercial à celle-ci qui, en raison des difficultés qu’elle rencontrait, a dû engager des frais pour se fournir en produits JCB et a souffert d’un manque à gagner ; qu’avant dire droit sur la réparation du préjudice, il ordonne une expertise aux fins de préciser le surcoût occasionné par la mise en place de circuits d’approvisionnement parallèles et par la création de sociétés ad hoc sur le territoire du Royaume-Uni, le surcoût engendré par le besoin en main-d’œuvre pour gérer les difficultés d’approvisionnement de la société Central parts en produits JCB tout en recherchant si ce surcoût a pu ou non être répercuté sur les clients, ainsi que la perte du chiffre d’affaires et de marge sur les produits dont la fourniture a été interdite ; qu’ainsi la cour d’appel, qui a fait ressortir le lien de causalité entre le dommage invoqué et les fautes commises par les sociétés JCB Service, JCB Sales et JC Bramford Excavators ayant concouru à sa réalisation, et qui n’était pas tenue de rechercher, à ce stade de son raisonnement, quelle était la part de ce préjudice pouvant être imputée à leurs manquements respectifs, a légalement justifié sa décision »11.
VIII – Action du ministre à l’encontre d’une pratique créant un déséquilibre significatif
Saisi d’un litige dans lequel le ministre chargé de l’Économie reprochait à la société Eurochan, centrale d’achats des magasins à l’enseigne Auchan, une pratique créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, la chambre commerciale a précisé la jurisprudence tant sur la recevabilité de l’action du ministre que sur le fond.
Sur le premier point, la Cour a précisé le champ de l’obligation du ministre d’informer les parties lorsqu’il exerce l’action en responsabilité sur le fondement de l’article L. 442-6, III du Code de commerce12 en énonçant qu’il résulte de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011 que c’est seulement lorsque l’action engagée par l’autorité publique tend à la nullité des conventions illicites, à la restitution des sommes indûment perçues et à la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés que les parties au contrat doivent en être informées. Or, en l’espèce, le ministre avait renoncé en cours d’instance à poursuivre l’annulation des clauses litigieuses. C’est donc, selon la Cour, à bon droit que la cour d’appel de Paris a retenu que son action, qui ne tendait plus qu’à la cessation des pratiques et au prononcé d’une amende civile, était recevable.
S’agissant du fond, la Cour a précisé que le déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I 2° du Code de commerce13 s’apprécie globalement sur l’ensemble d’un contrat et ne se limite pas à la seule clause en litige. Un fournisseur poursuivi pour avoir recouru à une pratique ayant créé un déséquilibre significatif peut par exemple se défendre en démontrant que d’autres clauses du contrat, issues de la négociation, compensent le déséquilibre significatif en cause14.
Notes de bas de pages
-
1.
Cass. com., 8 déc. 2015, n° 14-19589.
-
2.
Cass. com., 4 mars 2015, n° 14-40052.
-
3.
Cass. com., 6 oct. 2015, n° 15-15005.
-
4.
Cons. const., 7 janv. 2016, n° 2015-510 QPC.
-
5.
Cass. com., 14 oct. 2015, nos 14-29354 et 14-29542.
-
6.
Cons. const., 14 oct. 2015, n° 2015-489 QPC.
-
7.
Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-26003.
-
8.
Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-10792.
-
9.
Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-10792.
-
10.
Cass. com., 14 avr. 2015, n° 12-15971.
-
11.
Cass. com., 6 oct. 2015, n° 13-24854.
-
12.
C. com., art. L. 442-6, III : « L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article ».
-
13.
C. com., art. L. 442-6, I, 2° « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (…) de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
-
14.
Cass. com., 3 mars 2015, n° 13-27525 – v. aussi Cass. com., 3 mars 2015, n° 14-10907.