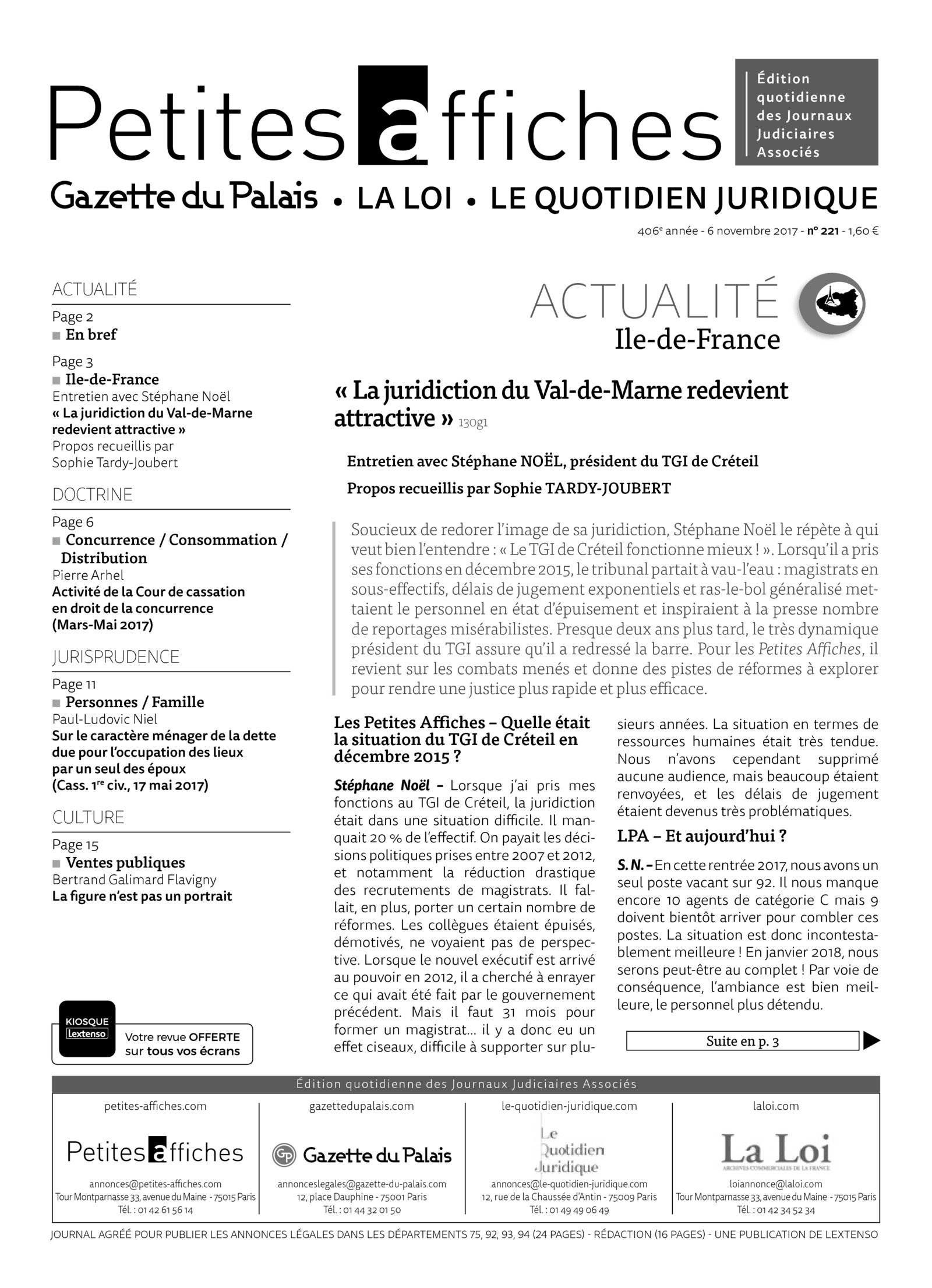Activité de la Cour de cassation en droit de la concurrence (Mars-Mai 2017)
La présente étude porte sur les arrêts rendus par la Cour de cassation en droit de la concurrence au sens du livre IV du Code de commerce. Plusieurs domaines sont théoriquement concernés. La Cour de cassation se prononce d’abord sur les arrêts que la cour d’appel de Paris rend lorsqu’elle est saisie d’un recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence ; elle est également saisie des arrêts rendus par les cours d’appel en matière de « transparence », « pratiques restrictives de concurrence » et « autres pratiques prohibées », au sens du titre IV du livre IV du Code de commerce ; elle est aussi compétente en matière de visite et de saisies opérées sur le fondement de l’article L. 450-4 du Code de commerce ; enfin, elle se prononce sur les décisions rendues dans le cadre de litiges entre opérateurs économiques. Les points suivants ont plus particulièrement retenu l’attention : compétence exclusive pour connaître des litiges en matière de pratiques restrictives de concurrence (I) ; compétence pour connaître des litiges en matière de rupture brutale de relations commerciales établies (II) ; demandes de renseignements formulées dans le cadre d’enquêtes simples (III) ; validation de saisies informatiques globales (IV) ; justification des opérations de visite et de saisies (V) ; étendue du droit à l’assistance d’un avocat lors des OVS (VI) ; pratiques d’éviction dans le secteur de la presse d’information sportive (VII) ; refus de communication des conditions générales de vente (VIII).
I – Compétence exclusive pour connaître des litiges en matière de pratiques restrictives de concurrence
La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence à propos de la compétence exclusive pour connaître des litiges en matière de pratiques restrictives de concurrence.
On sait qu’en application de l’article L. 442-6, III, du Code de commerce, les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du même code sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret et que l’article D. 442-3 du Code de commerce, issu du décret du 11 novembre 2009, fixe la liste des juridictions de première instance appelées à connaître de ces litiges et désigne la cour d’appel de Paris pour connaître des décisions rendues par ces juridictions.
Traditionnellement, la chambre commerciale jugeait que, la cour d’appel de Paris étant seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6, la méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel exclusif était sanctionnée par une fin de non-recevoir, de sorte qu’était irrecevable l’appel formé devant une autre cour d’appel1, et que cette fin de non-recevoir devait être relevée d’office2. Cette règle a été appliquée à toutes les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’article L. 442-6, même lorsqu’elles émanaient de juridictions non spécialement désignées.
Cette dernière solution était source, pour les parties, d’insécurité juridique quant à la détermination de la cour d’appel pouvant connaître de leur recours, eu égard aux termes mêmes de l’article D. 442-3. Elle conduisait en outre au maintien de décisions rendues par des juridictions non spécialisées, les recours formés devant les autres cours d’appel que celle de Paris étant déclarés irrecevables, en l’état de cette jurisprudence.
Il est donc apparu nécessaire, pour la chambre commerciale, d’amender cette jurisprudence, tout en préservant l’objectif du législateur de confier l’examen des litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 à des juridictions spécialisées. Pour y parvenir, elle retient qu’en application des articles L. 442-6, III et D. 442-3, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la cour d’appel de Paris, de sorte qu’il appartient aux autres cours d’appel, conformément à l’article R. 311-3 du Code de l’organisation judiciaire, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le second texte. Il en est ainsi même dans l’hypothèse où celles-ci auront, à tort, statué sur l’application du premier, auquel cas elles devront relever, d’office, l’excès de pouvoir commis par ces juridictions en statuant sur des demandes qui, en ce qu’elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables3.
II – Compétence pour connaître des litiges en matière de rupture brutale de relations commerciales établies
Par un arrêt rendu le 1er mars 2017, la chambre commerciale se prononce sur l’application d’une clause compromissoire et d’une clause attributive de juridiction dans un litige portant sur la rupture brutale de relations commerciales établies au sens de l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce.
À l’origine du litige, une société de maîtrise d’œuvre (CMO) a, en 2005, conclu avec la société Lavalin, un contrat comportant une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Créteil. En 2011 et 2012, CMO a conclu avec une autre société du même groupe (Lavalin International) cinq contrats comportant une clause compromissoire. En 2014, Lavalin International ayant résilié ces contrats, CMO a assigné le groupe devant le tribunal de commerce de Paris pour rupture brutale d’une relation commerciale établie. La société Lavalin International a soulevé l’incompétence de la juridiction sur le fondement de la clause compromissoire, tandis que la société Lavalin a soulevé une exception d’incompétence territoriale en se prévalant de la clause attributive de juridiction.
La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi introduit par CMO, tranche les questions de compétence en rejetant d’abord le premier moyen qui contestait l’application de la clause compromissoire : « selon le principe compétence-compétence, il appartient à l’arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage ; (…) ayant constaté que les contrats de 2011 et 2012 comportaient une clause d’arbitrage et justement énoncé que l’arbitrage n’était pas exclu du seul fait que les dispositions impératives de l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce étaient applicables, la cour d’appel, qui a retenu que la clause compromissoire n’était pas manifestement inapplicable, a statué à bon droit en déclarant le tribunal de commerce de Paris incompétent ».
En revanche, elle fait droit au deuxième moyen en énonçant que les dispositions de l’article L. 442-6 du Code de commerce, attribuant le pouvoir juridictionnel, pour les litiges relatifs à son application, aux juridictions désignées par l’article D. 442-3 du Code de commerce ne peuvent être mises en échec par une clause attributive de juridiction. Pour elle, en déclarant le tribunal de commerce de Paris incompétent alors que cette juridiction était désignée par l’article D. 442-3 pour statuer sur l’application de l’article L. 442-6, I, 5° pour le ressort de la cour d’appel de Paris, l’arrêt d’appel a violé les dispositions des textes susvisés4.
III – Demandes de renseignements formulées dans le cadre d’enquêtes simples
La Cour de cassation s’est, dans deux arrêts rédigés dans des termes identiques, penchée sur la question du recours dont disposent les entreprises destinataires d’une demande de renseignements opérée sur le fondement de l’article L. 430-3 du Code de commerce relatif aux enquêtes dites « simples ».
En l’espèce, la société Brenntag, mise en cause dans l’affaire des commodités chimiques, a saisi la cour d’appel de Paris d’un recours pour excès de pouvoirs contre la demande de renseignements que lui avaient adressée les rapporteurs de l’Autorité de la concurrence, mais le recours a été rejeté pour irrecevabilité.
Un pourvoi a alors été formé. À cette occasion, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation, a relevé que le quatrième alinéa de l’article L. 450-35 ne méconnaît pas le droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant la juridiction garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789 dès lors que ces dispositions ne confèrent aux agents habilités ni un pouvoir d’exécution forcée pour obtenir la remise de ces documents, ni un pouvoir général d’audition ou un pouvoir de perquisition dès lors que seuls les documents volontairement communiqués peuvent être saisis6.
L’affaire est ensuite revenue devant la Cour de cassation qui, s’inspirant de la décision du Conseil constitutionnel rejette le pourvoi. Répondant d’abord aux premier, troisième, sixième et septième moyens, elle approuve l’analyse de la cour d’appel de Paris qui avait relevé que les demandes du rapporteur ne sont pas assimilables à des actes intrusifs telle une inspection accomplie dans les locaux de l’entreprise. La cour d’appel avait ajouté qu’un délai avait été accordé à l’entreprise pour lui permettre de réunir et d’analyser la portée des éléments qu’elle entendait transmettre, ou qu’elle souhaitait ne pas communiquer si elle les estimait de nature à porter atteinte à ses droits, et de s’en expliquer afin de se prémunir contre tout reproche d’obstruction à l’enquête. Enfin, la cour d’appel avait estimé que la validité de ce type de demande et sa conformité au droit de l’Union peuvent être contestées, tant dans le cadre du recours au fond éventuellement exercé contre une décision de sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence qu’à l’occasion d’une procédure en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi de ce fait.
Pour la Cour de cassation, en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l’acte en cause ne constituait pas un acte contraignant faisant grief à l’entreprise, susceptible de porter atteinte au respect de son domicile et de sa correspondance, et qu’il pouvait faire l’objet d’autres recours assurant une protection juridictionnelle suffisante, la cour d’appel a fait une juste application des articles 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en déclarant le recours irrecevable.
Écartant ensuite le quatrième moyen qui faisait valoir que l’effectivité du recours dirigé contre l’acte par lequel l’Autorité de la concurrence contraint une entreprise, sous peine de sanctions, à fournir des renseignements, commande qu’il soit indépendant du recours éventuellement dirigé contre une décision postérieure, la haute juridiction reprend mot pour mot le libellé de la décision du Conseil constitutionnel : « Mais attendu que si les dispositions de l’article L. 450-3 du Code de commerce imposent de remettre aux agents habilités les documents dont ces derniers sollicitent la communication, elles ne leur confèrent ni un pouvoir d’exécution forcée pour obtenir la remise de ces documents, ni un pouvoir général d’audition ou un pouvoir de perquisition, de sorte que seuls les documents volontairement communiqués peuvent être saisis ; que la circonstance que le refus de communication des informations ou documents demandés puisse être à l’origine, dans un deuxième temps, d’une injonction sous astreinte, d’une amende administrative prononcée par une décision de l’ADLC, ou d’une sanction pénale, ne confère pas une portée différente aux pouvoirs dévolus aux agents habilités par ces dispositions ».
Par un cinquième moyen, la société Brenntag faisait encore valoir que le principe de protection juridictionnelle effective des droits conférés aux justiciables par le droit de l’Union européenne requiert, dans l’ordre juridique d’un État membre, la possibilité d’obtenir que des mesures provisoires soient octroyées pour suspendre l’application de dispositions nationales jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur leur conformité avec le droit de l’Union européenne. La Cour de cassation rejette également le moyen en énonçant que le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par la société Brenntag n’ayant pas eu pour objet d’obtenir des mesures provisoires permettant de suspendre l’application des dispositions nationales en cause jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur leur conformité avec le droit de l’Union européenne et la cour d’appel ayant retenu que les demandes d’informations en cause n’étaient pas de nature à causer une atteinte irréversible aux droits de la société Brenntag, le moyen est sans portée7.
IV – Validation de saisies informatiques globales
Saisie d’un pourvoi qui contestait le déroulement d’opérations de visites et saisies, et qui, en particulier reprochait à l’Autorité de la concurrence d’avoir saisi des documents n’entrant pas dans le champ de l’autorisation qui lui a été accordée, la chambre criminelle a, une nouvelle fois, validé la pratique de saisie globale de fichiers informatiques : « Le premier président, qui a souverainement constaté que les pièces appréhendées entraient dans le secteur d’activité visé et que les messages électroniques stockés dans un fichier unique avaient dû être saisis globalement pour en respecter l’origine, l’authenticité et l’intégrité, en raison de contraintes techniques qu’il n’était pas tenu de détailler, et s’est assuré, au vu des procès-verbaux et inventaires versés au dossier, que copie des documents et supports informatiques saisis avait été remise aux occupants des lieux concomitamment aux opérations, a justifié sa décision »8.
V – Justification des opérations de visite et de saisies
Saisie d’un pourvoi formé par l’Autorité de la concurrence, la chambre criminelle rappelle que pour autoriser des opérations de visite et de saisies visant à établir la réalité de pratiques anticoncurrentielles, il suffit de s’assurer de l’existence de présomptions sans que le juge des libertés et de la détention puisse exiger la production de preuves de ces pratiques.
En l’espèce, pour infirmer l’ordonnance du JLD ayant autorisé des opérations de visite et saisie aux fins de rechercher l’existence de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de distribution des produits « blancs » et « bruns », le premier président de la cour d’appel de Paris a énoncé qu’il devait vérifier si la société en cause avait participé à la mise en place du système dénoncé et/ou à une entente avec les fabricants.
Ce faisant, selon la haute juridiction, le premier président a méconnu l’article L. 450-4 du Code de commerce et le principe selon lequel les opérations de visite et saisie sont justifiées dès lors qu’il existe des présomptions de pratiques anticoncurrentielles9.
VI – Étendue du droit à l’assistance d’un avocat lors des OVS
Un arrêt rendu le 4 mai 2017 par la chambre criminelle dans l’affaire de la distribution de produits « blancs » et « bruns » précise le principe selon lequel l’entreprise faisant l’objet d’une opération de visite et de saisies doit pouvoir être assistée d’un avocat dès la notification de la décision autorisant l’opération.
En l’espèce, les enquêteurs de l’Autorité de la concurrence se sont présentés dans les locaux de la société Samsung Electronics France pour y effectuer des OVS dans le but de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles en indiquant à l’occupant des lieux qu’aucune communication avec l’extérieur n’était possible, y compris auprès des avocats, tant que l’ensemble des bureaux ne serait pas scellé. L’objet de cette étape des opérations était d’éviter toute déperdition des preuves.
Le premier président de la cour d’appel de Paris a approuvé cette exigence des enquêteurs en observant que la sécurisation des lieux n’a pris que quelques dizaines de minutes pendant lesquelles les enquêteurs n’ont effectué aucun acte et que, dès lors, l’inobservation des formalités en matière de visite domiciliaire n’a causé aucun grief.
Pour les hauts magistrats, en statuant ainsi, c’est-à-dire en limitant les droits des entreprises à être assistées d’un avocat dès la notification de l’ordonnance autorisant les OVS, le premier président a méconnu le principe résultant de l’article L. 450-4 du Code de commerce selon lequel « dans les procédures fondées sur la violation du droit de la concurrence, les droits de la défense peuvent être exercés par l’occupant des lieux dès la notification de l’ordonnance autorisant les opérations de visite et saisie ».
La cassation est encourue sans renvoi, le Cour de cassation estimant être en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige10.
VII – Pratiques d’éviction dans le secteur de la presse d’information sportive
La Cour de cassation confirme l’analyse de la cour d’appel de Paris dans l’affaire des pratiques d’éviction dans le secteur de la presse d’information sportive.
On se souvient que deux semaines après l’annonce du lancement du 10Sport.com, un quotidien sportif en couleurs de 24 pages à dominante footballistique, Éditions Philippe Amaury (EPA) a annoncé à son tour le lancement imminent d’un nouveau quotidien sportif, Aujourd’hui Sport, dont le positionnement (format, prix, ligne éditoriale, lectorat) était strictement identique à celui de 10Sport.com. Peu après, EPA a fait connaître que le lancement était programmé pour le même jour que celui du 10Sport.com.
Pour l’Autorité de la concurrence, ce faisant, EPA, qui occupait, grâce au journal L’Équipe, une situation de position dominante, et même de monopole, sur le marché du lectorat de la presse quotidienne nationale d’information sportive, a riposté à l’entrée sur le marché du 10Sport.com en lançant un quotidien à bas prix et à vocation éphémère dans le seul but d’empêcher l’arrivée du nouvel entrant et de protéger la place occupée par L’Équipe, stratégie d’éviction constitutive d’un abus de position dominante au sens de l’article L. 420-2 du Code de commerce et de l’article 102 TFUE11.
Cette analyse a été approuvée par la cour d’appel de Paris qui a d’abord rappelé que l’occupation d’une position dominante impose à l’entreprise concernée l’obligation particulière de ne pas porter atteinte, par son comportement, à une concurrence effective et non faussée sur le marché intérieur. Elle a ensuite relevé que, dès l’annonce du lancement du quotidien Le 10Sport.com, les sociétés du groupe Amaury ont eu pour objectif d’évincer ce concurrent du marché et qu’elles ont, à cette fin, envisagé trois solutions de riposte. La première consistant à ne pas réagir, la deuxième, à lancer un nouveau quotidien et la troisième, à améliorer le journal L’Équipe. Et de constater qu’ayant procédé à des estimations chiffrées de l’impact financier de chacune de ces options, la société EPA a opté pour la deuxième solution. Pour les magistrats parisiens, ce choix n’était pas rationnel d’un point de vue économique car il s’agissait de l’option la plus coûteuse, impliquant un sacrifice financier significatif par rapport aux autres stratégies envisagées. Ils ont encore retenu que le lancement d’un nouveau titre était, selon les anticipations chiffrées du groupe Amaury, l’opération la plus coûteuse pour l’entrant également en termes de lectorat. La cour d’appel a ajouté qu’en décidant de lancer un quotidien ne se démarquant pas du journal Le 10Sport.com, quant à son contenu, son prix et son format, et ce, le jour même du démarrage de celui-ci, le groupe Amaury a cherché à avoir un impact maximal sur le tirage et le résultat financier de ce journal et à entraver son développement, dès son arrivée sur le marché. Enfin, elle a retenu que le quotidien Aujourd’hui Sport présentait, dès l’origine, une vocation éphémère, son lancement ayant pour unique objet de contrer l’arrivée d’un concurrent sur le marché d’information sportive, dans un projet à court terme, sans se préoccuper de la rentabilité du quotidien et tout en se réservant la possibilité de se retirer du marché en cas de réussite de l’objectif ainsi poursuivi12.
Pour la Cour de cassation, de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la société EPA avait mis en œuvre une pratique qui ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une concurrence par les mérites et qui excédait ce qu’autorise le droit de riposte d’une entreprise en position dominante et qu’elle avait ainsi abusé de cette position13.
VIII – Refus de communication des conditions générales de vente
La Cour de cassation précise les conditions d’application de l’article L. 442-6, I, 9°, du Code de commerce qui dispose qu’engage la responsabilité de son auteur le fait « de ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l’article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l’exercice d’une activité professionnelle ».
Rappelons pour mémoire que cette disposition résulte de la dépénalisation du refus de communication des CGV opérée par l’article 8 de la loi du 3 janvier 2008 qui a fait basculer ce comportement de l’article L. 441-6 du Code de commerce à l’article L. 442-6, I, 9°.
Le litige opposait la société Pyxis, structure de regroupement à l’achat de produits pharmaceutiques, ainsi que la société Sagitta, centrale d’achat pharmaceutique, à la société Cooper, établissement pharmaceutique spécialisé dans la fourniture aux pharmaciens de médicaments et accessoires. La société Cooper a opposé un refus de communication de ses CGV aux deux autres entreprises, qui souhaitaient nouer une relation commerciale avec elle. La cour d’appel lui a donné raison au motif que les deux entreprises n’étaient pas une officine et n’établissaient pas qu’elles avaient vocation à bénéficier des CGV applicables aux officines.
La Cour de cassation n’approuve pas cette analyse. Elle commence par énoncer, en termes de principe, « qu’un fournisseur de produits est tenu de communiquer ses conditions générales de vente dans les conditions prévues à l’article L. 441-6 du Code de commerce » et « qu’il ne peut refuser à un acheteur la communication des conditions générales de vente applicables à une catégorie de clientèle que s’il établit, selon des critères objectifs, que cet acheteur n’appartient pas à la catégorie concernée ».
En l’espèce, elle estime qu’en se déterminant comme elle l’a fait, « sans préciser les critères appliqués par la société Cooper pour définir ses catégories d’acheteurs, lui permettant de retenir que la société Pyxis, qui n’est pas une officine, ne relevait pas de la même catégorie d’acheteurs que les officines et groupement d’officines et relevait ainsi nécessairement de celle des grossistes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale »14.
Notes de bas de pages
-
1.
Cass. com., 24 sept. 2013, n° 12-21089 : Bull. civ. IV, n° 138.
-
2.
Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10016 : Bull. civ. IV, n° 59.
-
3.
Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-17659 : RLC 2017/61, n° 3171 – V. aussi, dans le même sens, Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-24241 : RLC 2017/61, n° 3171 – Cass. com., 26 avr. 2017, n° 15-26780 : RLC 2017/62, n° 3192.
-
4.
Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-22675.
-
5.
C. com., art. L. 450-3, al. 4 : « Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission (…) ».
-
6.
Cons. const., 8 juill. 2016, nos 2016-552 QPC et 2016/553 QPC.
-
7.
Cass. com., 26 avr. 2017, n° 15-25699 ; Cass. com., 26 avr. 2017, n° 15-25701.
-
8.
Cass. crim., 8 mars 2017, n° 15-87010 ; V. aussi, dans le même sens, Cass. crim., 8 mars 2017, n° 15-87011 et Cass. crim., 8 mars 2017, n° 15-87012.
-
9.
Cass. crim., 4 mai 2017, n° 16-81060.
-
10.
Cass. crim., 4 mai 2017, n° 16-81071 : RLC 2017/63, n° 3225 ; v. aussi Ruy B., « Le point sur les visites domiciliaires : la fin d’un espoir ? », RLC 2017/63, n° 3221.
-
11.
Aut. conc., 20 févr. 2014, n° 14-D-02, pratiques mises en œuvre dans le secteur de la presse d’information sportive ; Sélinsky V., « Amaurie m’a tué ! L’abus révélé par l’irrationalité économique d’une stratégie de l’entreprise dominante », RLC 2014/39, n° 2511.
-
12.
CA Paris, 15 mai 2015, n° 14/05554.
-
13.
Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-19068.
-
14.
Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-27811.