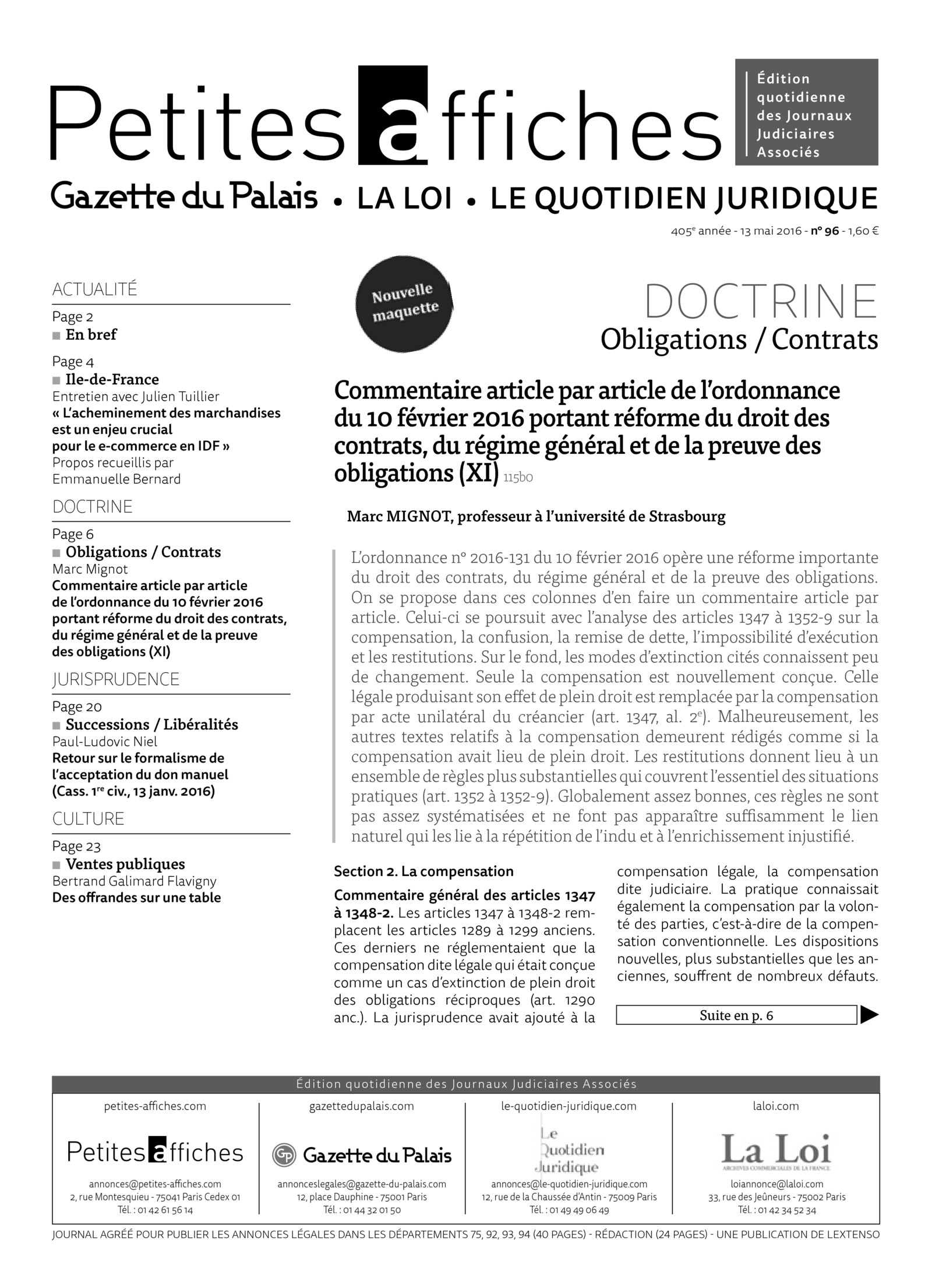Commentaire article par article de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (XI)
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 opère une réforme importante du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. On se propose dans ces colonnes d’en faire un commentaire article par article. Celui-ci se poursuit avec l’analyse des articles 1347 à 1352-9 sur la compensation, la confusion, la remise de dette, l’impossibilité d’exécution et les restitutions. Sur le fond, les modes d’extinction cités connaissent peu de changement. Seule la compensation est nouvellement conçue. Celle légale produisant son effet de plein droit est remplacée par la compensation par acte unilatéral du créancier (art. 1347, al. 2e). Malheureusement, les autres textes relatifs à la compensation demeurent rédigés comme si la compensation avait lieu de plein droit. Les restitutions donnent lieu à un ensemble de règles plus substantielles qui couvrent l’essentiel des situations pratiques (art. 1352 à 1352-9). Globalement assez bonnes, ces règles ne sont pas assez systématisées et ne font pas apparaître suffisamment le lien naturel qui les lie à la répétition de l’indu et à l’enrichissement injustifié.
Section 2. La compensation
Commentaire général des articles 1347 à 1348-2. Les articles 1347 à 1348-2 remplacent les articles 1289 à 1299 anciens. Ces derniers ne réglementaient que la compensation dite légale qui était conçue comme un cas d’extinction de plein droit des obligations réciproques (art. 1290 anc.). La jurisprudence avait ajouté à la compensation légale, la compensation dite judiciaire. La pratique connaissait également la compensation par la volonté des parties, c’est-à-dire de la compensation conventionnelle. Les dispositions nouvelles, plus substantielles que les anciennes, souffrent de nombreux défauts. D’abord, plusieurs dispositions anciennes paraissaient contestables (art. 1295 anc.) ou d’un intérêt pratique limité (art. 1293 anc.). Malheureusement, elles ont été reprises pratiquement à l’identique (art. 1347-5, 1347-2). Ensuite, la loi a répudié, au moins à titre général, la compensation légale (art. 1290 anc.) pour consacrer la compensation par acte unilatéral de volonté (art. 1347, al. 2e). Il s’agit d’un progrès porteur sur le principe de sécurité juridique. Néanmoins, le mécanisme de la compensation par acte unilatéral est insuffisamment réglementé. La loi ne donne aucune précision sur la nature de l’acte, ses conditions de fond et de forme, ses effets précis en cas de conflit et ses conditions d’opposabilité aux tiers. Le mécanisme de la compensation par acte unilatéral est isolé dans l’article 1347, alinéa 2e et aucunement coordonné avec les autres textes (art. 1347-4, 1347-6, 1347-7, 1348, 1348-1). En outre, la loi continue à consacrer un cas de compensation légale avec la compensation judiciaire prévue à l’article 1348-1. On ne sait pas vraiment si les articles 1348 et 1348-1 forment un seul cas de compensation légale ou respectivement un cas de compensation réellement judiciaire et un cas de compensation légale dans lequel le juge se borne à liquider l’une des créances. Enfin, le découpage entre les deux sous-sections de la section 2 est artificiel. L’article 1347-1 donne à penser que les articles 1348 à 1348-2 dérogent aux règles prévues à cet article. Les règles de la sous-section 2 sont a priori plus spéciales que celles de la sous-section 1. Après analyse, on s’aperçoit que la spécialité n’est qu’apparente. Pour s’en tenir à l’essentiel, les articles 1348 et 1348-1 sont rédigés comme si la compensation pouvait avoir lieu sans liquidation de la créance. En réalité, le juge doit liquider la créance et ne peut prononcer ou constater la compensation en passant outre cette condition. Il n’y a donc aucune dérogation à la condition. Finalement, il aurait été préférable de traiter de la matière plus méthodiquement en commençant par l’exposé des sources et conditions de la compensation légale (art. 1348-1), volontaire (art. 1347, al. 2e), judiciaire (art. 1348) et conventionnelle (art. 1348-2), puis l’exposé des effets de celle-ci entre les créanciers et débiteurs (art. 1347), puis à l’égard des tiers (art. 1347-7).
Sous-section 1. Règles générales
Art. 1347. Le texte énonce une condition (réciprocité) et les effets de la compensation (double extinction simultanée) (al. 1er). L’extinction se produit à concurrence de la somme la plus faible. Le texte consacre comme principe le caractère volontaire de la compensation (al. 2e). Il y a là une innovation importante (art. 1290 anc.). La solution était déjà consacrée indirectement en droit international privé français1. L’extinction aura lieu lorsque les conditions de la compensation seront réunies et que l’un des débiteurs l’aura invoquée. La solution est porteuse de sécurité juridique, pour peu que certaines précisions soient apportées. La compensation résulte de l’exercice d’un pouvoir légal par un acte unilatéral de l’un ou de l’autre créancier. Il aurait été utile que le texte se prononce sur la sanction d’un acte unilatéral relatif à des créances qui ne sont pas compensables. Il faudrait distinguer deux hypothèses selon l’importance de la condition manquante. Si elle est fondamentale, l’acte est inexistant. Il en sera ainsi en cas d’absence de réciprocité ou d’absence de certitude. L’acte sera nul d’une nullité relative si la condition manquante est moins essentielle. Tel sera le cas en l’absence de disponibilité ou de saisissabilité d’une créance (art. 1347-2). Il aurait été souhaitable que le texte détermine la forme de cet acte. On peut penser que l’acte unilatéral du débiteur est réceptice. Il est consensuel (art. 1100-1, al. 2e, art. 1172, al. 1er). Concrètement, le créancier provoquera la compensation par notification adressée à son débiteur mentionnant les deux créances, leurs sources, caractères, modalités et montants. De par sa précision, la notification vaut imputation le cas échéant (art. 1347-3). En cas de conflit avec des tiers, il faut que le créancier qui a provoqué la compensation puisse prouver la date de sa réalisation. Il aurait été utile que la loi se prononce sur l’opposabilité de l’acte unilatéral aux tiers.
Art. 1347-1. Le texte énumère les caractères des obligations à compenser. Dans l’ordre d’importance (qui n’est pas celui du texte), il faut qu’elles soient certaines, fongibles, liquides et exigibles (al. 1er). Le texte ne tient pas compte du caractère volontaire de la compensation (art. 1347, al. 2e). Le caractère exigible ne devrait plus être systématiquement requis. Le débiteur peut renoncer au terme prévu à son bénéfice en invoquant la compensation entre sa dette et une créance exigible (art. 1305-3). La liquidité peut aussi, dans une certaine mesure, résulter de l’acte unilatéral du créancier s’il indique les éléments suffisants au débiteur. Le texte définit la fongibilité (al. 2e) d’une façon plus restrictive que par le passé (art. 1291, al. 2e anc.)2. La conversion entre sommes d’argent en différentes monnaies devra s’opérer à la date de l’acte unilatéral.
Art. 1347-2. Certaines créances ne peuvent se compenser. Les créances sont en principe saisissables (CPC exéc., art. L. 112-1). Par exception, certaines créances sont insaisissables et ne peuvent dès lors se compenser avec d’autres créances. Tel est le cas des créances alimentaires (CPC exéc., art. L. 112-2, 3°, art. 1293 3° anc.) ou des créances de salaire pour une fraction (C. trav, art. L. 3252-2). Il aurait fallu aussi subordonner la compensation à la disponibilité de la créance. Le paiement étant un acte de disposition, la compensation suppose qu’elle soit disponible. Le texte reprend les hypothèses, dénuées d’intérêt pratique, prévues par l’article 1293 1° et 2° ancien. La dette de restitution visée au texte porte en général sur un corps certain de telle sorte que la compensation est presque inenvisageable. Pour qu’elle le soit, il faudrait qu’elle porte sur une chose fongible et que le créancier soit lui-même débiteur à l’égard du créancier de la même chose. Autant dire que le cas sera rarissime. Le texte prévoit nouvellement que le créancier peut consentir à la compensation. Ce consentement est inutile et se confond avec l’acte par lequel il provoque la compensation (art. 1347, al. 2e).
Art. 1347-3. Le texte reprend l’article 1292 ancien. Le délai de grâce est une faveur faite au débiteur qui ne peut s’exécuter (art. 1343-5). Le débiteur qui est également créancier de son créancier n’est pas dans cette situation.
Art. 1347-4. Le texte considère qu’en cas de pluralité de dettes compensables, les règles sur l’imputation s’appliquent à la compensation. Le renvoi est restrictif. La question de l’imputation se pose dans les cas où il y a paiement et pas seulement dans ceux d’une pluralité de dettes (v. art. 1342-10). La question de l’imputation va se poser notamment lorsqu’une créance au moins sera productive d’intérêts (art. 1343-1, al. 1er) et qu’en raison de son montant elle ne sera payée que partiellement. Elle se posera de la même façon lorsqu’une créance au moins sera garantie par une sûreté personnelle ou réelle et qu’en raison de son montant elle ne pourra être éteinte en totalité. Par ailleurs, il aurait fallu mettre cette règle en relation avec celle consacrée par l’article 1347, alinéa 2e. L’acte unilatéral par lequel le créancier provoque la compensation se confond avec celui par lequel il décide de l’imputation (art. 1347, al. 2e, 1342-10, al. 1er). Si le créancier provoque la compensation sans décider également de l’imputation, il y aura lieu de recourir à l’imputation légale (art. 1342-10, al. 2e).
Art. 1347-5. Le texte est imprécis et incomplet (art. 1295 anc.). Il doit être mis en relation avec la réciprocité des créances (art. 1347, al. 1er) et l’opposabilité de la cession de créance (art. 1324, al. 1er). La cession est opposable au cédé si elle lui est notifiée et s’il en a pris acte. Le texte ne traite pas de la notification mais seulement de la prise d’acte. Cette dernière est une reconnaissance par le cédé de l’existence de la cession. Elle prouve cette condition fondamentale inhérente à l’opposabilité (v. art. 1200). Le texte admet que la prise d’acte contienne une réserve. Cette précision est difficilement compréhensible parce qu’elle ne correspond pas avec la nature de l’acte du cédé. La réserve est une manifestation de non-vouloir qui suppose la possibilité d’une volonté de son auteur à l’origine d’effets directs produits dans son patrimoine. Or, par la prise d’acte, le cédé ne fait que reconnaître l’existence de la cession réalisée en dehors de lui. La prise d’acte est ou n’est pas mais ne peut contenir de réserve de non-vouloir. Le texte distingue arbitrairement entre les deux modalités de l’opposabilité que sont la notification et la prise d’acte. Dès que la cession est opposable au cédé, ce dernier ne peut plus se prévaloir de la compensation faute de réciprocité des créances, quel que soit le procédé utilisé pour aboutir à l’opposabilité. En outre, le texte considère que le cédé ne peut opposer la compensation après le moment auquel la cession lui est opposable. Il faudrait plutôt considérer qu’il ne peut provoquer la compensation par sa volonté unilatérale après ce moment (art. 1347, al. 2e). L’acte unilatéral par lequel il tenterait de provoquer la compensation après ce moment serait inexistant (v. art. 1347).
Art. 1347-6. La caution peut opposer la compensation intervenue entre le créancier et le débiteur (al. 1er ; art. 1294, al. 1er anc.). Le texte est rédigé comme si la compensation se produisait comme par le passé de plein droit (art. 1290 anc.). Il faudrait distinguer deux situations selon que l’une des parties au rapport principal a provoqué la compensation ou qu’aucune ne l’a provoquée. Dans le premier cas (art. 1347, al. 2e), la compensation a produit ses effets. La caution n’oppose pas la compensation mais s’en prévaut (art. 1200, al. 2e ; comp. al. 2e). Elle est libérée à due concurrence (art. 1347, al. 1er, 2311, 2313). Dans le second, la caution peut provoquer par la voie oblique (art. 1341-1) la compensation par représentation objective du débiteur principal, en se prévalant de son recours anticipé (art. 2309) ou en anticipant son recours personnel et/ou subrogatoire (2305, 2306), à condition que la carence du débiteur principal soit de nature à lui porter préjudice.
Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier et un autre codébiteur (al. 2e). Le texte est encore rédigé comme si la compensation se produisait de plein droit (art. 1290 anc.). Les deux hypothèses distinguées à propos du cautionnement, s’appliquent de la même façon à l’obligation solidaire. Le texte prévoit que la compensation ne vaut que pour la part divise du codébiteur dont la dette a été compensée. Cette restriction ne se justifie aucunement. Si l’on se réfère à la première hypothèse, sans doute la plus fréquente, la compensation produira ses effets selon l’acte unilatéral du codébiteur qui en est à l’origine (art. 1347, al. 2e). Ils se produiront à concurrence des sommes compensées au bénéfice de tous les codébiteurs (art. 1313, al. 1er). Ne pas l’admettre, c’est considérer sans raison aucune que la compensation ne puisse être invoquée par le codébiteur que pour sa part divise. Si les conditions de l’article 1347-1 sont réunies, et on suppose qu’elles le sont, et que le codébiteur le veut (art. 1347, al. 2e), la compensation doit produire ses effets à concurrence de la plus faible des créances, même si elle dépasse la part divise du créancier (art. 1100-1, al. 2e, 1103). S’il ne le veut pas, elle produira des effets moindres qui dépendront de sa volonté. Un codébiteur pourrait aussi utiliser la voie oblique pour provoquer la compensation si les conditions sont réunies (art. 1341-1).
Art. 1347-7. La compensation ne peut porter préjudice aux tiers. Le texte est relativement inutile : la règle découle des principes généraux et des caractères des créances compensables (art. 1347-1). L’indisponibilité d’une créance résultant notamment d’une saisie conservatoire (CPC exéc., art. L. 523-1) ou d’un nantissement (art. 2357) empêche la compensation. La disponibilité de la créance est en effet l’une des conditions de validité de l’acte unilatéral de l’article 1347, alinéa 2e. La cession de la créance empêche la compensation ultérieure faute de réciprocité (art. 1347, al. 1er). L’article 1298 ancien ajoutait que la saisie l’emporte sur la compensation. Il en est de même de la cession de l’une des créances qui empêchera, dès la date de son existence, toute compensation provoquée par le débiteur (art. 1323, al. 2e).
Sous-section 2. Règles particulières
Art. 1348. Le texte est relatif à la compensation judiciaire (1re phrase). Dans la conception traditionnelle, le juge procédait seulement à la liquidation d’une créance en vue de permettre à la compensation légale d’avoir lieu3. Le texte énonce que le juge prononce la compensation même si l’une des obligations n’est pas liquide ou exigible. Il est très imprécis. Le juge peut admettre le principe de la compensation sans liquider mais il ne peut pas prononcer la compensation sans y procéder. Il aurait été préférable de l’énoncer clairement. Une fois la liquidation réalisée par le juge, on peut considérer l’hypothèse de deux façons. Il est possible de suivre le texte et d’admettre que la compensation est prononcée par le juge. La mission du juge serait plus étendue que par le passé. Ou l’on considère que le rôle du juge se limite à la liquidation. Concrètement, la compensation judiciaire résulte d’une demande reconventionnelle d’une partie (CPC, art. 64, 70, al. 2e, 564 ; anc. CPC, art. 464) que l’on peut facilement assimiler à l’acte unilatéral par lequel le créancier entend produire la compensation (art. 1347, al. 2e). On notera ici que l’article 1348-1 consacre la conception traditionnelle de la compensation judiciaire dans laquelle le juge se borne à liquider la créance (v. art. 1348-1, al. 2e). Si l’on considère que les articles 1348 et 1348-1 ne forment qu’une seule et même hypothèse, il faut alors décider que la compensation judiciaire de l’article 1348 ne constitue qu’un cas particulier de compensation légale, voire qu’un cas particulier de compensation volontaire si l’on assimile la demande en justice à l’acte de l’article 1347, alinéa 2e.
Par dérogation à l’article 1347-1, alinéa 1er, l’une des deux créances peut ne pas être liquide ou exigible pourvu qu’elle soit certaine. Le texte est encore imprécis. Il y a un lien naturel entre le caractère liquide et le caractère exigible de la créance. Comme on vient de le voir, le juge doit au moins liquider la créance. Celle-ci est très généralement une créance d’indemnité qui n’est pas exigible parce qu’elle n’est pas liquide. Le juge rend la créance exigible en la liquidant. Si la créance apparaît fondée dans son principe et facilement liquidable, il doit d’abord admettre le principe de la compensation4. Il doit ensuite déterminer son quantum et soumettre la question à la discussion des parties5. Si la créance est incertaine ou difficilement liquidable, le juge doit rejeter la demande reconventionnelle en renvoyant le demandeur à mieux se pourvoir dans une autre instance6.
Le texte énonce que la compensation produit ses effets à la date du jugement, sauf décision contraire du juge la faisant remonter à une date antérieure (2e phrase). La solution de principe est parfaitement fondée. La rétroactivité prévue à titre d’exception peut être expliquée de deux façons : soit la décision du juge est réellement constitutive mais avec un effet rétroactif voulu par lui, soit elle est déclarative et, de ce fait, rétroactive parce qu’il se borne, comme par le passé, à liquider la créance.
Art. 1348-1. Le texte décide que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible (al. 1er). L’exigence de connexité procède de la généralisation d’une condition propre au droit des procédures collectives par un raisonnement dont la rigueur prête le flanc à la critique (C. com., art. L. 622-7)7. En cas de procédure collective, elle justifie l’atteinte portée à l’interdiction des paiements antérieurs8. En dehors d’une procédure collective, la connexité ne reçoit aucune justification. Elle n’est pas une condition requise en général des créances compensables (art. 1347-1) et n’est pas non plus une condition requise de la prétention formée par demande reconventionnelle (CPC, art. 70, al. 2e, 564 ; anc. CPC, art. 464). Si la condition n’est requise ni au fond, ni d’un point de vue procédural, la précision découlant du texte est parfaitement inutile.
Il reste à déterminer l’hypothèse visée par le texte. Il faut raisonner en l’appréciant dans son ensemble. L’hypothèse est celle d’une compensation légale facilitée par la liquidation judiciaire d’une créance. Il déroge donc plutôt à la compensation par acte unilatéral (art. 1347, al. 2e) qu’à la compensation judiciaire (art. 1348)9. Le texte suppose que le juge va liquider une créance qui ne l’est pas pour permettre à la compensation légale de produire son effet10. Il ne dit pas que le juge prononce la compensation comme l’article 1348 mais qu’il ne peut la refuser. Précisément, il ne peut refuser de liquider la créance, ce qui est une évidence (art. 4 ; CPC, art. 5).
L’alinéa 2e du texte corrobore cette interprétation. Il énonce que dans ce cas (celui de l’alinéa 1er) la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de l’une des créances. La liquidation de la créance étant déclarative, la compensation se produit de plein droit à la date indiquée (art. 1290 anc.). L’alinéa 3e fait aussi référence à la compensation légale. Il énonce que dans le même cas (celui de l’alinéa 1er toujours), l’opposabilité est celle d’une compensation réalisée par l’effet de la loi (art. 1294 anc.). Une fois réalisée, elle produit ses effets en sorte que les tiers ne peuvent acquérir de droits sur la créance.
Art. 1348-2. Le texte est relatif à la compensation conventionnelle. Le créancier et le débiteur peuvent conclure une convention prévoyant l’extinction présente ou future des créances selon qu’elles sont présentes ou futures. Dans le premier cas, la compensation conventionnelle produira des effets immédiats et, dans le second, des effets différés. Le texte n’exige pas que les créances soient fongibles, liquides et exigibles. Si elles ne sont pas fongibles, les parties devront s’accorder sur la valeur monétaire de l’obligation qui n’est pas de somme d’argent. Si elles ne sont pas liquides, les parties devront préalablement les liquider. Les parties sont censées renoncer aux termes par la compensation conventionnelle (art. 1305-3, al. 2e). Elles ne peuvent grâce à elle porter atteinte à l’indisponibilité de l’une des créances.
Section 3. La confusion
Commentaire général des articles 1349 et 1349-1. La confusion était réglementée par deux textes au titre des causes d’extinction de l’obligation (art. 1234, 1300, 1301 anc.). C’est encore le cas (art. 1349, 1349-1). Le mécanisme est difficile à appréhender d’un point de vue législatif parce que d’une rare complexité. Il concerne à la fois les droits réels (art. 617, 705) et personnels11. Si l’on s’en tient aux droits personnels, la confusion présente deux aspects qu’il importe de bien distinguer. Elle est d’abord le résultat d’une transmission dans le même patrimoine des aspects actif et passif d’un même droit ou ensemble de droits. Il résulte de cette transmission une paralysie dans l’exercice du droit. La confusion n’est pas en soi une cause d’extinction du droit dont les deux aspects sont cumulés. C’est au plus une situation empêchant son exercice. Ensuite, la confusion peut être une cause d’extinction du droit qu’elle concerne. Elle ne le devient que si la situation de cumul est destinée à demeurer. Si elle n’est que provisoire, la confusion n’est nullement extinctive. Le cumul provisoire peut disparaître par la dissociation retrouvée des aspects du droit résultant de son transfert actif ou passif à un tiers (C. com., art. L. 225-209)12. Il aurait été possible de subordonner l’extinction du droit à un acte de volonté unilatéral du titulaire cumulant les deux aspects de celui-ci13.
La réglementation de la confusion demeure lacunaire. La loi ne règle pas la difficile question du traitement de la succession active ou passive, en cas de pluralités d’héritiers dont l’un est le débiteur ou le créancier. Il y a deux façons de raisonner selon qu’on applique les règles du droit des obligations ou des successions. En droit des obligations, la succession conduit à une confusion partielle éventuellement extinctive à concurrence de la part du débiteur ou du créancier dans la succession (art. 1309, al. 1er), sauf lorsque l’obligation porte sur une prestation indivisible (art. 1320, al. 3e). En droit des successions, le raisonnement est autre. D’une façon générale, le principe de division s’applique pleinement dans les rapports entre les cohéritiers et le débiteur. En revanche, dans les rapports des cohéritiers entre eux, il y a lieu de considérer que les créances relèvent du partage et de son effet déclaratif14. Plus spécialement, les créances du défunt à l’égard d’un héritier figurent dans la masse indivise et font l’objet d’un partage (art. 864). L’héritier débiteur de la succession est alloti de la créance que la succession détient à son égard en sorte que l’obligation s’éteint à concurrence de la valeur de ses droits. Si la dette du copartageant égale ses droits dans la masse partageable, elle s’éteint entièrement par confusion puisque l’héritier devient créancier pour le total de lui-même. Si le montant de sa dette est supérieur à ses droits dans la masse, il doit le solde, c’est-à-dire la différence entre la valeur de son lot et le montant de sa dette. Lorsque le copartageant est à la fois créancier et débiteur à l’égard de la succession, il n’est alloti de la créance de la succession contre lui que si le solde de son compte est positif en faveur de la masse (art. 867).
Art. 1349. Le texte définit la confusion (1re phrase) (art. 1300 anc.). La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d’une même obligation dans la même personne. Pour être précis, elle procède du transfert de la créance ou de la dette au débiteur ou au créancier. Le mode de transfert n’a aucune importance. Il peut résulter d’une succession légale, d’un legs, d’une saisie-attribution sur soi-même, d’un contrat de cession de créance du créancier au débiteur (art. 1321) ou de dette du débiteur au créancier (art. 1327). Le texte énonce que la confusion porte sur une obligation. Il faut préciser que le créancier doit avoir un rapport direct et individuel à la créance. La confusion est impossible en cas d’indivision ou d’usufruit de celle-ci. La confusion peut aussi porter sur un contrat pour les mêmes raisons.
Le texte considère que la confusion éteint la créance et ses accessoires (2e phrase). La solution manque singulièrement de nuance15. La confusion résulte d’un transfert de créance au débiteur ou de dette au créancier. Le transfert n’est pas en soi extinctif. La confusion est moins un mode d’extinction de l’obligation qu’une situation produisant l’impossibilité d’exécution du droit16. Il aurait été possible de traiter de la confusion en parallèle avec l’impossibilité d’exécution due à la force majeure (art. 1351). La confusion ne produira aucun effet extinctif si elle est temporaire ; elle en produira un si elle est définitive (comp. art. 1218)17. Les droits accessoires sont maintenus lorsque la confusion ne produit aucun effet extinctif. Ils disparaissent par voie accessoire si elle en produit.
Le texte réserve les droits acquis par des tiers ou par le créancier ou le débiteur contre des tiers (2e phrase). Il est restrictif car il semble subordonner l’absence d’effet extinctif de la confusion à l’existence de droits des tiers contre le créancier ou le débiteur ou de droits du créancier ou du débiteur contre les tiers. Les deux questions doivent être dissociées. La confusion ne produit aucun effet extinctif même si l’intérêt d’aucune autre personne n’est en cause. Tout dépend de la durée probable de la confusion. Si un tiers a des droits contre le créancier ou le débiteur, ils sont maintenus malgré la confusion18. Si le créancier ou le débiteur a acquis des droits opposables aux tiers, la confusion demeure non extinctive pendant la durée d’existence de ces droits19. Si l’un ou l’autre a des droits contre le tiers, il peut les exercer20.
Art. 1349-1. Le texte reprend dans l’ensemble des solutions connues (art. 1301 anc.). La confusion entre le créancier et l’un des codébiteurs solidaires ou entre le débiteur et l’un des cocréanciers solidaires libère les autres codébiteurs ou préjudicie aux autres cocréanciers seulement pour la part divise du codébiteur ou cocréancier (al. 1er). La solution est fondée. La confusion entre le créancier et le débiteur principal libère la caution (al. 2e). La solution est également fondée. La confusion opérée dans la personne d’une caution ne libère pas le débiteur principal mais les autres cautions à concurrence de la part divise de la caution concernée par la confusion. On peut faire ici la même réserve qu’à propos de l’article 1335. Il faudrait distinguer selon que les cautions sont engagées chacune pour le tout par acte distinct ou qu’elles le sont ensemble par un même acte de cautionnement (v. art. 1335). La solution consacrée au texte ne vaut que dans la seconde hypothèse.
Section 4. La remise de dette
Commentaire général des articles 1350 et 1350-2. Les articles 1350 à 1350-2 remplacent les articles 1282 à 1287 anciens. Les règles des articles 1282 à 1284 anciens sont fusionnées en une seule à l’article 1342-9. Les articles 1350 et 1350-2, alinéa 2e, 2e phrase, sont nouveaux. Les articles 1285, 1198, alinéa 2e et 1287, 1288 anciens deviennent les articles 1350-1 et 1350-2. L’article 1286 ancien disparaît. Sur le fond, les textes ne modifient rien. Ils procèdent à un toilettage formel et intègrent une solution jurisprudentielle (art. 1350-2, al. 2e, 2e phrase). Les textes sont souvent rédigés comme si la remise résultait de la volonté du seul créancier. Cette inclination rédactionnelle est en décalage avec la définition de la remise comme convention (art. 1350).
Art. 1350. Le texte définit la remise. Elle est le contrat par lequel le créancier libère son débiteur sans exécution directe ou indirecte. On notera que l’ordonnance admet plusieurs cas de remise par acte unilatéral (art. 1216-1, 1327-2, 1332).
Art. 1350-1. Le texte reprend des solutions classiques (art. 1285 anc.). La remise conclue entre le créancier et un codébiteur libère les autres à concurrence de la part divise du codébiteur libéré (al. 1er ; art. 1315). Il faut préciser que la remise concerne toute la dette du codébiteur. Une solution identique est consacrée mutatis mutandis en cas d’obligation solidaire active (al. 2e).
Art. 1350-2. Le texte reprend encore des solutions classiques (art. 1287 anc.). La remise contractée par le créancier et le débiteur principal libère les cautions (al. 1er). La remise contractée par le créancier avec l’une des cautions ne libère pas le débiteur principal mais les autres cautions à concurrence de sa part (al. 2e). Cette dernière solution mérite exactement la même réserve que celle faite à propos des articles 1335 et 1349-1.
Le texte dispose que ce qui est reçu par le créancier doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à due concurrence (al. 2e, 1re phrase, 1288 anc.). La règle n’est guère explicite. Le texte consacre une solution jurisprudentielle (al. 2e, 2e phrase)21. Il faut supposer plusieurs cautions engagées ensemble par le même acte de cautionnement. Si l’une des cautions paye partiellement son obligation et obtient en même temps la remise de son obligation (et non du cautionnement), cette caution est entièrement libérée. Les autres cautions sont libérées soit du montant de la part divise de celle-ci si le paiement est inférieur à son montant, soit du montant payé s’il est supérieur à elle. En revanche, contrairement à ce qu’énonce le texte, ce qui a été payé par la caution n’est pas imputé sur la créance garantie en vue de libérer le débiteur à due concurrence. En réalité, la caution solvens est subrogée dans les droits du créancier à concurrence de son paiement. Elle viendra en concurrence avec lui pour le paiement mais à titre subsidiaire (art. 1346-3). Dans cette hypothèse, le paiement de la caution est extinctif dans les rapports avec les autres cautions et translatif de la créance garantie.
Section 5. L’impossibilité d’exécution
Commentaire général des articles 1351 et 1351-1. Les articles 1351 et 1351-1 remplacent les articles 1302 et 1303 anciens. Ces derniers avaient l’inconvénient de considérer le cas de la perte de la chose due comme le plus général alors qu’il ne constitue qu’une espèce d’un genre plus large, l’impossibilité d’exécution. Les deux textes nouveaux corrigent ce défaut en faisant de l’impossibilité d’exécution, le genre (art. 1351), et la perte de la chose due, l’espèce (art. 1351-1). L’impossibilité d’exécution est susceptible de concerner toute obligation, quelle que soit sa source, dès lors qu’elle ne concerne pas une obligation portant indirectement sur une chose de genre (Genera non pereunt). Ceci étant considéré, elle pourrait concerner une obligation de source quasi contractuelle ou extracontractuelle. En règle générale, elle concerne plutôt les obligations de source contractuelle, toujours à supposer qu’elle ne porte pas sur une chose de genre. La question qui se pose est alors moins celle des conséquences de l’impossibilité d’exécution sur l’obligation concernée que sur l’obligation réciproque de l’autre partie (art. 1106, al. 1er). Cette question demeure non résolue par les textes.
Il faut approuver la généralisation opérée par les textes nouveaux, tout en ayant conscience qu’une généralisation plus grande encore est possible. L’impossibilité d’exécution dans le droit des obligations est une application d’une théorie plus vaste qui concerne tous les droits sans exception (v. art. 1360). Et la perte de la chose due est une application qui relève avant tout du droit des biens. En cas de perte de la chose due, le droit de propriété disparaît du fait de la disparition de son objet. La perte de la chose due est une cause d’extinction de la propriété. Son extinction entraîne celle de l’obligation par voie de conséquence22.
Art. 1351. Le texte généralise utilement les dispositions anciennes qui ne concernaient que la perte de la chose due (art. 1302 anc.). En cas de force majeure définitive (art. 1218) rendant l’exécution impossible, le débiteur est libéré de l’obligation (art. 1307-2, 1307-5, 1308, al. 2e). Le texte ne concerne que les obligations portant sur un pur service ou indirectement sur un corps certain. Il n’y a aucune impossibilité d’exécution d’une prestation portant indirectement sur une chose de genre. L’extinction est à la mesure de l’impossibilité. Si elle est totale, l’extinction est totale. Si elle est partielle, l’extinction est partielle (comp. art. 1601). En cas d’obligation alternative, le débiteur doit exécuter la prestation qui peut l’être lorsque l’autre ne peut l’être par suite d’un cas de force majeure (art. 1307-3, 1307-4).
Le texte pose une exception à la règle lorsque le débiteur s’est chargé de la force majeure ou a été mis en demeure de s’exécuter avant sa survenance. Dans le premier cas, le débiteur garantit l’exécution de l’obligation même en cas de force majeure. La clause devra être licite (art. 1171). Il en sera de même s’il a été mis en demeure. Il est alors en faute de ne pas avoir exécuté. La faute est exclusive de la force majeure, à condition que le débiteur ait pu éviter ses effets par une exécution en temps utile. S’il n’est pas libéré et que l’obligation initiale ne peut plus être exécutée en nature, l’exécution ne pourra avoir lieu que par équivalent, c’est-à-dire par le versement d’une somme d’argent représentant la valeur de la prestation non exécutée (art. 1343, al. 3e).
Le texte ne se prononce pas sur les conséquences de cette extinction sur l’obligation de l’autre partie lorsque le contrat est synallagmatique. L’article 1218, alinéa 2e prévoit qu’en cas force majeure définitive, les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues par l’article 1351 et que le contrat est résolu de plein droit. Il résulte de la théorie des risques appliquée à un contrat synallagmatique non translatif de la propriété que l’extinction d’une obligation doit entraîner celle de l’autre obligation. La solution est implicitement reconduite ici (art. 1106, al. 1er). Il aurait été préférable de l’énoncer explicitement.
Le texte ne se prononce pas sur l’impossibilité d’exécution du créancier. On sait que le paiement suppose l’exécution d’une prestation par le débiteur et d’une autre par le créancier (art. 1342). Il est fréquent que le débiteur soit dans l’impossibilité de s’exécuter. Il est non moins fréquent que le créancier le soit. La jurisprudence considère que ce dernier est libéré s’il prouve que l’impossibilité dans laquelle il se trouve de remplir sa prestation est due à un cas de force majeure23.
Art. 1351-1. Le texte poursuit le précédent lorsque le débiteur doit un corps certain. Il ne se prononce pas sur le cas général mais directement sur une exception (« néanmoins »). Il faut revenir aux autres textes pour déterminer la solution de principe. La règle d’après laquelle les risques de la chose sont supportés par le propriétaire n’est d’aucune utilité. Elle est évidente et ne renseigne pas sur les risques du contrat (art. 1196, al. 3e, 1re phrase). En revanche, il en est question quand ceux de la chose sont à nouveau transférés au débiteur de l’obligation de délivrance, alors que le créancier demeure propriétaire (art. 1196, al. 3e, 2e phrase, 1344-2). L’article 1218, alinéa 2e prévoit également qu’en cas de force majeure définitive, les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues par l’article 1351-1 et que le contrat est résolu de plein droit. La règle est erronée toutes les fois que le créancier de la délivrance supporte les risques du contrat. Le débiteur est libéré de son obligation de délivrance, mais le créancier ne l’est pas de celle d’en payer le prix. Il y a extinction des deux obligations corrélatives et résolution de plein droit lorsque les risques du contrat sont supportés par le débiteur de l’obligation de délivrance, soit qu’il les ait conservés à sa charge, soit qu’ils lui aient été transférés en retour par une mise en demeure.
Cette solution comporte des inconvénients majeurs. Elle fait supporter les risques au créancier de l’obligation de délivrance, alors qu’il n’a jamais exercé le moindre contrôle sur la chose, simplement en raison du transfert immédiat de la propriété. Or, l’existence de la force majeure est en partie liée à ce contrôle. Elle n’existe pas lorsque ses effets peuvent être évités par des mesures appropriées que seul le débiteur peut prendre (art. 1218). Le créancier supporte donc les risques sans pouvoir les éviter parce qu’il n’a pas la détention de la chose. Il est plus juste de considérer que les risques doivent être supportés par le débiteur de la chose tant qu’il en a la maîtrise matérielle24. Ils doivent passer au créancier seulement lorsque le débiteur exécute son obligation de délivrance. Cette solution peut se réclamer directement de droits étrangers (C. civ. québécois, art. 1456, al. 2e) ou de la CVIM (art. 69). Elle est, en France, celle du droit de la consommation (C. consom., art. L. 138-4).
Elle résulte d’une conception concrète des contrats translatifs de la propriété d’un corps certain. De cette façon, le transfert n’est pas abstrait des obligations des parties, de l’obligation de délivrance et de celle relative au prix. Le système français maintenu par l’ordonnance abstrait le transfert de la propriété et des risques des obligations des parties contre toute réalité économique. L’obligation essentielle du vendeur dans la vente est celle de livrer ou délivrer la chose25. Si l’on admet cette conception de l’économie du contrat translatif, il faut considérer que le transfert de la propriété et des risques est situé dans la dépendance de l’obligation de livrer ou de délivrer. En reconduisant la solution classique, le droit français maintient une solution injuste, dépassée et passablement abstraite.
Il y a libération du débiteur malgré la mise en demeure s’il prouve que la perte aurait eu lieu également si l’obligation avait été exécutée (al. 1er ; art. 1302, al. 2e anc.). Ce faisant, le débiteur prouve qu’il n’est pas en faute et que la perte est effectivement due à un cas de force majeure. Les risques de la chose étant supporté par lui, il y a lieu d’appliquer littéralement les dispositions de l’article 1218, alinéa 2e. Le débiteur doit alors céder les droits et actions attachés à la chose (al. 2e ; art. 1303 anc.). Cette dernière solution ne cadre pas avec l’hypothèse. Il n’y a aucune raison que le débiteur cède ses droits et actions si les deux parties sont libérées et le contrat résolu de plein droit. Ces droits et actions sont siens parce qu’il est censé être demeuré propriétaire par l’effet de la résolution de plein droit du contrat. Le débiteur doit céder ses droits et actions seulement lorsqu’il ne supporte pas les risques et qu’en conséquence le créancier demeure tenu de payer le prix. Dans cette hypothèse, le contrat n’est pas résolu et le créancier est propriétaire. La cession des droits et actions « attachés à la chose » en est la conséquence.
CHAPITRE V. LES RESTITUTIONS
Commentaire général des articles 1352 à 1352-9. Les textes sont à l’origine d’un ensemble de règles plus substantielles que par le passé (art. 1378 anc. à 1381 anc.). Ils couvrent l’essentiel des situations factuelles. Néanmoins, ils présentent plusieurs défauts dus à une certaine approximation de rédaction et à un manque évident de coordination avec les autres textes.
Les articles 1352 à 1352-9 s’appliquent d’une façon générale en cas d’anéantissement rétroactif dû à une annulation (art. 1178, al. 3e), en cas de caducité (art. 1187, al. 2e) et de résolution ou résiliation (art. 1218, al. 2e) rétroactives. Seul l’article 1352-4 est limité à l’annulation pour cause d’incapacité d’une partie. Ces renvois (art. 1178, al. 3e, art. 1187, al. 2e, art. 1218, al. 2e) sont trompeurs. Ils donnent à penser que l’anéantissement rétroactif fonde directement les restitutions. En réalité, l’anéantissement révèle une situation de paiement de l’indu qui conduit aux restitutions. Autrement dit, c’est la répétition de l’indu qui fonde les restitutions (art. 1302-3).
Le fondement des restitutions peut encore être précisé. Le fondement le plus général des restitutions est l’équité et l’enrichissement injustifié. L’obligation de rendre ce qui a été payé sans être dû est fondée sur l’équité naturelle et le principe selon lequel nul ne doit s’enrichir aux dépens d’autrui26. Il aurait été souhaitable de placer en tête des dispositions sur les restitutions un article similaire à celui que l’on trouve à propos de l’accession mobilière (art. 565). Le fondement technique des restitutions réside dans deux quasi-contrats. Elles relèvent de la répétition de l’indu et de l’enrichissement injustifié (art. 1302 à 1303-4, 1378 à 1381 anc.). Le tout est mélangé avec la responsabilité civile extracontractuelle (art. 1240, 1241).
Les textes utilisent le mot restitution, sans se soucier du sens précis de ce terme. Au sens strict, l’obligation de restituer consiste pour son débiteur à rendre à son créancier la chose même qui lui avait été remise préalablement. La restitution a alors lieu en nature (art. 1353). Le créancier dispose d’une action personnelle et d’une action réelle en revendication ayant le même objet. On peut véritablement considérer qu’il y a restitution. Par assimilation, il est possible de considérer comme une restitution celle d’une chose fongible équivalente en quantité et qualité. Il ne peut y avoir restitution au sens le plus strict lorsque le débiteur de la prétendue restitution n’a pas préalablement reçu la chose à restituer de son créancier ou lorsqu’il doit restituer autre chose que ce qu’il avait préalablement reçu de lui. Il n’y a pas alors restitution mais indemnisation. La restitution en valeur est une forme d’indemnisation (art. 1352, 1352-2, 1352-3, 1352-6, 1352-8). La moins-value (art. 1352-1) et la plus-value (art. 1352-5) sont aussi indemnisées. Le créancier dispose tout au plus d’une action personnelle en paiement contre son débiteur mais d’aucune action réelle en revendication.
Il importe de bien distinguer les restitutions et de fonder chacune sur la règle adéquate. Pour être parfaitement précis, il faut considérer que la restitution du principal en nature relève de la répétition de l’indu (art. 1352, 1352-6)27. En revanche, l’indemnisation du principal en valeur (art. 1352)28, des fruits et de la jouissance (art. 1352-3), des plus-values (art. 1352-5)29, des moins-values (art. 1352-1) et des frais30 relève de l’enrichissement injustifié (art. 1303). Il devrait en être de même de l’indemnisation du service (art. 1352-8). Le principal mis à part (art. 1352), le tout varie en fonction de la bonne ou de la mauvaise foi du débiteur de la restitution (art. 1352-1, 1352-2, 1352-7, 1352-8).
La bonne foi n’est pas définie pas les textes. Est de bonne foi, celui qui a la conviction d’être définitivement propriétaire de la chose reçue en paiement. Est de mauvaise foi, celui qui sait ou doit savoir qu’il doit restituer. D’après la jurisprudence, est de mauvaise foi celui qui reçoit un paiement qu’il sait être dépourvu de cause objective. La connaissance par l’accipiens du vice de ce paiement sans cause constitue la mauvaise foi visée à l’article 1378 ancien31. La bonne et la mauvaise foi doivent s’apprécier in concreto (art. 1130, al. 2e). L’obligation de restituer les fruits est une peine sanctionnant la mauvaise foi32. Dans le détail, il est possible de puiser à plusieurs sources. La mauvaise foi peut consister dans la connaissance par l’accipiens des vices de son titre (art. 550, 1352-7). La mauvaise foi peut être envisagée dans le cadre de l’enrichissement sans cause (art. 1303-4, 2e phrase) ou de la répétition de l’indu (art. 1378 anc.). Est de mauvaise foi, celui qui a reçu l’indu en connaissance de cause. La mauvaise foi peut être envisagée dans le cadre de la responsabilité extracontractuelle (art. 1240, 1241)33. La mauvaise foi est alors une faute non intentionnelle. Sur le principe, il faut distinguer en fonction de la nullité34. Lorsque la nullité est relative, le contractant est présumé de bonne foi (art. 2274). Il sera de mauvaise foi lorsqu’il aura une connaissance effective du vice du contrat. Est de mauvaise foi, l’auteur d’une faute dans la conclusion du contrat et précisément celui d’une faute dolosive (art. 1137) ou d’une violence (art. 1140, 1143) à l’origine d’une crainte. Si la nullité est absolue, le contractant est présumé d’une façon irréfragable de mauvaise foi35.
Les héritiers et successeurs de l’accipiens continuent sa personne et sont donc considérés de la même façon que lui. Ils sont de bonne foi s’il était de bonne foi et de mauvaise foi, s’il était de mauvaise foi. Lorsque les deux parties sont de bonne foi, chacune doit à l’autre les fruits et/ou la compensation de la jouissance seulement à compter de la demande. Lorsque les deux parties sont de mauvaise foi, chacune doit à l’autre les fruits et/ou la compensation de la jouissance dès leur perception ou l’entrée en jouissance (art. 1352-7)36.
Parfois, le moment auquel la bonne foi est appréciée n’est pas précisé (art. 1352-1). Sinon, elle doit l’être au moment où le débiteur de la chose à restituer en a eu la détention (art. 1352-2, 1352-7, 1re phrase). Souvent, le débiteur des restitutions entré en détention de bonne foi est considéré comme étant de mauvaise foi par la demande formée contre lui par le créancier (art. 1352-7, 2e phrase). Mais dans certains cas, la demande n’est pas considérée comme ayant pour effet de rendre le débiteur de mauvaise foi (art. 1352-1). Ces variations ne sont pas rationnelles. Il n’y a que deux hypothèses : celle du débiteur de mauvaise foi ab initio et celle du débiteur de bonne foi rendu de mauvaise foi par la demande.
Les textes font grand usage du mot valeur (art. 1352, 1352-1, 1352-2, 1352-3, 1352-5, 1352-7, 1352-8). Les règles ne sont pratiques que si le mode d’évaluation de la valeur est précisé. Or, ils précisent la date d’évaluation de la valeur par le juge (art. 1352, 1352-3, al. 2e et 3e, 1352-5) mais pas les modalités d’évaluation. La façon d’évaluer la jouissance, les fruits, les services, les plus-values, les moins-values et la chose revendue n’est pas précisée. Il aurait été utile que les textes précisent le mode d’évaluation. Sur le principe, le juge devra se référer aux règles sur l’enrichissement injustifié (art. 1303).
Les textes ne sont pas homogènes sur la date d’appréciation de la valeur. Elle est appréciée tantôt à la date de la fourniture (art. 1352-8), tantôt à celle du jugement (art. 1352-3, al. 2e), tantôt à celle de la restitution (art. 1352, 1352-3, al. 3e, 1352-5), sans que les raisons de ces variations apparaissent avec évidence. Dans le cadre de l’enrichissement injustifié, l’évaluation se fait au jour du jugement (art. 1303-4, 1re phrase). C’est la solution la plus simple et la plus juste. L’indemnisation est une dette de valeur (art. 1343, al. 3e) dont le montant est liquidé lors du jugement. Il est donc logique que l’évaluation se fasse à ce moment ou dans cette période de temps. En période de dépréciation monétaire, plus l’évaluation est tardive et plus la valorisation est importante. L’évaluation au jour de la fourniture initiale n’est donc pas équitable pour le créancier. L’évaluation au jour de la restitution est aléatoire car ce jour n’est pas connu du juge. Il dépend du bon vouloir du débiteur, de sa solvabilité, du prononcé de l’exécution provisoire, de l’exercice des voies de recours suspensives, de la suspension de l’exécution provisoire le cas échéant, etc. Tous ces paramètres ne sont pas maîtrisés par le juge parce qu’ils dépendent de la volonté du créancier et du débiteur.
Art. 1352. Le texte distingue la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent et celle d’une somme d’argent. La restitution d’une chose de la première catégorie doit avoir lieu en principe en nature et, par exception, en valeur, en cas d’impossibilité de restitution en nature. La restitution a lieu en valeur sous la forme d’une somme d’argent lorsque la chose n’est pas restituée en nature. La distinction faite au texte n’est pas pertinente. Il aurait été préférable de distinguer la restitution d’un corps certain et celle d’une chose de genre. D’abord, la restitution d’un corps certain peut être impossible s’il a disparu ou si sa propriété a été cédée à autrui. En revanche, la restitution d’une chose de genre n’est pas impossible en principe, sauf hypothèse rarissime de disparition du genre dans son ensemble (Genera non pereunt). Ensuite, l’économie de la restitution n’est pas la même selon que la chose est un corps certain ou une chose de genre. La restitution d’un corps certain a lieu en nature par principe. L’anéantissement rétroactif de l’acte à l’origine de l’obligation entraîne sa disparition rétroactive et l’anéantissement conséquent de son paiement et du transfert de la propriété. Dès lors, le débiteur doit restituer la chose même qu’il avait reçue dont la propriété revient au créancier de la restitution. Le créancier bénéficie à la fois d’une action réelle en revendication et d’une action personnelle en restitution. En revanche, la restitution des choses de genre a lieu par équivalent parce que leur paiement n’est pas anéanti malgré la disparition de l’obligation leur ayant servi de cause. Le paiement d’une telle chose est abstrait de sa cause. Le débiteur doit alors compenser en payant au créancier une chose équivalente en quantité et qualité. L’anéantissement rétroactif de l’acte donne naissance à une obligation de restituer nouvelle portant sur des choses équivalentes. S’il s’agit d’une somme d’argent, le débiteur doit une somme d’un même montant de la même monnaie (art. 1343).
En outre, le texte est relativement incomplet. D’abord, il considère que la restitution d’un corps certain se fait en valeur lorsque sa restitution est impossible. Il aurait été souhaitable qu’il énonce le mode de détermination de la valeur et invite à prendre en considération l’état du bien. La valeur est celle de ce corps certain au jour de l’acte, compte tenu de son état à cette date37. Lorsque le contrat anéanti est à titre onéreux, cette valeur peut être soit le prix payé, augmenté des taxes et frais divers, soit celle sur le marché. Ensuite, le texte ne traite pas de l’hypothèse de la restitution des choses de genre d’une façon spécifique. Certes, ce sont des choses autres qu’une somme d’argent comprises dans le champ d’application du texte. La règle consacrée au texte n’est pas adaptée. Si l’accipiens les a conservées en nature, il les restituera sous cette forme. Le cas sera vraisemblablement rare. S’il les a vendues ou consommées, il les restituera par équivalent (égalité de quantité et de qualité) (art. 860-1). La restitution n’obéit pas aux règles de l’enrichissement injustifié. Il n’est pas tenu compte de l’emploi de la chose de genre. Il importe peu que l’accipiens l’ait dissipée. Il est réputé s’être enrichi à concurrence de ce qu’il a reçu. Il n’est fait exception à la règle de l’équivalence que dans l’hypothèse d’un incapable (art. 1352-4 ; 1312 anc.). Dans le détail, on peut distinguer les choses de genre autres que la monnaie et celle-ci. Les premières sont restituées pour leur quantité numérique et pour une qualité identique. L’accipiens doit livrer une chose équivalente à compter du prononcé de l’anéantissement de l’acte. Lorsque la chose de genre ne peut être restituée en nature, elle l’est en valeur. La valeur à prendre en compte est celle réelle, à l’exclusion du bénéfice du vendeur38. L’hypothèse de la restitution d’une somme d’argent est réglée par l’article 1352-6.
Art. 1352-1. Le texte ne s’applique qu’aux corps certains (art. 1352-1). Genera non pereunt. En effet, il vise l’hypothèse de celui qui doit restituer la chose et non une chose (v. art. 1352). Il ne définit pas les détériorations et dégradations. Il faut considérer que sont visées les détériorations ou dégradations anormales, qui ne résultent pas de la seule utilisation du bien. Les dégradations ou détériorations normales dues à son utilisation sont indemnisées par la prise en considération de la jouissance du bien (art. 1352-3, al. 1er). Au titre des dégradations anormales, il faudra prendre en considération la perte de valeur due à une détérioration matérielle ou celle due à la constitution d’un démembrement de propriété ou à la constitution d’une sûreté réelle sur le bien.
L’accipiens doit indemniser le solvens des dégradations et détériorations subies par la chose qui ont diminué sa valeur s’il est de mauvaise foi et si elles résultent de sa faute. Le texte distingue artificiellement la mauvaise foi et la faute, sauf à considérer que cette dernière tient à la seule demande en justice du solvens. La mauvaise foi conditionne la faute et la bonne foi l’exclut en principe. S’il est de mauvaise foi, l’accipiens doit apporter tous les soins raisonnables à la conservation du corps certain (art. 1197). Il est en faute s’il est détérioré par sa faute prouvée, quelle que soit sa qualification. L’accipiens ne doit pas indemniser le solvens s’il est de bonne foi car alors il ne peut être en faute (art. 544). Lorsqu’elle est due, l’indemnisation est égale à la valeur des dégradations ou détériorations. Concrètement, l’accipiens devra la plus faible des deux sommes entre la différence de valeur de la chose sans les détériorations et avec les détériorations, d’une part, et le coût du service nécessaire à leur suppression, d’autre part (art. 1303).
Les moins-values peuvent résulter des produits prélevés sur la chose. Ils sont restitués en nature au solvens lorsque cela est possible (art. 1352). Si l’accipiens a mobilisé des éléments d’un immeuble, il doit au solvens tout ce dont il s’est enrichi, c’est-à-dire la plus faible des deux sommes entre le prix de vente des éléments vendus et leur valeur sur le marché (art. 1303). Tel est le cas s’il a vendu les arbres ou les matériaux issus de la démolition de l’immeuble. Dans tous les cas, il faudrait évaluer les moins-values au jour du jugement (art. 1303-4).
La question se pose de savoir si le texte s’applique lorsque les dégradations et détériorations sont dues à un cas fortuit. Il semble qu’il faille donner une réponse négative. L’article 1352-1 s’inscrit dans le contexte de la responsabilité et non celui des risques. La précision que donnait l’article 1379 in fine a disparu. La logique veut que l’on s’en remette au droit commun des risques. Il faut alors appliquer l’adage res perit domino (art. 1196, al. 3e). Après le prononcé de l’anéantissement rétroactif de l’acte, les risques pèsent sur le solvens. Ce dernier les transfère à l’accipiens en le mettant en demeure de restituer la chose (art. 1344-2).
Art. 1352-2. Le texte détermine le régime des restitutions en cas de vente du corps certain. Il ne déroge nullement à l’article 2276 ou 2272. Il est fondé sur les principes de l’enrichissement injustifié (art. 1303, 1304-4, 2e phrase). En cas de revente de la chose, l’accipiens de bonne foi doit en restituer le prix, même s’il est inférieur à la valeur de la chose (art. 1380 anc.). En revanche, l’accipiens de mauvaise foi doit restituer la valeur de la chose et non le prix, sans préjudice de dommages et intérêts le cas échéant. Le texte considère que la valeur est appréciée au jour de la restitution. Il aurait été préférable de considérer qu’elle est appréciée au jour de la revente (art. 860, al. 2e, art. 1469, al. 3e) ou, au plus tard, au jour où le juge prononce l’anéantissement rétroactif de l’acte, et non au jour de la restitution, inconnue à l’avance. La bonne ou la mauvaise foi est appréciée au jour de l’exécution de l’obligation de délivrance issue de l’acte ultérieurement anéanti. Le texte ne vise que la vente (art. 1352-2, 1380 anc.). Il doit être étendu aux autres cas de transmission de la propriété. Si la chose a fait l’objet d’une donation par l’accipiens de bonne foi, celui-ci est dispensé de toute restitution parce qu’il ne s’est pas enrichi (art. 1303). Si l’accipiens est de mauvaise foi, il devra la valeur de la chose donnée au solvens, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts s’il y a lieu (art. 1304-4, 2e phrase).
Art. 1352-3. La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance (al. 1er). Le texte est imprécis. D’abord, il n’y a pas de restitution au sens strict des fruits et de la jouissance. Les fruits sont directement perçus par l’accipiens. Et la jouissance résulte de l’usage de la chose par lui. Le mot compensation est utilisé ici dans un sens assez vague. Il faudrait considérer qu’il y a indemnisation pour les fruits et pour la jouissance. Ensuite, il faut comprendre le lien entre les fruits et la jouissance. Au sens strict, la jouissance est le fructus (fruits) ; au sens large, c’est l’usage (usus) et la jouissance. Puisque le texte nomme les fruits, d’une part, et la compensation de la jouissance, d’autre part, il faut comprendre que la jouissance est l’usage. Il aurait donc été préférable de considérer que la restitution porte sur les fruits et/ou sur la jouissance ou plus simplement que la jouissance est un fruit civil39. En pratique, il faudrait traiter distinctement les hypothèses d’une chose frugifère (immeuble en général) exploitée par le débiteur de la restitution ou par un tiers pour lui ou celle d’une chose (meuble en général) dont la valeur tient à l’usage seulement. Il faut traiter séparément les fruits et la jouissance.
Tous les fruits sont concernés, qu’ils soient naturels, industriels, civils (art. 547). Pour une somme d’argent, les fruits sont les intérêts qu’elle produit (art. 1352-6). Pour un immeuble, il s’agit des loyers ou fermages dus en raison de sa location. En revanche, les intérêts et arrérages ne sont pas considérés comme des fruits s’ils sont payés à titre principal. Il y a lieu de régler le sort des fruits en combinant tous les textes qui s’appliquent à la question (art. 547 à 550, 1352-3, 1352-7, 1378 anc.) et en donnant la préférence aux plus spéciaux (Specialia generalibus derogant) (v. art. 1352-7).
Les fruits sont restitués en nature s’ils existent encore sous cette forme (al. 3e). S’ils ont été consommés, ils sont restitués par équivalent. L’indemnité est égale à leur valeur, estimée à la date de leur paiement. L’accipiens devra la plus faible des deux sommes entre le prix obtenu des fruits en cas de vente et leur valeur sur le marché. Le texte prévoit la possibilité pour les parties de déroger par une clause aux règles relatives au mode de restitution (en nature ou en valeur), à la date ou au mode d’évaluation ou encore à la prise en compte du l’état du bien. Cette référence au pouvoir de la volonté peut être comprise de deux façons. Il est possible que les parties au contrat finalement anéanti aient prévu une clause réglant la question des restitutions. Cette clause échappera à l’anéantissement rétroactif du fait de sa relative autonomie par rapport au contrat anéanti (art. 1230). Si les parties n’ont pas réglementé les restitutions dans le contrat anéanti, elles peuvent contracter ultérieurement une convention à cet effet. On peut donc s’étonner que cette « stipulation contraire » ne soit mentionnée que s’agissant des fruits alors qu’elle concerne toutes les restitutions sans distinction aucune (art. 1102, al. 1er). Le mieux aurait été de prévoir par une disposition générale que les restitutions relèvent de la liberté contractuelle.
Le texte ne donne aucune précision sur la façon dont il faut évaluer l’indemnité de jouissance. Sa compensation est l’indemnisation de celle-ci fondée sur l’enrichissement injustifié (art. 1303)40. Il faudrait alors distinguer l’enrichissement de l’accipiens et l’appauvrissement du solvens. Concrètement, il faudrait raisonner comme si le bien avait été loué. L’enrichissement est égal au montant du loyer que l’accipiens aurait accepté de payer. L’appauvrissement est égal au loyer que le solvens aurait obtenu d’une autre personne sur le marché41. L’indemnité est évaluée par le juge au jour où il se prononce (art. 1352-3, al. 2e), c’est-à-dire au jour du jugement (art. 1303-4, 1re phrase).
Il aurait fallu coordonner la compensation de la jouissance avec l’indemnisation de la détérioration ou dégradation du corps certain lorsqu’elle est due à son utilisation normale (v. art. 1352-1). Le créancier des restitutions ne pourra cumuler une indemnité pour détérioration de l’état du bien et une indemnité pour jouissance de celui-ci. La détérioration est une conséquence de la jouissance et est indemnisée avec elle. Le texte ne donne aucune précision sur le mode d’évaluation de l’indemnité (v. art. 1352-7).
Art. 1352-4. Le texte a un champ d’application restreint aux restitutions consécutives à une annulation prononcée d’un acte auquel est partie un incapable. Il s’applique à toutes les restitutions sans exception, c’est-à-dire aux restitutions au sens strict et aux indemnisations fondées sur l’enrichissement injustifié. Il reprend et modifie les dispositions de l’article 1312 ancien. Ce dernier ne concernait que les mineurs et les majeurs en tutelle, à l’exclusion de ceux en curatelle ou sous sauvegarde de justice. Le présent texte concerne désormais tous les incapables, sans exception. En principe, la restitution porte sur tout ce qui a été reçu. Son étendue ne dépend nullement de l’emploi de la chose par le débiteur de celle-ci (art. 1352). Il est ici fait exception à cette règle. L’incapable ne restitue que ce qui lui a profité, c’est-à-dire seulement à concurrence de ce qui a donné lieu à emploi utile. Il y a là une application des règles sur l’enrichissement injustifié (art. 1303).
La règle consacrée par le texte est fondée sur la volonté de protéger les incapables concernés. Si elle n’existait pas, ils ne seraient pas réellement protégés car ils devraient restituer y compris ce qu’ils ont dépensés et que l’on ne retrouve plus dans leur patrimoine. Elle incite le contractant de l’incapable à contrôler sa capacité et à ne pas contracter avec lui si le contrôle révèle son état d’incapable (v. art. 1149, al. 2e). Le texte apporte une modification importante à l’article 1312 ancien. Seul l’incapable bénéficiait des faveurs de la loi. L’autre contractant devait tout restituer, sans pouvoir se prévaloir de l’absence de restitution de l’incapable. Désormais, ce contractant peut limiter ses propres restitutions au prorata de celles dont il sera créancier de l’incapable. Cette modification introduit l’idée de justice commutative dans les restitutions.
Art. 1352-5. Le débiteur de la restitution est créancier d’une indemnité pour la conservation et l’amélioration du corps certain à restituer dans la limite de la plus-value (art. 1381 anc.). Le fondement de cette indemnisation réside dans les règles sur l’enrichissement injustifié (art. 1303). Il apparaît avec la distinction entre les dépenses nécessaires et utiles. Il était d’usage de distinguer entre trois types de dépense. Les dépenses nécessaires sont celles ayant pour objet de préserver la chose d’une perte ou détérioration. Elles visent à assurer sa conservation. Les dépenses utiles sont celles qui améliorent la chose (art. 861 anc., 1673, al. 1er). Les dépenses voluptuaires sont celles qui servent à l’embellissement, l’agrément et les décors de la chose (art. 599, al. 3e).
Le texte est d’application subsidiaire au profit des textes sur l’accession. Specialia generalibus derogant. En matière mobilière, il y a lieu d’appliquer les règles de l’accession mobilière (art 566 à 577). En matière immobilière, il faut appliquer l’article 555 lorsque les conditions qu’il pose sont réunies. Si ces textes spéciaux sont inapplicables, le présent texte pourra s’appliquer. Il reprend de façon synthétique les solutions classiques, avec quelques modifications. Il intègre l’indemnisation des dépenses nécessaires et utiles et exclut implicitement celle des dépenses voluptuaires. D’après le texte, les dépenses nécessaires et utiles sont indemnisées par application de l’article 1303, c’est-à-dire à hauteur de la plus faible des deux sommes entre la dépense elle-même et la plus-value procurée au bien. La solution est nouvelle s’agissant des dépenses nécessaires qui étaient par le passé intégralement indemnisées, peu important qu’elles soient supérieures à l’enrichissement. Le juge pourra modérer l’indemnité si l’appauvri est fautif (art. 1303-2, al. 2e). Il devrait évaluer l’enrichissement au jour du jugement (art. 1303-4, 1re phrase). Le texte prévoit néanmoins que les plus-values sont évaluées au jour de leur restitution (art. 1352-5). La solution est irréaliste car elle suppose que le juge connaisse d’avance la date de la restitution.
Art. 1352-6. Les sommes d’argent sont restituées pour leur montant numérique, incluant le capital et les accessoires (intérêts, taxes). Les intérêts restitués sont les intérêts payés par le solvens à l’accipiens. En outre, la dette globale (capital et accessoires) est productive d’intérêts sans mise en demeure à compter du paiement effectué par le solvens à l’accipiens lorsque ce dernier est de mauvaise foi42 et, à compter de la demande, lorsqu’il est de bonne foi (art. 1352-7, 1378 anc.)43.
Art. 1352-7. Le texte est à mettre en relation avec l’article 1352-3 dont il ne fait que compléter le dispositif. Il fait varier l’ampleur des restitutions en fonction de la bonne ou mauvaise foi de l’accipiens. Il concerne les fruits et notamment les intérêts des sommes d’argent et la jouissance du corps certain. L’accipiens de mauvaise foi doit les fruits et l’indemnité de jouissance à compter du paiement et celui de bonne foi, à compter de la demande (sur la bonne ou mauvaise foi, v. infra le commentaire général des articles 1352 à 1352-9)44. Il faut noter que le texte impose une appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi personne par personne (« celui qui a reçu »). Il faudra donc regarder si l’accipiens est de bonne ou de mauvaise foi et faire de même avec le solvens. Le texte exclut le règlement global de la situation consistant à dispenser une partie de la restitution parce que l’autre en est déchargée en raison de sa bonne foi. Dès lors, il y aura trois situations à distinguer : 1° l’accipiens et le solvens sont de bonne foi ; 2° l’accipiens est de bonne foi et le solvens de mauvaise foi ; 3° le solvens est de bonne foi et l’accipiens de mauvaise foi. La bonne ou la mauvaise foi doit être appréciée in concreto (art. 1130, al. 2e).
L’accipiens de bonne foi est en droit de conserver les fruits produits par la chose possédée (art. 1378 anc. a contrario). Il les conserve jusqu’à ce qu’il soit constitué de mauvaise foi. Il l’est par la demande en justice (2e phrase ; art. 1682, al. 2e)45. Il faudrait aussi considérer qu’il l’est par la mise en demeure (art. 1344-1). L’accipiens de mauvaise foi est tenu de restituer les fruits (art. 1378 anc.). Il est tenu compte de l’état du bien au jour de sa remise à l’accipiens (art. 549, 1352-3, al. 3e). L’accipiens de mauvaise foi ne doit pas les fruits produits par l’amélioration de la chose (art. 1352-5)46. Il devrait ceux que la chose aurait produits si elle n’avait pas été dégradée par lui (comp. art. 1352-1). Il doit restituer non seulement les fruits perçus mais ceux qu’il a négligés de percevoir. Les fruits restitués sont les fruits nets, déduction faite des frais faits pour les obtenir dont la valeur est estimée à la date du remboursement (art. 548).
L’indemnité de jouissance est d’un montant correspondant à la valeur de l’usage de la chose pendant la durée séparant l’entrée en détention et la restitution effective du corps certain faisant suite à l’anéantissement rétroactif de l’acte lorsque l’accipiens est fautif ou pendant la durée séparant la demande et la restitution effective du corps certain faisant suite à l’anéantissement rétroactif lorsque l’accipiens est non fautif. L’indemnité de jouissance dépend des règles de l’enrichissement injustifié (v. art. 1352-3). Lorsque l’accipiens est non fautif, elle est égale à la plus faible des deux sommes entre l’appauvrissement et l’enrichissement (art. 1303). Lorsqu’il est fautif, elle est égale à la plus forte des deux sommes (art. 1303-4, 2e phrase).
Art. 1352-8. Le service n’est pas restituable en nature mais indemnisable en valeur. Le texte est imprécis. Il se détache formellement des règles sur l’enrichissement injustifié. Néanmoins, il n’y a aucune raison de ne pas les appliquer comme par le passé. Il faudrait tenir compte de la bonne ou mauvaise foi de l’accipiens et de la différence entre son appauvrissement et son enrichissement. La valeur à prendre en compte sera soit celle de l’avantage reçu par l’accipiens, soit celle du service fourni par le solvens, c’est-à-dire du prix reçu par lui en contrepartie (art. 1303). L’accipiens de bonne foi devra la plus faible des deux sommes entre la valeur du service et son prix (art. 1303). L’accipiens de mauvaise foi devra la plus forte des deux sommes (art. 1303-4, 2e phrase). La valeur du service est appréciée au jour de sa fourniture (art. 1352-8).
Art. 1352-9. Les sûretés constituées pour le paiement de l’obligation sont reportées de plein droit sur l’obligation de restituer. Il n’est pas distingué selon que les sûretés sont réelles ou personnelles, constituées par le débiteur ou par un tiers. La règle pourra s’appliquer sans difficulté aux sûretés personnelles, cautionnement47 ou obligation solidaire48. Elle s’appliquera plus difficilement aux sûretés réelles monovalentes ou aux sûretés réelles polyvalentes dans lesquelles le principe de spécialité est conçu de façon stricte49. La solution procède d’une conception fonctionnelle et pratique des sûretés concernées. Elle ne signifie pas que l’obligation de restituer a la même cause que celle initiale au titre du contrat avant anéantissement. La caution n’est pas privée du bénéfice du terme. La solution pourrait être généralisée.
(À suivre)
Notes de bas de pages
-
1.
Règl. n° 1346/2000, 29 mai 2000, art. 6 – Règl. n° 2015/848, 20 mai 2015, art. 9 – Règl. n° 593/2008, 17 juin 2008, art. 17.
-
2.
V. Travaux de la Commission de réforme du Code civil. Année 1946-1947, 1948, Sirey, p. 999. La fongibilité est aussi définie par référence au caractère interchangeable (cité TCRCC 1946-1947).
-
3.
Cass. civ., 22 août 1865 : DP 1865, 1, p. 358 ; S. 1866, 1, p. 153 – Cass. req., 19 déc. 1871 : DP 1872, 1, p. 139 ; S. 1872, 1, p. 230.
-
4.
Fenet P.-A., t. XIII, p. 363.
-
5.
Cass. civ., 15 avr. 1942 : Bull. civ. 1942, n° 104.
-
6.
Cass. req., 5 févr. 1940 : DH 1940, p. 101.
-
7.
Mazeaud J. in D. 1967, p. 358-359 et les auteurs cités.
-
8.
Soinne B. avec la collaboration de Kerckhove E., Traité des procédures collectives, 1995, Litec, n° 1312.
-
9.
Sur l’origine du texte : Cass. 2e civ., 10 janv. 1963, n° 58-50094 : Bull. civ. II, n° 37 – Cass. 1re civ., 18 janv. 1967, n° 65-10721 : Bull. civ. I, n° 27.
-
10.
Chabas F., « Réflexions sur la compensation judiciaire » : JCP G 1966, I, 2026, II, B.
-
11.
Guével D., « La confusion ou les confusions : Théorie générale ou relativité générale ? » : Gaz. Pal. 1999, 2, doctr. p. 1641.
-
12.
En ce sens : CA Chambéry, 18 mars 1884 : Gaz. Pal. 1884, 2, suppl. p. 22 ; Jur. gen. supp., t. 11, v.°Obligations, n° 1237.
-
13.
En ce sens : CA Orléans, 11 janv. 1973 : AJDI 1974, p. 13 ; Rev. loyers 1974, note Viatte J.
-
14.
Cass. ch. réunies, 5 déc. 1907 : DP 1908, 1, p. 113, concl. Baudouin M.-A., note Colin A. ; S. 1908, 1, p. 5, note Lyon-Caen C.
-
15.
V. commentaire général des articles 1349 et 1349-1.
-
16.
En ce sens : Cass. req., 18 juill. 1820 : S. 1821, 1, p. 97.
-
17.
Mortier R., Le rachat par la société de ses droits sociaux, préf. Daigre J.-J., 2003, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, t. 27, n° 638.
-
18.
Cass. 3e civ., 2 oct. 2002, n° 00-16867 : Bull. civ. II, n° 188.
-
19.
Cass. req., 11 mai 1926 : DH 1926, p. 314.
-
20.
Cass. 1re civ., 25 mai 1992, n° 89-17045 : Bull. civ. I, n° 150.
-
21.
Cass. 1re civ., 11 juill. 1984, n° 82-16837 : Bull. civ. I, n° 229.
-
22.
TCRCC 1946-1947, op. cit., p. 17, art. 9 et art. 10, al. 1er.
-
23.
En ce sens : Cass. soc., 18 mai 1953, n° 2.097 : Bull. civ. IV, n° 374 – Cass. soc., 28 oct. 1957, n° 5.595 : Bull. civ. IV, n° 1016 – Cass. soc., 24 mars 1971, n° 70-40239 : Bull. civ. V, n° 240 – Cass. soc., 25 janv. 1978, n° 76-40819 : Bull. civ. V, n° 60 – Cass. soc., 27 mai 1998, n° 96-42303 : Bull. civ. V, n° 280.
-
24.
Sacco R. , « Le transfert de la propriété des choses mobilières déterminées par acte entre vifs en droit comparé » : Rivista di diritto civile 1979, n° 23, p. 479 et note n° 83.
-
25.
Règl. n° 1215/2012, 12 déc. 2012 (Bruxelles I bis), art. 7, § 1 b – CJUE, 25 févr. 2010, n° C-381-08, Car Trim GmbH c/ KeySafety Systems Srl.
-
26.
Pothier R.-J., Traité du quasi-contrat appelé Promutuum, 1861, Cosse et Marchal, t. V, n° 140.
-
27.
Cass. 1re civ., 19 déc. 1960, n° 59-10744 : Bull. civ. I, n° 548 – Cass. 1re civ., 18 juin 1969, n° 67-12690 : Bull. civ. I, n° 238.
-
28.
Cass. soc., 2 févr. 1961, n° 57-12323 : Bull. civ. IV, n° 160.
-
29.
Cass. civ., 18 févr. 1952, n° 1.269 : Bull. civ. I, n° 71.
-
30.
CA Nîmes, 2e ch., 4 févr. 1898 : DP 1898, 2, p. 381, 2e esp.
-
31.
Cass. civ., 11 déc. 1900, 3 arrêts : DP 1901, 1, p. 257.
-
32.
de Creuille B., Fenet P.-A, Communication officielle au Tribunat, 1827, Imp. de Marchand du Breuil, t. XIII, p. 473.
-
33.
En ce sens : Cass. ch. mixte, 9 juill. 2004, n° 02-16302 : Bull. mixte, n° 2.
-
34.
Bousiges A., Les restitutions après annulation ou résolution d’un contrat, thèse, 1982, université de Poitiers, t. I, p. 168.
-
35.
Cass. req., 3 janv. 1849 : S. 1849, 1, p. 282 – Cass. req., 3 déc. 1849 : S. 1850, 1, p. 380 – Cass. civ., 31 janv. 1853 : S. 1853, 1, p. 349 – Cass. civ., 28 mai 1856 : S. 1856, 1, p. 587 – Cass. com., 28 févr. 1967, n° 65-10131 : Bull. civ. III, n° 97.
-
36.
En ce sens : Cass. com., 28 févr. 1967, n° 65-10131, préc. Comp. : Cass. ch. mixte, 9 juill. 2004, n° 02-16302, préc. qui préconisait des solutions partiellement distinctes.
-
37.
Cass. com., 18 nov. 1974, n° 73-12660 : Bull. civ. IV, n° 291.
-
38.
Cass. 1re civ., 12 déc. 1979, n° 78-14604 : Bull. civ. I, n° 318.
-
39.
En ce sens : Pothier R.-J., Traité du droit de domaine de propriété, 1861, Cosse et Marchal, t. IX, n° 334.
-
40.
Cass. com., 16 déc. 1975, n° 74-14021 : Bull. civ. IV, n° 308 – Cass. 3e civ., 12 mars 2003, n° 01-17207 : Bull. civ. III, n° 63.
-
41.
Pothier R.-J. par Bugnet J.-J., Traité du quasi-contrat appelé Promutuum, op. cit., n° 169.
-
42.
Cass. civ., 20 févr. 1928 : Bull. civ. n° 34 – Cass. 1re civ., 6 déc. 1961, n° 60-13778 : Bull. civ. I, n° 581.
-
43.
Par le passé, les intérêts courraient à compter de la sommation et non de la demande : Cass. civ., 3 févr. 1904 : DP 1904, 1, p. 215 ; S. 1904, 1, p. 264 ; Gaz. Pal. 1904, 1, p. 281 – Cass. 1re civ., 6 déc. 1961, n° 60-13778 : Bull. civ. I, n° 581, p. 464.
-
44.
En ce sens : Cass. ch. mixte, 9 juill. 2004, n° 02-16302, préc.
-
45.
Cass. 1re civ., 1er févr. 1955, n° 32328 : Bull. civ. I, n° 48.
-
46.
Cass. 1re civ., 20 juin 1967, n° 65-12963 : Bull. civ. I, n° 227.
-
47.
Cass. com., 17 nov. 1982, n° 81-10757 : Bull. civ. IV, n° 357.
-
48.
Cass. 1re civ., 5 juill. 2006, n° 03-21142 : Bull. civ. I, n° 357.
-
49.
Cass. com., 2 nov. 1994, n° 92-14487 : Bull. civ. IV, n° 321 – Cass. 1re civ., 1er juill. 1997, n° 95-15642 : Bull. civ. I, n° 224.