La modification unilatérale du contrat
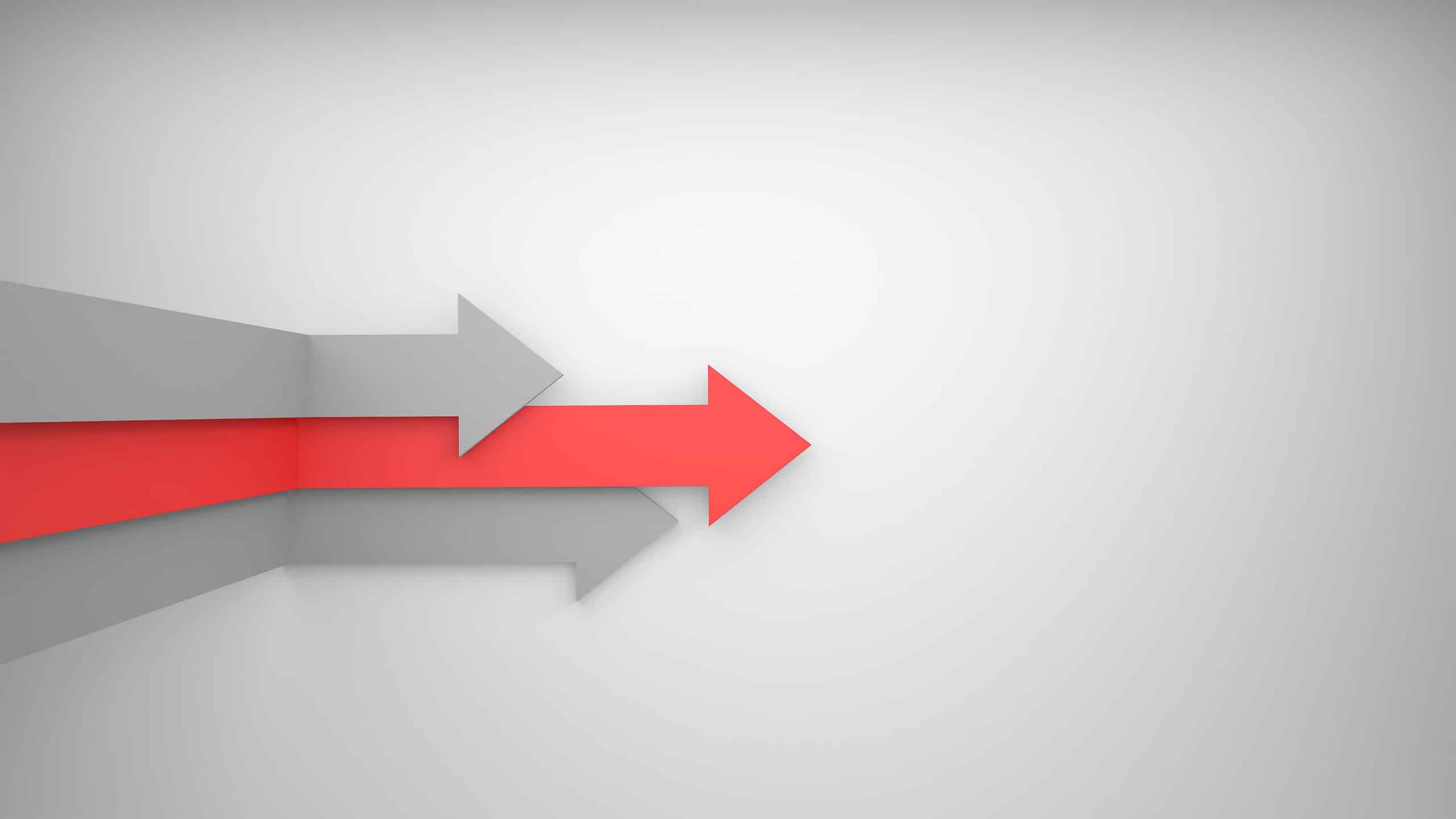
Le Code civil n’admet la modification du contrat que par consentement mutuel des parties ou dans les hypothèses prévues par la loi. Cette règle manifeste la conception bilatérale du contrat. Toutefois, si l’on peut voir en cette règle l’idée de préserver la prévisibilité contractuelle et la sécurité juridique des parties, elle oublie que le contrat est sujet à évolution. Certaines circonstances exigent que le contrat soit modifié unilatéralement par une partie au nom même de la sécurité juridique de l’ensemble des parties. La présente étude systématise ces circonstances et tente de forger l’admission d’une théorie générale de la modification unilatérale du contrat qui n’est pas incompatible avec la conception bilatérale du contrat.
Depuis le Code civil de 18041, sauf consentement mutuel des parties ou pour les causes prévues par la loi, le contrat légalement formé est intangible2. La raison est simple : le contrat étant au moins un acte juridique bilatéral3, la volonté unilatérale n’a que très restrictivement sa place4. Le contrat valablement conclu a une force obligatoire équivalente à celle de la loi : c’est le principe de la convention-loi5. Il ne saurait être unilatéralement modifié6 par un contractant. Toutefois, la loi admet des tempéraments ponctuels à cette règle en permettant dans des hypothèses exceptionnelles la modification unilatérale du contrat. Plusieurs textes spéciaux autorisent de plus en plus, et sous certaines conditions, la modification unilatérale de certains contrats. La fréquence de ces hypothèses de modification unilatérale, qui pourrait être expliquée par les réalités pratiques de la relation contractuelle7, conduit à s’interroger sur l’admission d’une théorie générale de la modification unilatérale du contrat. Pour preuve, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a été interpellé sur la question à l’Assemblée nationale, au sujet de la modification unilatérale de contrats d’abonnement téléphonique8.
La modification unilatérale du contrat est l’acte par lequel un contrat est valablement modifié par une seule partie9. Elle laisse subsister le contrat originaire10. Madame Molina distingue la modification qui éteint le lien contractuel de celle qui le laisse subsister11. La modification qui anéantit le lien contractuel constitue stricto sensu une fin de contrat plutôt qu’une modification12, car en ce cas aucun élément du contrat ne subsiste. Cette dernière situation renvoie alors à une résiliation ou une résolution, laquelle peut résulter de la loi13 ou de la volonté des parties. D’ailleurs pour éviter la confusion sur la question, le législateur a préféré utiliser à l’article 1211 du Code civil14 l’expression « mettre fin au contrat » au lieu de modification lorsqu’il a entendu conférer à chacune des parties le droit de sortir d’un contrat à durée indéterminée. La modification unilatérale peut porter sur plusieurs éléments du contrat : les obligations et leurs modalités, les éléments non obligationnels du contrat. Il est possible de distinguer deux sources de modification du contrat : la loi et la volonté des contractants. La loi peut habiliter, sous certaines conditions, l’un des contractants à unilatéralement modifier le contrat comme elle peut habiliter le juge15 à modifier le contrat. Stricto sensu, la modification du contrat par le juge n’est pas une modification unilatérale, mais plutôt une modification judiciaire car cette modification ne repose sur la volonté unilatérale d’aucun contractant. La modification unilatérale étant l’expression de la volonté d’un seul contractant16, elle se distingue des modifications conventionnelles17. Dès lors, la modification unilatérale du contrat devrait être appréhendée uniquement du côté des contractants. Elle n’est admise par le droit positif qu’à titre exceptionnel (I) mais, quoiqu’exceptionnelle, plusieurs textes spéciaux l’autorisent au point que l’on s’interroge sur la consécration d’une théorie générale de la modification unilatérale du contrat (II).
I – Admission exceptionnelle de la modification unilatérale du contrat
La modification unilatérale du contrat est admise, dans certaines hypothèses, par des dispositions légales (A). Les contractants peuvent aussi, sous certaines conditions, conférer à une partie la prérogative de modifier unilatéralement leur contrat (B).
A – Hypothèses légales de modification unilatérale du contrat
La modification unilatérale du contrat est admise par une disposition du droit commun (1) et par des dispositions spéciales régissant certains contrats spéciaux (2).
1 – Droit commun
Idée générale. La vision rigoriste de l’intangibilité du contrat s’étiole au profit de son utilité en admettant son adaptabilité. La manifestation de cette idée gît dans l’admission exceptionnelle de la modification unilatérale du contrat par le droit commun.
Source. Une disposition du Code civil consacrée à la théorie générale des contrats semble admettre la modification unilatérale du contrat sans équivoque.
Pouvoir légal de modification unilatérale du prix. L’article 1223, alinéa 1er, du Code civil habilite le créancier n’ayant pas encore intégralement payé le prix à le modifier unilatéralement lorsque le débiteur n’a pas parfaitement exécuté sa prestation18. Le créancier de l’obligation peut ainsi modifier unilatéralement le prix fixé ab initio. Le débiteur n’est sollicité dans le mécanisme que pour acquiescer ou non la modification effectuée par le créancier. L’initiative et le contenu de la modification reposent sur « la puissance décisionnelle »19 du seul créancier. L’accord du débiteur n’intervenant qu’après que le créancier a déjà modifié le prix, la qualification de modification unilatérale devrait s’imposer. La règle reflète bien la théorie du caractère évolutif du contrat : la prestation du débiteur n’équivalant plus au prix dont le créancier devait s’acquitter du fait d’une exécution imparfaite, le contenu du contrat se trouve nécessairement modifié. La disposition permet le maintien du lien contractuel lorsque le créancier y trouve un intérêt. Toutefois, la limite du texte réside dans sa circonscription aux seuls créanciers dont la prestation réciproque est monétaire.
Outre cette disposition, la doctrine considère que l’application des articles 1307 et 1308 du Code civil aboutit indirectement à une modification unilatérale de l’obligation. En réalité, il est difficile d’affirmer dans ces hypothèses que le contrat serait modifié, a fortiori de façon unilatérale. Ces dispositions confèrent seulement à l’un des contractants le choix d’exécuter une prestation parmi l’ensemble des prestations alternatives prévues au contrat ou la faculté de fournir une autre prestation pour se libérer de son obligation. Il s’agit donc de possibilités qui sont, ab initio, conventionnellement envisagées. Le choix ou la faculté ainsi exercée n’est qu’un acte d’exécution du contrat et non une modification du contrat. Cet acte d’exécution pourrait être qualifié comme « une explicitation du contrat », car le débiteur ne fait que préciser l’obligation qu’il a choisi d’exécuter sans changer le contenu contractuel convenu par les contractants.
Bilan du droit commun de la modification unilatérale du contrat. Le droit commun semble admettre la modification unilatérale du prix. Si le terme de modification n’apparaît pas expressément dans la disposition étudiée, le législateur utilise la notion de réduction qui traduit l’idée d’une modification du contrat. Le terme de réduction indique un certain changement dans le contenu contractuel, donc une modification.
2 – Droit spécial
Sources diverses. Plusieurs dispositions spéciales admettent la modification unilatérale de certains contrats spéciaux.
En droit de la consommation, la modification unilatérale du prix par le professionnel est admise si le prix est lié aux fluctuations d’un cours, d’un indice ou d’un taux20. L’article L. 224-33, aliné 1er, du Code de la consommation autorise également le fournisseur de services de communications électroniques à modifier les conditions contractuelles, à charge d’en notifier au consommateur, un mois avant leur entrée en vigueur. Ce dernier dispose d’un droit de résiliation de sorte qu’il n’est pas obligé d’accepter les nouvelles conditions contractuelles. Quoique soumis ex post au consentement du consommateur, il s’agit bien d’une modification unilatérale, car le contenu et l’initiative de la modification sont décidés ex ante par le seul professionnel. Toutefois, selon l’alinéa 2 du texte21 précité, le consentement du consommateur n’est pas requis lorsque « les modifications sont toutes exclusivement au bénéfice du consommateur » ou « ont un caractère purement administratif et n’ont pas d’incidence négative sur le consommateur ».
L’article L. 312-76, alinéa 1er, du Code de la consommation confère au prêteur le pouvoir unilatéral de réduire le montant total du crédit ou de suspendre le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur en cas de diminution de la solvabilité de ce dernier. Et inversement, l’article L. 313-47, alinéa 1er22, permet à l’emprunteur de rembourser par anticipation, en partie ou en totalité son prêt. Dès lors qu’un terme a été fixé, le remboursement anticipé du prêt semble constituer une modification du terme de l’obligation23.
En droit bancaire et financier, l’article L. 314-13, IV, du Code monétaire et financier permet la modification unilatérale du contrat-cadre de services de paiement tout en conférant au client, qui n’est pas obligé d’accepter la modification, une faculté de résiliation. L’article L. 312-1-1, IV, du même code24 autorise aussi la modification unilatérale de la convention de compte de dépôt en laissant au client une faculté de résiliation du contrat. L’article L. 213-6-3, V25, donne à l’émetteur la faculté de modifier unilatéralement le contrat d’émission des obligations sans le consentement des obligataires afin de corriger une erreur matérielle.
En droit du tourisme, l’article L. 211-12 du Code du tourisme autorise le professionnel26, si le contrat le prévoit et indique que le voyageur a droit à une réduction du prix, à modifier unilatéralement le prix en le majorant. Le contrat doit prévoir la manière dont cette majoration du prix sera calculée. Le texte n’admet sa modification que si la majoration est la conséquence directe d’une évolution « du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie », « du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du contrat (…) » et « des taux de change en rapport avec le contrat ». L’organisateur doit notifier la majoration de manière claire et compréhensible au voyageur en la motivant par une justification et un calcul au plus tard 20 jours avant le début du voyage ou du séjour. Par souci d’équité, le législateur admet au bénéfice du client, si le contrat prévoit la possibilité d’une majoration du prix, une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts précités qui intervient après la conclusion du contrat et avant le début du voyage ou du séjour. Outre le prix, l’article L. 211-13 du même code27 admet la modification unilatérale du contrat avec faculté de résiliation conférée au voyageur si, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible en raison d’un évènement extérieur non imputable aux parties. L’article R. 211-928 précise les conditions de mise en œuvre de la modification unilatérale. L’agence de voyages doit informer le voyageur des modifications proposées et, s’il y a lieu, leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour, le délai raisonnable dans lequel le voyageur doit envoyer sa décision à l’agence de voyages, les conséquences du silence du voyageur dans le délai fixé. Le voyageur a le choix de refuser les modifications proposées par l’agence de voyageur.
En droit de la construction, l’article L. 261-15 du Code de la construction et de l’habitation29 permet à l’acquéreur de modifier le projet initial du contrat préliminaire en revenant sur sa décision de se réserver l’exécution de travaux de finition ou d’installation d’équipements. Cette règle relève du bon sens : René Demogue expliquait que « celui qui fait faire par un autre un travail dans son intérêt a le droit de sa seule volonté de modifier les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté »30. La modification unilatérale s’explique ici par la nature du contrat qui consiste à faire réaliser des travaux dans son propre intérêt. René Demogue a classé, à ce titre, les contrats de construction parmi les « contrats d’aide ou de commandement » qui sont des contrats « par lesquels une personne engage une autre pour l’exécution d’un travail où certaines conditions de capacité technique, d’habilité commerciale, ou même simplement de résidence qu’elle ne remplit pas, sont nécessaires »31. Toutefois, l’auteur relève que la faculté de modification unilatérale dans les contrats d’aide ou de commandement ne devrait pas conduire à « imposer un changement total »32. C’est pourquoi la Cour de cassation contrôle la mise en œuvre de la prérogative disposée à l’article L. 261-15 précité en exigeant un motif légitime et sérieux pour l’admission de la modification. En l’espèce, un réservant avait modifié le projet initial après la signature du contrat préliminaire de réservation. La cour d’appel a confirmé cette modification en retenant que les articles précités autorisaient le réservant à modifier le projet à sa convenance. La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel en ce que celle-ci « n’a pas constaté que la modification substantielle du projet était justifiée par un motif sérieux et légitime »33.
En droit des assurances, l’article L. 141-4 du Code des assurances34 autorise la modification unilatérale du contrat d’assurance de groupe. Le souscripteur doit informer les adhérents trois mois au minimum avant la date d’entrée en vigueur des modifications. L’adhérent peut refuser la modification du contrat sauf si le lien qui l’unit au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat. Dans cette hypothèse, seuls l’initiative et le contenu de la modification sont unilatéraux.
En droit du travail, l’article L. 1222-6 du Code du travail permet la modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3 du même code. L’employeur adresse au salarié une lettre de notification dans laquelle il informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Ce délai est de 15 jours si l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire. À défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de 15 jours si l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Lorsque le salarié refuse d’accepter la modification opérée par l’employeur, ce dernier pourra prononcer son licenciement car, en ce cas, la modification reposerait sur une cause réelle et sérieuse : le motif économique. Cette hypothèse s’apparente bien à une modification unilatérale du contrat de travail puisque, quoique la modification soit soumise à l’acceptation du salarié, son employeur pourrait le licencier s’il la refusait.
La chambre sociale autorise l’employeur à procéder unilatéralement à certaines modifications en vertu de son pouvoir de direction35. La Cour de cassation distingue la modification du contrat de travail et celle des conditions de travail36. Elle scinde ce qui relève du contractuel de ce qui relève du pouvoir de direction de l’employeur. Alors que la modification du contenu contractuel requiert l’accord du salarié, la modification des conditions du travail, qui relève du pouvoir de direction de l’employeur37, ne requiert pas son accord.
En droit des baux commerciaux, l’article L. 145-5, alinéa 1er, du Code de commerce permet au locataire « d’adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires ».
Les contrats d’intermédiation de représentation sont aussi sujets à modification unilatérale par le donneur d’ordre. Tel est le cas du mandat de droit commun, dans lequel le mandataire dispose d’un pouvoir de direction si bien qu’il peut changer d’ordre à tout moment même si le contrat est en cours d’exécution. Ce pouvoir de modification unilatérale devrait se justifier dans tous les contrats où une personne se met sous les ordres d’une autre. Il devrait être de l’essence même de ces contrats que de permettre la possibilité d’un ajustement permanent de la mission du représentant.
En droit des sociétés, les modifications statutaires autres qu’à l’unanimité des associés constituent une forme de modification unilatérale. Le contrat de société peut être modifié à la majorité des signataires sauf si elle augmente l’engagement des associés. La loi ou les statuts peuvent parfois autoriser la modification des statuts par une partie des associés sous réserve de l’abus de majorité. Par exemple, excepté le changement de nationalité de la société, l’article L. 220-30 du Code de commerce autorise toutes autres modifications des statuts par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. L’article L. 225-96 du même code38 admet la modification des statuts de la société anonyme autre qu’à l’unanimité des actionnaires. Outre le contrat de société, l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis39 admet la modification du règlement à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.
Bilan du droit spécial de la modification unilatérale du contrat. Le régime de la modification unilatérale admise par le droit spécial est parfois circonscrit par certaines dispositions et, lorsque cela n’est pas le cas, la jurisprudence en précise le régime. Quatre points principaux ressortent du régime de la modification : l’objet et l’étendue de la modification, les critères d’admission de la modification, la procédure de modification et le droit de la partie subissant la modification. Certaines dispositions précisent l’objet de la modification, et d’autres sont silencieuses sur cet objet. L’objet de la modification unilatérale peut porter sur le prix du contrat, un élément essentiel du contrat, l’activité convenue dans le contrat, les modalités d’exécution du contrat ou le quantum de l’obligation.
Lorsque la modification porte sur le prix, elle est très souvent la conséquence d’une évolution du contrat : ou bien la modification est due à une fluctuation du cours, de l’indice ou du taux auquel est lié le prix, ou bien elle est due à un changement des critères de fixation du prix après la conclusion du contrat. Si la modification porte sur un élément essentiel du contrat, c’est que l’évolution des circonstances est telle qu’elle nécessite une modification de cet élément. Si la modification porte sur l’activité convenue au contrat telle que l’adjonction d’une activité connexe au bail commercial, c’est qu’elle répond à un besoin impérieux du preneur. Enfin, si la modification porte sur les modalités d’exécution ou le quantum de l’obligation telle que le remboursement anticipé ou la diminution du montant du prêt, c’est qu’elle est la résultante de l’évolution de la situation du contractant.
La modification unilatérale est admise lorsque les circonstances à l’origine du contrat ou les besoins des parties ont évolué. Le dénominateur commun à toutes les hypothèses de modification relevées consisterait à adapter le contrat aux évolutions des prévisions des parties. Plusieurs textes prévoient une procédure à respecter : le cocontractant doit être informé des modifications apportées au contrat avant leur entrée en vigueur. Le cocontractant peut parfois refuser les modifications apportées au contrat. Dans ce cas, les modifications effectuées ne sauraient entrer en vigueur sans son acceptation. Si l’accord du cocontractant n’est pas requis pour l’entrée en vigueur des modifications, c’est que très souvent les critères objectifs sur lesquels sont fondées ces modifications étaient connus et acceptés préalablement par le cocontractant. Parfois, certaines dispositions assortissent la modification unilatérale d’une obligation de motivation à la charge de l’auteur de la modification. Outre les habilitations légales de modification unilatérale de contrats, les contractants peuvent songer à conférer à une partie le pouvoir de modifier unilatéralement leur contrat.
B – Hypothèse conventionnelle de modification unilatérale du contrat
Lorsque les contractants confèrent à une partie le pouvoir de modifier unilatéralement leur contrat, l’unilatéralisme se manifeste uniquement dans l’acte de modification du contrat (1). Toutefois, eu égard au pouvoir unilatéral que confère la clause de modification unilatérale, son admission (2) n’est pas si certaine en droit positif.
1 – Unilatéralisme de l’acte de modification du contrat
Nature juridique de la clause de modification unilatérale du contrat. L’on peut déduire la nature juridique de la clause de modification unilatérale de sa définition. La clause de modification unilatérale est celle qui habilite un contractant à modifier unilatéralement le contrat. Elle confère un pouvoir unilatéral40 de modification à un contractant qui peut le mettre en œuvre sans requérir l’accord de l’autre contractant. Il en résulte que l’unilatéralisme gît seulement dans l’acte de modification du contrat que l’on pourrait qualifier d’acte d’exécution de la clause de modification. Dit autrement, c’est dans la mise en œuvre de la clause que la modification unilatérale se manifeste. En revanche, l’unilatéralisme n’existe pas dans l’initiative ou la décision de modification unilatérale qui est sans doute bilatérale.
Bilatéralisme de l’initiative de la modification unilatérale. Dans le cas de la clause de modification unilatérale, ce sont les parties elles-mêmes qui désignent, par commun accord, le contractant habilité à modifier le contrat. L’initiative de la modification unilatérale est alors bilatérale, car le contractant habilité tire son pouvoir unilatéral de modification de la volonté commune de l’ensemble des contractants. Si l’admission de la prérogative contractuelle ne fait plus débat en droit positif41, la réponse n’est pas si certaine s’agissant d’une prérogative de modification unilatérale du contrat.
2 – Admission de la clause de modification unilatérale du contrat
Validité de principe. L’article 1193 du Code civil énonce que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise »42. Dès lors, la clause de modification unilatérale devrait être valable : la règle est fondée sur l’autonomie de la volonté. Par exemple, l’article 5.70, alinéa 2, de la loi du 28 avril 2022 portant livre 5 « Les obligations » du Code civil belge43 admet clairement la clause de modification unilatérale.
Validité au regard de la déterminabilité de l’objet. L’on peut se demander si la clause de modification unilatérale est conforme au principe de déterminabilité de l’objet de l’obligation44. Le professeur Cyril Grimaldi a posé la question, s’agissant d’une clause de modification unilatérale dans un contrat de franchise, s’il « y a une réelle différence entre le contrat dont le contenu serait ab initio abandonné au pouvoir d’une seule partie et celui dont le contenu, ab initio déterminé d’un commun accord, pourrait être modifié unilatéralement par une partie ? »45. En effet, il est difficile de considérer qu’une clause de modification formulée de façon générale est conforme aux exigences de l’article 1163 du Code civil46. Le bénéficiaire de la clause pourrait modifier l’objet du contrat selon son bon vouloir. Il en résulte sans doute une indéterminabilité de l’objet.
L’article 1163, alinéa 247, énonce que l’objet de l’obligation doit être déterminé ou déterminable. L’objet ne doit pas alors être incertain ni fixé ultérieurement. La détermination de l’objet ne doit pas être abandonnée au pouvoir unilatéral de l’une des parties pour éviter tout risque d’abus48. Une clause de modification unilatérale trop générale ne serait donc pas conforme au principe de déterminabilité de l’objet. Ainsi, la clause de modification unilatérale devrait exactement préciser l’objet de la modification abandonnée au pouvoir de la partie désignée par la clause. Elle devrait préciser les causes donnant lieu à modification et le contour des modifications envisageables.
État de la jurisprudence sur l’admission de la clause de modification unilatérale du contrat. Si la jurisprudence admet en principe la clause de modification unilatérale49, la chambre sociale a toujours refusé son admission dans le contrat de travail. Elle a statué « que la clause par laquelle l’employeur se réserve le droit de modifier, en tout ou en partie, le contrat de travail est nulle comme contraire aux dispositions de l’article 1134, alinéa 2, du Code civil, le salarié ne pouvant valablement renoncer aux droits qu’il tient de la loi »50. Excepté le contrat du travail, la jurisprudence a admis la clause de modification unilatérale dans divers contrats. Elle a par exemple admis la clause autorisant l’assureur à modifier la liste et le nombre des supports dans un contrat d’assurance vie multisupport51, la clause de modification unilatérale du lieu de déchargement en matière de transport maritime52 (Liberty Clause).
Limite de l’usage déloyal. La jurisprudence pose, comme limite à toute prérogative contractuelle, son usage déloyal53. Cette limite a été forgée à partir du principe de bonne foi disposé à l’alinéa 1er de l’article 1104 du Code civil54. Elle signifie que le titulaire d’une prérogative contractuelle doit en faire un usage qui soit conforme à la bonne foi. À défaut, le juge pourra en sanctionner l’utilisation en la paralysant. La Cour de cassation a pu ainsi paralyser l’usage d’une clause résolutoire de mauvaise foi55. Si la finalité de la modification unilatérale poursuit un but illégitime, celle-ci constituera alors un usage déloyal qui exige de déclarer la clause inopérante. Le professeur Stoffel-Munck qualifie cette attitude d’« abus par détournement »56. Lorsque la clause de modification unilatérale prévoit des conditions procédurales pour sa mise en œuvre, la violation de celles-ci devrait aussi conduire à son inopérance. La jurisprudence admet déjà cette interprétation s’agissant de la violation des conditions procédurales d’une clause résolutoire57.
Il découle de l’analyse qui précède que l’état du droit positif n’est pas si réfractaire à l’admission d’une théorie générale de modification unilatérale du contrat.
II – Proposition d’une théorie générale de modification unilatérale du contrat
La modification unilatérale devrait être admise lorsqu’elle est profitable aux contractants (A) et dans les situations échappant au contrôle des contractants (B).
A – Admission de la modification unilatérale profitable aux cocontractants
La modification unilatérale du contrat pourrait être admise lorsqu’elle est motivée par l’intérêt commun des contractants (1) avec la limite de la substance des prestations essentielles du contrat (2).
1 – Admission au nom de l’intérêt commun des contractants
Intérêt des contractants. La modification unilatérale du contrat devrait s’imposer si elle escompte l’intérêt des contractants. Si la modification envisagée est favorable au cocontractant, elle devrait être admise et elle protège sans doute l’autre partie qui en est l’auteur. L’on doit se demander quelles seraient les conséquences sur l’économie générale du contrat sans cette modification. Cette idée se justifie davantage dans les contrats multipartites.
Particularité des contrats multipartites. Le Code civil conçoit l’hypothèse des contrats multipartites lorsqu’il énonce à son article 1101 que « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Le contrat multipartite est un contrat auquel plus de deux personnes ont consenti : c’est un contrat qui regroupe plusieurs parties58. Le domaine de prédilection des contrats multipartites est le contrat-organisation59, lequel permet à plusieurs personnes de mettre en commun des richesses en vue d’exploiter une activité conjointe. Le contrat de société60 en constitue un exemple. Un sociétaire peut être engagé sans spécialement donner son consentement à l’acte entrepris par l’organe investi du pouvoir de prendre des décisions, que cet acte modifie ou non l’engagement originaire souscrit.
Inadaptation de l’article 1193 aux contrats multipartites. L’exigence de l’article 1193 du Code civil n’est pas adaptée aux réalités des contrats multipartites. Admettre la modification de ces contrats par une catégorie de personnes apporte de la souplesse pour éviter notamment des blocages lorsqu’une partie disparaît ou s’oppose à l’intérêt commun des contractants. La règle de l’unanimité pour modifier le contrat étant mal adaptée à la structure du contrat de société, le législateur a dû adopter des règles dérogatoires au droit commun des contrats pour sa modification : le consentement unanime de tous les sociétaires n’est pas en principe requis pour procéder à une modification61. Cette règle devrait être étendue à tous les contrats multipartites dès lors qu’elle préserve l’intérêt commun des parties. René Demogue partage cette idée lorsqu’il admet la modification du contrat sans l’accord de l’ensemble des parties contractantes dans les contrats qui « ont eu pour résultat la création d’un organisme spécial »62.
Illustrations. La jurisprudence estime que le franchiseur63 détient un droit « de modifier l’organisation de son réseau de distribution (…) »64 en raison de l’évolution du réseau et des besoins de la clientèle. Or, la modification de l’organisation du réseau implique en réalité une certaine modification des contrats de franchise65. Par exemple, une organisation du réseau pourrait entraîner des coûts de travaux d’investissement supplémentaires à la charge des franchisés ou la disparition d’une enseigne du réseau. Le franchiseur a le pouvoir de changer la charte graphique de son réseau et d’imposer des travaux de mise aux normes à ses franchisés66. Toutes ces hypothèses engendrent plus ou moins une modification du contrat de franchise. Ces modifications sont admises au nom de l’intérêt des contractants. La Cour de cassation s’est prononcée sur une modification par un franchiseur de son enseigne Epil Center en une enseigne Esthetic Center. Elle a estimé que « la nouvelle enseigne était proposée sans investissements lourds (…) » et que « l’adoption de la nouvelle enseigne devait entraîner une progression du chiffre d’affaires des instituts par l’extension des prestations proposées en réponse à l’évolution des besoins de la clientèle »67. L’intérêt pour le cocontractant est respecté, car le changement d’enseigne est censé lui apporter plus de clientèle.
2 – Limite de la substance des prestations essentielles du contrat
Types d’obligations essentielles. L’article 1170 du Code civil énonce que « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». Cette disposition visant « toute clause », elle s’applique également à la clause de modification unilatérale68. On distingue l’obligation subjectivement essentielle de l’obligation objectivement essentielle69. La première est la contre-prestation qui a déterminé l’autre partie à contracter. La seconde est l’obligation essentielle à un contrat nommé et sans laquelle le contrat ne saurait être qualifié ni son régime identifié70. L’obligation essentielle constitue l’essence du contrat, car elle en est la pièce essentielle71 soit subjectivement par la volonté des parties, soit objectivement en raison de la nature du contrat.
Acception de la substance de l’obligation essentielle. La substance revêt deux acceptions distinctes. Selon la première, la substance renvoie à la matière de la chose, c’est-à-dire les éléments qui forment une chose. Il en découle que la substance dépasse les seules obligations essentielles72. Celle-ci serait donc le contenu contractuel dans son intégralité73 ou bien l’ensemble des dispositions du contrat. Elle ne serait alors ni plus ni moins que la somme des clauses du contrat. Selon la seconde acception qu’il convient de retenir, la substance serait l’essentiel du contenu d’un contrat appelé noyau dur ou le cœur du contrat. Cette conception impose de hiérarchiser le contenu du contrat en le fractionnant. Le législateur qui n’utilise que trois fois74 dans le Code civil la notion de « substance » semble lui-même retenir cette conception. En effet, il admet à l’article 1170 précité que chaque obligation essentielle a quelque chose de supérieur et fondamental qui en assurerait son existence : la substance. Cette interprétation s’induit du verbe « vider » employé par le législateur. Selon le dictionnaire de l’Académie française, « vider » signifie « retirer d’un récipient ou de quelque lieu que ce soit, ce qui était contenu ». Si le législateur entendait la substance comme l’ensemble du contenu d’une obligation ou d’un contrat, il aurait tout simplement utilisé l’expression « vider le contrat ou l’obligation de son contenu ». Or en visant la substance de l’obligation essentielle, il semble bien faire allusion à un élément précis du contenu de cette obligation. Dès lors, la substance ne constitue pas l’ensemble du contenu de l’obligation, mais l’élément qui assure l’existence de l’obligation et qui n’est rien d’autre que son cœur. Cet élément propre à chaque contrat n’est autre que « la prestation promise dans son principe et ses modalités »75.
Illustrations. Selon la deuxième chambre civile, la clause de modification unilatérale ne doit pas vider le contrat de sa substance. En l’espèce, un contrat d’assurance vie multisupport avait été modifié par l’assureur en vertu d’une convention d’arbitrage qui le lui autorisait. La Cour a censuré la modification effectuée au motif qu’elle « a été, massive, sans contrepartie, et effectuée afin de vider le contrat de sa substance pour en interdire le fonctionnement normal (…) »76. La Cour identifie bien dans le contrat l’élément précis qu’elle estime comme étant la substance. Elle a pu qualifier des droits de natures variées en tant que substance : tel fut le cas des modalités de paiement du prix fixé les parties77. Ainsi, la clause de modification unilatérale pourrait bien porter sur la substance du contrat ou de l’obligation essentielle, parce que l’initiative ou la décision de modification résulte de la volonté des contractants. M. Jean-Pascal Chazal a pu affirmer à juste titre qu’il « paraîtrait exagérément rigide de cantonner les possibilités de modification unilatérale aux éléments de très faible importance »78. Toutefois, la modification unilatérale sera inadmissible si elle vide le contrat ou l’obligation essentielle de sa substance. La modification unilatérale est davantage admise en cas d’évènement extérieur aux parties et lequel modifie fortement leur contrat.
B – Admission de la modification unilatérale en cas d’évènements extérieurs aux contractants
Le législateur pourrait admettre la modification unilatérale du contrat en cas d’urgence (1) et dans les circonstances échappant au contrôle des contractants (2).
1 – Admission en cas d’urgence
L’urgence. La notion d’urgence est utilisée à maintes reprises par le législateur79 sans que ce dernier la définisse. Elle correspond à l’état de situation exigeant d’agir immédiatement pour éviter un dommage imminent. Elle ne se confond pas avec la force majeure qui, au moment de la conclusion du contrat, est un évènement imprévisible échappant au contrôle du débiteur et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées de sorte qu’elle empêche l’exécution du contrat80. Lorsque l’urgence ne peut être surmontée par des mesures appropriées et qu’elle empêche l’exécution du contrat, elle s’apparente alors à la force majeure. Toute situation d’urgence n’est donc pas nécessairement une force majeure. René Demogue rappelle que « l’urgence autorise et impose même de s’écarter des instructions que l’on a reçues, des droits que l’on a normalement, lorsqu’il y a à cela un avantage évident (…). Et en particulier l’urgence doit faire exception à toutes les règles ou du moins à nombre d’entre elles »81. La modification unilatérale du contrat devrait être autorisée lorsque les contractants font face à une situation d’urgence qui contrevient à leur prévision contractuelle et nécessite une action immédiate. Il s’agirait là d’une mesure de circonstance pour répondre à un besoin impérieux. Dès lors, la modification pourrait être temporaire ou définitive ; ce qui importe est qu’elle soit de nature à répondre proportionnellement à l’urgence. Toutefois, l’urgence ne doit pas être utilisée par un contractant pour échapper à ses obligations. La modification doit être motivée par les circonstances. Le juge pourrait donc opérer un contrôle juridictionnel a posteriori pour constater la réalité de l’urgence. L’admission de la modification unilatérale au nom de l’urgence semble avoir écho dans la jurisprudence de droit maritime.
Illustrations. La jurisprudence admet en effet déjà la validité de la Liberty clause82 qui permet à un transporteur maritime de modifier le port de déchargement en cas de grève bloquant la destination convenue. La Cour de cassation a retenu la responsabilité d’un transporteur maritime qui s’était abstenu d’exercer la faculté de modification unilatérale du lieu de déchargement en vertu d’une Liberty clause convenue entre les parties83. L’admission de la modification unilatérale en cas d’urgence, telle qu’une grève, n’est donc pas si étrangère en droit positif. Le changement de destination en cas d’urgence est également connu dans les autres modes de transport. L’article L. 1222-6 du Code du travail également fondé sur l’urgence économique, permet la modification du contrat de travail par l’employeur. Tous ces exemples illustrent que le droit positif admet à certains égards, en cas d’urgence, la modification unilatérale du contrat.
2 – Admission en cas de circonstances échappant au contrôle des contractants
Circonstances échappant au contrôle des parties. Si le contrat est un acte de prévision84, les parties n’ont pas toujours le contrôle de toutes les circonstances pouvant modifier leur prévision. Au nom de l’équité, un contractant ne devrait pas s’exécuter si les circonstances sont telles qu’il ne se trouve plus dans la prévision à l’origine de son engagement85. Le législateur tient compte de cette hypothèse en droit commun des contrats par la théorie de l’imprévision86. Toutefois, les critères de l’imprévision sont si étroits qu’ils ne sauraient correspondre à toutes les circonstances échappant au contrôle des parties. C’est pour cette raison que l’on devrait permettre aux parties la modification unilatérale du contrat lorsqu’un fait échappant à leur contrôle contrevient à leur prévision contractuelle.
Illustrations. L’exemple des conditions de modification unilatérale, outre le prix, du contrat de tourisme disposé à l’article L. 211-13 du Code du tourisme illustre bien cette proposition. Ce texte admet la modification unilatérale si le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible en raison d’un évènement extérieur aux parties. Le texte utilise la notion d’évènement extérieur sans viser les caractéristiques de la force majeure87. C’est bien dire qu’il englobe toutes les situations échappant au contrôle des parties. D’autres dispositions instituent un droit de modification unilatérale du contrat dans certaines situations échappant au contrôle des contractants. Par exemple, l’article R. 212-3, 1°, du Code de la consommation confère au professionnel un droit de modification unilatérale du prix dans les « transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d’un cours, d’un indice ou d’un taux que le professionnel ne contrôle pas »88. Selon l’article R. 212-4, alinéa 1er, du Code de la consommation, les contraintes d’évolution technique peuvent justifier les modifications unilatérales du contrat89.
Institution d’une obligation de motivation. En cas de contestation, l’auteur de la modification unilatérale devrait motiver sa décision90. Cette obligation n’exclut pas le recours au juge pour un contrôle a posteriori. Plusieurs dispositions spéciales91 imposent déjà l’obligation de motivation dans le cadre de l’exercice de certaines prérogatives contractuelles. La réforme du droit des contrats a généralisé cette obligation en cas de résolution par notification par le créancier92. L’intérêt de l’obligation de motivation consiste à contraindre l’auteur de la modification unilatérale à la justifier par des motifs sérieux et légitimes93.
Conclusion
Si le droit commun des contrats est dominé par le bilatéralisme qui ne voit qu’en la volonté des parties la force créatrice ou extinctrice d’obligations, la volonté unilatérale permet parfois de modifier un contrat déjà formé. Le réalisme contractuel a conduit le législateur à assouplir le principe d’intangibilité du contrat en conférant à un seul contractant un droit de modification unilatérale du contrat dans des hypothèses spécifiques. Ce réalisme qui se manifeste sporadiquement en droit commun des contrats reçoit beaucoup d’application dans plusieurs contrats spéciaux. La jurisprudence admet également sous certaines conditions la clause de modification unilatérale du contrat. Partant de ce constat, il a été question de savoir si l’on pouvait introduire en droit commun une théorie de modification unilatérale du contrat. L’étude est partie des dispositions du droit commun, du droit spécial et de la jurisprudence pour démontrer que l’état du droit positif n’est pas si réfractaire à l’admission de la modification unilatérale du contrat. Elle a donc considéré qu’il serait temps d’admettre la modification unilatérale du contrat lorsqu’il y va de l’intérêt des contractants et dans les situations échappant au contrôle des contractants. Cette proposition ne procède pas d’une vaine théorie, mais plutôt de la conception moderne du contrat qui est sujet à évolution et qui devrait en conséquence s’adapter utilement aux prévisions des parties. Il serait non seulement injuste, mais surtout inutile que les parties continuent d’exécuter ce qu’elles se sont promis alors même que les circonstances sont telles qu’elles ne se trouvent plus dans les prévisions à la base de leurs promesses. Jacques Ghestin affirmait à juste titre que « le contrat n’est obligatoire que s’il est juste »94. L’étude s’inspirant de la jurisprudence relative à la modification unilatérale propose d’encadrer le régime de la modification en posant des critères d’admission drastiques. L’on pourrait ainsi admettre la disposition suivante : « Dans les situations échappant au contrôle des contractants et lorsqu’il y va de l’intérêt des contractants, une partie peut modifier unilatéralement le contrat pour motif légitime. La modification ne doit ni vider l’obligation essentielle de sa substance ni avoir d’incidence négative sur les droits de l’autre partie.
L’auteur de la modification doit, en cas de contestation par l’autre partie, motiver sans délai la modification. L’autre partie pourra, en cas d’abus ou d’usage déloyal, demander au juge d’adapter le contrat ou d’y mettre fin ».
Notes de bas de pages
-
1.
V. C. civ., art. 1134, al. 1er, anc.
-
2.
V. D. Mazeaud, « Intangibilité du contrat », RDC oct. 2009, p. 1358 ; v. aussi C. civ., art. 1193 : « Les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
-
3.
C. civ, art. 1101.
-
4.
Rép. civ. Dalloz 2017, v° Contrat : généralités – Principes directeurs du droit des contrats, n° 122, (actualisation oct. 2023), M. Latina.
-
5.
P. van Ommeslache, « Les obligations », in Traité de droit civil belge, t. 1, 2013, Bruylant, p. 176.
-
6.
V. H. Lécuyer, « La modification unilatérale du contrat », in C. Jamin et D. Mazeaud, L’unilatéralisme et le droit des obligations, 1999, Economica, p. 47-59 ; C. Delforge, « La modification unilatérale du contrat », in J.-F. Germain (dir.), La volonté unilatérale dans le contrat, 2008, Éditions du jeune Barreau de Bruxelles, p. 139 à 226.
-
7.
V. sur cette question, JCl. Travail Traité., fasc. n° 19-40, « Modification du contrat de travail », note G. de Raincourt.
-
8.
V. AN, question n° 2456, 25 oct. 2022, « Modifications unilatérales de contrats d’abonnements téléphonique et internet » : JOAN 7 mars 2023, p. 2185
-
9.
A. Ghozi, La modification de l’obligation par la volonté des parties. Étude de droit civil français, préf. D. Tallon, 1980, LGDJ, n° 26 ; v. aussi N. Dissaux, « Les clauses de modification unilatérale du contrat », AJ Contrat 2020, p. 260 ; R. Kruithof, « La modification conventionnelle du contrat », inRapports belges au XIIe Congrès de l’Académie internationale de droit comparé (Sydney-Australie), 18-27 août 1986, Anvers/Bruxelles, 1986, Kluwer/Bruylant, p. 97-134 ; S. Pellet, L’avenant au contrat, thèse, 2010, IRJS Éditions, p. 25, n° 12.
-
10.
N. Dissaux, « Les clauses de modification unilatérale du contrat », AJ Contrat 2020, p. 260.
-
11.
L. Molina, La prérogative contractuelle, thèse, 2020, université Paris I Panthéon Sorbonne, n° 60, p. 80.
-
12.
En ce sens, v. N. Dissaux, « Les clauses de modification unilatérale du contrat », AJ Contrat 2020, p. 260.
-
13.
V. C. civ., art. 1211, sur la faculté de mettre fin au contrat à durée indéterminée conférée à chacune des parties – C. civ., art. 1224, sur la clause résolutoire.
-
14.
C. civ., art. 1211 : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».
-
15.
V. C. civ., art. 1195 – C. civ., art. 1345-5, al. 1er – C. civ., art. 1345-5, al. 2.
-
16.
C. Delforge, « La modification unilatérale du contrat », in J.-F. Germain (dir.), La volonté unilatérale dans le contrat, 2008, Éditions du jeune Barreau de Bruxelles, p. 146, n° 7.
-
17.
C. Delforge, « La modification unilatérale du contrat », in J.-F. Germain (dir.), La volonté unilatérale dans le contrat, 2008, Éditions du jeune Barreau de Bruxelles, p. 146, n° 7.
-
18.
D. Houtcieff, « L’étendue des nouveaux pouvoirs unilatéraux du contractant », RDC sept. 2018, n° RDC115n0 ; v. aussi F. Chénedé, « La réduction du prix », RDC sept. 2017, n° RDC114k3.
-
19.
Sur cette expression, v. L. Molina, La prérogative contractuelle, thèse, 2020, université Paris I Panthéon Sorbonne, n° 209, p. 235.
-
20.
C. consom., art. R. 212-3.
-
21.
C. consom., art. L. 224-33, al. 2.
-
22.
C. consom., art. L. 313-47.
-
23.
V. J.-R. Mirbeau-Gauvin, « Le remboursement anticipé du prêt en droit français », D. 1995, chr. p. 46.
-
24.
C. mon. fin., art. L. 312-1-1, IV.
-
25.
C. mon. fin., art. L. 213-6-3, V.
-
26.
C. tourisme, art. L. 211-12.
-
27.
C. tourisme, art. L. 211-13.
-
28.
C. tourisme, art. R. 211-9.
-
29.
CCH, art. L. 261-15.
-
30.
R. Demogue, « Des modifications aux contrats par volonté unilatérale », Rev. trim. dr. civ. 1907, p. 264-265.
-
31.
R. Demogue, « Des modifications aux contrats par volonté unilatérale », Rev. trim. dr. civ. 1907, p. 264.
-
32.
R. Demogue, « Des modifications aux contrats par volonté unilatérale », Rev. trim. dr. civ. 1907, p. 265.
-
33.
Cass. 3e civ., 20 oct. 2004, n° 03-10.406 : « Qu’en statuant ainsi, alors que le réservant a l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat, la cour d’appel qui n’a pas constaté que la modification substantielle du projet était justifiée par un motif sérieux et légitime, a violé les textes susvisés (…) ».
-
34.
C. assur., art. L. 141-4.
-
35.
V. P. Waquet, « La modification du contrat de travail et le changement des conditions de travail », RJS 12/96, chr. p. 791 ; A. Lyon-Caen, « Une liaison dangereuse entre jurisprudence et théorie – à propos de la modification du contrat de travail », in Analyse juridique et valeurs en droit social, Études offertes à Jean Pélissier, 2004, Dalloz, p. 357 ; J. Pélissier, « Difficultés et dangers de l’élaboration d’une théorie jurisprudentielle : l’exemple de la distinction entre la modification du contrat de travail et le changement des conditions de travail », in Mélanges offerts à Pierre Couvrat, PUF, 2001, p. 101.
-
36.
JCl. Travail Traité., fasc. n° 19-40, « Modification du contrat de travail », note G. de Raincourt – v. aussi Cass. soc., 10 juill. 1996, n° 93-41.137 : v. G. Duchange, « La modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur », AJ Contrat 2020, p. 265.
-
37.
Cass. soc., 10 déc. 2014, n° 13-23.790.
-
38.
C. com., art. L. 225-96.
-
39.
L. n° 65-577, 10 juill. 1965, art. 26.
-
40.
V. pour cette notion, D. Houtcieff, Droit des contrats, 5e éd., 2021, Bruylant, n° 642-7, p. 509 ; v. aussi D. Fenouillet, « La notion de prérogative : un instrument de défense contre le solidarisme ou technique d’appréhension de l’unilatéralisme », RDC avr. 2011, p. 644 ; G. Helleringer, Les clauses du contrat. Essai de typologie, 2012, LGDJ, p. 187-191, nos 343-349, EAN : 9782275038452.
-
41.
L. Molina, La prérogative contractuelle, thèse, 2020, université Paris I Panthéon Sorbonne, n° 143, p. 162 – v. à ce sujet : C. civ., art. 1717 et s – v. aussi Cass. com., 10 juill. 2007, n° 06-14.768 – Cass. 3e civ., 9 déc. 2009, n° 04-19.923 – Cass. 3e civ., 25 juin 2013, n° 11-27.904 – Cass. com., 7 oct. 2014, n° 13-21.086 – Cass. com., 8 nov. 2016, n° 14-29.770 – C. civ., art. 1223, sur la modification unilatérale du prix de la prestation par le créancier – C. civ., art. 1736, sur la prérogative conférée à chacune des parties permettant de résilier le bail à durée indéterminée – C. civ., art. 1211, sur la faculté de résiliation unilatérale conférée à chacune des parties dans un contrat à durée indéterminée – Cass. 3e civ., 5 oct. 2017, n° 16-17.533 – Cass. 3e civ., 5 janv. 2012, n° 10-20.179, sur la faculté de résiliation unilatérale d’un bail commercial conférée à une partie.
-
42.
C. civ., art. 1193 : « Les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
-
43.
V. L., 28 avr. 2022, portant le livre 5 « Les obligations » du Code civil belge, art. 5.70, al. 2 : « Lorsque le contrat l’autorise, il peut être modifié ou résilié par une partie ou par un tiers ». Toutefois, la jurisprudence belge semble encadrer l’application de cette disposition en l’assortissant d’une limite. Dans un arrêt du 21 septembre 2009, la cour d’appel de Grand a jugé que la clause de modification unilatérale doit mentionner des critères objectifs : « Le droit de modification suppose que les parties aient stipulé, au moment de la conclusion du contrat, des critères suffisamment objectifs, lesquels permettent à la partie désignée de déterminer ou de modifier l’objet des obligations visées, par leur simple application et sans qu’une nouvelle expression volonté soit nécessaire ». La clause litigieuse contenue dans un contrat de bail commercial, était rédigée ainsi : « Le bailleur se réserve le droit de remplacer à tout moment les boissons prévues par des produits ayant les mêmes caractéristiques mais d’une autre marque ».
-
44.
G. Loseau, « Du caractère déterminable de la prestation dans les clauses de mobilité », RDC juin 2018, n° RDC115e5, qui soulève l’application de l’article 1163 du Code civil à la clause de mobilité ; C. Grimaldi, « Évolution du réseau de franchise : quelle liberté pour le franchiseur ? », RDC déc. 2016, n° RDC113r3.
-
45.
C. Grimaldi, « Évolution du réseau de franchise : quelle liberté pour le franchiseur ? », RDC déc. 2016, n° RDC113r3.
-
46.
C. civ., art. 1163, al. 2 : « Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable ».
-
47.
C. civ., art. 1163.
-
48.
J. Ghestin, G. Loiseau et Y.-M. Serinet, Traité de droit civil ; La formation du contrat, tome 2 : L’objet et la cause – Les nullités, 2013, LGDJ, nos 112 et 113, p. 92 et 94, EAN : 9782275039565.
-
49.
J. Heinich « La vie et la mort du pacte d’actionnaires : modification, transmission, nullité et caducité », RDC mars 2024, n° RDC201w2.
-
50.
Cass. soc., 27 févr. 2001, n° 99-40.219.
-
51.
Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-22.308.
-
52.
Cass. com., 13 déc. 2016, n° 14-20.804 : RDC mars 2018, n° RDC114v5, note P. Stoffel-Munck.
-
53.
Cass. com., 10 juill. 2007, n° 06-14.768 : Bull. civ. IV, n° 188 ; D. 2007, p. 2839, note P. Stoffel-Munck ; D. 2007, p. 2844, note P.-T. Gautier ; RTD civ. 2007, p. 733, obs. B. Fages ; Defrénois 30 oct. 2007, n° 38667, p. 1454 et s ; v. aussi, O. Deshayes, « Les sanctions de l’usage déloyal des prérogatives contractuelles », RDC avr. 2011, p. 726.
-
54.
C. civ., art. 1104, al. 1er : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
-
55.
Cass. 1re civ., 31 janv. 1995, n° 92-20.654 : Bull. civ. I, n° 57 ; D. 1995, p. 389, note C. Jamin.
-
56.
P. Stoffel-Munck, L’abus dans le contrat, Essai d’une théorie, thèse, préf. R. Bout, 2000, LGDJ, nos 634, 699, 745.
-
57.
Cass. 3e civ., 23 févr. 1982, n° 80-14549 : RTD civ. 1982, p. 619, note P. Remv – Cass. 3e civ., 22 juill. 1987, n° 86-13.998 : Bull. civ. III, n° 152 – Cass. 3e civ., 11 oct. 1977 : Bull. civ. III, n° 331 ; JCP G 1977, IV 289 – Cass. 3e civ., 1er oct. 1975 : Bull. civ. III, n° 268.
-
58.
C. Grimaldi, Droit des contrats, 2024, https://droitscontrats.fr, n° 606 – v. aussi L., 28 avr. 2022, portant le livre 5 « Les obligations » du Code civil belge, art. 5.12, « Le contrat multipartite est un contrat conclu par plus de deux parties ».
-
59.
V. P. Didier, « Brèves notes sur le contrat-organisation », in L’avenir du droit, Mélanges en hommage à François Terré, 1999, Dalloz-PUF-Juris-Classeur ; v. aussi, J.-F. Hamelin, Le contrat-alliance, thèse, 2012, Economica ; v ; aussi S. Lequette, Le contrat-coopération : contribution à la théorie générale du contrat, thèse, 2012, Economica, p. 89 et s.
-
60.
C. civ., art. 1833, al. 1er : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ».
-
61.
P. Didier, « Brèves notes sur le contrat-organisation », in L’avenir du droit,Mélanges en hommage à François Terré, 1999, Dalloz-PUF-Juris-Classeur, p. 642.
-
62.
R. Demogue, « Des modifications aux contrats par volonté unilatérale », Rev. trim. dr. civ. 1907, p. 277.
-
63.
V. pour ce contrat, C. Delforge, « La modification unilatérale du contrat », in J.-Fr. Germain (dir.), La volonté unilatérale dans le contrat, 2008, Éditions du jeune Barreau de Bruxelles, p. 173-183, nos 41-47.
-
64.
Cass. com., 2 déc. 2008, n° 07-18.775.
-
65.
C. Grimaldi, « Évolution du réseau de franchise : quelle liberté pour le franchiseur ? », RDC déc. 2016, n° RDC113r3.
-
66.
N. Dissaux, « Les clauses de modification unilatérale du contrat », AJ Contrat 2020, p. 260.
-
67.
Cass. com., 19 janv. 2016, n° 14-16.272.
-
68.
J. Heinich « La vie et la mort du pacte d’actionnaires : modification, transmission, nullité et caducité », RDC mars 2024, n° RDC201w2.
-
69.
C. Grimaldi, « Les clauses portant sur une obligation essentielle », RDC oct. 2008, p. 1095.
-
70.
C. Grimaldi, « Les clauses portant sur une obligation essentielle », RDC oct. 2008, p. 1095.
-
71.
P. Jestaz, « L’obligation et la sanction : à la recherche de l’obligation fondamentale », in Mélanges offerts à Pierre Raynaud, 1995, Dalloz-Sirey, p. 279.
-
72.
D. Houtcieff, Droit des contrats, 5e éd., 2021, Bruylant, n° 642-7, p. 508.
-
73.
D. Houtcieff, Droit des contrats, 5e éd., 2021, Bruylant, n° 642-7, p. 508 – v. aussi, Cass. com., 29 juin 2019, n° 17-29.000 : L. Molina, La prérogative contractuelle, thèse, 2020, université Paris I Panthéon Sorbonne, n° 27, p. 43.
-
74.
V. C. civ., art. 578 – C. civ., art. 1170 – C. civ., art. 1377.
-
75.
D. Houtcieff, Droit des contrats, 5e éd., 2021, Bruylant, n° 642-7, p. 509.
-
76.
Cass. 2e civ., 7 mai 2009, n° 08-17.325 rectifié par Cass. 2e civ., 17 sept. 2009, n° 08-17.325.
-
77.
Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-29.000, D – V. aussi : Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 19-13.355, pour une clause de pénalité de retard – Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-18.934, pour les conditions financières du contrat de parrainage et la dénomination de l’équipe sous le seul nom du parrain.
-
78.
J.-P. Chazal, « Tout n’est-il pas contractuel dans le contrat ? », RDC avr. 2004, p. 237.
-
79.
C. aviation, art. L. 410-5 – C. civ., art. 9 – CPC exéc., art. R.121-12 – C. transp., art. R. 6221-15 – C. civ., art. 1226.
-
80.
C. civ., art. 1218, al. 1er : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
-
81.
R. Demogue, « Des modifications aux contrats par volonté unilatérale », Rev. trim. dr. civ. 1907, p. 306-307.
-
82.
P. Stoffel-Munck et P. Y. Gautier, « Entre la bonne foi et le respect des clauses, que choisir ? », (2e partie), Actes de la journée Ripert, 2009, DMF, p. 72.
-
83.
Cass. com., 13 déc. 2016, n° 14-20.804 : RDC mars 2018, p. 20, note P. Stoffel-Munck.
-
84.
V. sur cette qualification, M. Hauriou et J. Ghestin, L’utile et le juste dans les contrats, 1981, Sirey, Archives de philosophie du droit, t. 26, p. 35 ; P. Hébraud, « Rôle respectif de la volonté et des éléments objectifs dans les actes juridiques », Mélanges offerts à Jacques Maury, p. 424, n° 26 ; C. Jamin, « Révision et intangibilité du contrat, ou la double philosophie de l’article 1134 du Code civil », in « Que reste-t-il de l’intangibilité du contrat », Dr. & patr. 1998, p. 47 ; H. Lécuyer, « Le contrat, acte de prévision », inL’avenir du droit,Mélanges en hommage à François Terré, 1999, Dalloz-PUF-Juris-Classeur, p. 643.
-
85.
V. en ce sens un arrêt très particulier : Cass. com., 3 nov. 1992, n° 90-18.547 : Bull. civ. IV, n° 338, RTD civ. 1993, p. 124, obs. J. Mestre ; JCP G 1993, II 22164, note G. Virassamy.
-
86.
C. civ., art. 1195.
-
87.
J.-D. Pellier, « La modification unilatérale du contrat en droit du tourisme », AJ Contrat 2020, p. 316.
-
88.
C. consom., art. R. 212-3, 1°.
-
89.
Sur cette question, v. V. Legrand, « La modification unilatérale du contrat en droit de la consommation », AJCA 2020, p. 308.
-
90.
Sur cette idée, v. M. Mekki, « Le nouvel essor du concept de clause contractuelle », RDC oct. 2006, p. 1051.
-
91.
V. C. rur., art. L. 143-3 – C. com., art. L. 145-9 – L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 15 – C. assur., art. L. 113-12-1.
-
92.
C. civ., art. 1226 : « Le créancier peut à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ».
-
93.
D. Mazeaud, « Bonne foi », RDC avr. 2005, p. 264.
-
94.
J. Ghestin, La formation du contrat, 3e éd., 1993, LGDJ, n° 251.
Référence : AJU016w3




