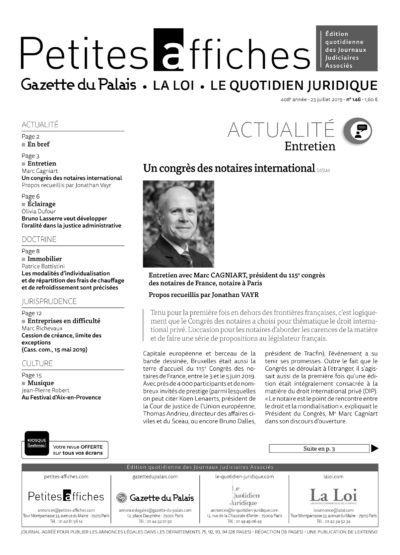Au Festival d’Aix-en-Provence
Le Requiem de Mozart

Le Requiem de Mozart
Pascal Victor/Artcompress
Le Festival d’Aix-en-Provence donne une version scénique du Requiem de Mozart, » enrichie » par l’ajout de diverses autres pièces, majoritairement empruntées à Mozart lui-même. Et une adaptation scénique de ce nouveau tout. Il y a tant de légendes autour de ce chef-d’œuvre, resté inachevé, que ce nouvel avatar n’est plus pour étonner. On sait la théâtralité émanant de toute musique de l’auteur de Don Giovanni. Raphaël Pichon est passé maître dans l’art du montage de musiques pour faire sens. Pour ce nouvel opus, il met en miroir diverses pièces avec les séquences du Requiem : chants grégoriens, pages allemandes de Mozart et » pastiches » de celui-ci, selon un découpage habile qui finalement ne nuit pas à l’œuvre phare. Les parties ajoutées en prolongent le sens, voire l’enluminent. Ainsi introduit-il le Requiem par plusieurs morceaux : un chant grégorien, un hymne maçonnique et un Miserere. L’idée de faire précéder l’Introït par, entre autres, la Meistermusik K. 477B, est particulièrement judicieuse car elle rappelle combien la composante maçonnique est essentielle dans l’écriture du Requiem. Tout aussi intéressante est l’idée d’ouvrir le spectacle par un chant grégorien, parangon de dépouillement, et de le refermer par un autre, » In Paradisium », une antienne extatique. C’est là que la composante proprement théâtrale prend le relais et s’impose à l’analyse.
Romeo Castellucci n’est pas seulement un maître de l’image, il est aussi un penseur philosophe savant. Il voit dans le Requiem un voyage dans le temps. À contre chronologie sans doute, car si sa première image montre une vieille femme s’éteignant dans un geste banal de la vie quotidienne – le fait de se coucher –, l’ultime offre la vision d’un nouveau-né déposé par sa mère au centre du plateau, découvrant le monde alentour. Symboles d’exploration à la fois de l’origine et de la fin. Entre ces deux extrêmes, Castellucci interroge » l’idée d’extinction, tant individuelle que de l’espèce ». Pour illustrer le propos, une succession de mots s’affiche en fond de scène, défilant continûment : les hommes, les peuples, les villes, les références à l’actualité. Et pourtant il y a là tout sauf » un espace dévolu à la lamentation », selon le régisseur italien. Car » ce Requiem célèbre la vie ». Au-delà de l’apparente contradiction, on retiendra une volonté de mêler toutes sortes de symboles et des visions qui ne peuvent cacher leur sombritude. Et un usage systémique du paradoxe : au plus fort des déluges sonores et dramatiques du » Dies irae » ou du » Tuba mirum », on assiste à une joyeuse farandole. C’est que Castellucci estime que » la fête pénètre littéralement le Requiem et inocule en son corps solennel et funéraire, en quelque sorte, un excès de vie ». Le tempo inculqué au spectacle est soutenu par l’emphase portée sur le chœur, un élément primordial du Requiem il est vrai. La présentation est on ne peut plus savante, et souvent à la limite de l’abscons : des rites initiatiques, cette petite fille ointe de quelque onguent, aspergée de sang puis criblée de cendre, avant d’être affublée d’une peau de bête, côtoient des visions symboliques, comme cette carcasse de voiture défoncée dans un accident de la route, et sur laquelle, au » Sanctus », se brisent les uns les autres avant de finir pas s’allonger raide morts. Les images sont souvent saisissantes par leur beauté apollinienne : les quatre solistes vêtus de blanc immaculé au » Recordare ». Elles le sont tout autant par leur aspect effrayant. Ainsi, à l’avant dernier épisode, lorsque le sol se soulève à la verticale pour devenir un mur dont tout se défait, vision de cataclysme vers le néant. Les symboles n’auront pas été en reste, comme cet enfant jouant à la balle avec un crâne humain au son d’un petit air à vocalises, lui qui à la toute fin entonne le » In paradisium ».
Cette profusion ne semble pas éprouver la symbiose existant entre dramaturgie et musique. L’exécution qu’en donne Raphaël Pichon ne se ressent pas de cette captation incessante de l’œil. Car voilà une interprétation pensée jusque dans le moindre détail. Aux accents extrêmement travaillés font écho des sonorités magiques. Ses musiciens de Pygmalion prodiguent un son d’une beauté inouïe, avec ce caractère si particulier que procure le jeu sur instruments anciens, aux couleurs plus austères comme dégraissées de toute brillance inutile. L’émotion, que le relatif éparpillement de la régie ne ménage pas toujours, on la ressent dans ce flot musical intarissable, les accents terrifiants de jugement dernier ou la sérénité de l’appel à la clémence divine. Le chœur Pygmalion est d’une beauté comparable et d’une prestance certaine. Des quatre solistes, se détachent la basse Luca Tittolo et l’alto de Sara Mingardo. On sort de cette expérience singulière et audacieuse en pensant que mettre en image cet immense morceau de musique sacrée, contemporain d’œuvres théâtrales comme Die Zauberflöte ou La Clemenza di Tito, n’est finalement pas déraisonnable, tant bien de ses pages viennent en écho à ces grands moments de théâtre.
Mahagonny de Kurt Weill
Fruit le plus accompli de la collaboration entre un compositeur très engagé, Kurt Weill, et un dramaturge théoricien du théâtre épique, Bertolt Brecht, Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny est créé en 1930 à Leipzig. Non sans son lot de scandale, sur fond de montée du nazime et de refus de certains artistes pourtant peu enclins au conservatisme de le voir créer dans la capitale allemande. Il s’agit d’une fable satirique dont le but est de dénoncer le pouvoir dévastateur de l’argent. Née de la volonté de trois individus en rupture de ban, Mahagonny est une » ville piège », mirage qui devient vite réalité au milieu de nulle part. Une prospérité inventée et le sexe facile attirent les » requins » de tous bords dont le bûcheron Jim Mahoney. S’installe peu à peu un lieu de facilité. Mais » la ville d’or », un temps menacée par la ruine, l’est encore plus par la survenance imminente d’un cyclone. Celui-ci ayant épargné la ville, est érigée une règle de vie adossée à la devise » Tout est permis » et ses quatre » droits inaliénables : se remplir la panse, faire l’amour, se battre et boire ». Jusqu’au jour où Jim se retrouve ruiné. Arrêté et traduit devant le tribunal, il est condamné à mort pour le plus grand de tous les crimes : le manque d’argent. Morale de l’histoire : le bonheur promis par Mahagonny n’était qu’illusion. La colère de Dieu s’abat sur la ville ravagée par les flammes. Mais si cette ville existe c’est que le monde est mauvais. Cette fable aussi cruelle que corrosive, la musique de Weill n’en adoucit pas la violence, loin s’en faut. Même si quelques passages d’un fervent lyrisme, comme le fameux » Alabama song », en interrompent un moment le cours.
Le metteur en scène Ivo van Hove s’empare à bras-le-corps de cette parabole caustique, bâtie sur un montage fait d’une suite de tableaux indépendants les uns des autres. Usant de ses techniques favorites, dont la projection vidéo et le style making off. Une telle œuvre programmatique avec sa charge de satire politique, sa dose de provocation mais aussi son côté moralisateur, est nul doute une mine. Ce seront donc une succession d’épisodes, d’abord à partir d’un espace vide, réduit à ses attributs scéniques bruts, puis peu à peu construits au fil de l’action, et ce en trois dimensions. Car il fait appel au filmage en direct. Ainsi voit-on le ou les personnages en gros plan sur un écran en fond de scène. Cette simultanéité entre ce qui se passe normalement sur le plateau et un agrandissement de l’un de ses éléments, a ses avantages en termes d’animation et de démultiplication dans l’espace. L’écran possède une autre vertu, celle d’annoncer le titre des scènes, une invention didactique essentielle de la dramaturgie de l’œuvre. Ce work in progress laisse un sentiment d’improvisation, au début du moins, car on a peine à trouver ses marques. Mais van Hove en use habilement, en particulier dans l’art de traiter les masses, figurants et choristes, dont les groupements sont d’une remarquable pertinence. Plus d’une image est d’un formidable effet. Telle l’attente insoutenable du cyclone où l’on perçoit à la fois la densité de la foule resserrant les rangs au premier plan, et le sentiment de frayeur panique se lisant sur les visages au second. Reste que la première partie, essentiellement narrative, libère moins d’intensité que la seconde où l’opéra défend alors une thèse. Le message est dès lors plus concret et la traduction scénique plus resserrée. D’une cruauté extrême, la satire n’en ressort que plus fortement.
Une chose est certaine : on est littéralement happé par un orchestre incandescent. Car Esa-Pekka Salonen ne lésine pas sur la puissance sonore. Le Philharmonia Orchestra sonne brillant et coloré, dans ces tunes aux tournures séduisantes qui voient les pupitres des bois étinceler. L’entrain qu’il communique à ses musiciens, on le retrouve dans la distribution. Au premier chef Karita Mattila, Leokadja Begbick, qui se déchaîne et brûle les planches de sa voix ardente, de sa gouaille façon mère Macrelle. Annette Dasch est une Jenny de pareille stature, soprano large et bien projeté, prestance haute en couleurs. Le Jim de Nikolai Schukoff offre une voix de stentor dotée d’une réserve de puissance à revendre lui permettant de faire face aux exigences d’un rôle qui frôle le Heldentenor. Les barytons Thomas Oliemans et Alan Okel, la basse Peixin Chen et le ténor Sean Panikkar sont de la même eau. La palme revient au Chœur Pygmalion qui au lendemain de sa prestation déjà magistrale dans le Requiem de Mozart, offre un étonnant savoir-faire tant vocal que scénique.

Mahagonny de Kurt Weill
Pascal Victor/Artcompress