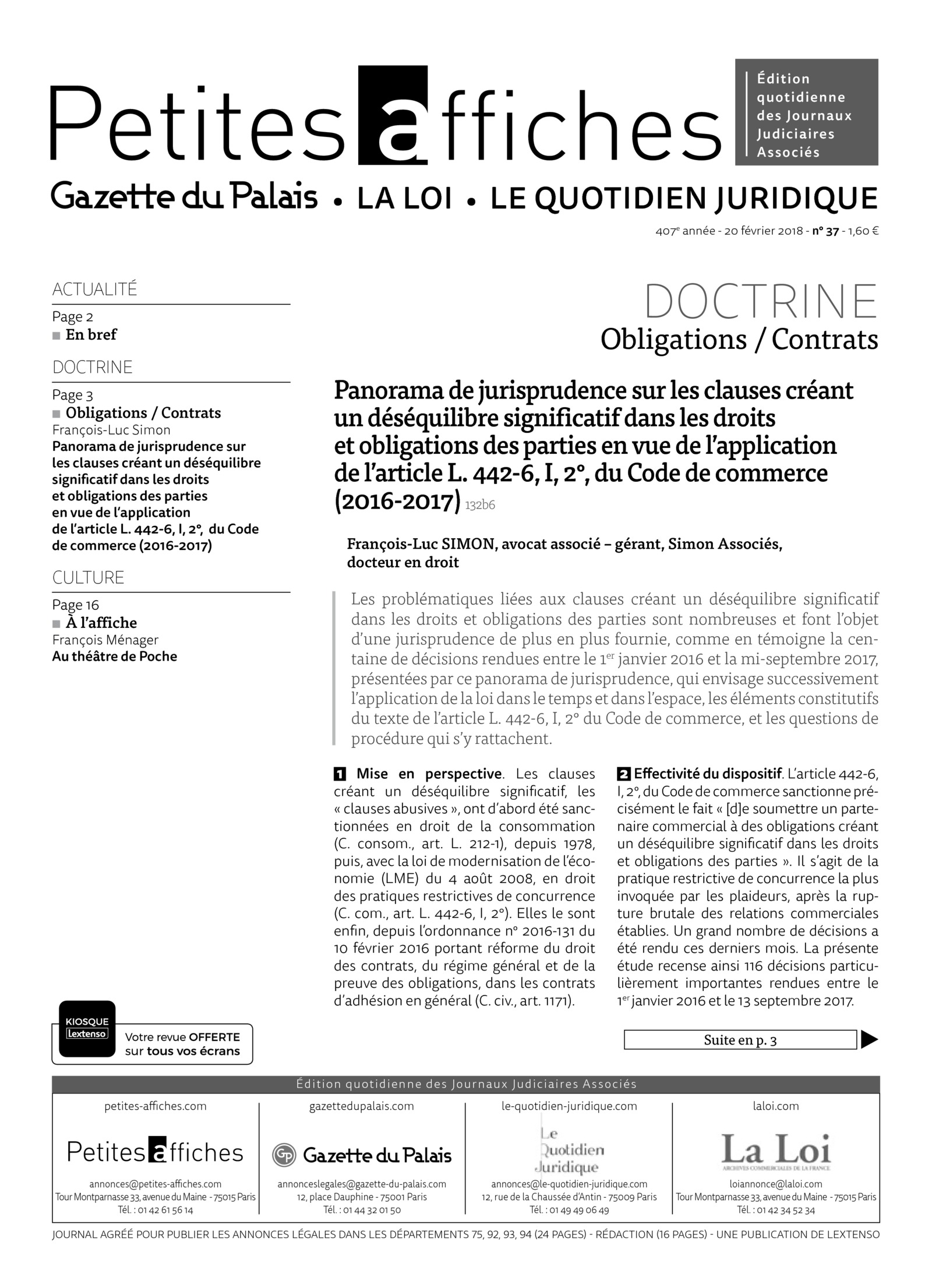Au théâtre de Poche

Pierre et le loup

Pierre et le loup
Tertullien
Ressusciter un théologien chrétien quasi oublié et adapter pour le théâtre un texte latin à première vue anachronique est pour le moins singulier. Hervé Briaux l’a fait en choisissant dans l’œuvre abondante de Tertullien son Traité contre les spectacles, qu’il avait donné dans un salon du château de Villerville et qui avait retenu l’attention d’une critique enthousiaste. Le singulier spectacle est repris au théâtre de poche Montparnasse, à 19 heures. Pourquoi cet intérêt nouveau ? Sans doute à cause de la puissance de son style et de sa pensée. Il a laissé de nombreuses maximes comme celle qui inspira Kierkegaard et Simone de Beauvoir : « On ne naît pas chrétien on le devient », son fameux « credo quia absurdum » ou cet hymne à la foi : « C’est certain parce que c’est impossible ». Sans doute aussi par la résonnance de ses imprécations et de son fanatisme avec les excès contemporains. Il ne cherche pas à démontrer, refuse toute discussion, toute tolérance, il vocifère et ses cibles sont nombreuses. La cible ici choisie est celle des spectacles et du théâtre en particulier. L’art est une tromperie, la fiction un mensonge diabolique qui séduit et infecte l’âme, la création ne peut être que divine et c’est profaner dieu que d’admirer de fausses idôles, derrière lesquelles se tient l’Autre, Satan le victorieux : « Ne va jamais au théâtre. Tiens-toi loin de cet endroit où grouillent tant de démons ». Durant une heure, Hervé Briaux, costume sombre, voix grave, regard mi glacial mi malicieux transmet ces imprécations d’une violence admirable autant qu’inquiétante et réussit ce que Tertullien vomissait : séduire. Il résume parfaitement le parti qu’il a pris : « À son absolu fanatique j’oppose un absolu de théâtre. Je fais de l’adversaire du théâtre un personnage de théâtre ». Et remarquable est la liberté qu’il a eu raison de s’octroyer dans la traduction-adaptation. La rencontre avec ce père de l’Église — qui pour les exégèses, n’en est pas un — et avec un texte ésotérique devient, grâce à la perspicacité, l’intelligence et le talent du comédien, un face-à-face qui met le spectateur dans une sorte de sidération. C’est trop en trop peu de temps et on a envie de poursuivre seul ou à plusieurs, la disputatioque refusait l’auteur.
Le souper
À 21 heures, après une pause au bar du théâtre, un autre spectacle mérite d’être vu, il s’agit de la reprise de la pièce de Jean-Claude Brisville : « Le souper ». Cet éditeur amis des auteurs poursuivait en même temps une riche carrière littéraire donnant au théâtre plus de dix pièces la plupart assurées d’un beau succès ce qui est la cas de ce « souper », créé en 1989 avec les deux Claude, Rich et Brasseur, et repris souvent ensuite notamment par Niels Arestup et Patrick Chesnais. On retrouve ici Daniel Mesguish et son fils William, qui s’étaient déjà affrontés dans un autre entretien de Jean-Claude Brisville, celui de Descartes et de Pascal « le jeune ». En une soirée, le 6 juillet 1815 et autour d’un souper en tête-à-tête la réponse va être donnée à une question capitale : qui va gouverner la France après la défaite de Waterloo le 18 juin 1815, l’abdication de Napoléon deux jours plus tard, le prompt retour de Louis XVIII et les émeutes populaires en faveur de la République. Deux hommes vont en décider au cours d’un souper. Ainsi en est-il du destin des nations et des guerres meutrières, le destin des masses devenu un jeu à quelques partenaires. Il s’agit ici de deux grands squales de la politiques au destin exceptionnel : Talleyrand et Fouché. L’aristocrate a sauvé sa tête lors de la Révolution, alors que Fouché a ordonné les pires atrocités à Nantes et Lyon ; Napoléon les a promus ministres. Le premier souhaite le retour du roi, le second soutient la République et a la police à son service. Le tête-à-tête au domicile de Talleyrand, rue Saint Florentin à Paris, décidera du sort de la France car le retour du roi ne se fera que si la police maîtrise la rue et si les anciens révolutionnaires y trouvent leur compte. Ce « souper » est un petit bijou d’élégance. Le texte de Jean-Claude Brisville, coulé dans le style de l’époque, a fait l’unanimité quant à sa subtilité littéraire, son sens des formules, son art de coller aux caractères des personnages : le « diable boîteux » est un aristocrate et le « féal régicide » sort de la « petite bourgeoisie », rien de commun dans leur façon de parler comme de se comporter. L’interprétation des Mesguich père et fils et la mise en scène signée par le premier tiennent compte de cette distance. Daniel Mesguich donne un Talleyrand savoureux, toujours maître de lui, dont le sourire de bonne éducation fait oublier le regard souvent glacial. C’est un Jean d’Ormesson jouant les Raminagrobis. Son art est celui de la séduction et il en joue sans grand succès, auprès d’un Fouché froid, passionné, délibérement colérique et mal élevé, joué avec conviction par William Mesguich, plus au premier degré que son père. Pas de soumission, Fouché ne cédera sur le retour du roi qu’aux toutes dernières minutes, après avoir réalisé que son avenir politique en dépend… La mise en scène de Daniel Mesguich est alerte, pleine de subtilités, mettant en valeur le texte vif et piquant, jouant avec les silences, les intonations, l’humour à la française, la complicité des deux fauves.