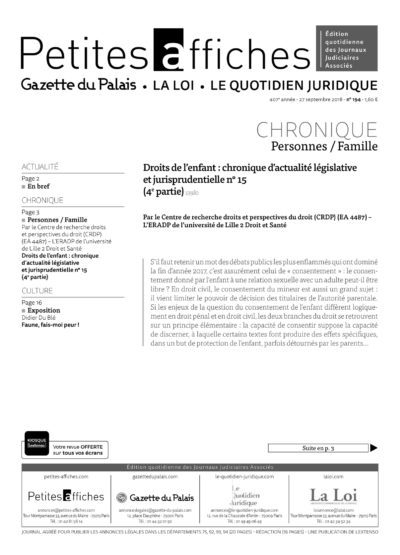Faune, fais-moi peur !

Paul Dardé, Grand Faune, musée de Lodève
DR
Dans la mythologie gréco-romaine, les faunes et les satyres appartiennent au même monde : celui des êtres mi-humains, mi-animaux, et ils sont proches des dieux olympiens. Cependant, ils résident sur terre, dans les bois et les montagnes, des espaces pastoraux où la vie animale échappe au contrôle des cités. Ce ne sont en aucune façon des héros. Chez Ovide, ils sont regroupés avec les sylvains, habitants des bois, ou les nymphes, divinités des sources.
Les faunes descendraient de Faunus, roi du Latium, petit-fils de Saturne, et père de Latinus. Ainsi, ils seraient des êtres divins, inscrits dans le cours de l’histoire romaine, et bien ancrés dans le monde latin. Quant aux satyres, leur généalogie n’est pas vraiment établie. Selon Nonnos de Panopolis, un poète épique du IVe siècle de notre ère, ils seraient les fils d’Hermès et d’une nymphe. Mais il ne faut pas les confondre comme le firent les Romains.
Représentation mythique, le faune est une figure du monde archaïque, un être hybride, espiègle, érotique. En choisissant cette thématique, le musée de Lodève a souhaité faire dialoguer des œuvres d’époques et de techniques différentes, pour montrer à quel point ce personnage de la mythologie a fasciné les artistes de tout temps.
Dessins, estampes, peintures ou sculptures, du Ve siècle avant notre ère au XXe siècle, nous proposent différentes représentations du faune qui inspira le poète Stéphane Mallarmé, le compositeur Claude Debussy ou le danseur Vaslav Nijinski. Le faune est facétieux, parfois tendre ou enfantin, comme le représenta Picasso.
L’exposition est organisée en trois sections. La première nous montre la connotation d’espièglerie érotique du faune. Symbole de fécondité dans la mythologie latine, le faune est viril et il est toujours associé avec les nymphes qu’il s’amuse à surprendre et tente de séduire. On rencontre également des variantes où le faune est associé à Vénus ou à Antiope. Le rapt, l’enlèvement de nymphes, constitue un autre aspect de la représentation.
La deuxième section est consacrée aux fêtes dionysiaques. Le faune, compagnon de Bacchus, est fréquemment assimilé à la vigne et à l’ivresse. Il est l’un des principaux protagonistes des Bacchanales. Cette alliance entre la faune et le vin a une place particulière dans les représentations avec Silène. Mais le faune peut être l’intercesseur entre le monde sauvage et le monde civilisé ; il effraie les bergers et les voyageurs. Très rusé, il se cache dans son milieu, la forêt, pour surprendre l’homme qui y passe. Dans une fable d’Ésope, L’homme et le satyre, nous voyons la sagesse face à la duplicité de l’homme civilisé.
La troisième section est consacrée à l’inspiration qu’apporta le faune dans les arts. Certains historiens assimilent le nom de faune à deux mots hébreux désignant les masques dont on se servait dans les fêtes de Bacchus et dans les comédies satyriques.
Poètes, musiciens, peintres, sculpteurs et décorateurs, se sont saisis de cet être fantastique, objet de multiples fantasmes. Le poème de Stéphane Mallarmé, L’Après-midi d’un faune, l’illustre parfaitement. Tout comme Faune musicien et danseuse de Pablo Picasso, ou Pan et Syrinx de Michel Dorigny (1616-1665).
Les artistes, au cours des siècles, ont écrit les chapitres de son histoire, avec leur vison, leur fantaisie, leur inventivité, en se référant à une antiquité fantasmée. Le faune a donc divers déguisements, divers masques, et chaque artiste nous propose le sien.