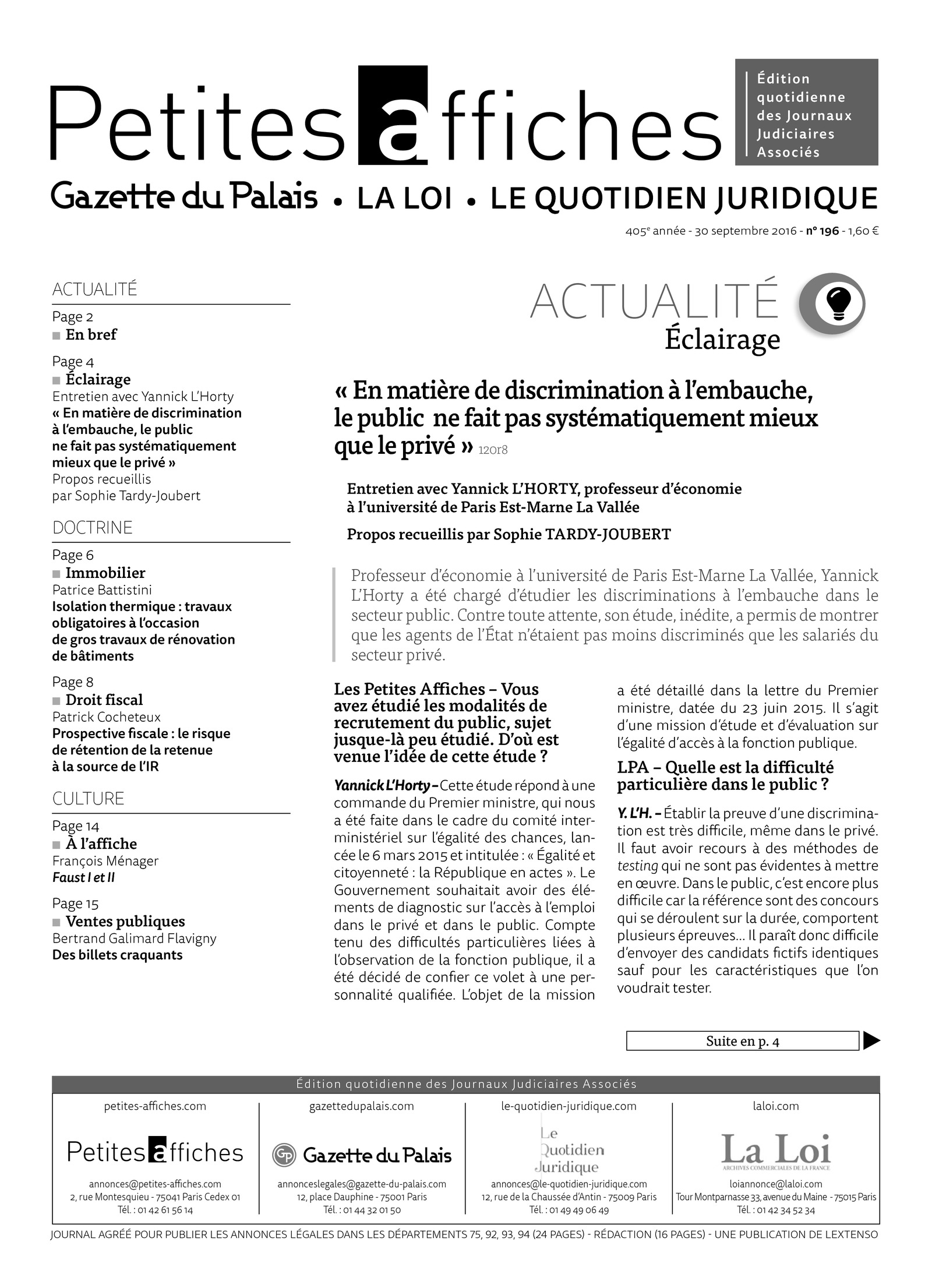Faust I et II
Le Théâtre de la Ville, contraint – pour cause de travaux – de se produire sur différentes scènes parisiennes, ne pouvait trouver un meilleur espace que celui du Châtelet pour représenter le très singulier Faust imaginé par Robert Wilson et interprété par le prestigieux Berliner Ensemble sur une musique de Herbert Grönemeyer. Une fois de plus s’affirme la complicité entre le metteur en scène américain et la scène mythique berlinoise et celle entre son directeur Claus Peymann et Emmanuel Demarcy-Mota qui, dans son Théâtre de la Ville, l’accueille régulièrement depuis 2010.

Faust réinterprété par Robert Wilson.
Lucie Jansch
Robert Wilson avait déjà rencontré Faust, mais sans Goethe. Il avait mis en scène le Dr Faustus Lights the Lights de Gertrude Stein, le Black Rider de Tom Waits et, à l’opéra, le Faust de Manzoni d’après Thomas Mann et celui de Gounod, et voici qu’après ces « échauffements » il ambitionne de représenter les deux Faust de Goethe et de leur donner la dimension d’un opéra dans la tradition du duo Bertolt Brecht et Kurt Weill.
Il s’est donné carte blanche pour transformer en toute liberté l’œuvre célèbre, trancher dans les 12 111 vers de l’original (qui avait donné lieu à un spectacle de 21 heures quand Peter Stein l’avait monté dans son intégralité à Hanovre en 2000) et choisir la forme de l’opéra-bouffe ou plutôt de l’opéra-pop, faisant appel au comédien-compositeur Herbert Grönemeyer, qui avait déjà travaillé avec lui pour Léonce et Léna.
Une fois de plus, c’est une réussite magistrale de ce théâtre total hors du commun qu’il sert opiniâtrement avec succès depuis si longtemps. Il ne faut certes pas s’attendre à un rendez-vous avec l’émotion ou la philosophie, la fille séduite et l’infanticide sont des personnages secondaires, le pacte avec le diable ne conduit pas à la réflexion métaphysique, et la magie de la poésie doit être recherchée hors du texte, lui aussi secondaire.
Mais comme Goethe qualifiait son œuvre d’« étrange édifice » fait de « plaisanteries sérieuses », il est à parier qu’il aurait aimé cette danse sabbatique effrénée, ce parti pris de l’intimité fusionnelle entre un Faust – ou plutôt quatre Faust – et un Méphistophélès devenu une sorte de rock star vieillissante, cette alchimie fuyante entre le bien et le mal, la raison et la démesure, la sagesse et les turpitudes, et cette réconciliation dans l’allégresse et les brins de folie.
Sans doute y a-t-il des longueurs et quelques pertes de rythme, mais l’ensemble est grandiose. Tous les artifices sont ici réunis, ceux des lumières et du son, ceux du contraste entre le trop-plein et l’épure en une succession de tableaux d’une beauté à couper le souffle, ceux du bizarre, parfois du saugrenu, des inventions avec notamment un curieux robot, les vidéos géantes de courses d’animaux sauvages, tant et tant de créativité poétique (image servante du texte ou plutôt l’inverse ?). Tant et tant… impossible à décrire.
La musique de Grönemeyer est à l’unisson, chatoyante, sophistiquée, mélodique, superbe. Quant à la troupe de comédiens du Berliner Ensemble, leur énergie et leurs talents multiples de chanteurs, mimes, acrobates… provoque une fois de plus l’admiration. Et que dire de la performance, quatre heures durant, de Christopher Nell, un Méphisto frénétique, présent presque en même temps aux quatre coins du plateau, et qui mène en grand magicien, joyeusement pervers, le sabbat dionysiaque dans un désordre savamment ordonné par un grand architecte.