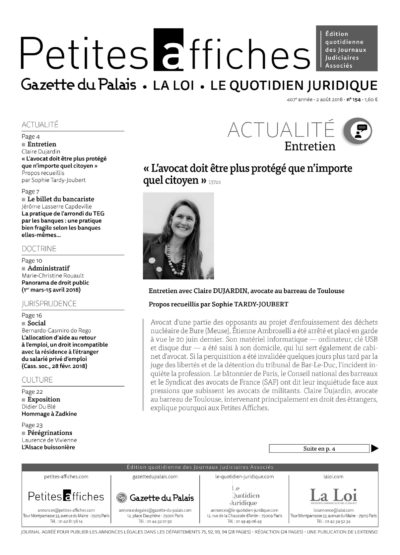Hommage à Zadkine

DR
À deux pas du jardin du Luxembourg, le musée Zadkine offre un petit écrin de verdure et de sculptures. Il fut rénové en 2012, pour être au plus près de l’esprit d’atelier où Zadkine travailla et habita, les pièces de la collection dialoguant merveilleusement dans un décor dépouillé et sous la lumière des verrières. Nous sont présentés des plâtres, des terres, des bois et des pierres, des œuvres qui s’échelonnent sur près de quarante ans de création.
Ossip Zadkine naquit à Vitebsk en 1890 mais il passa son enfance à Smolensk. Après un séjour de deux années en Angleterre, il décida de venir à Paris à l’automne 1909. Dans un premier temps il s’installa à la Ruche, puis rue de Vaugirard et rue Rousselet. C’est en 1928, qu’il s’établit rue d’Assas. Il côtoya Amedeo Modigliani, Blaise Cendrars, Max Jacob ou Henri Miller. Dès les années 1920, Zadkine acquit une certaine réputation et une dimension internationale. À la déclaration de la Seconde Guerre mondiale il partit aux États-Unis, où il enseigna. Il poursuivra cette activité à son retour à Paris, en 1945, à l’académie de la Grande Chaumière.
Tout comme Modigliani, Lipchitz ou Archipenko, Zadkine rechercha, dans les années 1910-1920, une manière personnelle pour la construction des formes. Rejetant l’académisme et l’influence prégnante de Rodin, Zadkine puisa dans l’archaïsme et le primitivisme. Il était plus attiré par la disproportion, l’ellipse et la simplification des plans. Ses œuvres de jeunesse comme l’Hermaphrodite, Les vendanges ou La sainte famille, procèdent d’un répertoire slave. En revanche, la Tête aux yeux de plomb ou Léda, qui montrent une synthèse des plans, sont inspirées par l’art africain et l’art des Cyclades. Zadkine avait l’aptitude de tirer parti des imperfections de la matière.
En parcourant l’enfilade des pièces, nous croiserons un ensemble de huit pierres calcaires, réalisées entre 1920 et 1930. Leurs thèmes sont la musicienne et la femme à l’oiseau, récurrents dans l’œuvre de Zadkine. Un grand plâtre polychrome représentant la figure d’une Rebecca, dite aussi Grande Porteuse d’eau. Cette sculpture est haute de trois mètres, et elle fut moulée à même le bois de cormier dans lequel Zadkine la tailla.
Le jardin est la respiration de ce musée. Des sculptures y sont installées ici et là, telles la Naissance de Vénus, Mélancolie, Orphée ou La Poétesse. Ces œuvres s’inscrivent dans un style néo-classique, style qui s’affirma chez Zadkine au début des années 1930, quand il fit, en 1931, un voyage en Grèce. Zadkine eut alors une attirance pour les sujets mythologiques et il eut recours à des éléments empruntés à l’Antiquité. Mais nous remarquerons des réminiscences cubistes, avec un jeu des volumes concaves et convexes. Son projet de Monument à Guillaume Apollinaire est vraiment représentatif de cette période ; il est l’un des quatre que Zadkine projetait à la fin des années 1930, pour rendre hommage aux poètes qu’il admirait.
À l’autre bout du jardin, nous remarquerons deux bronzes : Orphée et le Monument de la Ville détruite. Ils sont placés au pied des grands sycomores, un emplacement qu’avait souhaité Zadkine pour eux. Le Monument de la Ville détruite, fut érigé dans le port de Rotterdam, en 1953, symbolisant la destruction de cette ville par les bombardements allemands, en 1941. Avant son décès, en 1967, il réalisa deux plâtres, Sculptures pour l’architecture, qui montrent son goût pour le renouvellement des formes. Ces deux œuvres sont dans un style quasiment abstrait.