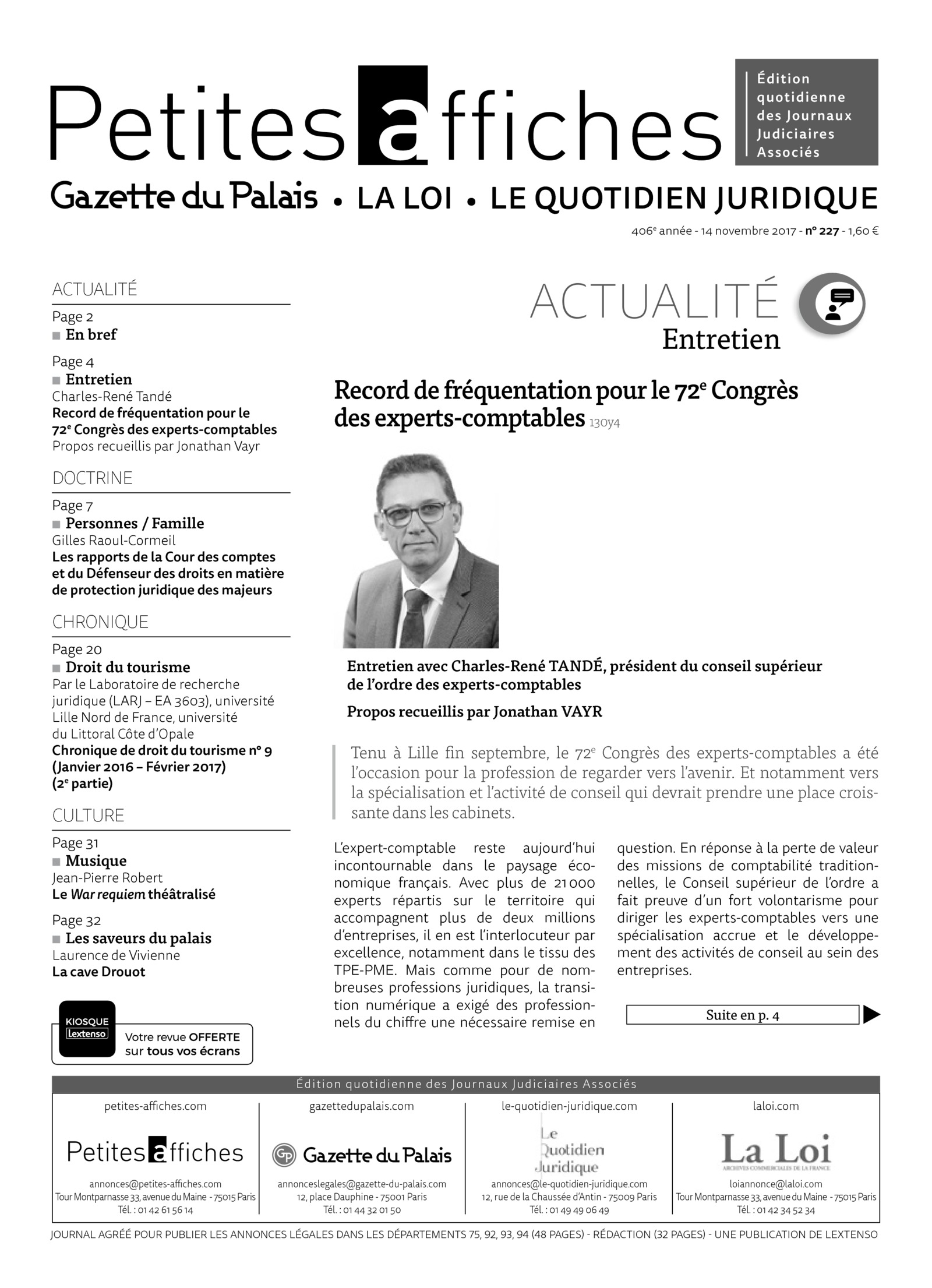Le War requiem théâtralisé

Le War requiem à l’Opéra de Lyon.
Stofleth
Une des œuvres maîtresses de Benjamin Britten, le War requiem, véhicule deux éléments essentiels de sa pensée : la soif de pacifisme, présente à bien des égards dans ses opéras antérieurs, comme l’horreur des conflits armés dont sa génération était témoin depuis la déflagration de la Seconde Guerre mondiale. Commandée pour les célébrations de la consécration de la cathédrale de Coventry, bombardée par les armées ennemies en 1940, l’œuvre, créée le 30 mai 1962, se veut aussi bien un mémorial pour les morts des deux guerres mondiales qui ébranlèrent le XXe siècle qu’un vibrant appel à la paix. Pour ce faire, le musicien a conçu un requiem qui mêle l’Office des défunts et des textes séculiers, en l’occurrence des poèmes du jeune auteur anglais Wilfred Owen, tombé au front de la Somme en 1918. En un schéma tripartite : une première strate, celle de la Messe des morts proprement dite, confiée au grand orchestre symphonique et à une soprano, une deuxième — au plan humain — à un ténor et un baryton s’exprimant sur les poèmes de Owen, accompagnés par un orchestre de chambre, et le troisième — au plan surnaturel — dévolu à un chœur d’enfants et à l’orgue. À travers la poésie d’Owen, l’œuvre se teinte de compassion par-delà la révolte et la lamentation. La justesse et le ton original des poèmes transforment la Messe des morts en un immense acte d’espoir. Dernière remarque, et non des moindres, la pièce a été écrite pour des interprètes spécifiques représentant chacun une des nations concernées dans le second conflit mondial, un Anglais, le ténor Peter Pears, et un Allemand, le baryton Dietrich Fischer-Dieskau, auxquels s’ajoutait la soprano russe Galina Vichnevskaïa.
Conçue pour le concert, l’œuvre ne se prêterait-elle pas à la scène ? C’est le pari tenté et réussi pour l’Opéra de Lyon par Yoshi Oïda. Le metteur en scène japonais qui s’est déjà confronté au défi de théâtraliser des œuvres non théâtrales, avec Le voyage d’hiver de Schubert, a tiré le suc de ce qui est fondamentalement dramaturgique. Il place l’orchestre de chambre comme le chœur d’enfants sur scène, de chaque côté, et les chœurs en fond, le tout laissant saillir au milieu du plateau une aire où vont se dérouler les divers épisodes d’une trame réimaginée au fil des six sections de la messe. Car c’est bien de trame qu’il s’agit : deux soldats ennemis, un Anglais, un Allemand, confrontés à la même horreur de la guerre, se rejoignent dans une même dénonciation de son ineptie et se confrontent, bravaches, avec la mort, tandis qu’une femme est dévastée par pareil désastre. Yoshi Oïda unifie les trois strates en un tout cohérent. Une vraie et nécessaire complémentarité s’établit entre la foule des anonymes, les enfants et les trois personnages. Il brosse des tableaux impressionnants où chaque geste, chaque mouvement fait sens. Comment ne pas être ému par l’humanité qui anime ces soldats que pourtant tout sépare, qui en réalité n’ont jamais été si proches dans la douleur et ne se haïssent peut-être pas ? « Était-ce pour en arriver là que l’argile leva ? », lance l’Anglais. Les images sont saisissantes, rehaussées par des éclairages spectraux, et vous empoignent par leur justesse. Ainsi, à l’Offertoire, de la scénette façon théâtre de marionnettes (joli clin d’œil à la cité de Guignol !), reprenant le sacrifice d’Abraham. Ou plus tard, au Sanctus, de ces drapeaux des nations en conflit qu’on empile sur un cercueil, celui de quelques soldats inconnus, et dont on va envelopper chaque petite victime qui en est extraite ; fascinant rappel du poème clamé plus haut à l’Offertoire : « Le vieil homme… tua son fils, et la moitié des enfants d’Europe, un par un ». La dernière sera enfouie dans l’Union Jack par la femme. Espérance de réconciliation enfin, au Libera me, lors du bref duo des soldats d’où jaillit un sentiment de mutuelle compassion.
Cette production révélatrice est servie par une interprétation musicale digne d’éloges. L’urgence héroïque, la désolation, la peur panique, la joie fugace qu’exprime la musique, l’orchestre de l’Opéra de Lyon, conduit par son nouveau chef permanent, le jeune Daniele Rustioni, les forge magistralement. Les chœurs et la maîtrise, pareillement inspirés, délivrent un chant habité jusque dans des fins de phrases longuement tenues en résonance. Les trois solistes se hissent au premier plan : Ekaterina Scherbachenko, beau soprano traversé d’éclairs de révolte, rongée par l’abattement, Paul Groves, ténor expressif, poignant acteur d’un drame qui dépasse le soldat anglais valeureux, Lauri Vasar qui prête à l’allemand de fiers et déchirants accents et tend la main à celui d’en face malgré l’écroulement alentour.