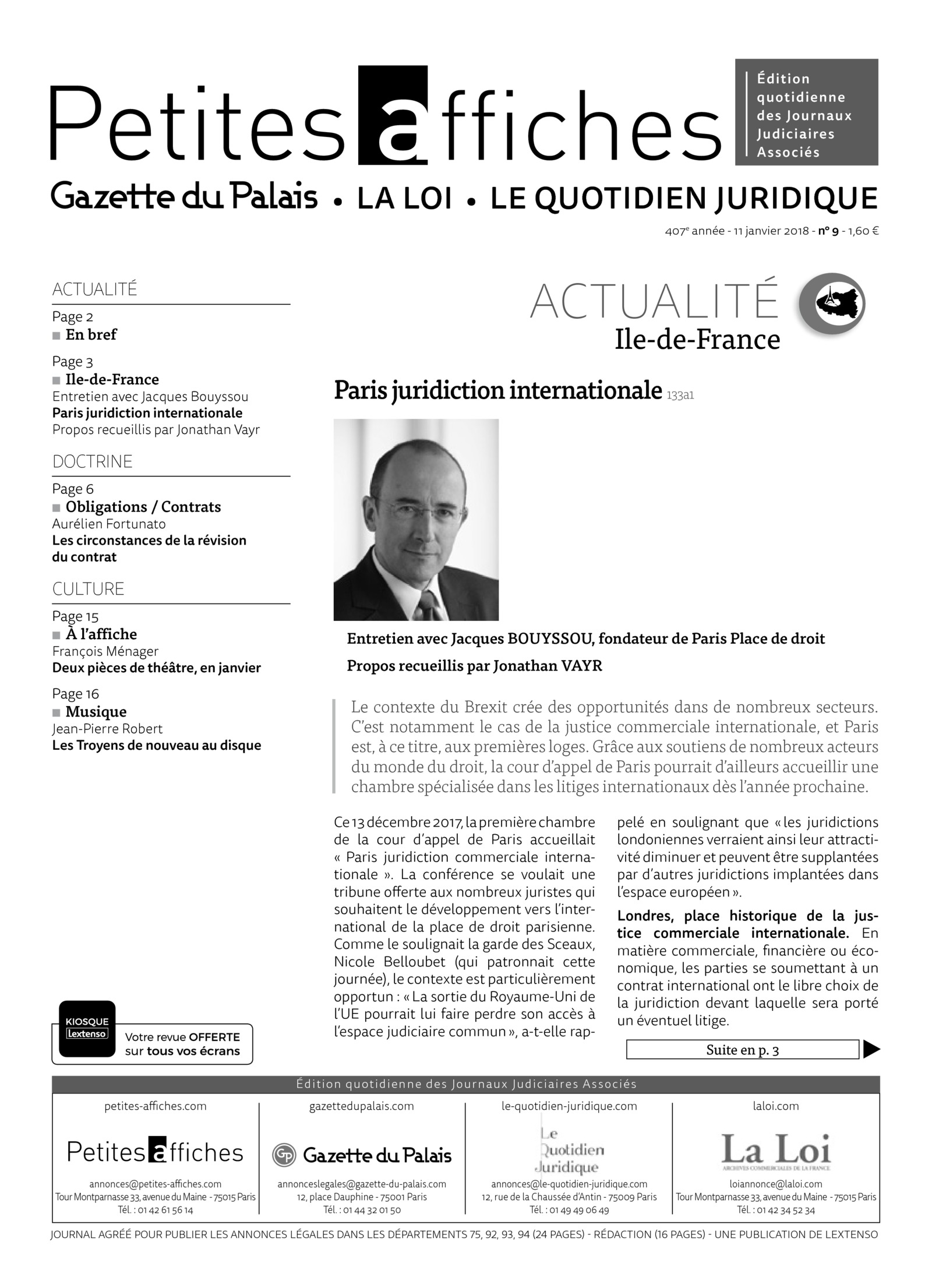Les Troyens de nouveau au disque

DR
Les exécutions marquantes du Grand opéra Les Troyens, de Hector Berlioz, ne sont pas légion. En ces temps de disette opératique au disque, cette nouvelle venue fait figure d’événement. Hector Berlioz a très tôt été fasciné par L’Énéide, de Virgile, et il n’est pas étonnant qu’il s’y soit directement référé pour y puiser son propre texte, sans faire appel à quelque librettiste. Cette immense fresque a quelque chose de shakespearien, ne serait-ce que dans la juxtaposition de scènes éminemment contrastées. Les passages de la guerre de Troie et de la rencontre de Didon et d’Énée à Carthage hanteront longtemps Hector Berlioz avant que mûrisse ce chef-d’œuvre unique dans l’histoire de l’opéra français du XIXe siècle. Ses deux longues parties en témoignent : La prise de Troie (actes I & II), et Les Troyens à Carthage (actes III, IV & V). Mais la monumentalité ne doit pas effrayer. La partition la plus audacieuse de son auteur veut atteindre, comme il le souligne dans ses Mémoires, « la vérité simple, la grandeur sans enflure, la force sans brutalité ».
L’œuvre rencontre chez John Nelson un goût inné pour l’idiome berliozien. Pour ses sonorités étranges empruntées à un instrumentarium rare et ses timbres aux couleurs spécifiques. Pour ses enchaînements singuliers, voire inattendus, témoins des grandes convulsions romantiques, ses tournures originales et vagues envahissantes d’une musique inextinguible, ce parfum de nostalgie baignant plus d’une page de poésie frémissante. L’aspect visionnaire, il le ménage au fil des ruptures de rythme, qui souvent semblent interrompre le récit alors qu’elles en révèlent les divers soubresauts, et de cette succession de tableaux intimistes et d’ensembles grandioses qui architecturent la partition.
L’Orchestre philharmonique de Strasbourg développe une sonorité d’une belle finesse française, dont les cuivres, tout en rondeur. La contribution chorale, combien déterminante ici pour incarner ces foules tour à tour affligées ou vindicatives, est elle aussi remarquable. Pas moins de trois formations ont été réunies : les Chœurs de l’Opéra national du Rhin, le Chœur philharmonique de Strasbourg et le Badischer Staatsopernchor de Karlsruhe.
On est admiratif devant la qualité de la diction des solistes au soutien d’une interprétation de grande classe. Le challenge était de distribuer l’opéra à des voix françaises. Pari osé, mais tenu car, à l’exception des rôles de Didon et d’Énée, distribués à deux américains, c’est la fine fleur du chant français qui est à l’honneur, pour la plupart assumant de surcroît une prise de rôle. À commencer par Stéphane Degout dont le timbre évolue désormais vers une couleur plus sombre, solide Chorèbe, idéalement projeté. Puis les basses Nicolas Courjal, majestueux Narbal, Jérôme Varnier et Jean Teitgen. Ou les ténors, qui par une ligne de chant immaculée, illuminent les parties de Iopas (Cyrille Dubois) et d’Hylas (Stanislas de Barbeyrac). Le beau timbre de Marianne Crebassa adorne la partie d’Ascagne d’une authentique aura de jeunesse. La Cassandre de Marie-Nicole Lemieux a fière allure. Le charisme de l’artiste, qui ne se ménage pas, porte le personnage, même si, à l’occasion, elle est taxée par le registre aigu du rôle.
Joyce DiDonato est une Didon passionnée et vibrante d’humanité. Un art inné de la déclamation française lui permet d’insuffler à la reine de Carthage des accents grandioses puis à la femme éplorée, d’autres, bouleversants. Le Monologue du suicide, plus que déchirant, atteint le pathétique et l’air « Adieu, fière cité » est d’une justesse de ton, d’une noblesse qui transfigurent littéralement le personnage, concourant à porter à l’incandescence la fin de l’œuvre. Michael Spyres est un Énée dont le timbre clair, éclatant, satisfait toutes les exigences de vaillance et de lyrisme de ce rôle délicat. Typique des compositions du XIXe siècle, à la fois proche de Rossini par les exigences de la quinte aiguë et d’un Meyerbeer par l’intensité de la ligne, sans parler de l’endurance. Le portrait s’accomplit au fil des scènes jusqu’au récitatif « Inutiles regrets » et à l’air final atteignant une réelle grandeur. Les deux chanteurs américains avaient, lors du duo « Nuit d’ivresse et d’extase infinie », distillé à la fois tendresse et exaltation en une union frôlant l’idéal.
L’enregistrement live – tour de force en l’occurrence – effectué lors d’exécutions de concert en avril 2017, à Strasbourg, offre un indéniable avantage. Car l’engagement palpable de chacun ne se dément pas de la première à la dernière note de cette immense fresque qui a peu d’équivalent dans le répertoire.