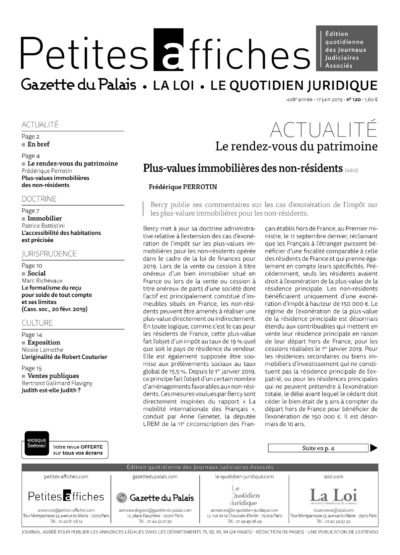L’originalité de Robert Couturier

Le Guerrier, par Robert Couturier.
Adagp, Paris 2019
Ce sculpteur figure parmi les plus importants du XXe siècle, mais sa discrétion, son indépendance expliquent qu’il soit moins connu du grand public que Rodin, Maillol, Bourdelle ou Giacometti.
L’occasion est actuellement donnée de revoir une partie de son œuvre – 60 pièces – la galerie Dina Vierny.
Pour certains visiteurs, ce sera une découverte car il s’agit d’une création toute personnelle ; cet artiste s’est peu à peu éloigné des codes classiques tout en préservant l’essentiel…
En 1928, Robert Couturier fait la connaissance d’Aristide Maillol, il devient son élève puis son ami et, durant plusieurs années, il sera son meilleur disciple.
Durant cette période, il travaille volontiers la pierre et crée des sculptures réalistes aux formes pleines, chaleureuses ; c’est Fernande couchée en 1930, où l’on perçoit l’influence de son maître. Six ans plus tard, Le Jardinier, exécuté pour l’Esplanade du Trocadéro, est accueilli avec succès.
Mais au fil du temps, il se sent moins à l’aise dans la création néo-classique et c’est à partir des années 1945-1950 qu’apparaît davantage sa personnalité dans un art qui s’est évadé de toute référence. L’artiste aime maintenant travailler le plâtre, plus malléable, et qui répond mieux à son imagination créatrice.
Il affirme alors une réelle audace de conception. Les volumes des corps sont étirés au maximum, il n’hésite pas à réaliser des déformations plastiques assez proches de l’expressionnisme : bras et jambes démesurés, Robert Couturier allonge les corps dont il réinvente la forme sans la trahir. Ainsi vivent nus et couples.
L’important pour lui ce sont l’expression, la vie, la présence. Parfois il travaille davantage le modelé » (Faune jouant du pipeau, 1949).
Chez Robert Couturier, le corps obéit à des volumes maigres, anguleux, les seins et le ventre sont symbolisés par des boules ; le style est nerveux et affirme une virtuosité d’exécution.
Il pratique avec talent le sens de l’ellipse. Dans les années d’après-guerre, il renouvelle la figuration comme le fait Alberto Giacometti ; si ce dernier étire également les volumes, leur représentation diffère. Robert Couturier préfère souvent la ligne au modelé, bien qu’il ne le néglige pas totalement. Le vide et son organisation tiennent une place importante dans sa création ; en témoignent Fillette au cerceau (1952) ou la très intéressante Femme au fauteuil d’une grande invention, élégante et dans laquelle le sculpteur libère les volumes de tout ce qui est pesant.
Le sculpteur est en recherches constantes ; vers la fin de sa vie, il va inclure des objets de récupération dans ses plâtres trouvant dans cette association un autre moyen d’exprimer la vie.
Pour lui, la sculpture doit répondre à un désir parfois servi par le hasard. « Je n’aime pas les choses qui sentent la sueur. Au fond, la sculpture m’embête par certains côtés », disait-il avec humour. Et cependant, sa création obéit à un travail mais un travail dans le plaisir de modeler la matière, de la plier à son exigence plastique.
Il fut professeur à l’École des Arts Décoratifs puis professeur à l’École Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 1963, avant d’en devenir chef d’atelier de sculpture en 1966.
Robert Couturier a, comme Giacometti ou Germaine Richier, qui fut son amie, révolutionné l’art de son temps…