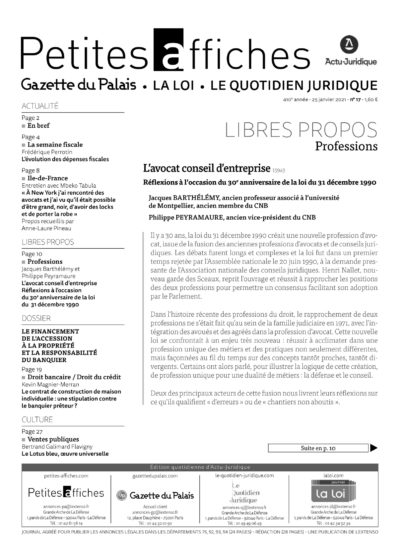L’avocat conseil d’entreprise
Il y a 30 ans, la loi du 31 décembre 1990 créait une nouvelle profession d’avocat, issue de la fusion des anciennes professions d’avocats et de conseils juridiques. Les débats furent longs et complexes et la loi fut dans un premier temps rejetée par l’Assemblée nationale le 20 juin 1990, à la demande pressante de l’Association nationale des conseils juridiques. Henri Nallet, nouveau garde des Sceaux, reprit l’ouvrage et réussit à rapprocher les positions des deux professions pour permettre un consensus facilitant son adoption par le Parlement.
Dans l’histoire récente des professions du droit, le rapprochement de deux professions ne s’était fait qu’au sein de la famille judiciaire en 1971, avec l’intégration des avoués et des agréés dans la profession d’avocat. Cette nouvelle loi se confrontait à un enjeu très nouveau : réussir à acclimater dans une profession unique des métiers et des pratiques non seulement différentes, mais façonnées au fil du temps sur des concepts tantôt proches, tantôt divergents. Certains ont alors parlé, pour illustrer la logique de cette création, de profession unique pour une dualité de métiers : la défense et le conseil.
Deux des principaux acteurs de cette fusion nous livrent leurs réflexions sur ce qu’ils qualifient « d’erreurs » ou de « chantiers non aboutis ».
Le 30e anniversaire de la loi du 31 décembre 1990 portant création de la nouvelle profession d’avocat coïncide curieusement avec la remise au garde des Sceaux du rapport demandé à Dominique Perben sur l’avenir de la profession d’avocat. Une nouvelle fois sont mobilisés des énergies et des talents pour ouvrir des perspectives et orienter des arbitrages sur notre avenir professionnel.
Ce n’est pas la qualité du travail qui interroge, mais la démarche : notre profession est-elle tellement immature et mal organisée pour qu’un énième rapport soit nécessaire ? Tous les talents qu’elle recèle en son sein sont-ils considérés comme incapables de se mettre au service du collectif, tant l’individualisme y règne en maître culturel ? Le contenu de ce rapport ne nous choque nullement et notre propos, en cet anniversaire, n’est pas de lancer une critique à son égard. C’est donc son existence et sa nécessité qui nous interpellent.
En notre qualité d’acteurs de la mise en œuvre de la loi du 31 décembre 1990 — l’un en qualité de vice-président de la Commission nationale des conseils juridiques, l’autre de président de l’Association nationale des conseils juridiques (ANCJ) — nous avons assumé, vis-à-vis tant des conseils juridiques que de l’ensemble des professionnels du droit et plus largement du monde économique, une responsabilité rare : faire disparaître une profession qui donnait satisfaction au marché, pour la fondre dans un ensemble sensé et permettre à ses membres de mieux se développer, tant en France qu’à l’étranger, en offrant un service plus complet.
L’objectif de mettre à disposition des entreprises françaises une profession du droit unifiée était séduisant, même si les obstacles d’un rapprochement, déjà identifiés, paraissaient difficiles à surmonter. En œuvrant à la réalisation de ce projet, nous, avec d’autres confrères représentants de l’ancienne profession de conseils juridiques, avons souhaité faire partager nos ambitions : l’amélioration de nos performances au profit du monde de l’entreprise et la consolidation de nos positions sur un marché en voie d’internationalisation.
Les anniversaires sont des moments privilégiés pour s’interroger sur la satisfaction de nos ambitions et faire part de nos réflexions à ce sujet. Certes nous représentions une profession spécialisée dans le conseil aux entreprises et nos options en étaient imprégnées. Pour autant, dès lors que l’on nous invitait à participer à la création d’une nouvelle profession, les principes que nous défendions méritaient autant de considération que ceux défendus par ailleurs, d’autant qu’ils étaient partagés par certains représentants de l’ancienne profession d’avocat, spécialement le « barreau d’affaires ».
Ainsi, chacun d’entre nous, à la lumière de son expérience, peut se faire une opinion. Mais l’analyse du passé n’a d’intérêt que si elle éclaire l’avenir. Notre exercice, pour être compris, sera donc exposé en fonction des thèmes tels qu’ils ont été posés à cette époque, en distinguant les erreurs d’appréciation commises lors de cette fusion des chantiers ouverts qui n’ont, depuis, pas ou peu évolué.
Il nous est apparu comme une évidence l’obligation de nous exprimer en raison de ce que la profession nouvelle n’a pas atteint le leadership dans ce qu’on a coutume d’appeler « droit des affaires », alors qu’il s’agissait de l’objectif principal de la création de cette nouvelle profession. Cela tient pour une bonne partie à l’identification de la profession d’avocat par l’activité judiciaire. II n’y a aucune critique sous-jacente dans ce propos, simplement le rappel d’une situation de fait, due sans doute à l’histoire et au poids de la pratique dominante. Cela crée des réflexes pavloviens excluant de fait, dans le déroulement de l’activité professionnelle, l’organisationnel et le préventif qui induisent le souci d’adaptation des normes au contexte et à son évolution ainsi qu’au projet d’un côté, la gestion prévisionnelle des risques que l’on prend dans le monde de l’entreprise avec des objectifs et des résultats attendus, d’un autre côté. Du reste sans pratiquer l’inventivité (chère à Jean-Marc Mousseron et à Jean Paillusseau, créateurs des DJCE), les honoraires ne sont pas une charge mais un investissement lié aux plus-values attendues. À cet égard il est important de souligner que se contenter de dérouler des règles, donc de donner simplement de l’information, ne pourra conduire très vite qu’à la paupérisation de la profession dès lors qu’avec les progrès des NTIC, spécialement le numérique et l’intelligence artificielle, le client non seulement aura le réflexe de l’accès direct à cette information, mais aura également accès à des structures qui lui délivreront également des prestations d’ingénierie juridique ou pluridisciplinaire.
I – LES ERREURS
Deux erreurs fondamentales – dont nous partageons avec d’autres la responsabilité – ont été commises au moment de la mise en place de la nouvelle profession :
-
la première concerne la formation, tant initiale qu’en cours de vie professionnelle, spécialement en ce qui concerne l’accès à une spécialisation. L’ambition en la matière a été volontairement limitée et, pire, on se donne l’illusion de la grandeur au travers d’institutions qui coûtent cher et copient mal l’université ;
-
la seconde est relative aux formes juridiques d’exploitation figées sur une mauvaise interprétation du concept d’indépendance technique caractéristique de toute profession libérale réglementée.
A. La formation
Le corporatisme ambiant dans toutes les professions libérales réglementées disposant d’un ordre, et spécialement dans celle d’avocat, incite fortement à disposer d’organes spécifiques. Nous avions anticipé les difficultés d’harmonisation des approches par la signature, à l’initiative de l’ANCJ, d’un accord réunissant toutes les organisations ordinales et syndicales. Malheureusement il n’a jamais fait l’objet d’un début d’application ni même servi de document de référence.
1. En matière de formation initiale, cela s’est traduit par une école du barreau qui coûte cher et dont l’efficacité reste à démontrer. Si une formation spécifique s’impose s’agissant de la déontologie (prise ici au sens large), on voit mal l’intérêt de reproduire l’essentiel de ce que la plupart des élèves avocats ont travaillé dans le cadre d’un DESS, d’un master avec des professeurs de droit alors qu’à l’école interviennent plutôt des avocats. Les efforts colossaux et l’énormité du temps investi, notamment au CNB, reste la démonstration de cette erreur originelle et de la difficulté à gérer rapidement la nécessaire évolution du système. Nous l’avons sous-estimé, sans doute parce que nous avions une logique différente : dans la profession de conseil juridique et avant même qu’elle ne soit réglementée, un partenariat étroit avait été établi avec certaines universités, essentiellement celles ayant créé un DESS DJCE dans lequel les grands cabinets (mais aussi d’autres) apportaient leur concours en complément des interventions de type plus scientifique. Une partie de l’ancienne profession d’avocat n’avait pas grande considération pour le niveau des conseils juridiques (malgré la présence de cabinets prestigieux) dont elle n’avait pas perçu l’évolution et a négligé voire combattu l’apport qui aurait pu être le nôtre.
2. Mais c’est surtout dans la concrétisation des mentions de spécialisation que ce qui a été mis en place est fortement critiquable :
-
L’accès à la spécialisation ressort d’une procédure insuffisante, limitée à un entretien avec un jury alors qu’il faudrait que soit mise en place une préparation dans le cadre d’un réel apprentissage assorti d’un mémoire présenté devant un jury. Au demeurant, on a tué les spécialisations en appelant leur titulaire « spécialisé en », alors que la seule significative, c’est « conseil en » en vigueur précédemment chez les conseils juridiques dans la mesure où, par cette appellation, on montre bien que l’avocature ne se limite pas à l’activité judiciaire. Mais surtout, on a multiplié le nombre des spécialisations, ce qui fait perdre au concept toute pertinence. Sans doute était-ce voulu par les nostalgiques de la profession d’antan ;
-
Le stage a été dépossédé de toute force dès lors qu’il intervient après l’accès au titre et il dérive dans une approche purement formaliste. Là encore, ce n’est pas neutre car être avocat avant le stage écarte le risque de qualification en salarié, donc les charges sociales payées par le cabinet. Et c’est bien ce qui a conditionné la solution !
Cette approche nous parait pénalisante pour les jeunes , dont la qualité de la formation, pourtant fondamentale, est laissée au hasard de l’affectation. Cela crée une véritable inégalité de chances pour eux, surtout s’ils n’ont pas la chance d’intégrer un cabinet structuré ou dont les responsables sont convaincus de cette nécessité. Mais depuis le départ cette approche a été inaudible car derrière la réalité d’un véritable stage contraignant il y a aussi un effet mécanique de régulation de l’accès à la profession.
B. Les formes d’exercice
L’activité de conseil juridique était concentrée non seulement sur le droit de l’entreprise, mais encore sur l’activité de conseil en organisation à partir de matériaux juridiques. D’où du reste les trois spécialisations « conseil en droit fiscal », « conseil en droit des sociétés », « conseil en droit social ». D’où, parce que cette activité de consulting nécessitait des réflexes de dirigeants d’entreprise, le recours aux sociétés classiques de capitaux simplement aménagées pour que soit respectée l’indépendance technique du praticien, mais aussi du salariat interne car l’activité de conseil qui se concrétise par de l’ingénierie juridique exige un travail en équipe.
1. Une partie significative de la profession d’avocat était totalement hostile à l’un et à l’autre
Les positions respectives des deux professions étaient profondément, voire philosophiquement différentes.
L’indépendance, caractéristique de notre profession, est mise en avant pour écarter la mécanique démocratique des sociétés de capitaux. Cela atteste d’un contresens majeur, à savoir que la notion est fonctionnelle. Or, c’est d’indépendance technique dont il s’agit, ce qui n’exclut ni la subordination juridique (qui s’exerce au plan des seules conditions de travail pour définir le salarié) , ni la dépendance économique qui n’exclut pas l’atteinte à l’égalité contractuelle. Aujourd’hui – et par réalisme – essentiellement pour favoriser, dans le secteur des professions libérales en général, l’efficacité économique dont la poursuite n’est plus considérée comme un comportement imposé (en apparence toutefois car il y a souvent un grand décalage entre les déclarations et les attributions ), on a adopté des solutions plus anciennes mais qui laissent subsister des interdictions auxquelles, fondamentalement, on peine à trouver des justifications.
2. Le « statut » du professionnel libéral collaborateur relève de la même philosophie
Dans la profession d’avocat, on n’admettait, avant la fusion, que le non-salariat, ce qui conduisait hélas parfois à des situations totalement anormales sur le terrain des droits fondamentaux, notamment celui des libertés. Encore aujourd’hui est très répandue l’idée que l’avocat salarié est un sous-avocat, ce qui n’exclut pas que, en cas de rupture des relations avec le cabinet, soit entrepris un combat judiciaire en vue de la requalification, ce qui ne se traduit qu’en dommages-intérêts pour absence de cause sérieuse de licenciement. Nous recherchons toujours le fondement éthique de cette approche…
Ce contexte sociologique a conduit à des conditions d’accès au salariat enfermées dans des règles formelles dans le seul but d’éviter que le cabinet subisse les conséquences financières de la requalification. S’inscrit dans cette même logique la volonté manifeste, au moment de la fusion, pour que l’avocat salarié relève du régime de retraite des non-salariés avec des conséquences, y compris sur le plan administratif, qui ont eu un coût élevé et ont créé des charges. C’est un peu contradictoire avec l’opposition de la profession au régime universel actuellement à l’étude par le gouvernement.
Et surtout a été posé en postulat que l’indépendance technique identitaire du professionnel libéral interdit de manière absolue le statut de salarié, ce qui est une absurdité non seulement juridique mais aussi d’ordre sociologique. Que la dépendance technique induise un haut degré d’autonomie au plan des conditions de travail, cela ne fait aucun doute mais alors il faut cultiver le régime juridique de la parasubordination pour passer de l’opposition irréductible entre salariés et indépendants à des statuts différents en fonction du degré d’autonomie, donc de responsabilité, ce que le droit italien avec les « co. co. co » et le droit allemand avec les leitente Angestellte reconnaissent parfaitement. Cette approche est à mettre en parallèle avec l’opposition – complètement surréaliste – à l’avocat en entreprise.
II – LES CHANTIERS NON ABOUTIS
Au-delà de l’examen de ces erreurs, cet anniversaire doit être également l’occasion de faire un état des chantiers ouverts en 1990, et jamais aboutis depuis.
La loi ne pouvait certes tout régler. L’intersyndicale créée alors entre l’ACAVI, la FNUJA et le SAF et l’ANCJ a demandé au garde des Sceaux d’inscrire dans la loi un certain nombre d’évolutions. Puis les arbitrages ont été rendus, et certaines demandes sont restées sans suite, par exemple l’incompatibilité des missions de contrôle et de conseil au sein d’ un même groupe ou l’exercice d’une activité comptable accessoire à l’activité fiscale.
D’autres sujets ont été considérés, faute d’un consensus suffisant, comme devant être renvoyés aux diligences des instances de la nouvelle profession… qu’on s’est empressé d’oublier de traiter ! Il en résulte aujourd’hui un certain nombre de déficiences.
A.Permettre une représentation pluraliste au sein du Conseil national des barreaux (CNB)
L’objectif était d’en faire un moteur des évolutions. La modification ultérieure du système électoral a confisqué l’élection au profit, alternativement, du barreau de Paris et de la Conférence des bâtonniers. Ce n’est pas un procès en légitimité que nous faisons ici, puisque cette situation trouve sa source en grande partie dans la faiblesse des syndicats, victimes de l’indifférence d’une partie du barreau à leur endroit, sauf pour des fins électorales. Ni même de l’opposition radicale de certains au motif que le seul organe représentatif est l’Ordre, notamment parce qu’élu par toute la profession. De ce fait, les ordres vont au-delà de leur vocation première – c’est à dire une mission d’intérêt général au nom de la préservation et la promotion des droits des usagers du droit, des clients du cabinet – et s’attribuent des prérogatives parfois difficiles à concilier avec leurs missions régaliennes. Celles-ci sont trop importantes : l’évolution des sociétés modernes n’est pas sans danger pour le conseil et la défense ; le rôle irremplaçable des ordres doit être protégé. La dispersion des ordres dans d’autres missions est un facteur de banalisation et donc d’affaiblissement de leur autorité. La captation du pouvoir au sein du CNB par les représentants ordinaux contribue à cet affaiblissement.
Les conséquences de cette orientation sont lourdes pour la profession : éparpillement des énergies, éclatement des légitimités, parcellarisation des approches et des réflexions. Qu’ils soient délivrés en interne ou vis-à-vis de l’extérieur, les messages ont du mal à être pris en compte. Le « handicap originel » est facile à identifier : les bâtonniers ne sont, dans leur grande majorité, pas préparés à s’occuper de l’ensemble des problèmes de la profession, et certains ne le souhaitent pas pour ne pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de leur « base ».
La faiblesse des syndicats prive la profession de corps intermédiaires qui canalisent les énergies, facilitent la formation des cadres, œuvrent pour la mise en cohérence des politiques professionnelles avec les souhaits de ses composantes et, disons-le, contrarient assez souvent les réflexes poujadistes qui existent dans toutes les professions libérales.
Les choses n’ont pas beaucoup évolué depuis 30 ans, malgré le formidable progrès que représente la création du CNB.
En tant que fondateurs d’un syndicat, nous n’avons jamais opposé institution ordinale et syndicats. Au contraire, nous pensons leurs actions complémentaires et nous formulons un regret, celui d’un manque de coopération… Au point que certains syndicalistes considèrent que la première fonction du syndicat est de permettre d’accéder au conseil de l’Ordre ! Loin de nous l’idée de sous-estimer l’importance des élections, fondamentales pour le fonctionnement de la profession. Mais il ne faut pas inverser les priorités et celles-ci ne sont que le moyen d’accéder à la promotion d’options et de stratégies professionnelles réfléchies. On nous pardonnera d’avoir la faiblesse de rendre ici hommage à l’action de l’ACE, seul syndicat issu du rapprochement de structures originaires des deux anciennes professions, au premier rang desquelles l’ACAVI présidée par Jean du Parc et l’ANCJ…

B. Capitaliser sur l’image de l’avocat-conseil
En matière de droit de l’entreprise, c’était l’un des enjeux de la fusion mais, en la matière, nous avions déjà beaucoup demandé à un garde des Sceaux soumis à de fortes pressions contraires : faire admettre le salariat, les sociétés de capitaux, les sociétés interprofessionnelles, le CNB, le régime des retraites avec compensations, la rénovation des pratiques dans un règlement intérieur unifié, l’incompatibilité entre les missions de contrôle et de conseil… D’où le renvoi de ce sujet aux instances professionnelles d’après-fusion qui s’est traduit par un fiasco total.
Pour de trop nombreuses entreprises la perception de l’avocat est restée figée dans l’arrêt sur image préexistant : il est et demeure l’homme ou la femme du contentieux. C’est, dans ce segment de marché, d’un effet dévastateur. Ce handicap d’image, allié à un désintérêt de la majorité de la profession fusionnée pour certains secteurs tels que la fiscalité d’accompagnement ou le conseil patrimonial, ont favorisé la récupération de ces marchés par d’autres, notamment les experts-comptables et les conseils en gestion de patrimoine, les conseils financiers ou encore certains cabinets de consulting. Dans le droit social, cela a entrainé une césure entre « avocats prud’homalistes » – dont l’activité est centrée sur le judiciaire – et « avocats-conseils », apportant leur concours à la construction de stratégies, qui subissent la concurrence de conseils en organisation, ce dont peu s’émeuvent.
L’image qui demeure de l’avocat, y compris dans les milieux économiques, et surtout dans celui des PME/TPE, est celle de l’homme et de la femme de prétoire. Ce constat n’est pas en lui-même porteur d’un jugement de valeur comme on le présume trop souvent, ce qui empêche tout progrès dans sa prise en compte. En 30 ans, l’image de conseil ne s’est pas imposée comme le deuxième pilier de la profession. Ou plutôt, celle qu’avaient les conseils juridiques s’est estompée ! Cette situation est surtout dommageable pour les petites et moyennes structures qui se consacrent prioritairement à cette activité. Les grandes structures, qu’elles soient françaises ou étrangères, sont suffisamment identifiées auprès de leur clientèle.
Sur un marché concurrentiel où interviennent les experts-comptables et d’autres professionnels, dont l’activité est réglementée ou non, la profession d’avocat se prive donc d’un vecteur de développement primordial.
C. L’avocat en entreprise
Lors de la préparation de la fusion, l’ANCJ avait tenté d’intégrer dans les réflexions les juristes d’entreprise. L’AFJE (Association française des juristes d’entreprises), y était favorable mais le barreau y était farouchement opposé. En outre, le CNPF d’alors a tout de suite marqué son hostilité et l’a fait très clairement savoir au président de l’ANCJ. Isolée, cette dernière a dû renoncer alors que dans les États voisins de la France, l’avocat peut être intégré à une entreprise.
Les mentalités ont évolué, et cet obstacle n’existe plus. Les difficultés viennent désormais essentiellement de la profession d’avocat. Certains reprennent les arguments qui avaient servi lors de la fusion : le salariat, la déontologie… C’est à dire, consciemment ou non, une vision théologique de la notion d’indépendance alors que celle du professionnel libéral n’est et ne peut qu’être celle de l’exercice de l’art dans un cadre déontologique défini. Nous n’avons pas constaté que des problèmes graves aient surgis dans ces domaines après le 1er janvier 1992. Dans cet interminable débat, il est inquiétant de constater que les éléments d’une stratégie à long terme intégrant les aspects internationaux sont systématiquement rejetés, sans véritable analyse des arguments lorsque les défenseurs de cette évolution les invoquent. On aboutit à une situation dans laquelle les avocats d’entreprises, les premiers concernés, défendent cette évolution sans en craindre les effets sur la concurrence alors que les adversaires sont trop souvent ignorants du fondement de cette évolution.
Si bien que certains attendent que la solution soit imposée de l’extérieur. Nous le regrettons car l’expérience nous a enseigné qu’il est préférable de maîtriser les évolutions plutôt que de les subir.
D. Maintenir une culture diversifiée
La profession de conseil juridique était née des besoins du marché du conseil aux entreprises, ignoré largement par la profession d’avocat centrée sur le judiciaire, et cette genèse avait entraîné l’émergence d’une culture particulièrement adaptée aux besoins des PME. Cette culture n’est pas neutre dans l’appréhension des attentes des opérateurs. Elle joua également un rôle dans l’évolution de la profession avant même qu’elle ne soit réglementée en 1971. Cela a provoqué des choix structurels (sociétés de capitaux, salariat) mais aussi en matière de formation (DJCE et DESS de conseil juridique par exemple) et de pratique des stages.
Cela s’est également traduit par l’organisation des cabinets afin de satisfaire les clients dans des segments d’activité à faible valeur ajoutée mais permettant la contractualisation d’assistances permanentes, c’est à dire une forme d’abonnement. Le mot n’était pas encore employé mais il s’agissait là d’une modalité d’externalisation de services juridiques que les PME ne pouvaient pas s’offrir en interne. Ainsi en était-il en matière de droit des sociétés, de droit social, de fiscalité.
Nous ne pouvons que constater que la présence de la nouvelle profession dans ce segment de marché n’a cessé de s’éroder, et que beaucoup de cabinets s’en désintéressent. Ce marché a été de ce fait largement récupéré par les experts-comptables et il n’est pas exagéré d’affirmer aujourd’hui qu’en ayant su s’adapter à ces besoins, ils ont, pour les satisfaire, recréé en leur sein une nouvelle activité de conseil juridique et fiscal. Aujourd’hui, les missions permanentes dans les PME sont très largement entre les mains de cette profession qui en profite pour capter, en complément, les missions de conseil à forte valeur ajoutée et conforte son image de conseil naturel des PME. Pour éviter toute confusion sur le sens de ce paragraphe, il est important de souligner que l’un et l’autre nous entretenons d’excellentes relations, notamment professionnelles, avec les instances tant ordinales que syndicales de cette profession comme avec de nombreux cabinets.
La fusion devait permettre d’armer la nouvelle profession d’avocat sur le marché du droit. Ce n’est pas la réalité dans toutes les activités et l’on peut craindre, par exemple, que l’exercice de la fiscalité par les avocats, au fil du temps, soit de plus en plus fragilisé.
E. Enfin, on ne peut conclure sans évoquer l’interprofessionnalité
La nécessaire diversité culturelle, indispensable au conseil d’entreprise, dépasse l’approche par discipline. C’est une philosophie de ce que l’on veut faire pour enrichir la profession d’avocat qui est en cause. Celle-ci n’échappe pas à une loi commune : cet enrichissement nécessite une bien plus grande ouverture en matière de formation et de recrutement. Dans notre approche, elle devait être le pendant de la fusion. Ce qui explique que la seconde loi de 1990 sur les sociétés d’exercice libéral créa les sociétés interprofessionnelles. C’était le thème du dernier congrès de l’ANCJ en 1991 à Versailles.
Depuis, c’est un euphémisme de dire que les débats se sont enlisés. Le dossier était pourtant bien lancé avec la signature, à notre initiative, d’une charte sous l’égide de L’UNAPL. Elle concernait les professions libérales règlementées et quelques autres dont la CNCEF. Ensuite, grâce à la Délégation interministérielle aux professions libérales, un rapport avait été présenté au ministre de la Justice au nom de la Commission de concertation par l’un des cosignataires. Ce rapport définissait les moyens à mettre en œuvre pour que les décrets d’application puissent intervenir.
Certaines professions de santé et les notaires étaient réservés. La profession d’avocat à enlisé le débat. Beaucoup de temps a été perdu (plus de 25 ans !) avant que de timides mais intéressantes avancées soient mises en œuvre. Mais les parts de marché envolées n’ont pas été perdues pour tout le monde. Le marché du droit de l’entreprise demande de la réactivité. Les avocats savent y répondre individuellement… mais ont négligé la mise en place de cet outil collectif d’une stratégie professionnelle !
En guise de conclusion
D’autres exemples des ambitions déçues pourraient être relevés.
Certains peuvent s’étonner de ces propos, signes sans doute d’une grande naïveté de notre part : nous avons cru en la stimulation du plus grand nombre par leur capacité à mettre leurs talents au service d’objectifs que nous pensions être partagés.
La civilisation du savoir qui se dessine peu à peu par suite de l’abandon progressif des modes hiérarchiques d’organisation du travail au profit de systèmes modulaires, conséquence des NTIC (spécialement du numérique et de l’intelligence artificielle), ne peut que condamner les stratégies fondées sur la préservation des acquis, donc l’immobilisme et pire le corporatisme.
Le monde des professions libérales fondé sur l’indépendance technique et la déontologie (plutôt l’éthique) qui en est le corollaire indispensable peut aider à la mutation du monde du travail en découlant. Cela fait devoir à leurs organisations ordinales et syndicales de modifier en profondeur les comportements et de promouvoir une culture écartant ce corporatisme qui fait en permanence privilégier l’intérêt de la profession stricto sensu alors que le monde économique exige la promotion de l’interprofession. Ceci vaut aussi pour la profession d’avocat.
Les constats et commentaires ci-dessus ne sont ni pessimistes ni optimistes. Ce que nous n’avons pas su ou voulu réaliser le sera, sous d’autres formes peut-être par l’évolution des mentalités qui provoquera, tôt ou tard, des remises en cause des structures et de leurs justifications.
Peu de gens ont véritablement perçu la signification profonde de certaines dispositions de la loi Macron. Elles sont les prémices de remises en cause auxquelles la profession doit se préparer. Il lui revient de s’emparer des débats sur son avenir en hiérarchisant ses priorités à long terme, en donnant aux activités de conseil d’entreprises la place qui lui revient dans un pays qui se glorifie d’être une des principales puissances économiques du monde. Un exercice délicat s’il en est compte tenu de la culture dominante. Il faudra contenir les réactions épidermiques les plus nocives et les guerres picrocholines (telle celle actuelle envers l’UNAPL) qui n’ont jamais servi les intérêts d’une profession. Une majorité peut-elle émerger pour définir ce que devraient être les exigences de qualité, de compétence et d’organisation d’une profession compétitive en dehors de ses monopoles ? Une prise de conscience forte de ces enjeux paraîtra utopique à beaucoup. D’autres, imprégnés d’une forme de légitimité conféréé à l’activité de défense judiciaire qui serait d’une essence supérieure, hiérarchisent l’acceptation des principes à appliquer, reléguant de fait les besoins et les aspirations des activités de conseil aux entreprises au second plan, parfois même en se dispensant du moindre effort d’analyse.
Or vouloir développer la dualité des cultures est possible. Certains cercles ou associations à but scientifique le démontrent de la plus belle des manières, tenant ainsi le haut du pavé sur de nombreux sujets du droit de l’économie.
Nous pensons en outre que cette dualité est un élément important pour aider à résoudre certaines difficultés de la profession, telle l’existence inacceptable d’un « prolétariat paupérisé » ou, d’un autre coté du spectre, la trop faible émergence de firmes internationales dans lesquelles les entités françaises jouent un rôle important.
Ce 30e anniversaire est pour nous l’occasion de rappeler qu’il ne s’agit pas là de remettre en cause d’autres priorités, mais simplement, après tout ce temps, de rappeler ce qui a été largement oublié ; d’autant que pour nous ce débat n’est pas porteur d’un quelconque conflit de légitimité, simplement l’occasion de rappeler que les principes que nous défendons ont leur propre légitimité qui provient de la notion même de nouvelle profession retenue par la loi.
Sur certains sujets fondamentaux, tels les droits de la défense, la protection des libertés publiques et des droits humains, la profession a démontré qu’elle pouvait dégager un large consensus. Pourquoi n’en serait-il pas de même sur les sujets de fond qui engagent l’équilibre de son avenir ?
La profession recèle tous les talents individuels pour conduire de telles ambitions. Puissent-ils s’unir pour réaliser cette « révolution culturelle » dont nous savons qu’elles sont les plus délicates à réussir ! Après 30 ans de vie commune il nous paraît opportun de retrouver l’esprit et la volonté de construire que nous avions partagés avec un certain nombre de représentants des deux professions en 1990 à qui nous dédions ces libres propos.