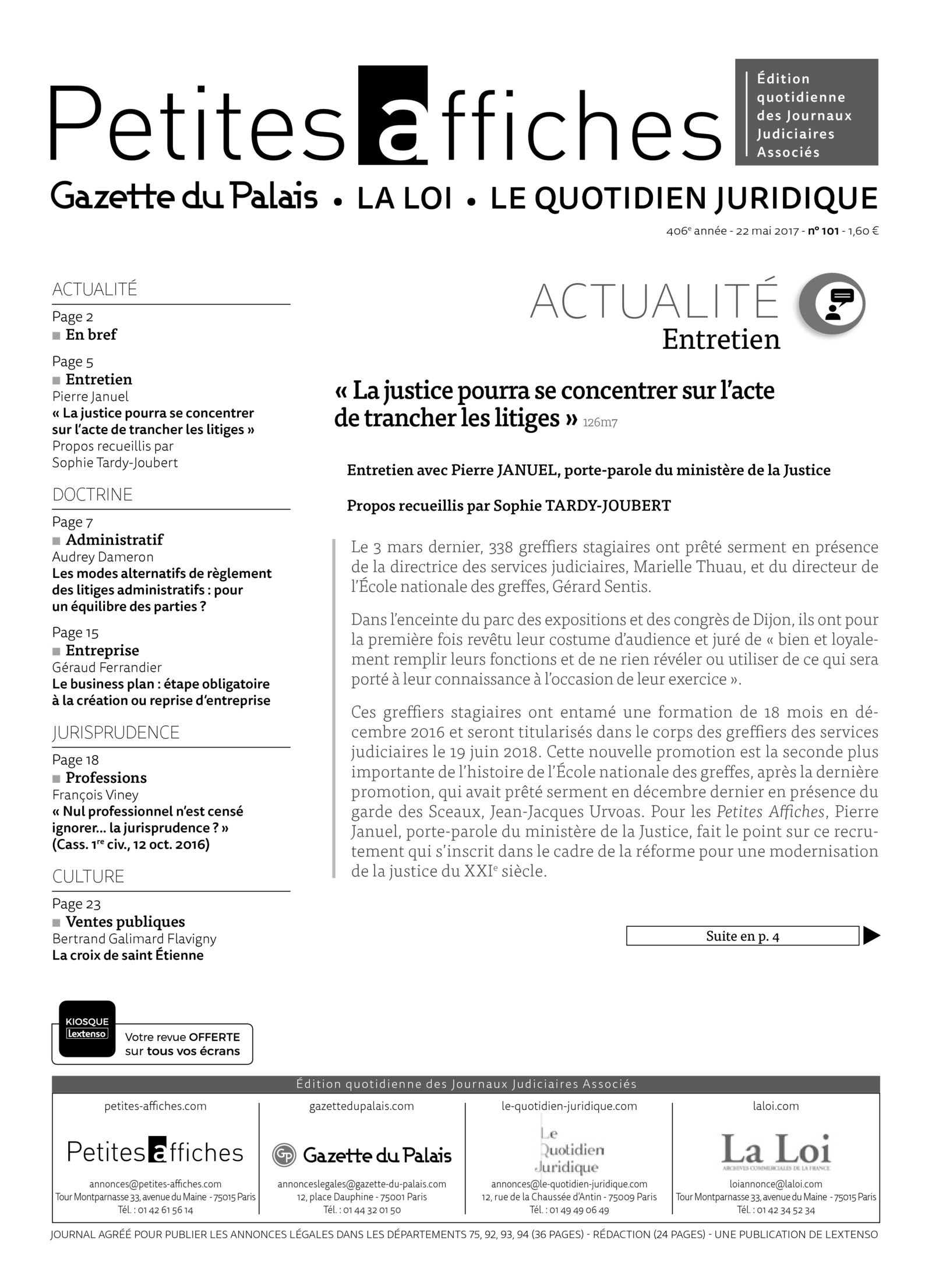« Nul professionnel n’est censé ignorer… la jurisprudence ? »
Est privé de base légale l’arrêt qui retient la faute du notaire ayant méconnu une jurisprudence nouvelle, sans rechercher si celle-ci avait fait objet d’une publication ou d’une mesure d’information au moment de son intervention, et sans vérifier également si l’évolution de la jurisprudence était prévisible.
Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, no 15-18659
La jurisprudence constitue un élément incontournable de compréhension du droit positif auquel chacun doit se soumettre. Elle doit donc être accessible à la connaissance des justiciables. Il est piquant de noter les manifestations de cette prise de conscience par la Cour de cassation elle-même, qui applique à ses arrêts des raisonnements identiques à ceux que l’on connaît à propos de la loi nouvelle !
Dans un arrêt du 12 octobre 20161, la première chambre civile censure un arrêt d’appel qui avait retenu la responsabilité pour faute d’un notaire, lequel ne s’était pas conformé au droit positif, son intervention étant postérieure « à [un] arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 31 mai 1988, qui a fixé, de manière claire et précise, les conditions de forme auxquelles se trouvait soumise la rédaction [d’un acte, le mandat de donner caution] ». Par ailleurs, les juges du fond avaient relevé que « le principe dégagé par l’arrêt (…) n’était pas entièrement nouveau, mais s’inscrivait dans une évolution jurisprudentielle constante », de sorte que « le notaire aurait dû être particulièrement vigilant et s’assurer de la régularité du mandat de caution donné en l’espèce ». Or sur ces deux points, l’arrêt est censuré par la Cour de cassation au regard de l’article 1382, devenu l’article 1240 du Code civil. En omettant de rechercher si d’une part, « l’arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 1988 avait fait l’objet, à la date de l’intervention du notaire, d’une publication ou de toute autre mesure d’information », et si d’autre part, « l’évolution de la jurisprudence (…) rendait prévisible, à la date de l’intervention du notaire, une évolution comparable de la jurisprudence interprétant les mêmes dispositions (…) », la cour d’appel avait privé sa décision de base légale.
Ainsi, la motivation des juges du fond apparaît insuffisante pour appliquer la loi – elle fait l’impasse sur des faits qui sont indispensables à caractériser la faute d’imprudence et de négligence. Effectivement, mesurer la diligence et la bonne volonté, par rapport aux données spécifiques d’une cause, nécessite d’établir au préalable ce que pouvait savoir l’agent. La prudence est la vertu du calcul (de risques, d’opportunité, d’anticipation), qui nécessite des informations précises. Au-delà de l’état du droit positif, la faute du notaire, professionnel du droit, s’apprécie à l’aune de ses connaissances, surtout de la connaissance de l’état de la jurisprudence – laquelle est dépendante de son information –, et en considération de la prévisibilité de l’évolution de la jurisprudence.
I – La connaissance de l’état de la jurisprudence
La décision évoquée a trait à l’application temporelle d’une jurisprudence nouvelle, mais sans toucher directement à la question de la rétroactivité ou la modulation dans le temps des revirements de jurisprudence2. S’agissant de l’affaire jugée, la solution nouvelle semblait bien s’appliquer aux faits de l’espèce, puisque la décision de justice qui l’a consacrée leur était antérieure. Pour les juges du fond, son application immédiate est incontestable ; nul besoin de vérifier si la décision était connue au moment des faits. Porteuse de l’interprétation nouvelle d’une règle plus ancienne, elle ne s’en dissocie pas et fait corps avec celle-ci : la décision rendue par la Cour de cassation le 31 mai 1988 s’applique, le notaire ne peut échapper à sa responsabilité et justifier ne pas en avoir tenu compte en arguant d’une quelconque méconnaissance.
Pourtant, la censure s’explique, parce qu’il est ici question d’apprécier la faute, laquelle ne s’enferme pas dans un strict respect de la légalité, ni même dans des principes rigides. Pour apprécier la faute, la Cour de cassation subordonne l’effectivité d’une jurisprudence nouvelle à la vérification de l’existence d’une publication ou d’une mesure d’information : le caractère occulte de l’information initiale empêche que l’on puisse considérer l’ignorance fautive.
C’est une nécessité connue pour l’« entrée en vigueur » des lois et règlements. Hors cadre de la faute, la conformité d’un comportement aux exigences de ces textes implique que les règles qu’ils consacrent aient été portées à la connaissance des justiciables ou leurs conseils. On ne saurait, en effet, sanctionner la méconnaissance d’un texte secret sans basculer dans l’arbitraire3. Cela impose des moyens d’information à destination de tous et l’écoulement d’un certain temps, assurant la transmission d’informations. Ainsi, l’article 1er du Code civil prévoit une entrée en vigueur à la date qu’ils fixent, ou à défaut, au lendemain de leur publication au JO : à compter de cette date, la loi ou le règlement est réputée connue des justiciables et des professionnels du droit. Pourquoi une telle date ? Car à partir de cette publication, la loi est réputée connue des justiciables et des professionnels du droit. Jusqu’en 2004, la loi était réputée connue et entrait en vigueur « un jour franc » après sa publication. Mais cela ne valait que pour Paris ! Partout ailleurs, ce délai ne courait qu’à compter de la date où le Journal officiel était parvenu au chef-lieu du département, ceci afin que les justiciables en province aient pu, de manière supposée, prendre connaissance des textes.
Une telle information est également, à l’inverse, un corollaire nécessaire de l’adage « Nul n’est censé ignorer la loi ». Cette maxime ne signifie pas que le quidam comme le professionnel sont tenus de connaître le droit positif dans ses moindres détails ou ses dernières évolutions, même si le Conseil constitutionnel veille au respect des objectifs constitutionnels d’« accessibilité » et d’« intelligibilité » de la loi4. De manière plus pratique, il signifie que personne ne peut invoquer une ignorance de l’état du droit positif, pour se soustraire aux règles qu’il impose5. Mais pour cela, encore faut-il s’assurer qu’existent les moyens de connaître la loi !
L’arrêt commenté semble consacrer une idée analogue s’agissant de l’application de la jurisprudence, malgré toutes les réserves que – notamment – la différence de nature qui la distingue d’avec la loi peut soulever6. Certes, la nécessité de connaître la jurisprudence n’est pas une découverte récente, et la publication des décisions a, tôt, été organisée par l’édition du Bulletin des arrêts pour la Cour de cassation, ou de recueils pour les décisions des Conseil d’État, Conseil constitutionnel, CJUE et Cour EDH. Les décisions du Conseil constitutionnel font aussi l’objet d’une publication au JO ! Elle explique le procédé de hiérarchisation des décisions, mis en place par la Cour de cassation elle-même, décidant, par l’indication de lettres sur la minute des arrêts, de l’étendue de la publicité qui leur est accordée.
Ce qui est notable toutefois, c’est que dans cet arrêt, la Cour de cassation impose aux juges du fond la vérification de l’effectivité de la transmission d’informations, qui passe par l’indice de sa publication, comme un préalable indispensable à la caractérisation de la faute. Mais la publication ne fait pas tout ! Et même à supposer que celle-ci soit intervenue, le bon sens impose de laisser s’écouler un certain délai de prise de connaissance, dépendant du mode d’accès à l’information et de la date de diffusion. Si l’on s’en tient à une appréciation in abstracto, qui commande l’appréciation de la faute, plus l’information est récente, moins le bon père de famille n’est censé la connaître et moins sa méconnaissance apparaît fautive.
Quoi qu’il en soit, l’indice factuel déterminant que constitue l’accessibilité de l’information implique une appréciation très concrète et circonstanciée. Dans un arrêt du 21 octobre 2003, la Cour EDH a intégré cette donnée temporelle, pour fixer l’entrée en vigueur d’une voie de recours interne, résultant d’une jurisprudence nouvelle du Conseil d’État7. La Cour avait pris en compte « un laps de temps raisonnable, nécessaire aux justiciables pour avoir effectivement connaissance de la décision interne qui la consacre ». Les motifs révèlent que, pour déterminer ce laps de temps « raisonnable », la Cour s’est référée aux dates de diffusion de l’arrêt sur le site internet du Conseil d’État et de publication dans les différentes revues juridiques. La Cour estime alors qu’« il peut être considéré qu’il avait acquis un degré de certitude juridique suffisant à une période qui se situe aux alentours de la fin de l’année 2002, soit environ six mois après sa lecture ». Nul doute que le « laps de temps raisonnable » évoqué par la Cour EDH, est en tout cas largement dépendant des circonstances, et donc difficilement quantifiable a priori8…
Sur quelques points, la décision commentée laisse également perplexe. Sur sa pérennité d’abord : si on peut la comprendre pour l’espèce envisagée, la question de la transmission de l’information et du délai sera-t-elle essentielle demain, alors que les arrêts sont mis en ligne presque en temps réel, ou simplement quelques jours après avoir été rendus9 ? Quant à sa portée, ensuite : il n’était ici pas question d’appliquer à des faits antérieurs une jurisprudence nouvelle, mais, en quelque sorte, « de l’applicabilité immédiate » de cette jurisprudence à des faits contemporains à son admission. La Cour de cassation pourrait-elle, a fortiori, étendre cette solution et se référer à la publication des arrêts, pour couper court à toute difficulté d’application dans le temps d’une jurisprudence nouvelle, spécialement pour éviter d’appliquer rétroactivement une décision non rendue au moment des faits ? À trop s’écarter de la conception simplement interprétative de la jurisprudence…
II – La prévoyance de l’évolution de la jurisprudence
À la lecture de l’arrêt, quand bien même le professionnel n’aurait pas été informé d’une évolution jurisprudentielle, celui-ci peut être en faute quand il aurait pu la prévoir… La décision commentée laisse entendre que la prévisibilité de l’évolution de la jurisprudence rend fautif l’agent qui n’a pas su l’anticiper. Nul doute que la prévoyance supposée de l’agent constitue un élément central de l’appréciation de la faute10. Pourtant, la Cour de cassation est généralement indulgente envers les justiciables, même des professionnels, lorsque le comportement traduit un manque de perspicacité dans l’appréciation des tendances évolutives du droit positif. Ainsi, considère-t-elle, dans un arrêt du 25 novembre 1997, « qu’il ne peut être reproché à un notaire de n’avoir pas prévu une évolution ultérieure du droit »11, tout en ajoutant, dans un autre arrêt que « l’existence d’une incertitude juridique ne dispense pas le notaire de son devoir de conseil »12. Tout juste a-t-elle tempéré, dans un arrêt rendu par la première chambre civile, le 7 mars 2006 qu’« une évolution juridique en cours doit conduire le notaire à mettre en garde son client »13. L’arrêt commenté va plus loin : si l’évolution était prévisible alors, le notaire est en faute de ne pas l’avoir spontanément anticipée en ajustant son comportement.
La référence à la prévisibilité de l’évolution jurisprudentielle est trompeuse. On peut remarquer que, dans l’arrêt commenté, comme dans un arrêt antérieur rendu le 14 mai 200914, la question n’était toutefois pas de prévoir l’évolution, mais finalement d’analyser rationnellement et avec pertinence la portée d’une évolution déjà acquise15. Dans l’arrêt rendu en 2009, la Cour de cassation avait été assez claire sur ce point, en admettant que « sans que puisse lui être imputé à faute de n’avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif [l’avocat] se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l’extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer ».
Plus généralement, la solution paraît conforme à l’idée traditionnelle qui veut que l’évolution de la jurisprudence ne constitue jamais une atteinte de la sécurité juridique des justiciables, parce que la jurisprudence procède à une clarification des règles répondant aux exigences sociales, et qu’ainsi tout justiciable averti devrait intuitivement percevoir les évolutions du droit lorsque celles-ci sont latentes. Comme l’écrit Frédéric Zénati, « Si une loi rétroactive peut être jugée insupportable parce qu’elle impose arbitrairement un ordre nouveau qui n’existait pas à l’état latent dans la société, ce grief ne peut pas être adressé à la jurisprudence qui est au contraire le reflet de l’ordre social. Autrement dit, la jurisprudence, contrairement à la loi, est toujours prévisible ; il suffit de vivre avec son temps pour appréhender le sentiment du droit qui prévaut et qui ne manquera pas à terme d’être consacrée par les juges. Ce pressentiment peut permettre aux sujets de droit d’organiser leurs intérêts dans la perspective de cette consécration future, pour ne pas souffrir de sa survenance »16. Toujours est-il que, s’agissant du professionnel du droit en particulier, il reste à savoir à partir de quel moment l’ignorance du droit en perpétuelle mutation, cesse d’être légitime, pour devenir fautive…
S’agissant d’une véritable évolution, la difficulté demeure de déterminer : à partir de quand passe-t-on du prévisible au prophétique ? Quoi qu’on en dise, la « fiction » du « justiciable averti » bute ici largement lorsqu’on l’applique aux circonstances concrètes et à la réalité. Indépendamment des faits de la cause, une évolution de la jurisprudence, comme une réforme éventuelle ou même annoncée, n’est jamais certaine tant qu’elle n’est pas intervenue17, et la doctrine sur ce point ne pourra opposer aucun démenti ! Combien de revirements appelés de leurs vœux par les auteurs (qui d’ailleurs ne sont pas toujours d’accord sur tout…) ne trouvèrent jamais de concrétisation ? Et quand bien même un revirement serait intervenu, faut-il rappeler que les juges ne se prononcent pas au-delà de l’espèce dont ils sont saisis ? Finalement, est-ce toujours une faute juridique de se tromper sur une évolution du droit ?
Notes de bas de pages
-
1.
Cass. com., 12 oct. 2016, n° 15-18659 : RDC 2017, n° 113v9, p. 48, obs. Pellet S. ; Defrénois 30 janv. 2017, n° 125k5, p. 141, note Dagorne-Labbe Y. ; Resp. civ. et assur. 2017, comm. 13, obs. Groutel ; Gaz. Pal. 10 janv. 2017, n° 288q1, p. 37, obs. Mekki ; RTD civ. 2017, p. 161, obs. Jourdain.
-
2.
Sur ce point, v. not. Molfessis N., « La Cour de cassation face à la modulation dans le temps des revirements de jurisprudence », D. 2009, p. 2567.
-
3.
V. Deumier P., Introduction au droit, 3e éd., 2013, LGDJ-Lextenso éditions, Manuels, n° 257.
-
4.
V. not. Frison-Roche M.-A. et Baranès W., « Le principe constitutionnel de l’accessibilité et de l’intelligibilité de la loi », D. 2000, p. 361 et s.
-
5.
V. Deumier P., op. cit., nos 249 et s. – Sur l’adage, v. not. Roland H. et Boyer L., « Nul n’est censé ignorer la loi », Adages du droit français, 4e éd., 1996, Litec, n° 291, p. 579 et s. ; Terré F., « Le rôle actuel de la maxime Nul n’est censé ignorer la loi », Travaux et recherche de l’Institut de droit comparé, 1966, p. 91 à 123 ; Carbonnier J., « La maxime “Nul n’est censé ignorer la loi” en droit français », Journées de la Société de législation comparée, Revue Internationale de droit comparé, 1984, p. 321-327.
-
6.
V. sur ce point not., RTD civ. 2006, p. 521, obs. Deumier P. ; RTD civ. 2009, p. 725, obs. Jourdain P.
-
7.
CEDH, 21 oct. 2003, nos 27 928/02 et 31694/02 : LPA 15 sept. 2005, p. 15, obs. Mauléon E.
-
8.
Sur le délai raisonnable, v. Viney F., « L’expansion du “raisonnable” dans la réforme du droit des obligations : un usage déraisonnable ? », D. 2016, p. 1940.
-
9.
V. not. Pellet S., obs. précitées.
-
10.
« Encore aujourd’hui, la faute est opposée à la diligence, cette dernière étant intimement liée à la prévoyance » : Dunand J.-P., Schmidlin B. et Winiger B., Droit privé romain, II, Obligations, 1re éd., 2010, Bruylant, Schulthess, p. 204 – Sur l’appréciation de la faute, v. Viney F., La personne raisonnable [Le bon père de famille et le plerumque fit], Contribution à l’étude de la distinction des standards normatifs et descriptifs, thèse Paris I, Loiseau G. (dir.), 2013.
-
11.
Cass. 1re civ., 25 nov. 1997, n° 95-22240 : JCP G 1998, I 144, n° 23, obs. Viney ; D. 1998, p. 7 ; AJDI 1999, p. 44 ; ibid. p. 45, obs. Teilliais ; RTD civ. 1998, p. 210, obs. Molfessis ; ibid. p. 367, obs. Mestre ; adde, pour un avocat, Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-24550 : D. 2012, p. 94 ; ibid. p. 145, édito Rome F. ; Rev. sociétés 2012, p. 176, obs. Prévost ; RTD civ. 2012, p. 318, obs. Jourdain.
-
12.
Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 96-10378 : Bull. civ. I, n° 362 ; Defrénois 15 mars 1998, n° 75328, p. 354, obs. Aubert J.-L.
-
13.
Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n° 04-10101 : Bull. civ. I, n° 136 ; Defrénois 30 mai 2006, n° 83973, p. 851, obs. Gelot B. ; ibid. p. 1200, note Hébert ; RDC 2006, p. 1234, obs. Carval S. ; D. 2006, p. 2894, note Marmoz ; JCP G 2006, I 166, n° 9, obs. Stoffel-Munck ; JCP N 2006, 1217, note Buy ; RTD civ. 2006, p. 521, obs. Deumier ; ibid. p. 580, obs. Gautier ; RTD civ. 2007, p. 103, obs. Mestre et Fages.
-
14.
V. déjà, Cass. 1re civ., 14 mai 2009, n° 08-15899 : D. 2010, p. 183, note De la Asuncion Planes ; ibid. 49, obs. Brun ; RTD civ. 2009, p. 493, obs. Deumier ; ibid. p. 725, obs. Jourdain ; ibid. p. 744, obs. Gautier.
-
15.
V. sur ce point not. : Pellet S., obs. précitées.
-
16.
Zénati F., La jurisprudence, 1991, Dalloz, Méthodes du droit, p. 154-155.
-
17.
V. obs. Brun P., préc.