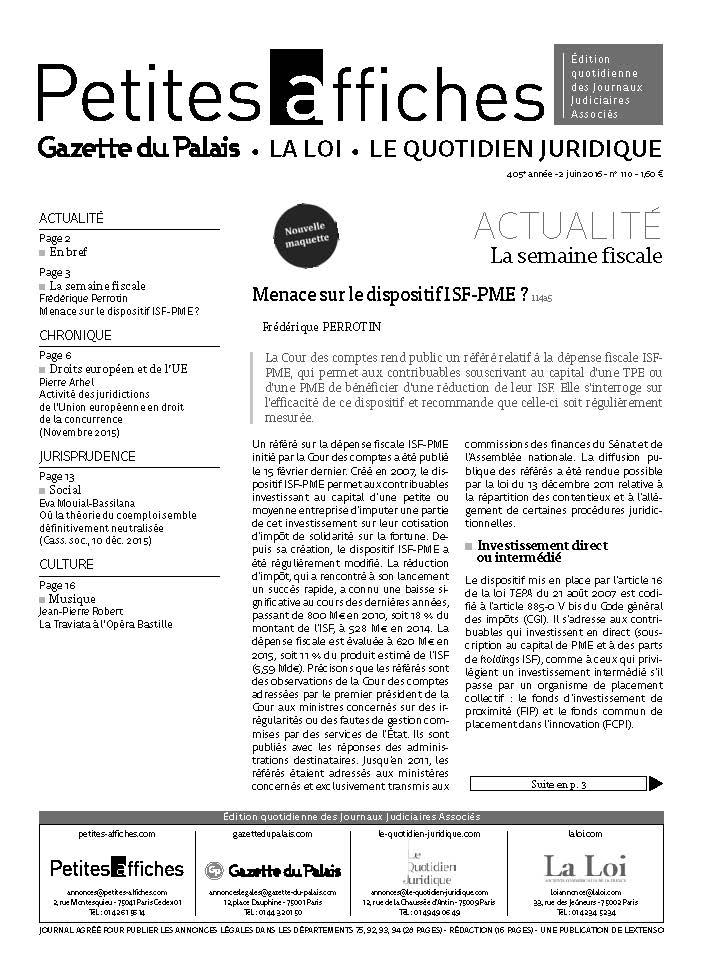Où la théorie du coemploi semble définitivement neutralisée
« Le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société mère, et que celle-ci ait pris durant les quelques mois suivant la prise de contrôle de la filiale des décisions visant à sa réorganisation dans le cadre de la politique du groupe, puis ait renoncé à son concours financier destiné à éviter une liquidation judiciaire de la filiale, tout en s’impliquant dans les recherches de reclassement des salariés au sein du groupe, ne pouvait suffire à caractériser une situation de coemploi ». Ainsi la Cour de cassation persiste et signe dans sa volonté de rendre la théorie du coemploi inoffensive pour les groupes de sociétés et leurs actionnaires majoritaires.
Cass. soc., 10 déc. 2015, no 14-19316, FS–PB
Sous la lumière crue de faits caricaturaux, la Cour de cassation a choisi de réaffirmer dans une décision publiée sa volonté de neutraliser la théorie du coemploi qui s’était élaborée ces dernières années1.
En effet, il s’agissait ici d’une société, Fayat (appartenant à un grand groupe de 118 entreprises et occupant plus de 17 000 salariés), qui avait acheté la totalité des actions d’une autre société, Établissements J. Richard Ducros (EJRD). Un peu plus de deux mois après la cession, la société EJRD était mise en redressement judiciaire, puis en liquidation trois mois plus tard, ce qui entraîna le licenciement de ses 284 salariés.
La présente décision rassurera de prime abord bon nombre de personnes. Les principaux concernés sont les actionnaires qui voient le spectre du coemploi s’éloigner durablement et pourront ainsi être soulagés de constater que le groupe de sociétés n’est plus en soi source de la confusion pouvant mener à la qualification de coemployeur sans que ne soit caractérisé le lien de subordination entre les salariés et la société du groupe concernée. Dans une moindre mesure, les spécialistes de la question le seront également, qui s’inquiétaient pour certains d’une éventuelle « destruction du droit du travail »2.
Certes, on reconnaîtra volontiers que « la gestion d’une entreprise n’est pas une science exacte et [qu’]il est redoutable d’imaginer qu’elle fera l’objet d’appréciations rétrospectives avec des conséquences aussi lourdes pour les actionnaires »3. Néanmoins, il serait assez tentant d’espérer qu’entre une gestion malhabile pouvant se justifier en se replaçant dans un contexte et une pure instrumentalisation d’une filiale, voire, comme en l’espèce, un rachat à finalité douteuse, les magistrats sachent faire la part des choses.
Qu’on en juge. Ici, le rachat des actions s’était fait à une période où la cessation des paiements devait déjà exister (deux mois avant le jugement d’ouverture). Il semble donc probable que l’opération poursuivait un but autre que le redressement de la société EJDR. C’est notamment ce qui était reproché par la cour d’appel à l’actionnaire unique, lequel avait refusé « d’apporter le concours financier initialement prévu lors de la cession afin d’éviter la liquidation judiciaire d’une entreprise antérieurement concurrente ».
Malgré les faits qui avaient emporté la conviction des juges de la cour d’appel de Nîmes sur l’existence d’une situation de coemploi, la Cour de cassation rappelle les critères qu’elle a elle-même posés précédemment : « Hors état de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ».
Sans doute peut-on comprendre de la décision que la requalification en employeur « de fait » ne doit plus servir à sanctionner les abus commis par certaines sociétés mères. Le risque de distorsion du contrat de travail paraît assurément trop élevé et les arguments invoqués par certains ont apparemment porté.
Pour autant, il nous semble important que l’instrumentalisation abusive d’une filiale, lorsqu’elle a des conséquences sur ses salariés, puisse être sanctionnée sur le terrain de la responsabilité délictuelle, c’est-à-dire l’article 1382 du Code civil4. Cette décision doit donc faire comprendre à l’avenir la nécessité qu’il y a à davantage affiner les arguments en termes de faute, de préjudice et de lien de causalité. En effet, la Cour de cassation a eu l’occasion, en sa chambre sociale, d’affirmer que les sociétés d’un groupe, bien que non employeurs, engagent leur responsabilité délictuelle envers les salariés licenciés de la filiale mise en liquidation judiciaire dès lors qu’elles ont, par leur faute et légèreté blâmable, concouru à la déconfiture de la société employeur et à la disparition des emplois5.
Le fait ici de ne pas exécuter son engagement de concours financier aurait-il pu être considéré comme fautif et, surtout comme ayant causé le préjudice des salariés, c’est-à-dire la perte de leur emploi ? Il est probable que non.
Il faut toutefois évoquer une autre décision récente remarquée par laquelle la Cour de cassation, par une interprétation a contrario, a pu affirmer que la « faute intentionnelle (de l’associé), d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé, est de nature à engager sa responsabilité personnelle envers le tiers cocontractant de la société »6. La chambre sociale s’emparera-t-elle, à son tour, de cette figure de la faute de l’actionnaire majoritaire ? Les salariés étant des « tiers contractants » de la filiale sacrifiée, l’évolution est à suivre avec attention.
Enfin, il aurait été intéressant de savoir quelle était la nature de cet engagement pris par la société mère envers sa filiale : simple engagement d’honneur, lettre d’intention ? Si l’engagement avait été contractualisé (dans le cadre de la cession d’achat par exemple), alors le manquement à cet engagement contractuel pourrait suffire à entraîner l’obligation pour l’auteur de ce manquement (ici l’actionnaire unique) de réparer le préjudice subi par les tiers (ici les salariés), conformément à la jurisprudence Bootshop7. En effet, l’Assemblée plénière y avait affirmé que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Des voix avaient déjà pu s’élever pour souligner le danger de cette jurisprudence en droit des sociétés8. L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats n’ayant rien précisé sur ce point, il y a tout lieu de penser que la jurisprudence pourrait donc continuer dans cette lignée.
Notes de bas de pages
-
1.
Notamment depuis la fameuse affaire Metaleurop : Cass. soc., 28 sept. 2011, n° 10-12278 : BJS janv. 2012, n° 15, p. 59, note Morelli N. ; JCP S 2011, 1548, note Guyot H.
-
2.
Pagnerre Y., « L'extension de la théorie des coemployeurs, source de destruction du droit du travail ? », JCP S 2011, 1423. V. également Gaihlbaud C., « De la théorie du coemployeur à la notion de coemploi – Contribution à l'étude renouvelée du quasi-contrat », Gaz. Pal. 4 août 2012, p. 11 et s. V. les obs. approbatives sous l’arrêt ici rapporté par Lucas F.-X., LEDEN janv. 2016, n° 1, p. 1.
-
3.
Lucas F.-X., « Coemploi et responsabilité de l’actionnaire », BJS oct. 2014, n° 112p2, p. 418.
-
4.
Article 1240 avec l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations à compter du 1er oct. 2016.
-
5.
Cass. soc., 8 juill. 2014, n° 13-15573 : BJS oct. 2014, n° 112n7, p. 398, note Mouial-Bassilana E.
-
6.
Cass. com., 18 févr. 2014, n° 12-29752 : BJS juin 2014, n° 111z5, p. 382, note Fages B. ; D. 2014, p. 764, obs. Favario T.
-
7.
Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13255, société Bootshop c/ Myr’ho : D. 2006, p. 2825, note Viney G. ; RTD civ. 2007, p. 61, obs. Deumier P. ; ibid. p. 115, obs. Mestre J. et Fages B. ; JCP G 2006, II, 10181, note Billiau M. ; JCP G 2007, I, 115, obs. Stoffel-Munck P.
-
8.
V. par ex., obs. Fages B. sous Cass. com., 8 févr. 2011, n° 09-17034 : RTD civ. 2011, p. 350.