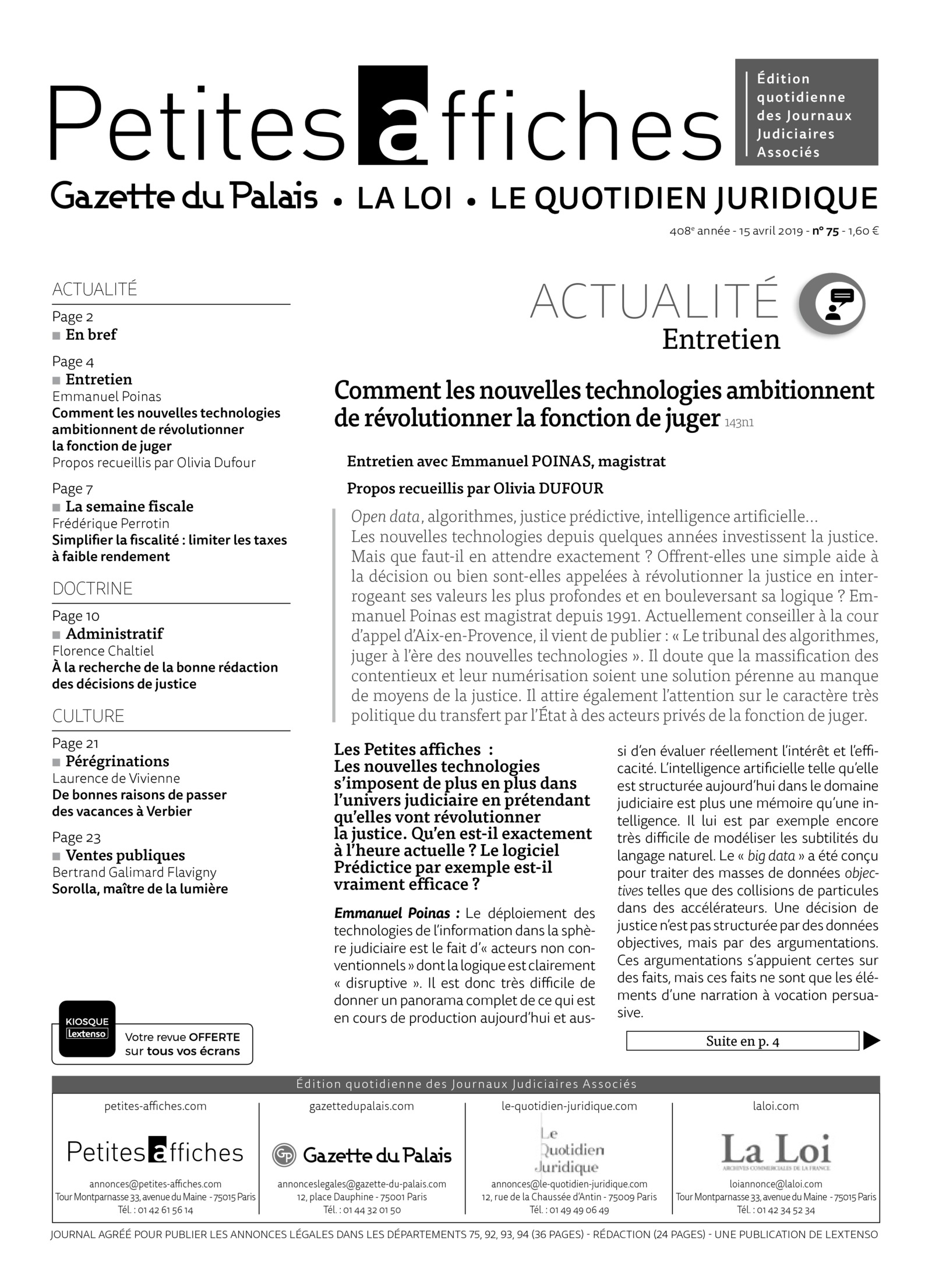À la recherche de la bonne rédaction des décisions de justice
La lecture d’un arrêt du Conseil d’État par le citoyen, ou même par un étudiant en droit ou encore par un avocat, n’est pas tâche aisée. Les membres de la juridiction administrative en sont si conscients qu’ils ont lancé, depuis plusieurs années déjà, des réflexions sur leurs modes de rédaction. Depuis le 1er janvier 2019, de nouvelles recommandations de rédaction sont entrées en vigueur, sous la forme d’un « vade-mecum ». Si la presse a relayé ces nouveautés, comme la disparition annoncée de telle expression ou mot jugé désuet ou peu lisible, quelques interrogations ne manquent pas d’émerger à la lecture de ce Vade-mecum.
Le doyen Jean Carbonnier, dans Flexible droit, envisageait une classification du juge, du juge magique au juge logique en passant par le juge charismatique1. Les travaux récents du Conseil d’État2 semblent, quant à eux, chercher à atteindre la qualité de « juge lisible ».
« Considérant qu’en estimant que, nonobstant le bilan des premières années de M. A. à la tête de Radio France, le maintien de son mandat en dépit de sa condamnation serait préjudiciable aux relations de cette société avec l’État et les pouvoirs publics, ainsi qu’à la sérénité et à la disponibilité nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci et à l’accomplissement des missions du service public dont elle a la charge, le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas commis d’erreur d’appréciation ».
« Ayant considéré que, nonobstant le transfert de domicile fiscal de M. A., cette plus-value, réalisée avant ce transfert, devait être taxée en France, l’Administration l’a soumise à l’impôt au taux forfaitaire de 16 % en vertu des dispositions de l’article 200-A-2 du Code général des impôts. M. A. se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qui, sur l’appel du ministre de l’Économie et des Finances, a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil qui l’avait déchargé de ces impositions, et remis à sa charge ces impositions dans la limite de la somme de 1 494 120 euros en base ».
Ces extraits d’arrêt, lus respectivement le 14 décembre3 et le 28 décembre 20184, constituent une des illustrations, nombreuses, de la complexité de la rédaction des arrêts du Conseil d’État.
Ce dernier, pleinement conscient de ce défaut, certes difficile à corriger, car en partie au moins inhérent à la complexité du droit lui-même, ne cesse de chercher à y remédier.
Dans des travaux menés en 2012, le Conseil d’État soulignait bien que « la nécessité de justifier, dans une même phrase, des dispositions applicables parmi une hiérarchie des normes étendue, de leur interprétation et de leur application à des faits complexes, rend de plus en plus difficile la rédaction d’une réponse claire sous la forme actuelle de la phrase unique et aboutit souvent à une rédaction multipliant les subordonnées, dans laquelle le lecteur se perd et perd le fil du syllogisme que cette syntaxe particulière a pourtant pour fonction de rendre évident »5.
Il est ainsi piquant de constater qu’alors même qu’entraient en vigueur, le 1er janvier 2019, de nouvelles règles de rédaction des décisions pour l’ensemble de la juridiction administrative à la suite des travaux menés sous l’égide de l’ancien président de la section du contentieux, Bernard Stirn, de nouvelles règles avaient déjà été décidées en… 2012. Sans doute, l’ouvrage doit-il être régulièrement mis sur le métier, mais sans doute aussi, les simplifications annoncées en 2012 ne furent pas suffisamment suivies d’effet. À vrai dire, 2019 est en partie une suite de 2012, sachant qu’une série d’expérimentations devaient être menées par des sous-sections – devenues « chambres » depuis – et être généralisées si elles apparaissaient satisfaisantes. C’est ce que contient, en partie, la réforme de 2019. La présentation générale l’explicite comme suit : « Cette “réflexion sur les méthodes de rédaction des décisions de la juridiction administrative [a] pour objectif de les améliorer, c’est-à-dire de les rendre mieux compréhensibles à un public plus large, sans rien sacrifier de leur qualité”. Ce rapport a permis le lancement d’une expérimentation, au sein du Conseil d’État puis de tribunaux administratifs et de cours administratives d’appel qui a, ensuite, fait l’objet d’une évaluation approfondie. C’est à l’issue de ce bilan qu’a été engagée la rédaction d’un Vade-mecum, destiné à fournir des lignes directrices pour la rédaction de l’ensemble des décisions de la juridiction administrative »6. C’est ainsi qu’une des évolutions phares, d’ailleurs relevée par la presse, est celle de la suppression du « considérant ». Plus exactement, il s’agit de la suppression du « considérant » itératif, en début de chaque paragraphe, au profit de la formule « considérant ce qui suit ».
Rappelons les apports de l’année 2012 en la matière. Le rapport rendu en 2012 précisait d’emblée la situation : la structure, les éléments constitutifs et le style de rédaction des décisions de la juridiction administrative française présentent une grande constance puisqu’ils n’ont que peu évolué depuis l’institution du Conseil d’État et des conseils de préfecture7. Le rapport de 2012 se constituait de plus de 200 pages dont deux tiers consacrés à des cas pratiques pour montrer des exemples possibles de nouvelles rédactions. Ce rapport donnait ainsi sa philosophie : quelles que soient les suites qui seront données aux propositions formulées, les réflexions menées au sein du groupe sur les modes de rédaction des décisions de justice ont mis en lumière l’importance de la formation des juges aux techniques de rédaction, sur lesquelles l’accent n’est peut-être pas suffisamment mis actuellement. Une telle formation est nécessaire, y compris si aucune modification ne devait être apportée aux modes de rédaction en vigueur. En effet, la syntaxe actuelle des décisions de justice ne constitue pas, par elle-même, une garantie de rigueur et de précision du raisonnement et il est tout à fait possible de motiver trop, mal ou de manière imprécise dans le cadre de la phrase unique. Mais il est évident que, si certaines réformes devaient être mises en œuvre, leur nécessaire accompagnement serait l’occasion de sensibiliser les jeunes magistrats, avant leur entrée en fonction mais aussi dans les mois qui suivent, à l’importance de la rédaction et à la rigueur du raisonnement juridique qu’elle doit traduire aussi exactement et clairement que possible8.
Quelle que soit la juridiction dont elle émane, la décision se décompose en trois grandes parties comprenant respectivement la synthèse des conclusions des parties et des moyens présentés à leur soutien, la mention des références des textes dont il sera fait application et le rappel des principaux actes de l’instruction (« visas »), l’exposé du raisonnement qui conduit à la solution (« motifs ») et l’énoncé de cette solution (« dispositif »). Ces éléments s’inscrivent au fil d’une phrase unique dont le sujet, précédé de la formule « au nom du peuple français », est la juridiction mentionnée au début et le verbe principal le mot « décide » qui sépare les motifs du dispositif, les visas et les motifs figurant comme autant de subordonnées introduites par les termes « Vu » et « Considérant », les seconds comportant eux-mêmes de nouvelles subordonnées. S’agissant plus particulièrement des motifs, cette syntaxe fait ressortir la rigueur du syllogisme juridique par lequel le juge raisonne et qui le conduit à appliquer au cas d’espèce la règle générale qu’il a précédemment citée ou résumée9.
Dit encore autrement, la décision de justice doit d’abord rappeler les grandes étapes de la procédure, renvoyer aux textes juridiques utiles et utilisés pour rendre la décision en question. Elle doit ensuite expliquer les problèmes juridiques qui se posent dans un contexte factuel dont l’essentiel pour la compréhension doit être rappelé ; confronter ces questions juridiques aux textes en présence, mais aussi aux interprétations jurisprudentielles déjà connues – la règle des précédents est particulièrement importante en droit administratif – afin de donner des réponses aux « moyens », c’est-à-dire l’ensemble des argumentations développées par les parties à l’espèce. Elle doit enfin, au terme de ces réponses aux moyens des parties, prendre une décision qui se réalise dans le « dispositif ». Celui-ci, introduit par le mot « décide » au centre de la page, donne raison ou tort aux parties, tire les conséquences de cette décision selon les contentieux concernés comme on le détaillera plus bas et décide de qui paiera les frais liés à l’instance, en tout cas une partie d’entre eux.
C’est ce schéma qui est séculaire10 et que les différentes réformes n’entendent pas modifier. Ce qui doit être modifié, qui l’a déjà été et qui le sera encore, tient dans la rédaction, les tournures de phrases, le style, le vocabulaire, dans le sens d’une plus grande lisibilité de la décision. La réforme est elle-même complexe, car il existe un langage ancien, fait de compréhension explicite ou tacite entre les membres de la juridiction administrative et les avocats ; et il n’est pas facile d’apporter de substantielles modifications. Certaines des raisons de cette nécessaire stabilité semblent fondées et légitimes, tandis que d’autres paraissent davantage liées à un certain entre-soi qui pourrait être questionné. Cette dernière proposition concerne essentiellement le Conseil d’État et les avocats au Conseil. Il convient d’apporter quelques éléments de précisions sur ces derniers, à ce stade de la réflexion.
L’existence des avocats au Conseil et à la Cour est ancienne, même si éclipsée au moment de la Révolution française. On en trouve les premières bases dans un édit du 2 septembre 1643. Une ordonnance du 10 octobre 1817 donne les bases de l’organisation contemporaine. Ces avocats disposent du monopole de la prise de parole au Conseil. Il s’agit là, selon la plume autorisée du président Guy Canivet, « à l’évidence [d’un] facteur d’inégalité (…) dans tous les cas où cette représentation (par des avocats aux Conseils) n’est pas obligatoire »11. En ce sens, si la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé en 2000 qu’« il est clair que la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation peut justifier de réserver aux seuls avocats spécialisés le monopole de la prise de parole, elle a condamné la France dans le cas où, par exception, la représentation par un avocat aux Conseils n’était pas obligatoire (en matière pénale) et où il n’a pourtant pas été permis au requérant se défendant seul, ou assisté d’un avocat à la Cour, de répondre aux conclusions du ministère public12. Il reste que la Cour européenne a admis le principe même de la représentation obligatoire par des avocats aux Conseils, en affirmant notamment qu’il « convient de prendre en considération la directive n° 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, ainsi que la jurisprudence de la CJCE y afférente, aux termes desquelles les États membres peuvent établir des règles spécifiques d’accès aux cours suprêmes, à l’instar du recours à des avocats spécialisés, dans le but d’assurer le bon fonctionnement de la justice ». Enfin on indiquera qu’une proposition de réforme avait été formulée13. Cette proposition est pour le moment restée sans suite. Il existe donc une tradition ancienne de juges administratifs, d’avocats spécialisés dans le contentieux administratif et un langage que d’aucuns pourront estimer codé.
Cette situation est certes liée aux modes de rédaction dans la mesure où le langage utilisé dans les décisions de justice est inhérent à une tradition mettant en présence deux acteurs essentiels que sont l’avocat et le juge, dont la relation est constante et dont la compréhension par le citoyen est un enjeu en termes d’État de droit et de démocratie. Ces deux derniers éléments sont au cœur des réflexions sur la rédaction des décisions de justice.
En 2012, une vaste consultation a ainsi été organisée, recueillant plusieurs points de vue de membres de la juridiction administrative, de professeurs ou encore d’avocats, mais aussi des regards d’autres pays. Le groupe de travail avait alors émis le regret de ne pas avoir pu auditionner de justiciables14.
Avaient alors été décidées de nombreuses recommandations pour une rédaction plus lisible et des expérimentations dans quelques sous-sections – d’ailleurs appelées chambres depuis. Six ans plus tard, des expérimentations ont eu lieu, des dialogues entre membres du Conseil d’État, mais aussi entre membres des juridictions administratives dans leur ensemble, mais aussi encore des échanges entre magistrats administratifs et avocats ou juristes en général. Ces échanges ont sans doute influé sur l’aboutissement que représente ce Vade-mecum à l’usage des rapporteurs mais aussi de l’ensemble de la juridiction administrative, et rendu public sur le site internet du Conseil d’État, laissant la possibilité à chaque citoyen de s’approprier le texte. Il en ressort deux traits saillants au moins. Le premier est le principe cardinal de la motivation de la décision, qui est un impératif de l’État de droit (I). Le second, qui lui est lié, est celui de la lisibilité de la décision, impératif de la démocratie (II).
I – La motivation des décisions, impératif de l’État de droit
La motivation des décisions de justice est non seulement une obligation légale rappelée par l’article L. 9 du Code de justice administrative, mais aussi une exigence démocratique15. En réalité, plus qu’une exigence démocratique, s’agissant de la motivation des décisions, il s’agit d’une exigence inhérente à l’État de droit. Il s’agit d’un corollaire nécessaire du respect de la hiérarchie des normes.
Au sens commun, motiver une décision signifie l’expliquer. Appliqué à la juridiction, quelle qu’elle soit, cela signifie que le juge doit répondre à chaque demande formulée par un requérant et aux argumentations présentées par le requérant ou son conseil, afin d’expliquer pourquoi il donne, ou pas, satisfaction à sa demande. Cet impératif est essentiel. Il permet de mettre en relation, dans le syllogisme juridictionnel, la majeure, correspondant aux bases juridiques en présence, et la mineure correspondant à la situation de fait et de droit présentée au juge.
Il est remarquable, et même, dans certains cas, étonnant, que de nombreux arrêts de cours administratives d’appel soient cassés pour défaut ou insuffisance de motivation. Dans le champ lexical de la motivation se trouvent les « motifs ». Dans les recommandations contenues dans le Vade-mecum précité, plusieurs pages y sont consacrées (B), les motifs s’inscrivant, dans l’architecture de la décision, entre les visas et le dispositif, dont la précision est aussi essentielle à la motivation globale et à l’État de droit (A).
A – Les visas et le dispositif d’une décision ou les bases juridiques applicables à la décision retenue
Les visas sont les éléments formels, essentiels à la régularité de la décision. Ils « visent » en premier lieu la demande formulée devant le juge, rappellent la procédure qui a précédé la saisine du juge. Ils visent ensuite les textes applicables à la résolution du litige présenté devant le juge. Ils visent enfin les échanges de mémoires et d’arguments des parties au procès.
Ils représentent d’une certaine manière le prérequis, ou le mode d’emploi de la décision. Ils sont la base juridique du dispositif qui intervient après les motifs.
Le Vade-mecum donne ainsi les recommandations suivantes : les visas d’une décision contiennent la restitution par le juge de la teneur des demandes et de l’argumentation des parties, la mention de l’accomplissement de certaines formalités procédurales et la mention des dispositions applicables. Ils visent à présenter le cadre du litige et permettent, en particulier, aux parties de s’assurer que le juge a correctement et complètement analysé et restitué leurs conclusions et leur argumentation.
À cette fin, les visas rappellent les échanges contradictoires entre les parties, en énumérant les mémoires qu’elles ont produits dont ils restituent précisément les conclusions et les moyens. Les visas mentionnent aussi les textes sur lesquels le juge administratif fonde sa décision. Le Vade-mecum souligne le rôle essentiel du rapporteur. On notera d’ailleurs ici que cet acteur est relativement peu connu des justiciables. Le rapporteur est un membre de la juridiction administrative qui peut être un auditeur, un maître des requêtes ou même un conseiller d’État. Il est mentionné dans la décision de justice une fois celle-ci rendue publique.
Le rapporteur est celui qui reçoit en premier lieu le dossier, après que le président de sa chambre le lui a attribué. Il a le premier regard de la formation de jugement, qui n’interviendra que plus tard, sur les faits de l’affaire et sur les arguments des avocats. Il devra proposer un projet de décision assorti d’une note explicative. En restituant la demande et l’argumentation des parties, le rapporteur détermine le cadre du litige. Son travail ne peut dès lors se limiter à une simple photographie des conclusions et moyens tels qu’ils figurent dans les mémoires des parties ; il implique une interprétation et une qualification, voire dans certains cas une requalification, des écritures des parties. Ce travail d’interprétation concerne tant les conclusions que l’argumentation des parties, de laquelle il importe de dégager les moyens auxquels le juge devra répondre. Face à des mémoires foisonnants, le rôle du rapporteur consiste à extraire d’une argumentation parfois profuse ou confuse les moyens qui sont le support de la demande. Cette première tâche peut s’accompagner d’un travail de ré-ordonnancement des moyens présentés dans le mémoire.
Ce rôle du rapporteur est d’autant plus important que c’est sur la base de son travail d’identification des moyens que se prononcera ensuite le juge dans les motifs de sa décision16.
Il l’est également dans la mesure où les visas des décisions ne sont que peu ou pas discutés lors des délibérés. Les visas se situent ainsi en amont des motifs, tandis que le dispositif en est l’aboutissement.
À propos du dispositif, le Vade-mecum se prononce comme suit : le dispositif exprime le sens de la décision qui découle du raisonnement énoncé dans les motifs, en un article (par exemple rejet de la requête) ou plusieurs (annulation partielle ; rejet du surplus des conclusions). Sauf en cas de rejet de la requête ou du surplus, il convient d’éviter de statuer sur des conclusions différentes dans un même article du dispositif ; il est recommandé d’isoler, autant que possible, chaque décision du juge dans un article distinct, de telle sorte, notamment, que puisse être mieux circonscrite l’intervention du juge d’appel ou de cassation.
Les articles du dispositif doivent fidèlement traduire les différents éléments de la décision du juge, tels qu’ils ont été énoncés dans les motifs. Il faut veiller à ne pas en omettre, et vérifier soigneusement que le dispositif statue bien sur l’ensemble des points en débat et des conclusions des parties (demandeurs, défendeurs, admission des interventions, conclusions accessoires…). Comme pour les motifs, la rédaction du dispositif requiert une expression claire et rigoureuse.
En cas d’annulation partielle, il convient d’identifier avec précision les parties de la décision contestée qui sont annulées, en se référant aux articles pertinents de son dispositif ou, à défaut, en mentionnant les parties concernées. Il est alors indiqué, dans le dispositif de la décision juridictionnelle, que la décision attaquée est « annulée en tant qu’elle… » ou, lorsque la partie annulée représente une part peu significative de la décision attaquée, qu’elle est « annulée en tant seulement qu’elle… ». Il convient, dans toute la mesure du possible, d’être extrêmement précis sur le périmètre de l’annulation partielle. De même, dans un souci de meilleure compréhension, le rejet du surplus des conclusions de la requête doit se traduire, dans un article distinct, par la formule suivante : « Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus »17.
B – Les motifs ou l’application d’un raisonnement à un cas d’espèce
Les motifs sont le cœur de la décision juridictionnelle. L’équilibre doit être trouvé entre une réponse pertinente aux moyens développés et à l’ensemble de l’argumentation qui les sous-tend, d’une part, et une lisibilité suffisante pour le justiciable, d’autre part. Il va de soi que la complexité du droit peut appeler des raisonnements et argumentations complexes.
C’est souvent la conduite de ces raisonnements qui semble sinueuse, parfois fastidieuse et, insuffisamment accessible au citoyen. Il est notable, en premier lieu, que le Vade-mecum revienne, encore – car c’est déjà le cas dans le « guide du rapporteur » qui, lui, n’est pas public – sur les significations de termes inhérents aux relations entre les justiciables – et leurs conseils – et la juridiction administrative. « Conclusions, moyens, arguments, comment les distinguer », titre le Vade-mecum, dans sa partie consacrée à une meilleure rédaction des motifs de la décision. Si ce rappel s’avère nécessaire à destination du rapporteur, c’est sans doute que, pour les membres mêmes de la juridiction, des éléments ne sont pas si faciles à définir et à distinguer. Les définitions que donne le Conseil d’État, dans l’opus le plus récent, le Vade-mecum, sont les suivantes : les conclusions sont, de manière schématique, ce que demande le requérant et dans certains cas, la défense. Plus précisément, les conclusions « décrivent l’objet des demandes présentées au juge administratif. Elles exposent les prétentions que les parties soumettent au juge. En excès de pouvoir, les conclusions du demandeur tendent à l’annulation totale ou partielle d’une décision administrative. En plein contentieux, les conclusions peuvent avoir un objet plus varié dans la mesure où les pouvoirs plus importants du juge de plein contentieux l’habilitent à prononcer des annulations, mais aussi à réformer des décisions administratives, à se prononcer en lieu et place de l’Administration, à prononcer des condamnations pécuniaires, à prononcer la décharge ou la réduction d’une imposition, à proclamer les résultats d’élections »18.
L’exigence inhérente aux motifs, sur ce premier point, est l’obligation de statuer sur l’ensemble des conclusions, sans quoi, précise le Vade-mecum, il statuerait « infra petita », expression qu’il déconseille d’ailleurs un peu plus loin, dans le document.
Outre l’obligation de répondre à chaque conclusion par les motifs – réponse reprise en fin de décision, dans le « dispositif » –, l’exigence de motivation porte sur ce que l’on appelle, en droit, traditionnellement, les « moyens ». Ceux-ci exposent l’argumentation juridique présentée par les parties au soutien de leurs prétentions. Ces raisons de droit et de fait visent à convaincre le juge du bien-fondé des conclusions.
Les moyens viennent ainsi au soutien des conclusions présentées. Ils émanent en premier lieu du demandeur. Ils peuvent aussi émaner du défendeur, soit qu’il conteste la recevabilité de la requête en articulant des fins de non-recevoir, soit qu’il conteste le bien-fondé des moyens du demandeur, soit enfin qu’il présente des conclusions reconventionnelles.
Ces moyens peuvent eux-mêmes comporter plusieurs « branches » ou ramifications, et arguments. Ces termes correspondent au développement des moyens par les parties. Le Vade-mecum précise que s’il est impératif de répondre à l’ensemble des moyens, il n’est pas utile de répondre à chaque argument ou sous-argument. C’est au subtil équilibre entre motivation suffisante d’une décision de justice et lisibilité de celle-ci que la rédaction doit parvenir.
Une fois ces précisions apportées, le document donne la fonction des motifs. L’explication du sens de la décision se retrouve dans ses motifs, introduits par « considérant ce qui suit : ». Ils permettent aux parties de comprendre les raisons qui ont conduit le juge à rejeter ou à faire droit à leurs prétentions. Ils éclairent également la communauté des juristes et des membres de la juridiction administrative sur la place que prend la décision dans la jurisprudence qu’elle reprend ou qu’elle modifie. L’équilibre délicat recherché par le juge dans la rédaction de ses décisions se cristallise ainsi dans ses motifs19.
S’ensuivent, dans le Vade-mecum, une série de recommandations à destination du rapporteur. Celui-ci doit respecter une série de termes, afin de conférer une harmonie de lecture à l’ensemble des décisions juridictionnelles. Ainsi, sans reprendre chaque recommandation, selon les cas, l’office du juge conduit à privilégier certains types de raisonnements et à employer certaines formulations, par exemple le fait de dire « il ressort des pièces du dossier » en excès de pouvoir et « il résulte de l’instruction » en plein contentieux20.
Outre ces codes de rédaction, le Vade-mecum insiste sur la méthode déductive des motifs. Le syllogisme doit reprendre une majeure générale, une mineure d’application à l’espèce et une conclusion. Selon les termes mêmes du Vade-mecum, cette construction déductive des raisonnements, et la concision de rédaction qu’elle appelle, contribuent à la force démonstrative des décisions. Elle sert directement à la fonction explicative du jugement en conférant à ce dernier une cohérence d’ensemble lui permettant d’être mieux compris et, partant, mieux admis des justiciables. Elle n’implique cependant pas la transposition écrite de toutes les étapes ou toutes les raisons qui ont convaincu le juge, en son for intérieur, de retenir ce raisonnement. Autrement dit, si la décision doit indiquer aux parties les raisons de la solution, elle n’est pas tenue de leur dévoiler les raisons de ces raisons : par exemple, si le juge doit exposer l’interprétation qu’il donne de la règle de droit, il n’est pas tenu d’expliquer s’il a été convaincu de retenir cette lecture en raison du texte, du contexte ou d’une analogie21.
Enfin, le document rappelle, de manière utile, même si non nouvelle, les méthodes d’interprétation des textes. Il s’agit ici d’un sujet essentiel, au cœur de l’État de droit et de l’office du juge. Ce sont plusieurs défis et difficultés qui se présentent au juge lorsqu’il doit d’abord interpréter une norme – figurant dans un texte à quelque degré de hiérarchie des normes qu’il soit, ou dans une jurisprudence, émanant d’une cour suprême quelle qu’elle soit, nationale ou européenne –, puis appliquer la norme telle qu’interprétée à l’espèce, et enfin donner sa décision. Ces défis sont liés à l’absence de clarté des textes eux-mêmes. Dans ce cas, le Vade-mecum rappelle les méthodes d’interprétation.
Ainsi, sur ce point, l’interprétation de la règle de droit peut découler :
-
de la lettre même du texte lorsque celui-ci est clair ;
-
de l’économie générale du texte lorsque la règle de droit appliquée ne trouve son sens que par référence au cadre global dans lequel elle s’insère ;
-
de la combinaison de plusieurs textes ;
-
des travaux parlementaires lorsque les dispositions législatives appliquées ne sont pas claires, parce qu’ambiguës ou ne prenant pas parti sur le point à trancher ;
-
des exigences résultant de la hiérarchie des normes juridiques qui conduisent à privilégier une interprétation du texte conforme aux normes qui lui sont supérieures ;
-
de la jurisprudence du Conseil d’État lorsque celle-ci a déjà donné une interprétation de la règle que le juge applique.
Il convient, dans ce cas, de ne pas donner la référence de ces précédents mais de reprendre, lorsqu’ils existent, les paragraphes de principe des décisions publiées ou fichées du Conseil d’État sans les modifier, sauf bien sûr s’il s’agit pour le rapporteur de proposer d’amender la jurisprudence. Par exception, lorsque le juge tire les conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel ou de la Cour de justice de l’Union européenne qui s’impose à lui, il peut y faire référence dans les motifs de sa décision22.
L’exigence d’État de droit est ainsi celle du respect de la hiérarchie des normes par le juge. Cette exigence se décline dans les trois éléments qui structurent une décision de justice, ainsi que le Vade-mecum le rappelle. Les visas ont pour objet de donner le cadre du litige et de mentionner les bases juridiques applicables. Le Vade-mecum donne la recommandation de présentation des textes visés. Une harmonie des décisions doit en ressortir. Notons que c’est déjà le cas et que le « guide du rapporteur » – qui, lui, et contrairement à ce Vade-mecum, n’est pas accessible au public –, dans ses versions successives, a déjà pour objectif de parvenir à cette harmonie. Il s’agit là d’un formalisme, que les uns pourront trouver excessif, tandis que les autres y verront un gage de rigueur. Ces rappels, dans le Vade-mecum sont ainsi autant d’appels à la vérification scrupuleuse des règles inhérentes au procès, telle/es que garantie/es en droit français et en droit européen. Le rapporteur est enfin invité à s’assurer de la cohérence de l’ensemble de la décision de justice. Il appartient, enfin, au rapporteur de relire et de s’assurer de la cohérence globale de la décision à tous les stades d’écriture et de réécriture du projet : du début des visas à la fin du dispositif, en passant par les motifs, la décision doit être parfaitement cohérente. Ce contrôle de la qualité et de la cohérence de la décision est particulièrement important au moment où le rapporteur dépose son projet de décision ainsi que lorsqu’il relit, pour la dernière fois, la minute de cette décision avant de la signer23.
C’est, à vrai dire, le moins que l’on puisse attendre d’une décision de justice, qu’elle soit cohérente. L’État de droit est d’ailleurs, sur ce point, perfectionné par la possibilité d’un recours en rectification d’erreur matérielle. En effet, malgré les nombreuses relectures, avant le délibéré, et après, à la fois par le rapporteur, les réviseurs, les présidents adjoints à la section du contentieux et le secrétariat, il peut arriver que des coquilles ou erreurs matérielles demeurent.
En contentieux administratif, le recours en rectification d’erreur matérielle permet de rectifier une erreur formelle. Selon l’article R. 741-11 du Code de justice administrative, lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d’un jugement ou d’une ordonnance est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l’ordonnance rectificative rouvre le délai d’appel contre le jugement ou l’ordonnance ainsi corrigés. Lorsqu’une partie signale au président du tribunal l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. Selon l’article R. 833-1 du même code, lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’État est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Il s’agit d’un recours exercé régulièrement. Pour donner un exemple récent, il est possible de citer une décision du 31 décembre 2018, selon laquelle « considérant, toutefois, qu’il ressort des pièces du dossier que si le pourvoi sommaire présenté pour M. B., enregistré le 17 juillet 2017, présentait des conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de la SCP Zribi, Texier, le mémoire complémentaire produit dans l’instance, enregistré le 17 octobre 2017, avait renoncé à ces conclusions et présenté à la place des conclusions tendant à l’application, au bénéfice de M. B., des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ; que c’est du fait d’une erreur purement matérielle que le Conseil d’État a omis de tenir compte de la modification des conclusions relatives aux frais de l’instance ; que cette erreur, qui n’est pas imputable aux parties, a exercé une influence sur la partie de la décision qui a statué sur les conclusions en cause ; que, par suite, la requête tendant à la rectification de cette erreur matérielle est recevable ; qu’il y a lieu de statuer à nouveau sur ces conclusions »24.
Il est notable que ce recours existe aussi en droit privé et la Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de se prononcer récemment sur ce sujet. La Cour de cassation se prononce clairement pour l’éviction de tout délai de prescription pour l’exercice de l’action en rectification d’erreur matérielle25. On remarquera alors que cette interprétation n’est pas celle qui ressort, en contentieux administratif, de l’article R. 833-1 du Code de justice administrative. Le Conseil d’État pourrait ainsi être amené à se prononcer, lui aussi, sur cette question de délai. Ce simple exemple montre la perfectibilité de l’État de droit, que les décisions de justice renforcent au fil du temps et des espèces. Cette perfectibilité de l’État de droit, entendue comme conformité de chaque norme à l’ensemble des normes supérieures se double d’une perfectibilité de la lisibilité des décisions en tant qu’exigence démocratique.
II – La lisibilité des décisions, exigence démocratique
Le choix de la syntaxe et du vocabulaire est intrinsèque à la lisibilité de la décision de justice en particulier et d’un texte, quel qu’il soit, en général. Or le Vade-mecum le reconnaît très nettement : certaines formules, certains mots, relèvent de conventions. C’est sur ce dernier point que l’appréciation des évolutions de la rédaction des décisions de justice peut être nuancée. Ainsi, si l’on peut saluer les évolutions dans le sens de l’abandon et du maintien – selon les cas – à ce stade de la réflexion en tout cas, d’une série de termes et formules (A), la persistance d’une série de conventions, qui peuvent s’apparenter à un langage codé apparaît, dans certains cas au moins, facteur d’insuffisante lisibilité (B).
A – Des évolutions prometteuses en termes de lisibilité
Ce qui a le plus marqué les premiers commentateurs, la presse, est l’abandon du « considérant ». En réalité, ce n’est pas tant le « considérant » au début de chaque proposition, désormais remplacé par un « considérant ce qui suit : », qui rend la décision difficile à lire que le style utilisé. Il est vrai que la formule retenue de « considérant ce qui suit : » permet de développer l’argumentation au style plus direct et d’abandonner la phrase unique.
Dans sa rubrique consacrée au vocabulaire, le Conseil d’État distingue des termes qui seraient désuets, ou inusités, des termes techniques et enfin des termes conventionnels.
On notera en premier lieu la suppression de l’expression latine « ultra petita ». Cette expression signifie que le juge n’a pas le droit de statuer au-delà de ce qui lui est demandé, à l’exception de ce que l’on appelle les moyens dits d’« ordre public ». Ces derniers, comme la compétence de l’auteur de l’acte, doivent être soulevés obligatoirement par le juge, même si les parties au procès administratif ne le faisaient pas. Mise à part cette exception, il est constant que le juge ne peut pas statuer au-delà de la demande qui lui est faite. Cette interdiction vise à ne pas dévoyer l’office du juge, qui porte sur les demandes qui sont formulées devant lui. Il ne peut d’ailleurs pas davantage statuer « infra petita », c’est-à-dire en deçà des demandes. Si le rapporteur omettait de répondre à une demande ou à un moyen, alors la décision serait viciée. D’ailleurs, le Vade-mecum comporte une forte invitation à s’assurer de la cohérence de la décision. Cette cohérence contient inévitablement la vérification de l’absence d’« infra » ou d’« ultra petita ». Il est piquant de constater que dans le Vade-mecum lui-même, le Conseil d’État ne peut s’empêcher d’utiliser l’expression !
Outre cet exemple typique, le Vade-mecum présente un tableau, comprenant une colonne recensant les termes à éviter et une colonne reprenant des termes, sans doute peu clairs, s’ils figurent dans le tableau, mais dont le maintien est admis. Il faut bien souligner que les termes dont l’usage n’est pas recommandé ne sont pas proscrits. D’ailleurs le texte du Conseil d’État recommande, en cas d’usage retenu d’un terme jugé peu clair, de mettre en place un « glossaire aisément accessible au public »26.
Sans reprendre la liste complète des termes non recommandés, quelques exemples témoignent de certains archaïsmes, pour lesquels la suppression semble effectivement un progrès net dans la lisibilité. Il en est ainsi par exemple de l’expression « juridiction de céans », ou de l’expression « il s’évince de ». Cette dernière expression, régulièrement employée par les rapporteurs publics – comme l’assistance à des séances publiques peut le démontrer aisément –, semble être une habitude transmise de génération en génération. Remplacer cette expression inutilement peu claire par un banal « il ressort » ou « il se déduit que » semble en effet salutaire. De même, la quelque peu théâtrale « décision querellée » devrait être remplacée par une plus raisonnable « décision attaquée ».
Outre ces termes ou expressions qui semblent désuets, des modifications sont recommandées s’agissant d’une série de termes techniques. Il en est ainsi de la notion d’« interjeter appel », remplacée par « faire appel », ou encore d’« ester en justice » supplantée par « agir en justice ». Enfin l’expression de « frais irrépétibles » était déjà moins utilisée si l’on observe la dernière décennie. Pourtant, si l’expression est remplacée, selon les recommandations du Vade-mecum, par la notion de « frais non compris dans les dépens », l’expression de « frais irrépétibles » est souvent employée par les praticiens du droit. Dans l’ensemble, ces recommandations d’abandon de termes désuets sont satisfaisantes. En revanche il est possible de s’interroger sur l’utilité, la pertinence même, du maintien de certains termes ou expressions.
B – L’utilité incertaine du maintien de certains termes ou expressions
En 2012, on pouvait lire la phrase suivante dans la recherche de meilleure motivation, sans perdre la tout aussi nécessaire concision. « Il faut enfin convenir que l’enrichissement des motivations n’est pas toujours nécessaire et n’est en tout état de cause pas possible dans tous les litiges, notamment lorsque la solution, qui repose essentiellement sur ce que les parties ont apporté dans les débats, ne peut être davantage étayée en fait. Une structure rédactionnelle qui imposerait une motivation trop détaillée qui n’aurait pas d’objet représenterait alors pour le juge une contrainte inutile »27. Force est de constater que le juge administratif, même lorsqu’il réfléchit à se rendre plus accessible au citoyen, apprécie beaucoup – c’est le moins que l’on puisse observer – l’expression « en tout état de cause ». Or, si dans la phrase citée immédiatement au-dessus, l’expression se comprend, et est utilisée dans son sens commun, qui correspond peu ou prou, à « de toute façon » dans les décisions de justice, elle est peu compréhensible à qui n’est pas rompu à l’écriture ou à la lecture de la décision de justice administrative28. La liste est aussi dite non exhaustive.
Or, si une série de termes et expressions est jugée peu souhaitable, on observe que s’agissant des expressions dites conventionnelles, la colonne des termes à éviter est… vide ! Il s’agit là de termes et expressions existant dans le langage courant en français, mais qui prennent un sens spécifique en contentieux. Il y a là une certaine approche de coutume, de dialogue implicite et informel entre les juges administratifs et les avocats. Certaines expressions sont plus accessibles que d’autres, même si aucune proposition de suppression n’apparaît dans le Vade-mecum.
Ainsi, le tableau de propositions de suppression/maintien propose de conserver l’ensemble des expressions ou termes que le Conseil d’État appelle conventionnels. Il en donne une liste qui ne saurait d’ailleurs être exhaustive. Il en est ainsi de :
-
« manque en fait, n’a pas pour objet / ne saurait avoir pour effet, ne peut qu’être écarté, ne peut utilement soutenir que ;
-
n’est pas fondé à se plaindre de ;
-
n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que ;
-
par les dispositions contestées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du…, le législateur ;
-
sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
-
sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête ;
-
sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par… ;
-
sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ».
Le juge use souvent de ce qui s’appelle l’économie de moyen. C’est ce que révèle l’emploi fréquent des formules débutant par « sans qu’il soit besoin ». Il peut s’agir dans certains cas de préciser qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’ensemble des moyens (ensemble d’arguments, ainsi qu’on l’a rappelé plus haut). C’est le cas si un seul moyen suffit à donner satisfaction au requérant. Il peut aussi s’agir d’éviter de se prononcer sur une fin de non-recevoir. Rappelons que la fin de non-recevoir peut être invoquée par la défense afin que le juge rejette la requête ou le pourvoi pour irrecevabilité. L’irrecevabilité peut être causée par plusieurs facteurs, tels le délai dépassé, ou encore l’absence d’intérêt à agir. Dans les circonstances où la demande formulée par le requérant est rejetée, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité. Tel est le sens de ce genre de formulation.
Ce qui peut surprendre dans ce maintien des conventions est que non seulement certaines sont peu compréhensibles sans information préalable sur les méthodes de travail du juge administratif, mais que le juge cherche à les théoriser. C’est-à-dire que chaque expression conventionnelle correspond à une certaine méthode de travail. Ainsi, en matière d’interprétation, le Conseil d’État indique, dans son Vade-mecum, ce que chaque expression implique :
-
« Il résulte des termes mêmes de l’article… que : interprétation littérale ;
-
il résulte clairement de : application de la théorie de “l’acte clair” ;
-
par les dispositions contestées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du…, le législateur a entendu : interprétation finaliste ;
-
eu égard à l’objectif poursuivi par : interprétation finaliste ;
-
il résulte de l’ensemble de ces dispositions / de ces dispositions combinées : interprétation mettant en cohérence différents textes ;
-
il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de : interprétation conforme ;
-
n’a pas pour objet / ne saurait avoir pour effet : interprétation neutralisante ».
On relèvera aussi une série de termes techniques, que le Conseil d’État estime devoir conserver, moyennant l’usage d’un glossaire, sans pour autant en préciser suffisamment les modalités pratiques. Parmi ces termes dits techniques, il est possible de citer :
-
« action subrogatoire / récursoire ;
-
appel en cause / en garantie ;
-
appel (incident / provoqué) ;
-
pourvoi ;
-
capitalisation des intérêts ;
-
consorts ;
-
effet dévolutif / évocation ;
-
excès de pouvoir ;
-
exciper ;
-
fin de non-recevoir ;
-
plein contentieux / pleine juridiction ;
-
par voie de conséquence ;
-
protestation, grief (contentieux électoral) ;
-
office du juge ;
-
inopérant ;
-
rappel, rehaussement, cotisation (contentieux fiscal) (d’autres termes techniques sont recensés dans le glossaire publié sur le site internet des juridictions) ».
Sur ce dernier point, plutôt que de renvoyer à un glossaire par juridiction, sans doute faudrait-il assortir toute décision du glossaire pertinent selon les termes employés. La dématérialisation des dossiers le permettrait aisément.
Si l’unité de ton et la marque de fabrique29 peuvent rester de mise, il demeure des tournures et des termes qui, par leur dimension codée, rendent la lecture d’une décision de justice encore trop difficile. Ainsi, les termes laudatifs employés par le Conseil d’État lui-même ne sauraient avoir valeur absolue. On lit en effet, dans le Vade-mecum, pourtant consacré à une évolution des modes de rédaction des décisions de justice, que « l’écriture des décisions de justice obéit à des règles et des conventions qui lui sont propres. Celles-ci garantissent l’exactitude et l’élégance de l’expression, la rigueur et la clarté du raisonnement. Elles sont le fruit de pratiques coutumières, qui fondent l’unité de la juridiction administrative. Pour mieux répondre aux exigences d’accessibilité et de lisibilité des décisions de justice, les règles d’usage du vocabulaire, ainsi que des formules de coordination et de liaison logique ont été recensées et, le cas échéant, clarifiées ». C’est ce que propose ce Vade-mecum.
Outre les interrogations que peuvent susciter les maintiens retenus de tel mot ou telle expression, on notera qu’il s’agit là de recommandations. Or ces recommandations, lues au miroir de l’importance des précédents dans la jurisprudence administrative, vont jusqu’à la recommandation faite au rapporteur, dans ce document même, nommé Vade-mecum, de reprendre, lorsque cela est adapté, des formules déjà employées dans des décisions précédentes. Sur ce point, il faut indiquer ici que la base de données Ariane, en partie accessible au grand public, comporte une importante aide à la rédaction des décisions par les rapporteurs successifs. En effet, outre la recherche par mots-clés permettant d’accéder à des décisions comparables, la recherche par analyse de la décision permet d’avoir un accès plus précis encore aux décisions qui traitent de sujets similaires. Il ressort de la mise en parallèle des deux recommandations que les risques ne sont pas négligeables de voir se perpétuer des mots ou formules pourtant « déconseillés ».
On relèvera encore la recommandation forte, faite au rapporteur, eu égard à la structuration de la décision, de ne pas donner la conclusion du raisonnement dans le premier paragraphe du raisonnement. C’est une constante des décisions de justice, et pas seulement des juridictions administratives. Cependant, à l’observation du déroulé des décisions de justice, et particulièrement de celles du Conseil d’État, dont le laconisme devrait perdurer, la question du bien-fondé de cette pérennité peut se poser. En effet, une des recommandations des enseignants à l’égard des étudiants est de « commencer par la fin » lors de l’étude d’une décision du Conseil d’État. En effet, étant informé de l’issue du raisonnement, le lecteur lira plus aisément les étapes du raisonnement du juge. Il ne semblerait pas impossible de commencer les motifs par une formule indiquant « il sera fait droit aux conclusions du requérant pour les raisons qui suivent », ou encore « il sera partiellement fait droit », ou enfin « il ne sera pas fait droit aux conclusions… ».
Il est intéressant d’observer les premières décisions rendues sous l’empire de ces recommandations. On pourra ainsi par exemple noter que depuis le 1er janvier, le terme, dont le maintien est recommandé, mais dont le caractère quelque peu ancien et peu clair persiste, « nonobstant » a été déjà employé plusieurs fois. Citons ainsi notamment : « Cette obligation n’ayant pas été contestée, l’intéressé a été interpellé le 20 novembre 2018 et placé au centre de rétention administrative du Canet sur décision du préfet des Bouches-du-Rhône datée du 21 novembre 2018. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2018 à 10 heures 10, M. A. a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, aux fins de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire du 31 décembre 2017 et de constatation de l’atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de mener une vie familiale normale. Nonobstant la requête adressée au tribunal administratif de Marseille, l’intéressé a été reconduit vers la Tunisie le 24 novembre 2018 vers 12 heures. M. A. demande au juge des référés du Conseil d’État, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, d’annuler l’ordonnance du 27 novembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Var du 31 décembre 2017 l’obligeant à quitter le territoire français, en deuxième lieu, à ce qu’il soit fait injonction au préfet du Var de transmettre le dossier, dans un délai de quinze jours, au préfet des Bouches-du-Rhône devenu territorialement compétent, à titre subsidiaire, qu’il lui soit fait injonction de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, en dernier lieu, à ce qu’il soit fait injonction à l’Administration de prendre toutes mesures utiles pour organiser son retour en France dans les meilleurs délais »30.
L’emploi dans le sens affirmatif ou négatif de l’expression « est fondé à soutenir que c’est à tort » est très fréquent et s’inscrit désormais dans un style direct, indéniablement plus clair : « Eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d’aller et venir, une décision prise par l’autorité administrative en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du Code de la sécurité intérieure, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l’Administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde. Si le ministre de l’Intérieur, par un arrêté modificatif en date du 2 janvier 2019, a accepté de changer l’horaire de présentation quotidienne de M. A. à la gendarmerie et l’a autorisé à se déplacer en dehors du territoire de la commune de Mantes-la-Jolie pour rejoindre son lieu de travail situé dans la commune de Limay, afin de rendre la mesure de contrôle administratif et de surveillance compatible avec ses contraintes professionnelles, ces aménagements ne constituent pas des circonstances particulières de nature à remettre en cause, au cas d’espèce, l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. Par suite, M. A. est fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés s’est fondé sur l’absence d’urgence pour rejeter sa demande »31.
En somme, c’est une recommandation en demi-teinte que formule le Conseil d’État. Tout se passe comme si, tout en étant conscient d’un certain ésotérisme, préjudiciable au principe d’intelligibilité et de clarté du droit, il était si attaché à une série de termes ou expressions qu’il les lie inexorablement à la rigueur du rendu de la justice. En d’autres termes, le Vade-mecum est lui-même symptomatique de la carte d’identité du juge administratif. D’ailleurs, il est officiellement à destination du rapporteur, venant ainsi compléter – voire dans certains cas redire – ce que dit le « guide du rapporteur », tout en étant accessible en ligne. Il mêle ainsi des recommandations de bon sens, comme le bon usage des conjonctions de coordination (mais, ou, et, donc, or, ni, car…) et des éléments plus fondamentaux que l’on a présentés plus haut.
La volonté de « démocratiser » la lecture des décisions doit toujours, selon le Conseil d’État, se concilier avec une certaine « codification » à laquelle le juge administratif tient. C’est somme toute une question de curseur, qui semble se déplacer peu à peu d’un laconisme peu compréhensible au commun des mortels vers une accessibilité au justiciable encore perfectible.
Notes de bas de pages
-
1.
Carbonnier J., Flexible droit, 1971, Paris, LGDJ.
-
2.
http://www.conseil-etat.fr/content/download/149628/1515101/version/1/file/Vade-mecum-Redaction-decisions-de-la-juridiction-administrative.pdf.
-
3.
CE, 14 déc. 2018, n° 419443.
-
4.
CE, 28 déc. 2018, n° 392589.
-
5.
Rapport rendu en avril 2012, à la suite des travaux menés sous la direction du Conseiller d’État Martin P., p. 12, http://www.conseil-etat.fr/content/download/1690/5098/version/1/file/rapport_redaction_decisions_juradm_2012.pdf.
-
6.
CE, 10 déc. 2018, http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Juridiction-administrative-nouveaux-modes-de-redaction-des-decisions.
-
7.
Rapport rendu en avril 2012, à la suite des travaux menés sous la direction du Conseiller d’État P. Martin, http://www.conseil-etat.fr/content/download/1690/5098/version/1/file/rapport_redaction_decisions_juradm_2012.pdf.
-
8.
Rapp. CE 2012, http://www.conseil-etat.fr/content/download/1690/5098/version/1/file/rapport_redaction_decisions_juradm_2012.pdf, p. 54.
-
9.
Rapp. CE 2012, http://www.conseil-etat.fr/content/download/1690/5098/version/1/file/rapport_redaction_decisions_juradm_2012.pdf, p. 54.
-
10.
V. notre ouvrage, Le Conseil d’État, acteur et censeur de l’action publique, 2017, Lextenso.
-
11.
L’égalité d’accès à la Cour de cassation (par M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation), sur le site de la Cour de cassation.
-
12.
CEDH, 8 févr. 2000, n° 27362/95, Voisine c/ France.
-
13.
Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française 2007-2008, dite commission Attali : https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000041.pdf.
-
14.
Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française 2007-2008, dite commission Attali : https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000041.pdf., p. 6.
-
15.
Vedel G., Le droit administratif peut-il être indéfiniment jurisprudentiel ?, 1979-1980, EDCE, p. 37 et s. L’exigence légale de motivation des décisions de justice est d’ailleurs d’origine révolutionnaire, puisqu’elle trouve sa source dans la loi des 16 et 24 août 1790. Cité dans l’étude précitée du Conseil d’État 2012, note 7.
-
16.
Vade-mecum, p. 5
-
17.
Vade-mecum, p. 15.
-
18.
http://www.conseil-etat.fr/content/download/149628/1515101/version/1/file/Vade-mecum-Redaction-decisions-de-la-juridiction-administrative.pdf, p. 6.
-
19.
Vade-mecum, p. 8.
-
20.
Vade-mecum, p. 9.
-
21.
Vade-mecum, p. 9.
-
22.
Vade-mecum, p. 10.
-
23.
Vade-mecum, p. 16.
-
24.
CE, 31 déc. 2018, n° 421434.
-
25.
Cass. 2e civ., 3 juill. 2018, n° 16-28539 : par acte authentique, une société avait acquis auprès d’une autre société des actions que cette dernière détenait d’une troisième société. Un jugement d’un tribunal mixte de commerce avait prononcé le plan de redressement et d’apurement du passif de cette dernière société. Par requête, le mandataire liquidateur a saisi ce tribunal en interprétation du jugement. La juridiction a rendu un jugement rectificatif qu’une cour d’appel a infirmé au motif que la requête ne relevait pas de l’interprétation mais de l’erreur matérielle. Par une requête postérieure, la société acquisitrice et le mandataire liquidateur ont sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif du même jugement. La juridiction saisie a déclaré cette requête en rectification d’erreur matérielle irrecevable comme prescrite. Pour les juges du fond, l’action en interprétation du jugement, procédant d’une cause distincte mais tendant vers le même but que l’action en rectification, interrompt le délai de prescription de cette dernière. Cette extension de l’interruption suppose que l’interruption soit toujours en cours, ce qui n’est plus le cas en l’espèce, la requête en interprétation ayant été rejetée par la cour d’appel par un arrêt antérieur devenu définitif. Par un moyen relevé d’office, l’arrêt est cassé au visa de l’article 462 du Code de procédure civile. La Cour de cassation énonce que la requête en rectification d’erreur matérielle, qui ne tend qu’à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et qui ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, n’est pas soumise à un délai de prescription. V. https://www.dalloz-actualite.fr/flash/requete-en-rectification-d-erreur-materielle-pas-de-delai-de-prescription#.XEwp4NvsbVI.
-
26.
Vade-mecum, p. 18.
-
27.
Rapport de 2012, p. 11.
-
28.
V. notre ouvrage, Le Conseil d’État, acteur et censeur de l’action publique, Lextenso 2017.
-
29.
Termes employés dans le Vade-mecum, p. 3 : http://www.conseil-etat.fr/content/download/149628/1515101/version/1/file/Vade-mecum-Redaction-decisions-de-la-juridiction-administrative.pdf.
-
30.
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp ?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=nonobstant+2019&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=4&Pluriels=True.
-
31.
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp ?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=n %27est+pas+fond %E9+ %E0+soutenir+que+c %27est+ %E0+tort+2019&Page=1&querytype=advanced&NbEltPerPages=4&Pluriels=True.