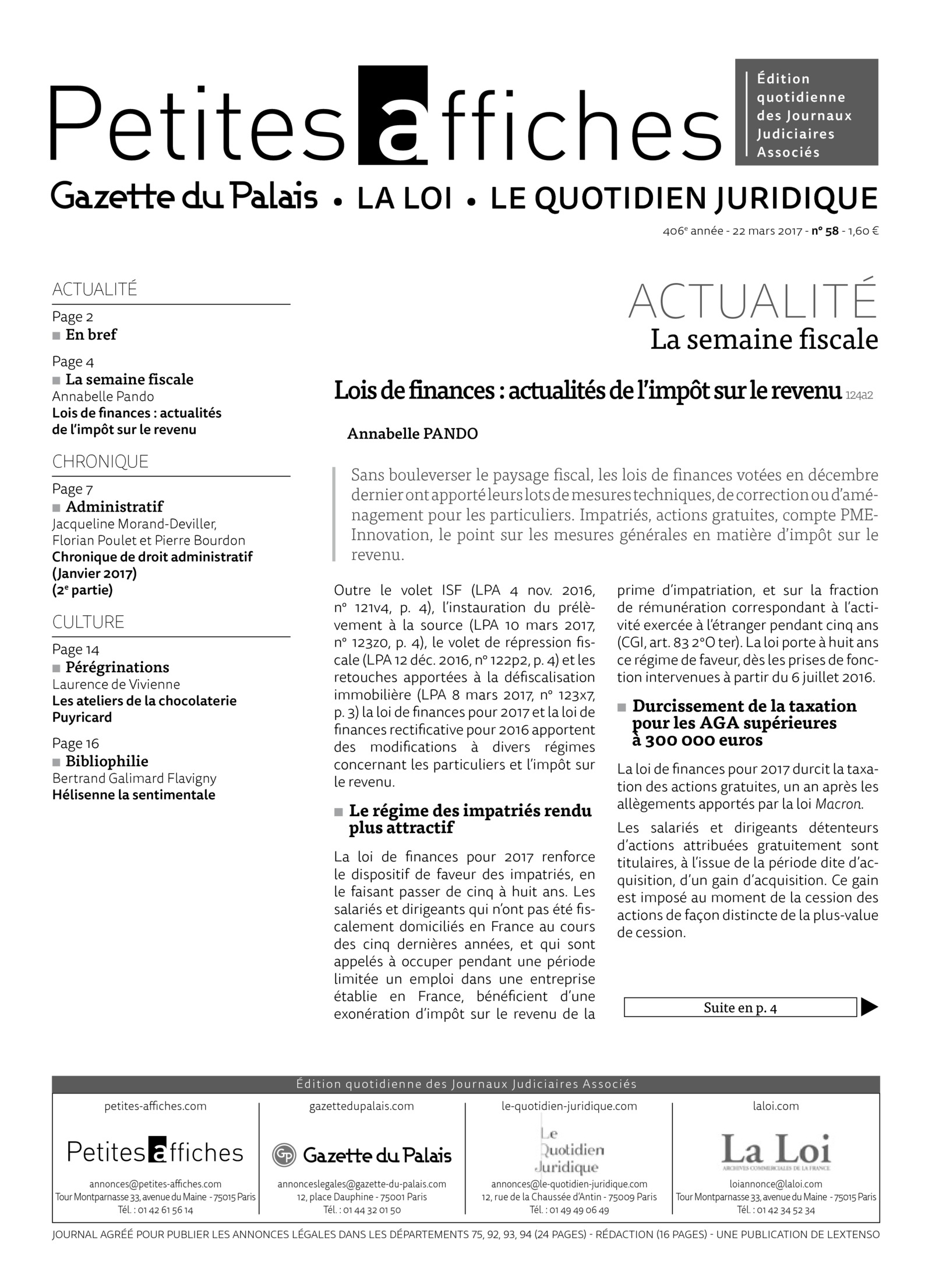Chronique de droit administratif (Janvier 2017) (2e partie)
I – Droit administratif des biens
II – Responsabilité administrative
III – Administration locale
La consultation, garantie substantielle de la libre administration des collectivités territoriales
Cons. const., 21 oct. 2016, n° 2016-588 QPC, Cté de cnes des sources du lac d’Annecy et cne des Abrets en Dauphiné. Les départements et les régions ne sont pas les seules collectivités concernées par le mouvement de rationalisation des collectivités territoriales actuellement à l’œuvre. Les quelque 36 000 communes françaises sont intéressées presque naturellement.
D’ailleurs, les mesures de rationalisation de la carte communale semblent enfin fonctionner. L’on se souvient que le mécanisme de fusion des communes, issu de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 dite loi Marcellin, n’avait apporté qu’un résultat modeste. Plus ambitieuse, la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 est aussi plus effective, grâce notamment aux incitations financières qu’elle propose. Les chiffres en témoignent. La France comptait encore 36 683 communes au 1er janvier 2011. Ce chiffre s’est établi à 35 585 au 1er janvier 2016 d’après la direction générale des collectivités locales. Une diminution de 3 % en cinq ans.
Les règles de la loi de 2010 ont été codifiées aux articles L. 2113-1 à L. 2113-22 du Code général des collectivités territoriales. L’un de ces articles, L. 2113-5, envisage l’hypothèse d’une fusion de communes qui ne sont pas membres du même établissement public de coopération intercommunale (à fiscalité propre) – EPCI-FP en abrégé. Et pour cause ! L’article L. 5210-2 interdit à une commune d’appartenir à plus d’un EPCI-FP. Lorsque des communes fusionnent et qu’elles sont rattachées à plus d’un EPCI-FP, il convient de déterminer l’unique EPCI-FP de rattachement de la commune nouvelle.
L’article L. 2113-5 prévoit que le conseil municipal de la commune nouvelle détermine l’EPCI-FP de rattachement. Toutefois, jusqu’à la décision ici commentée, l’article L. 2113-5 envisageait aussi un « désaccord » du préfet et la faculté pour ce dernier d’obtenir le rattachement de la commune nouvelle à un autre EPCI-FP « auquel appartenait une des communes dont la commune nouvelle est issue ».
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, transmise par le Conseil d’État, visant l’article L. 2113-5. D’après les auteurs de la question, les pouvoirs du préfet prévus par l’article L. 2113-5 étaient contraires au principe de libre administration des collectivités territoriales (sur ce principe, v. supra). Dans sa décision rendue le 21 octobre 2016, le Conseil constitutionnel a admis le grief d’inconstitutionnalité.
Ce faisant, le Conseil constitutionnel est venu étoffer sa jurisprudence sur le rattachement d’une commune à un EPCI-FP. Cette jurisprudence est issue notamment de sa décision Commune de Thonon-les-Bains de 20141.
Dans l’affaire Commune de Thonon-les-Bains jugée en 2014, le juge constitutionnel a constaté l’inconstitutionnalité de dispositions permettant au préfet de rattacher à un EPCI-FP une commune rattachée à aucune structure de ce type. La censure, fondée sur la méconnaissance du principe de libre administration, reposait sur l’absence de trois garanties :
-
l’absence de consultation des communes intéressées par le rattachement, y compris celle dont le rattachement est envisagé ;
-
l’absence de prise en compte du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) pour décider du rattachement ;
-
l’obligation de suivre la proposition émise par la Commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), mais seulement en cas d’avis négatif de l’EPCI-FP de rattachement.
Dans l’affaire ici commentée, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions de l’article L. 2113-5 du Code général des collectivités territoriales ne prévoyaient pas, elles non plus, des garanties suffisantes, telles que :
-
la consultation des communes intéressées par le rattachement ;
-
la faculté pour les EPCI-FP ou les communes de saisir la CDCI en cas de désaccord avec le projet de rattachement.
Il faut relever que l’on ne voit pas en quoi la seconde garantie mentionnée ci-dessus était utile. En cas de désaccord, le préfet était de toute façon tenu de saisir la CDCI.
En revanche, l’absence de prise en compte du SDCI n’a pas été sanctionnée dans la présente décision. Le commentaire de la décision publié sur le site du Conseil constitutionnel n’évoque même pas le schéma. L’absence de prise en compte du SDCI avait pourtant été sanctionnée dans la décision Commune de Thonon-les-Bains de 2014. La comparaison des deux décisions laisse croire qu’une telle garantie n’est pas substantielle.
Mais ce n’est pas tout.
L’EPCI-FP de rattachement était obligatoirement consulté d’après les dispositions censurées par la décision de 2014. Dans la présente affaire, cette garantie n’était pas prévue par les dispositions litigieuses. Il n’était prévu de consulter ni le futur EPCI-FP de rattachement, ni même celui ou ceux dont le retrait était envisagé.
En somme, la comparaison de la décision de 2014 avec celle rendue le 21 octobre 2016 permet de tirer au moins un enseignement. Le Conseil constitutionnel considère comme une garantie substantielle la consultation de toutes les collectivités – communes et EPCI-FP – parties prenantes à l’opération de rattachement ou de retrait d’un EPCI-FP.
Le Conseil constitutionnel a finalement reporté au 31 mars prochain le prononcé de l’abrogation des dispositions inconstitutionnelles. Malgré ce report lointain, les conséquences de la décision du 21 octobre 2016 ont été tirées dès le 26 courant. Un amendement du gouvernement a été adopté pour pallier l’inconstitutionnalité lors des débats au Sénat sur une proposition de loi « tendant à faciliter la recomposition de la carte intercommunale ». La réaction aura été très rapide. La rationalisation de la carte communale fait décidément l’objet d’une grande attention de la part du gouvernement, du Parlement… et du juge !
PB
Du burkini aux crèches : vers la consécration d’un principe de tolérance
CE, ord., 26 août 2016, nos 402742 et 402777, Ligue des droits de l’Homme et a. – CE, 9 nov. 2016, n° 395122, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne – CE, 9 nov. 2016, n° 395223, Fédération de la libre pensée de Vendée. À première vue, le burkini et les crèches n’ont pas grand-chose en commun. Le premier est un vêtement d’été, alors que les secondes sont une décoration d’hiver. Pourtant, le burkini et les crèches concernent, de près ou de loin, les religions, et en l’occurrence ce que l’on appelle parfois les « religions du Livre », le judaïsme, le christianisme et l’islam. En outre, l’un et les autres ont fait l’objet de décisions – celle sur le burkini est plus précisément une ordonnance – rendues par le Conseil d’État à quelques mois d’intervalle. Enfin, l’on trouve dans chacune des décisions une référence au principe de laïcité. L’on y trouve aussi une référence, très implicite, au principe de tolérance.
Les faits et les décisions rendues par le Conseil d’État sont bien connus. On les rappellera très brièvement. Dans l’affaire du burkini, était en cause l’arrêté de police d’un maire interdisant sur les plages, le port de tenues considérées comme manifestant une appartenance religieuse, comme le burkini. Dans l’affaire des crèches, le litige concernait l’installation de crèches de Noël par les personnes publiques. Il résulte des décisions rendues que ni le burkini ni les crèches ne peuvent être interdits.
Chacune de ces décisions aurait pu être rendue dans un sens totalement inverse, dans le sens de l’interdiction. Tant et si bien qu’il peut être difficile de donner une cohérence aux solutions apportées. À bien y regarder, le principe de tolérance semble former la colonne vertébrale de ces décisions. L’un des sens de la tolérance n’est-il pas de ne pas interdire ce qui pourrait l’être ? Les décisions contiennent plusieurs références très implicites au principe de tolérance. Ces références concernent la notion de respect, le pluralisme et le principe de laïcité.
En premier lieu, la notion de respect est mise à l’honneur par les décisions ici présentées. L’ordonnance « burkini » rappelle aux maires qu’ils doivent concilier leur pouvoir de police « avec le respect des libertés ». L’article 1er de la Constitution d’après lequel « La France (…) respecte toutes les croyances » aurait également pu être cité. Il est seulement mentionné dans les visas de l’ordonnance. Ces dispositions sont en revanche citées dans la décision sur les crèches. Ainsi, à travers la notion de respect, les décisions appellent à tolérer l’exercice par chacun de ses libertés, notamment en matière de croyance.
En deuxième lieu, les décisions ici rapportées protègent le pluralisme. Avec l’ordonnance « burkini », c’est tout particulièrement le pluralisme des « libertés fondamentales » qui est mis en avant : « la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle ». L’atteinte à ces libertés a entraîné l’illégalité de l’arrêté « anti-burkini ». Dans les décisions sur les crèches, c’est la circonstance qu’« une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations » (religieuse ou non) qui a été mise en avant. « Cette pluralité de significations » – les décisions insistent ! – a rendu légale « l’installation d’une crèche de Noël, à titre temporaire, à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public », sauf, d’une part, si cet emplacement est le siège d’une collectivité publique ou d’un service public ou, d’autre part, si l’installation constitue un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse. Ainsi, à travers le pluralisme, les décisions appellent à tolérer l’exercice de diverses libertés et, en particulier, l’expression de diverses significations.
Enfin, les décisions ici commentées n’exigent pas une application stricte du principe de laïcité. L’ordonnance « burkini » n’y fait même pas référence, sauf lorsqu’elle cite entre guillemets les motifs sur lesquels les maires ont tenté de fonder l’interdiction du burkini. Toutefois, comme l’a rappelé la décision, seule l’atteinte à l’ordre public peut justifier une mesure de police. Et la laïcité n’est pas une composante de l’ordre public. La décision le rappelle implicitement. La décision sur les crèches fait quant à elle référence au principe de laïcité, mais uniquement lorsqu’elle cite l’article 1er de la Constitution : « La France est une République (…) laïque ». La laïcité était pourtant à peu près partout dans les conclusions du rapporteur public Aurélie Bretonneau sur cette affaire. À la toute fin de ses conclusions, Aurélie Bretonneau a d’ailleurs très bien résumé le rôle du juge administratif à l’égard de la laïcité : « privilégier la dimension pacificatrice de la laïcité et l’ajuster autant que possible à des usages en constante évolution ». Ainsi, à travers la laïcité, les décisions ici commentées appellent à tolérer les usages existant au sein de la société.
Finalement, depuis une vingtaine d’années, la jurisprudence du Conseil d’État s’est lancée dans la consécration de principes moraux, tels que la dignité2, ainsi que la loyauté3. Un principe manque à l’appel, alors qu’il est sans doute aussi important que les deux autres. C’est le principe de tolérance. On le perçoit de manière très implicite dans certaines décisions récentes. À quand une reconnaissance explicite ?
PB
IV – Contrats administratifs
L’irrégularité d’un contrat ou de l’un de ses actes détachables ne se répercute pas sur un permis de construire
CE, 17 oct. 2016, n° 373990, Association « Les Amis du Montaiguet et du Pont de l’Arc ». C’est une jurisprudence plutôt classique, mais peu connue. En principe, les contrats administratifs sont étanches aux actes administratifs pris en matière immobilière. Cette jurisprudence a trouvé à s’appliquer pour l’essentiel dans le domaine de l’expropriation, notamment à l’égard des déclarations d’utilité publique et des arrêtés de cessibilité. Une décision rendue par le Conseil d’État le 17 octobre 2016 fait application de cette jurisprudence, dans le domaine de l’urbanisme, à propos d’un permis de construire.
Selon une jurisprudence aujourd’hui périmée, l’irrégularité d’un acte administratif immobilier était indissociable du contrat ou de l’acte détachable du contrat qui avait le même objet. L’irrégularité de l’un se répercutait sur l’autre. Ainsi, l’irrégularité d’une déclaration d’utilité publique était invocable contre l’acte d’approbation d’un contrat de concession4.
La jurisprudence considère désormais que l’irrégularité d’un acte administratif immobilier est dissociable du contrat ou de l’acte détachable du contrat qui a le même objet. L’irrégularité de l’un ne se répercute pas sur l’autre, et inversement.
C’est à l’occasion d’une décision Époux Merlin rendue en 1975 que le Conseil d’État a estimé qu’il n’y avait « aucun lien direct et nécessaire entre ces deux actes », l’acte immobilier et l’acte contractuel. Par suite, il a jugé que l’irrégularité de la déclaration d’utilité publique ne peut pas être invoquée au soutien de conclusions dirigées contre l’acte d’approbation d’un contrat5. Cette jurisprudence est constante et la circonstance que la déclaration d’utilité publique soit postérieure ou antérieure à la conclusion du contrat est sans incidence sur l’invocabilité de l’irrégularité de la déclaration6.
Il faut signaler, en revanche, qu’une jurisprudence très ancienne admet que l’annulation de la déclaration d’utilité publique des travaux puisse entraîner la résiliation du contrat par l’Administration. En effet, le contrat perd son objet en cours d’exécution dans une telle situation7. Cette jurisprudence ne semble pas avoir été contredite.
À l’inverse, « l’exception d’illégalité de la convention » ne peut être utilement invoquée par des requérants « à l’appui de leur contestation de la déclaration d’utilité publique »8.
À l’occasion d’une décision rendue le 17 octobre dernier, le Conseil d’État a appliqué cette jurisprudence au domaine de l’urbanisme. Dans le sixième considérant de sa décision, l’on peut lire que « la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique en jugeant inopérant le moyen tiré de l’illégalité de la convention de projet urbain partenarial conclue le 4 juillet 2011 avec la SCI Les Bornes sur le fondement de l’article L. 332-11-3 du Code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal du 27 juin 2011 qui l’avait approuvée, le permis de construire attaqué n’ayant pas été pris en application de ces actes, qui n’en constituent pas davantage la base légale ».
Le caractère indissociable de l’irrégularité de la convention de projet urbain partenarial par rapport au permis de construire n’était pas une évidence, ceci malgré la solidité de la jurisprudence antérieure. En effet, le Code de l’urbanisme prévoit que si « les travaux projetés font l’objet d’une convention de projet urbain partenarial (…), la demande [de permis de construire] est accompagnée d’un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée d’exonération de la taxe d’aménagement » (C. urb., art. R. 431-23-2). En conséquence, contrairement à l’idée de base de la décision d’assemblée Époux Merlin précitée, l’on ne peut pas dire qu’il n’y a absolument « aucun lien direct et nécessaire entre ces deux actes », l’acte immobilier et l’acte contractuel. L’on ne peut pas exclure que l’instruction de la demande de permis de construire ait été effectuée au regard de la convention de projet urbain partenarial.
Finalement, il faut remarquer que la décision rendue le 17 octobre 2016 émane de la seule 7e chambre du contentieux et qu’il n’est pas envisagé qu’elle soit publiée au Recueil Lebon, ni même simplement mentionnée aux Tables. D’ailleurs, par définition, la jurisprudence n’a jamais dit son dernier mot. Une formation plus solennelle du Conseil d’État pourrait tout à fait poser un autre regard sur les liens entre les conventions de projet urbain partenarial et les permis de construire.
PB
Les règles du Code civil sur le consentement ne s’appliquent pas nécessairement en matière de contrat administratif
CE, 7 oct. 2016, n° 392722, Mme Caliot. La réforme du droit civil des contrats, issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, est entrée en vigueur le 1er octobre dernier. Quelques jours après, le Conseil d’État est venu rappeler opportunément le principe aussi fondamental qu’ancien selon lequel le Code civil ne s’applique pas nécessairement en droit administratif, y compris s’il est question d’un contrat. C’est l’un des mérites essentiels de la décision Caliot rendue par les 7e et 2e chambres réunies du contentieux du Conseil d’État le 7 octobre 2016.
Les faits de l’espèce, assez classiques eux aussi, sont les suivants. Mme Caliot s’est engagée dans l’armée en 2004. À cette fin, elle a signé un contrat d’engagement en qualité d’élève-officier médecin, ce qui est « un acte administratif »9. Mineure au moment de la signature, le père de l’intéressée est intervenu pour donner son consentement à cet engagement. Mais quelques années plus tard, Mme Caliot a voulu quitter l’armée.
La résiliation du contrat d’engagement dans l’armée implique pour l’ancien militaire de rembourser à l’État les frais relatifs à sa formation, ce qui peut représenter une somme pouvant parfois s’élever jusqu’à 50 000 € pour un élève-officier. Décidant de changer son fusil d’épaule, l’ancien soldat peut faire valoir que le contrat d’engagement est en réalité illégal et que son annulation doit être prononcée. Ce faisant, l’ancien militaire espère faire disparaître rétroactivement le contrat… et le remboursement des frais de formation. C’est ce qu’a tenté Mme Caliot dans cette affaire. Mais le tribunal administratif, la cour administrative d’appel, puis le Conseil d’État l’ont tour à tour déboutée.
Mme Caliot prétendait que le consentement à son contrat d’engagement dans l’armée n’avait été donné que par son père. Selon la requérante, un tel contrat était contraire à l’article 372 du Code civil qui prévoit l’exercice en commun de l’autorité parentale.
Dans le deuxième considérant de sa décision Caliot, le Conseil d’État a estimé que ne s’appliquait pas à l’engagement dans les armées le « principe selon lequel l’exercice conjoint de l’autorité parentale requiert l’accord des deux parents pour les actes non usuels de l’autorité parentale ». Par suite, le Conseil a confirmé « la règle permettant que le consentement à l’engagement d’un mineur puisse être valablement donné par un seul des deux parents ».
L’on constate que le Conseil d’État n’a pas mentionné le Code civil dans ce deuxième considérant relatif au principe de l’autorité parentale. Ne peut-on pas y voir une volonté du juge administratif de renforcer la distinction entre le droit civil et le droit administratif, ainsi que l’autonomie de ce dernier ? La jurisprudence récente, notamment en matière de garantie décennale, avait déjà tendance à abandonner toute référence au droit civil10.
Toutefois, la décision Caliot indique aussi, de façon un peu maladroite, que les règles du droit administratif relatives à l’engagement dans les armées formeraient un « régime dérogatoire ». Ce faisant, les règles du droit administratif seraient une sorte de corpus de règles particulières par rapport à un droit commun assimilé au droit civil. Voilà qui menace la distinction entre le droit civil et le droit administratif, mais surtout l’autonomie de ce dernier.
Telle n’est pourtant pas l’option choisie explicitement par le législateur. En effet, c’est la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 qui, dans son article 1er, a remplacé le principe de la puissance paternelle par celui de l’autorité parentale. La loi de 1970 ne crée cependant aucune « dérogation » pour les contrats d’engagement dans les armées. Elle s’en tient à prévoir, dans un article 8 rappelé par la décision Caliot, que « Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux règles relatives à l’engagement dans les armées ». Autrement dit, les règles du droit administratif préexistaient à la loi de 1970 et n’ont tout simplement pas été remises en cause par les nouvelles règles du droit civil.
Une décision Ministre des Armées rendue par le Conseil d’État quelques années avant la loi de 1970 va exactement dans ce sens. Dans cette affaire, le juge administratif a dénié le caractère de « règle spéciale » aux normes relatives à l’engagement dans les armées. Ces règles ont même été qualifiées de « principe » et de « règle générale alors applicable à tous les engagements [dans les armées] »11.
Finalement, il faut aussi reconnaître que toute autre décision du Conseil d’État aurait fragilisé bon nombre de contrats d’engagement dans les armées. Or, le contexte actuel, marqué par la lutte contre le terrorisme, ne justifie-t-il pas de faire prévaloir, comme dans la décision Caliot, l’intérêt public que constitue l’intérêt de la défense nationale ?
PB
Pas d’indemnisation en cas de non-reconduction tacite d’un contrat de commande publique (en principe !)
CE, 17 oct. 2016, n° 398131, Cne de Villeneuve-le-Roi. L’indemnisation en fin de contrat administratif a fait l’objet de plusieurs décisions au cours des vingt dernières années, notamment sous l’angle de l’annulation et de la résiliation. L’on attendait toutefois des précisions dans le cas particulier de la non-reconduction tacite d’un contrat. Les 7e et 2e chambres réunies du Conseil d’État ont apporté ces précisions à l’occasion d’une décision Commune de Villeneuve-le-Roi rendue le 17 octobre dernier.
L’une des personnes impliquées dans cette affaire, la société commerciale « Les Fils de Madame Géraud », est connue dans le contentieux des contrats publics. L’on se souvient de la décision rendue en 2005 concernant cette société et par laquelle le Conseil d’État a consacré l’utilité « des dépenses d’investissement (…) consenties » au titre des biens de retour d’un contrat de concession. Depuis lors, ces dépenses sont indemnisées malgré la nullité du contrat. En l’occurrence, le contrat avait pour objet l’exploitation du stationnement payant dans la commune éponyme12. La décision ici commentée juge, quant à elle, que ne doit pas être indemnisée la non-reconduction tacite d’un contrat de commande publique (par exemple, un contrat de marché, un contrat de concession).
Les faits et la procédure méritent d’être présentés. Mme Géraud et la commune de Villeneuve-le-Roi (dans le Val-de-Marne) ont conclu en 1957 un contrat de concession ayant pour objet l’exploitation des halles et marchés de la commune. Un avenant conclu en 1976 a fixé à 30 ans la durée de la concession. Le même avenant prévoyait que la concession devait se renouveler par tacite reconduction pour une durée de dix ans. L’avenant envisageait aussi une indemnité assez élevée en cas de non-reconduction tacite par la commune (« une indemnité égale au quart des annuités versées, majorée à compter de la 16e année d’exploitation d’un intérêt calculé au taux de 6 % selon la méthode à intérêts composés »). Le contrat de concession n’a pas été reconduit par la commune. Les représentants de la société « Les Fils de Madame Géraud » ont donc saisi le tribunal de grande instance de Créteil en vue d’obtenir l’indemnité de non-reconduction. L’on sait, en effet, que le juge judiciaire est compétent à l’égard du contrat de concession ayant pour objet l’exploitation des halles et marchés, comme l’a dit une autre décision relative à la société « Les Fils de Madame Géraud »13.
Le juge judiciaire s’est interrogé sur la légalité de la clause prévoyant la tacite reconduction et un droit à indemnité en cas de non-reconduction. Il a choisi de renvoyer les parties devant le juge administratif afin que ce dernier se prononce sur la légalité de la clause. Par un jugement du 2 mars 2016, le tribunal administratif de Melun a déclaré illégale la clause de tacite reconduction, mais pas le droit à indemnité en cas de non-reconduction. Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État a confirmé l’illégalité de la clause de tacite reconduction et prononcé également l’illégalité du droit à indemnité en cas de non-reconduction.
Ainsi, dans le neuvième considérant de sa décision du 17 octobre 2016, le Conseil d’État a estimé « que les clauses de tacite reconduction contenues dans des contrats de la commande publique étant illégales, aucun préjudice, et donc aucun droit à indemnité, ne peut naître, pour le cocontractant de l’Administration, de l’absence de reconduction tacite d’un contrat à l’issue de la durée initiale convenue par les parties ; qu’ainsi, l’illégalité de la clause de tacite reconduction contenue dans un contrat de la commande publique a pour conséquence l’illégalité de la clause prévoyant l’indemnisation du cocontractant de la personne publique à raison de la non-reconduction tacite du contrat ».
Ce faisant, le Conseil d’État a rappelé sa jurisprudence Commune de Païta d’après laquelle la clause de tacite reconduction d’un contrat de commande publique est illégale14. Le Conseil est venu ajouter que la clause d’indemnisation en cas de non-reconduction tacite d’un contrat de commande publique est elle-même illégale.
Et ce n’est pas tout.
Le Conseil d’État a également précisé qu’il s’agissait là d’une irrégularité d’ordre public. En effet, toujours d’après le neuvième considérant de la décision Commune de Villeneuve-le-Roi, « l’illégalité d’une telle clause indemnitaire dépourvue de fondement légal doit être relevée d’office par le juge ».
Il convient de tempérer la rigueur apparente de la décision du 17 octobre 2016. L’on sait que la reconduction tacite peut être légale dans le cadre de certains contrats de commande publique. Comme le Code des marchés publics avant eux15, les nouveaux textes relatifs à la commande publique admettent la reconduction tacite d’un contrat « à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale »16. En pareille situation, l’on peut en déduire que la clause d’indemnisation en cas de non-reconduction tacite d’un contrat de commande publique est légale.
Finalement, la décision Commune de Villeneuve-le-Roi du 17 octobre 2016 ne dit pas ce qu’il en est d’une éventuelle indemnisation de l’illégalité de la clause indemnitaire de non-reconduction tacite. En effet, le terrain extracontractuel ne paraît pas avoir été exploité dans cette affaire. L’on reverra donc peut-être bientôt la société « Les Fils de Madame Géraud ».
PB
La promesse du législateur n’engage que celui qui l’écoute
CE, 27 juin 2016, n° 382319, M. Bernabé et a. La réforme issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 modifie aussi le Code civil en ce qui concerne la promesse unilatérale. Cette pratique ancienne est désormais consacrée à l’article 1124 du Code civil au sein d’une section relative à la conclusion du contrat. Ces dispositions ne s’appliquent bien évidemment pas à l’État en sa qualité de législateur, comme l’a jugé le Conseil d’État dans une décision Bernabé rendue le 27 juin 2016 par les 10e et 9e chambres réunies du contentieux.
Les faits de l’espèce, eux aussi assez anciens, sont les suivants. Les parents de M. Bernabé étaient propriétaires de trois exploitations agricoles qui ont été nationalisées en 1962 par l’Algérie à la suite de l’indépendance de ce nouvel État. À la fin des années 2000, la famille Bernabé a demandé la réparation des préjudices relatifs à cette nationalisation et les a estimés à environ 26 millions d’euros. Mais le tribunal administratif, la cour administrative d’appel, puis le Conseil d’État ont tour à tour débouté M. Bernabé et les membres de sa famille.
Dans cette affaire, la responsabilité de l’État était mise en cause de plusieurs points de vue qui ont tous été rejetés par le Conseil d’État. L’un d’eux mérite une attention particulière. C’est l’argument relatif aux effets d’une promesse du législateur.
L’article 4, toujours en vigueur, de la loi française n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer prévoyait qu’« une loi distincte fixera, en fonction des circonstances, le montant et les modalités d’une indemnisation en cas de spoliation et de perte définitivement établies des biens appartenant aux personnes ».
D’après M. Bernabé, en ne tenant pas la promesse de la loi de 1961, l’État avait commis une faute en sa qualité de législateur et était susceptible d’engager sa responsabilité.
D’ailleurs, la jurisprudence administrative attribue une valeur juridique à la plupart des promesses prises par l’Administration17. À titre d’illustration, le juge administratif a fait produire des effets à des promesses parmi lesquelles on trouve notamment :
-
une promesse de recrutement18 ;
-
une promesse de subvention19 ;
-
une promesse de vente d’un immeuble20 ;
-
une promesse de modification d’un contrat21.
Il y a même longtemps, bien longtemps, le Conseil d’État n’avait pas considéré comme irrégulière la « promesse » faite par l’Administration à un entrepreneur « qu’un marché lui serait consenti en temps opportun »22.
Toutefois, dans le sixième considérant de sa décision Bernabé, le Conseil d’État a dit pour droit que, « le législateur ne pouvant lui-même se lier, une disposition législative posant le principe de l’intervention d’une loi ultérieure ne saurait constituer une promesse dont le non-respect constituerait une faute susceptible d’engager, devant le juge administratif, la responsabilité de l’État ».
Ce faisant, le Conseil d’État s’est placé dans le sillage de deux jurisprudences. En effet, d’une part, ce considérant reprend mot pour mot (ou presque) les termes de la décision « planification » rendue par le Conseil constitutionnel en 1982. « Le législateur ne peut lui-même se lier »23. D’autre part, le considérant de la décision Bernabé s’inscrit dans l’esprit de la jurisprudence refusant de qualifier de fautive une action du législateur. L’on sait par exemple que la méconnaissance d’une convention internationale par la loi entraîne la responsabilité sans faute de l’État « sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques »24. La responsabilité sans faute étant d’ordre public et le juge devant la soulever d’office25, l’on peut en déduire que le Conseil d’État a entendu, implicitement mais nécessairement, l’exclure pour les affaires concernant une promesse du Parlement.
Il faut ajouter que la promesse du législateur portait sur un acte général et impersonnel. Cependant, il ressort de la jurisprudence administrative citée ci-dessus que le juge n’attribue une valeur juridique qu’aux promesses prises par l’Administration en vue d’un acte individuel. C’est là une extension de la règle selon laquelle nul n’a droit au maintien d’un acte administratif réglementaire26. Cette règle est liée au principe de mutabilité applicable, par ailleurs, en matière de contrat administratif27.
En fin de compte, la décision Bernabé rendue par le Conseil d’État paraît reposer sur un (triple) fondement solide. Toutefois, les principes d’espérance légitime et de sécurité juridique ne sont-ils pas en mesure d’apporter un tempérament à cette jurisprudence ?
PB
V – Relations entre le public et l’Administration
VI – Justice administrative
(À suivre)
Notes de bas de pages
-
1.
CC, 25 avril 2014, Commune de Thonon-les-Bains et autre, déc. n° 2014-391 QPC ; cf. également les décisions n° 2007-548 DC, n° 2013-687 DC, n° 2013-303 QPC, n° 2013-304 QPC et n° 2013-315 QPC.
-
2.
CE, ass., 27 oct. 1995, n° 136727, Cne de Morsang-sur-Orge : Lebon, p. 372.
-
3.
CE, ass., 28 déc. 2009, n° 304802, Cne de Béziers : Lebon, p. 509.
-
4.
CE, ass., 30 juin 1961, nos 42774 et 42775, Groupement de défense des riverains de la route de l’Intérieur : Lebon, p. 452.
-
5.
CE, ass., 14 févr. 1975, nos 93132 et 93133, Épx Merlin et Association de défense des habitants des quartiers de Super-La Ciotat et de Ceyreste : Lebon, p. 110.
-
6.
Pour une DUP antérieure, v. CE, ass., 20 févr. 1998, n° 159517, Thalineau : Lebon, p. 57 – pour une DUP postérieure, v. CE, 26 mars 2001, n° 202209, Association pour la gratuité de l’autoroute A8 : Lebon, p. 1042.
-
7.
CE, 7 avr. 1876, n° 48137, Cne d’Olmeto contre Pianelli : Lebon, p. 351.
-
8.
CE, sect., 11 juill. 2011, nos 320735 et 320854, SODEMEL c/ Min. de l’Intérieur, de l’Outre-Mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration : Lebon, p. 347.
-
9.
CE, 10 mars 1965, n° 59086, Min. des Armées c/ Sieur Möller : Lebon, p. 157.
-
10.
CE, 7e/2e ss.-sect. réunies, 15 avr. 2015, n° 376229, Cne de Saint-Michel-sur-Orge : Lebon, p. 151.
-
11.
CE, 20 déc. 1967, n° 70002, Min. des Armées c/ Sieur Möller : Lebon, p. 512.
-
12.
CE, 16 nov. 2005, n° 262360, MM. Auguste c/ Commune de Nogent-sur-Marne : Lebon, p. 508.
-
13.
T. confl., 10 avr. 1995, n° 02958, Consorts Auguste-Géraud et a. : Lebon, p. 494.
-
14.
CE, 29 nov. 2000, n° 205143, Commune de Païta : Lebon, p. 573 ; AJDA 2001, p. 219, étude Richer L.
-
15.
V. article 16 du Code des marchés publics dans sa rédaction issue de D. n° 2011-1000, 25 août 2011.
-
16.
V. not. D. n° 2016-361, 25 mars 2016.
-
17.
En matière de police, on se permet de renvoyer à Bourdon P., Le contrat administratif illégal, thèse Paris 1, 2014, Dalloz, n° 257.
-
18.
CE, 1er déc. 1972, n° 79391, Demoiselle Texier : Lebon T., p. 1223.
-
19.
CE, 3 mars 1989, n° 80749, Sté Sagatour et Min. des Départements et territoires d’outre-mer : Lebon T., p. 905.
-
20.
CE, 1er mars 2012, n° 346673, SCI Stemo : Lebon T., p. 652.
-
21.
CE, 21 juin 1985, n° 38144, Mme Manzano : Lebon T., p. 732.
-
22.
CE, 13 juill. 1922, n° 67467, Sieur Henry : Lebon, p. 619.
-
23.
Cons. const., 27 juill. 1982, n° 82-142 DC, loi portant réforme de la planification : Rec. Cons. const. 1982, p. 52.
-
24.
CE, ass., 8 févr. 2007, n° 279522, M. Gardedieu : Lebon, p. 78.
-
25.
CE, 21 mai 1920, n° 52010, Épx Colas : Lebon, p. 532.
-
26.
CE, 25 juin 1954, n° 13993, Syndicat national de la meunerie à seigle : Lebon, p. 379.
-
27.
CE, sect., 18 mars 1977, n° 97939, CCI de La Rochelle : Lebon, p. 153.