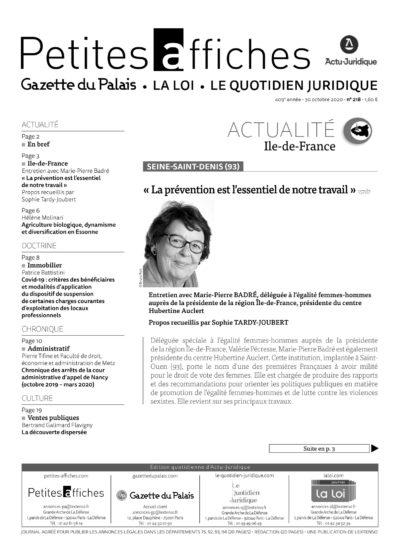Chronique des arrêts de la cour administrative d’appel de Nancy (octobre 2019 – mars 2020)
La présente chronique revient sur les arrêts marquants rendus par la cour administrative d’appel de Nancy entre octobre 2019 et mars 2020. Un premier commentaire porte sur la question de la protection fonctionnelle, laquelle, si elle bénéficie aux agents publics, ne s’applique pas aux élus qui n’exercent aucune fonction exécutive. Dans une seconde affaire, la cour transpose la jurisprudence Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT, qui a pour effet de limiter le jeu de l’exception d’illégalité, au contentieux de l’expropriation. Enfin, dans une dernière affaire, la cour précise que la théorie des sujétions techniques imprévues, qui trouve à s’appliquer dans le domaine des marchés publics de travaux, se rattache à la responsabilité extracontractuelle du maître d’ouvrage.
I – Fonction publique
La protection fonctionnelle ne bénéficie pas aux élus qui n’exercent aucune fonction exécutive, et qui, en conséquence, n’ont pas la qualité d’agent public (CAA Nancy, 12 déc. 2019, nos 18NC02134 et 18NC02144, M. B. et Assoc. ANTICOR). Les agents publics bénéficient de mesures de protection et d’assistance de la part de l’Administration lorsqu’ils sont victimes d’une infraction dans le cadre de leurs fonctions ou en raison de leurs fonctions. Dans la présente affaire, un élu d’opposition au sein du conseil municipal de la commune de Faulquemont avait estimé qu’il avait fait l’objet de propos diffamatoires dans le bulletin d’informations municipales paru en juin 2017, et il avait intenté une action devant le juge pénal contre le maire de la commune. Il avait alors demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle conformément aux dispositions de l’article L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales. Par une délibération du 25 septembre 2017, le conseil municipal lui a refusé cette protection tout en l’accordant au maire en raison des poursuites engagées par le requérant. Dans un jugement du 30 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette délibération. C’est ce jugement qui est contesté devant la cour administrative d’appel de Nancy.
En l’espèce, la cour rappelle que si un maire peut bénéficier de la protection fonctionnelle (I), tel n’est pas le cas d’un élu qui n’exerce pas de fonctions exécutives, et qui ne saurait, par conséquent, être assimilé à un agent public (II).
I. Le maire d’une commune peut bénéficier de la protection fonctionnelle
Concernant les collectivités territoriales, les règles relatives à la protection fonctionnelle des élus sont organisées par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du Code général des collectivités territoriales. S’agissant plus particulièrement des communes, l’article L. 2123-34 de ce code précise que « la commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions ».
Si une condamnation pénale – et a fortiori de simples poursuites pénales – ne caractérise pas toujours une faute détachable des fonctions électives de l’élu, il en va autrement lorsque sont en cause des faits qui « révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité »1. Tel est le cas dans une affaire où un maire a fait acquérir par la commune deux voitures de sport ne répondant pas aux besoins d’une administration communale et dont il a fait une utilisation à des fins privées2.
En l’espèce, le maire est mis en cause en sa qualité de directeur de la publication du bulletin d’informations municipales. La commune était en conséquence tenue de lui accorder la protection fonctionnelle, à moins que les propos publiés pussent être qualifiés de faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. Il lui est reproché d’avoir signé une tribune visant à « faire le point sur les derniers contentieux jugés par les différents tribunaux ». Après avoir cité nommément le requérant, il le qualifie « d’opposant procédurier » et rappelle deux affaires judiciaires le concernant, l’une le mettant en cause pour délit de favoritisme et pour laquelle il a été relaxé en appel, l’autre relative à un recours pour excès de pouvoir rejeté par le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l’annulation d’une délibération cédant une parcelle de terrain à une boulangerie-pâtisserie. Le maire a ensuite insisté sur le coût que représente pour la commune ce contentieux en qualifiant le comportement du requérant d’opposition « stérile et systématique ».
Dans un arrêt Commune de Pointe-à-Pitre du 27 avril 1988, le Conseil d’État a considéré qu’un maire commet une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions en usant dans un communiqué de termes susceptibles de provoquer une plainte en diffamation3. Il n’est pas sûr, toutefois, que cette jurisprudence déjà ancienne soit en phase avec la position de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). En effet, la CEDH a eu l’occasion de condamner récemment la France pour violation de la liberté d’expression à la suite de la condamnation d’un conseiller municipal qui avait accusé le maire de la commune et son premier adjoint d’escroquerie au cours du conseil municipal et dans un tract4. La CEDH a pu relever dans cette affaire que « précieuse pour chacun, la liberté d’expression l’est tout particulièrement pour un élu du peuple ; il représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts. Partant, des ingérences dans la liberté d’expression d’un élu du peuple (…) commandent à la cour de se livrer à un contrôle des plus stricts ».
Si la relation par le maire des affaires judiciaires mettant en cause le requérant est empreinte de partialité, notamment parce qu’elle ne mentionne pas l’issue favorable pour lui de certaines affaires le concernant, il ne semble donc pas qu’elle puisse être regardée comme une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. La commune était donc tenue de lui accorder la protection prévue par l’article L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales.
II. Un élu qui n’a pas de fonctions exécutives ne peut pas bénéficier de la protection fonctionnelle
La garantie fonctionnelle a un champ d’application particulièrement étendu. Elle est reconnue, d’abord, au bénéfice des fonctionnaires par l’article 11, IV, du titre I du statut général de la fonction publique dont il résulte que « la collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Pour les agents qui ne relèvent pas du statut général de la fonction publique, ce droit résulte d’un principe général du droit dégagé par le Conseil d’État à l’occasion de l’arrêt de section du 26 avril 1963, Centre hospitalier régional de Besançon5. Ce principe a été reformulé de façon plus générale par le Conseil d’État – dissipant notamment des doutes concernant les agents relevant de statuts spécifiques – dans son arrêt Garde des sceaux du 11 février 20156 dont il résulte qu’il existe un « principe général du droit qui s’applique à tous les agents publics, (selon lequel) lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions (en vertu duquel) il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle ». Cette solution s’applique également aux collaborateurs occasionnels du service public7 ainsi qu’aux agents publics étrangers soumis par leur contrat non pas au droit français mais au droit local, comme les civils afghans recrutés par l’armée française à l’occasion de sa mission en Afghanistan8. Elle bénéficie également au président élu d’un établissement public administratif9.
Si tous les agents publics bénéficient donc de la protection fonctionnelle, la question se posait de savoir si un membre du conseil municipal pouvait également en bénéficier. Or l’article L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales ne vise que les membres de l’exécutif, c’est-à-dire le maire, les élus qui le suppléent ainsi que ceux qui ont reçu une délégation. Cette solution est logique. En effet, la garantie fonctionnelle a pour objet non seulement de protéger les agents publics mis en cause par un tiers en raison de ses fonctions, mais également de protéger l’Administration dans le cadre de son fonctionnement. Or ici, ce n’est pas le fonctionnement de la commune qui est menacé par les propos tenus par le maire à l’égard du requérant. En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté la demande de protection fonctionnelle du requérant.
II – Expropriation
Limitation jurisprudentielle du jeu de l’exception d’illégalité dans le contentieux de l’expropriation (CAA Nancy, 27 déc. 2019, n° 18NC03397, M. F. et a.). La phase administrative de la procédure d’expropriation donne lieu à une succession d’actes administratifs dont les principaux sont l’arrêté ou le décret portant déclaration d’utilité publique de l’opération projetée et l’arrêté de cessibilité dont l’objet est de déterminer la liste des parcelles concernées et de préciser l’identité des propriétaires des biens. Il s’agit dans les deux cas d’actes décisoires qui peuvent faire chacun l’objet d’un recours pour excès de pouvoir en raison de leurs vices propres ou des vices entachant les mesures préparatoires à ces actes. Il arrive toutefois que l’acte déclarant l’utilité publique soit équivalent à un arrêté de cessibilité, dès lors qu’il intervient après l’enquête parcellaire et qu’il est établi conformément aux prescriptions de l’article R. 132-2 du Code de l’expropriation relatives à l’identification des parcelles et de leurs propriétaires.
Cette hypothèse mise à part, la déclaration d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité constituent également une opération complexe au sens du droit administratif. Cette théorie s’applique « lorsqu’une décision finale ne peut être prise qu’après intervention d’une ou plusieurs décisions successives, spécialement prévues pour permettre la réalisation de l’opération dont la décision finale sera l’aboutissement »10. En d’autres termes, l’arrêté de cessibilité est consubstantiel à la déclaration d’utilité publique. Il ne saurait exister indépendamment d’elle. Cette solution connaît un prolongement dans l’hypothèse où la déclaration d’utilité publique a fait l’objet d’un arrêté ou d’un décret de prorogation. Dans ce cas, le Conseil d’État a jugé que « l’arrêté de cessibilité, l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel il a été pris et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l’objet constituent les éléments d’une même opération complexe »11. La même solution a été retenue concernant l’ensemble formé par un arrêté déclarant un immeuble insalubre à titre irrémédiable et l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le projet d’acquisition de cet immeuble et prononçant sa cessibilité, en vue de permettre la réalisation de nouvelles constructions12. En revanche, l’ensemble formé par l’arrêté de déclaration en état d’abandon manifeste et l’arrêté portant déclaration d’utilité publique et de cessibilité ne constitue pas une opération complexe13. En effet, ces deux procédures reposent sur des législations distinctes, dès lors que la seconde est organisée par le Code de l’expropriation alors que la première est régie par les dispositions des articles L. 2243-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. En outre, si l’expropriation constitue la raison d’être ultime de la procédure visée par ce code, elle a également pour finalité de conduire le propriétaire à mettre fin de lui-même à l’état d’abandon ou à ce qu’il s’engage à effectuer les travaux nécessaires. Par ailleurs, le conseil municipal dispose, après avoir pris une déclaration d’état d’abandon manifeste, d’une simple possibilité de mise en œuvre ultérieure de la procédure d’expropriation. En d’autres termes, la déclaration d’utilité publique et plus généralement la procédure d’expropriation ne sont pas la seule suite possible à la déclaration d’état d’abandon manifeste, ce qui fait que les actes considérés ne sauraient être vus comme constituant une opération complexe.
En revanche, la déclaration d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité constituant une opération complexe, il est possible d’exciper à l’appui de conclusions dirigées contre cet arrêté, de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique sur le fondement de laquelle il a été pris14.
Dans la présente affaire, la commune de Besançon a décidé de réaliser un écoquartier dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté. Par un arrêté du 27 octobre 2011, le préfet du Doubs a déclaré d’utilité publique cette opération au profit de la commune de Besançon. L’aménagement de la zone a ensuite été attribué à la société publique locale Territoire 25 par une délibération du conseil municipal de la commune. Par un arrêté du 7 mars 2014, le préfet du Doubs a, en conséquence, modifié la déclaration d’utilité publique afin de désigner la SPL Territoire 25 comme en étant la bénéficiaire, en qualité de concessionnaire de l’opération. Par un arrêté du 20 mars 2014, le préfet du Doubs a également déclaré cessibles au bénéfice de la SPL Territoire 25 les parcelles concernées par l’opération.
Plusieurs propriétaires de terrains inclus dans le périmètre de l’opération contestée ont saisi le tribunal administratif de Besançon d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les arrêtés préfectoraux des 7 et 20 mars 2014. Si ces recours ont été rejetés par le tribunal, dans un arrêt du 8 juin 2017, la cour administrative d’appel de Nancy a considéré qu’ils étaient entachés d’illégalité. Faisant jouer la technique de l’exception d’illégalité, elle a considéré qu’à la date à laquelle elle a été déclarée d’utilité publique, l’opération d’aménagement n’était pas compatible avec les prescriptions du plan local d’urbanisme15. En application de la théorie des opérations complexes, l’illégalité de la déclaration d’utilité publique intervenue le 27 octobre 2011 avait pour effet de contaminer à la fois l’arrêté modificatif du 7 mars 2014 et l’arrêté de cessibilité du 20 mars 2014 qui devaient donc être annulés.
Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État a ensuite, par une décision du 5 décembre 201816, rectifiée pour erreur matérielle par une ordonnance du 17 décembre suivant, annulé l’arrêt de la cour. Il a considéré que l’arrêté du 7 mars 2014 avait pour seul objet de modifier le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique et qu’eu égard à la portée de cet arrêté modificatif, les requérants ne pouvaient utilement exciper, au soutien de leurs conclusions tendant à son annulation, de l’incompatibilité de la déclaration d’utilité publique initiale du 27 octobre 2011 avec le plan local d’urbanisme. En se fondant sur ce moyen, qui était inopérant, la cour administrative d’appel de Nancy a ainsi commis une erreur de droit. S’agissant du recours dirigé contre l’arrêté de cessibilité du 20 mars 2014, le Conseil d’État fait application de sa jurisprudence Département du Gard de 2015 en vertu de laquelle une opération qui fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ne peut être regardée comme compatible avec un plan local d’urbanisme « qu’a la double condition, d’une part, qu’elle ne soit pas de nature à compromettre le parti d’aménagement retenu par la commune au travers de ce plan, et, d’autre part, qu’elle ne méconnaisse pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue »17. Il censure l’erreur de droit commise par la cour qui n’a pas pris en compte le caractère programmatique de l’opération en question et du classement de la zone concernée.
Si cette analyse est reprise par la cour, la décision commentée présente comme un intérêt majeur le fait d’étendre la jurisprudence Fédération des finances et des affaires économiques de la CFDT18 au contentieux de l’expropriation. Le Conseil d’État, selon une approche du principe de sécurité juridique qui protège les intérêts de l’Administration plus que ceux des administrés, a ici voulu limiter dans le temps le recours à la technique de l’exception d’illégalité. En effet, « si, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux ».
La transposition de cette jurisprudence au contentieux de l’expropriation apparaît contestable, tant elle limite l’accès au juge des personnes expropriées. Il faut ici rappeler que la déclaration d’utilité publique, qui relève de la catégorie hybride des actes non réglementaires et non individuels fait l’objet d’un arrêté ministériel, d’un arrêté préfectoral ou inter préfectoral19 ou d’un décret en Conseil d’État20 qui sont publiés, alors que l’arrêté de cessibilité est notifié aux personnes expropriées. Il n’est donc pas rare, dans la pratique, que les personnes expropriées n’exercent un recours que lorsque cette notification est faite, faute pour elles d’avoir pris connaissance de la déclaration d’utilité publique en temps utile pour pouvoir l’attaquer. La CEDH a d’ailleurs eu l’occasion de considérer que la technique de l’exception d’illégalité permet à la fois la protection du droit de propriété et l’accès au juge lorsque la déclaration d’utilité publique n’a pas été contestée21. Il n’est donc pas sûr que la restriction de ce mécanisme satisfasse aux exigences de la cour.
III – Contrats
Les sujétions techniques imprévues se rattachent à la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage (CAA Nancy, 17 oct. 2019, n° 17NC02898, SAS Dybiec Obs). En 2011, la commune de Chaumont a attribué un marché à forfait en vue de la construction d’un cinéma multiplexe. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Cattani et le lot n° 3 « couvertures bardage-métallique zinc » à la société Dybiec Obs. La durée prévisionnelle des travaux était fixée à 8 mois dont 82 jours pour les travaux de couverture à partir de l’été 2011, mais à la suite des retards qui ne lui sont pas imputables – un retard dans l’exécution d’autres lots et l’existence d’autres travaux à proximité du chantier – les travaux de la société Dybiec Obs ont été réalisés entre février et septembre 2012. À l’occasion de l’établissement du décompte final, la société a adressé un mémoire en réclamation à la commune dans lequel elle lui demande de l’indemniser des préjudices subis en raison du décalage des travaux. À la suite du refus de celle-ci, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le recours exercé par la société au motif de l’irrecevabilité du mémoire en réclamation.
1. C’est cette difficulté procédurale que doit trancher en premier lieu la cour. L’article 50.1 du CCAG travaux précise que « dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants ». Ces stipulations ont été précisées par le Conseil d’État qui considère qu’un mémoire ne peut être regardé comme une réclamation « que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé, et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées »22.
En l’espèce, la réclamation de la société Dybiec Obs résulte initialement d’un mémoire en réclamation du 23 octobre 2012 adressé à la commune en cours d’exécution du marché, puis d’un courrier du 11 décembre 2013, auquel est joint le même mémoire, dans lequel elle refuse de signer le décompte général adressé par la commune.
Considérés ensemble, ce courrier et le mémoire en réclamation satisfont aux exigences du CCAG travaux. D’une part, en effet, le mémoire du 23 octobre 2012 indiquait de façon claire le montant total de la réclamation et en précisait les différents chefs : la mobilisation de matériels de sécurité et de levage sur une durée plus longue que prévu, l’engagement de 181 jours supplémentaires de compagnonnage, la présence de salariés à 20 réunions supplémentaires de chantier, la réalisation de travaux incombant à d’autres entrepreneurs, et, enfin, les pénalités de retard subies sur d’autres chantiers sur lesquels l’entreprise intervenait au même moment. D’autre part, le courrier du 11 décembre 2013 exposait un différend sur le décompte général lui-même, faute pour la commune de Chaumont d’avoir tenu compte des sommes demandées par le mémoire en réclamation du 23 octobre 2012.
Le mémoire en réclamation de la société Dybiec Obs répondait donc aux exigences de l’article 50.1 du CCAG travaux, tel qu’il est interprété par la jurisprudence du Conseil d’État, ce qui conduit la cour à annuler le jugement attaqué et à faire jouer son pouvoir d’évocation pour trancher l’affaire au fond.
2. Il est assez évident, en l’espèce, que le décalage des travaux est à l’origine du préjudice financier dont la société Dybiec Obs demande réparation. Toutefois, dans le cadre d’un marché à prix forfaitaire, l’indemnisation du cocontractant est étroitement encadrée. Dans un arrêt Région Haute-Normandie du 5 juin 2013, dont la cour reproduit le considérant de principe, le Conseil d’État a jugé que « les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics »23.
3. La question se pose ici d’abord de savoir si les difficultés auxquelles la société Dybiec Obs a été confrontée peuvent être qualifiées de sujétions imprévues. Dans son arrêt Commune de Lens du 30 juillet 200324, le Conseil d’État a défini ces sujétions comme étant « des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion et dont la cause est extérieure aux parties ». Cette définition est proche à la fois de celle de la force majeure et de celle de l’imprévision. Elle se distingue toutefois de la force majeure qui présente, en plus des caractères d’extériorité et d’imprévisibilité, un caractère d’irrésistibilité. Elle n’est pas non plus assimilable à l’imprévision, qui se caractérise par des difficultés économiques – et plus précisément par le bouleversement de l’équilibre du contrat – là où les sujétions imprévues présentent un caractère matériel ou technique.
Quoi qu’il en soit, dans la présente affaire, les multiples difficultés d’ordre matériel auxquelles la société Dybiec Obs a été confrontée ne sauraient être qualifiées de sujétions imprévues.
Tout d’abord, les retards liés à la coordination des travaux ainsi que les travaux de réfection entrepris à proximité de la gare ne présentent un caractère ni exceptionnel ni imprévisible. Il ne s’agit d’ailleurs même pas de difficultés matérielles ou techniques, mais plutôt de difficultés organisationnelles.
Ensuite, si l’entreprise a dû démarrer ses travaux en fin de période hivernale, ce qui a également contribué à ralentir les travaux, le froid ne peut être regardé, à cette période et dans cette zone géographique comme étant imprévisible, étant précisé par ailleurs que l’hiver dont il s’agit n’a pas été particulièrement rigoureux.
La question se pose ensuite de déterminer si le caractère plus meuble que prévu du sol et la proximité d’une canalisation, qui seraient à l’origine des retards de travaux des lots « Gros œuvre » et « Charpente métallique », peuvent consister des sujétions techniques imprévues ouvrant un droit à réparation à la société Dybiec Obs qui est, rappelons-le, titulaire d’un autre lot. A priori des difficultés de ce type peuvent être qualifiées de sujétions imprévues. En effet, les éléments susceptibles de provoquer l’application de la théorie des sujétions imprévues tiennent en général à des évènements climatiques25 ou à la composition du sous-sol26.
Mais encore faut-il, pour que cette théorie soit susceptible de s’appliquer en l’espèce, que l’on considère qu’elle se rattache à la responsabilité extracontractuelle, dès lors que la société Dybiec Obs demande la réparation d’un préjudice financier qui est lié à des difficultés dans l’exécution de lots du marché qui ne lui ont pas été attribués. Traditionnellement, la doctrine a en effet plutôt tendance à rattacher la théorie des sujétions imprévues, comme la théorie de l’imprévision, à la responsabilité extracontractuelle. On peut citer à cet égard la formule célèbre du commissaire du gouvernement Riboulet sur l’arrêt du Conseil d’État, Société du Gaz de Nice du 27 juin 1919, dont il résulte que lorsqu’il fait jouer la théorie de l’imprévision le juge ajoute au contrat « une superstructure et fait face à une situation extracontractuelle en se plaçant en dehors du contrat »27. Cette approche est toutefois aujourd’hui critiquée, surtout depuis que le Conseil d’État a explicitement rattaché la théorie de l’imprévision à la responsabilité contractuelle28. Si le Conseil d’État n’a pas encore pris position sur cette question concernant la théorie des sujétions techniques imprévues, la cour administrative d’appel de Bordeaux a retenu une solution identique à l’occasion d’un arrêt du 20 décembre 201829. Elle a en effet relevé que « la responsabilité contractuelle sans faute de la collectivité publique cocontractante au titre de l’imprévision procède d’une cause juridique distincte de la responsabilité contractuelle pour faute. Or (…) la demande de première instance (…) relative aux difficultés d’exécution du marché liées à l’allongement du chantier se plaçait uniquement sur le terrain de la responsabilité contractuelle sans faute… au titre des sujétions imprévues, le moyen soulevé pour la première fois en appel, est par suite irrecevable ». C’est cette solution qui est ici reprise de façon beaucoup plus explicite par la cour administrative d’appel de Nancy qui précise que « s’il est admis qu’elle puisse être invoquée par le sous-traitant bénéficiant d’un droit au paiement direct, la théorie des sujétions imprévues étant un fondement de responsabilité contractuelle, le principe de l’effet relatif des conventions s’oppose à ce qu’un cocontractant du maître d’ouvrage ayant participé à la même opération de travaux publics, mais tiers par rapport au contrat dont l’exécution a donné lieu à la rencontre de telles sujétions, puisse s’en prévaloir pour obtenir la réparation d’un préjudice ». Il en résulte que la société Dybiec Obs ne peut, au titre de la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage à son égard, se prévaloir des sujétions imprévues rencontrées par les titulaires d’autres lots.
De façon assez surabondante, la cour précise « au surplus, (qu’elle) n’établit pas que ces circonstances ont présenté un caractère exceptionnel, imprévisible et extérieur aux parties pour les titulaires des lots et la commune lors de la conclusion du contrat, alors qu’il résulte de l’instruction… que des sondages avaient été réalisés préalablement aux travaux. Elle n’établit pas davantage que ces mêmes circonstances revêtaient un caractère exceptionnel et imprévisible ayant eu pour effet de bouleverser l’économie de son marché ».
4. La société Dybrec Obs invoque également la faute qui aurait été commise par le maître d’ouvrage auquel elle reproche son inertie dans la direction et le contrôle du chantier. La cour relève toutefois que la commune de Chaumont n’est pas restée inactive face aux retards de chantier, lesquels résultent – rappelons-le – d’un sol plus meuble que ce que les sondages laissaient présager et de la présence d’une canalisation plus proche de l’ouvrage que prévu. Elle a incité le maître d’œuvre à tenter de faire avancer parallèlement différentes parties du chantier qui devaient initialement se succéder dans le temps et elle a pris les mesures nécessaires pour assurer la coordination entre les travaux de la société requérante et ceux de la société Vinci qui réalisait des travaux sur le chantier voisin de la gare. Elle est également intervenue, à l’automne 2011, pour veiller à la sécurité des travaux réalisés par la société Dybiec Obs. Enfin, la cour relève qu’alors même qu’ils ont été partiellement réalisés en saison hivernale, les travaux de la société Dybiec Obs ne se sont pas déroulés dans des conditions climatiques incompatibles avec la nature des travaux qu’elle devait réaliser.
5. En dernier lieu, la société requérante demande l’indemnisation des travaux supplémentaires qu’elle aurait réalisés. On rappellera sur ce point que le Conseil d’État opère une distinction entre les travaux utiles, qui ne sont pas en principe indemnisés et les travaux « indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché » qui peuvent être indemnisés sur le fondement de l’enrichissement sans cause, sans qu’il soit nécessaire qu’un ordre de service ne soit émis30. En l’espèce, toutefois, l’ensemble des travaux pour lesquels l’entreprise Dybiec Obs demande réparation ne présente pas ce caractère, et, par conséquent, elle n’est pas non plus fondée à demander à être indemnisée à ce titre.
Notes de bas de pages
-
1.
CE, 30 déc. 2015, n° 391798, Cne de Roquebrune-sur-Argens : AJCT 2016, p. 163, note Yazi-Roman M. ; AJDA 2016, p. 1575, note Rihal H. ; BJCL 2016, p. 175, concl. Cortot Boucher E. et obs. Poujade B.
-
2.
CE, 30 déc. 2015, n° 391798, Cne de Roquebrune-sur-Argens : AJCT 2016, p. 163, note Yazi-Roman M. ; AJDA 2016, p. 1575, note Rihal H. ; BJCL 2016, p. 175, concl. Cortot Boucher E. et obs. Poujade B.
-
3.
CE, 27 avr. 1988, n° 66932.
-
4.
CEDH, 7 sept. 2017, n° 41519/12, Lacroix c/ France.
-
5.
CE, sect., 26 avr. 1963, Centre hospitalier régional de Besançon : Lebon, p. 242, concl. Chardeau J. ; S. 1963, p. 338.
-
6.
CE, 11 févr. 2015, n° 372359 : Lebon, p. 60 ; AJDA 2015, p. 944, concl. Van Coester S. ; Dr. adm. 2015, Comm. 43, note Fort F.-X. ; JCP A 2015, 2112, note Jean-Pierre D.
-
7.
CE, 13 janv. 2017, n° 386799, Fievet.
-
8.
CE, 1er févr. 2019, n° 421694.
-
9.
CE, sect., 8 juin 2011, n° 312700, Farre : Lebon, p. 170.
-
10.
Chapus R., Droit du contentieux administratif, 13e éd., 2008, Montchrestien, p. 692.
-
11.
CE, 12 oct. 2018, n° 417016, Ministre de l’Intérieur : AJDA 2018, p. 1996 ; RDI 2018, p. 589, note Hostiou R.
-
12.
CE, 20 mars 2015, n° 371895, Sté Urbanis Aménagement c/ EURL La compagnie des Immeubles du Midi : Lebon T., p. 714 ; AJDA 2015, p. 609, obs Pastor J.-M. ; AJDI 2015, p. 449, note Otero C. ; RDI 2015, p. 291, note Hostiou R.
-
13.
CAA Marseille, 26 juin 2015, n° 13MA02409, Eddie G. et a. c/ Préfet Alpes-Maritimes : JCP A 2016, 2017, concl. Revert M. – CAA Nancy, 25 févr. 2016, n° 15NC00426, Bournery : LPA 30 mars 2017, n° 121n4, p. 5, note Tifine P.
-
14.
Par ex., v. CE, 20 déc. 2006, n° 285591, Muratori.
-
15.
CAA Nancy, 8 juin 2017, n° 16NC00913.
-
16.
CE, 5 déc. 2018, n° 412632, Sté Territoire 25 : Lebon T., p. 721 ; AJDA 2018, p. 2421 ; AJCT 2019, p. 216, obs. Bonnefont R. ; BJDU 2019, p. 96, concl. Dutheillet de Lamothe L. ; JCP A 2019, 2140, chron. Vandermeeren R.
-
17.
CE, 27 juill. 2015, n° 370454 : Lebon T., p. 714 ; AJDA 2015, p. 2357 ; RDI 2015, p. 493, obs. Soler-Couteaux P.
-
18.
CE, ass., 18 mai 2018, n° 414583 : AJDA 2018, p. 1206, chron. Roussel S. et Nicolas C. ; AJDA 2018, p. 1241, trib. Melleray F. ; AJDA 2018, p. 1465, trib. Seiller B. ; Dr. adm. 2018, repère 7, note Plessix B. ; Dr. adm. 2018, Comm. 45, note Eveillard G. ; JCP A 2018, act. 469, obs. Touzeil-Divina M. ; JCP A 2018, 2197, note Friedrich C. ; Procédures 2018, comm. 236, note Chifflot N. ; RFDA 2018, p. 649, concl. Bretonneau A.
-
19.
C. expr., art. R. 121-1.
-
20.
C. expr., art. R. 121-2.
-
21.
CEDH, 19 sept. 2006, n° 13844/02, Maupas c/ France : AJDA 2007, p. 180, note Hostiou R.
-
22.
CE, 3 oct. 2012, n° 349281, Sté Valterra : Contrats-Marchés publ. 2012, Comm. 308, note Zimmer W. – V. aussi concernant le CCAG-PI, CE, 26 avr. 2018, n° 407898, Sté EMTS et Envéo Ing : Contrats-Marchés publ. 2018, Comm. 158, note Devillers P.
-
23.
CE, 5 juin 2013, n° 352917, Région Haute-Normandie : Contrats-Marchés publ. 2013, Comm. 216, note Eckert G. – V. aussi CE, 12 nov. 2015, n° 384716, Sté Tonin : Contrats-Marchés publ. 2016, Comm. 3, note Ubaud-Bergeron M. – CE, 6 janv. 2016, n° 383245, Sté Eiffage construction Alsace Franche Comté ; CE, 9 nov. 2017, n° 396892, Sté d’équipement de la Martinique.
-
24.
CE, 30 juill. 2003, n° 223445 : AJDA 2003, p. 1727, note Dreyfus J.-D. ; BJCP 2003, p. 462, concl. Piveteau D. ; Contrats-Marchés publ. 2003, Comm. 172, note Pietri J.-P.
-
25.
Par ex., v. CE, 13 mai 1987, n° 35374, Sté Citra-France : Lebon, p. 821 ; D. 1987, Somm., p. 433, obs. Terneyre P. ; RDP 1988, p. 1426.
-
26.
Par ex., v. CE, 1er juill. 2015, n° 383613, Régie des eaux du canal de Belletrud : Contrats-Marchés publ. 2015, Comm. 235, note Pietri J.-P. – CAA Bordeaux, 14 oct. 2014, n° 12BX00056, Sté Guintoli.
-
27.
Lebon, p. 572.
-
28.
CE, 28 juill. 2011, n° 332256 ; CE, 11 juill. 2014, n° 359980 : Contrats-Marchés publ. 2014, Comm. 276, note Piétri J.-P.
-
29.
CAA Bordeaux, 20 déc. 2018, n° 15BX04145 : Contrats-Marchés publ. 2019, Comm. 81, note Pietri J.-P.
-
30.
CE, sect., 17 oct. 1975, n° 93704, Cne de Canari : Lebon, p. 516 ; AJDA 1975, p. 562 – Pour les marchés à forfait, v. CE, 14 juin 2002, n° 219874, Ville d’Angers : JCP A 2002, 1339, note Linditch F.