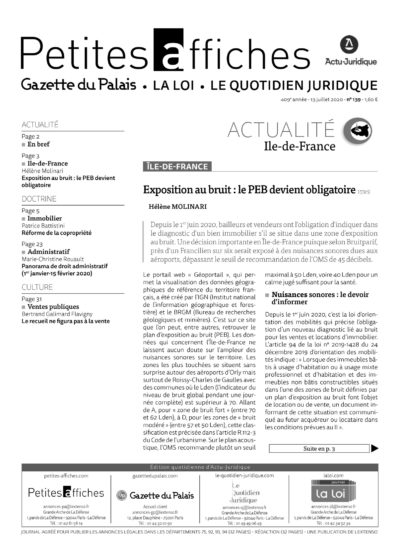Panorama de droit administratif (1er janvier-15 février 2020)
Parmi les 254 arrêts et quelques lus durant les six premières semaines de l’année 2020, ont été sélectionnés en priorité ceux relatifs à la fonction publique et au contentieux administratif. Est particulièrement notable un revirement de jurisprudence décidant qu’une annulation pour excès de pouvoir peut ouvrir droit à des intérêts moratoires. Ont été relevés également des arrêts relatifs à la communication des documents administratifs, aux collectivités territoriales, notamment une décision en matière de responsabilité en cas de substitution d’action.
Un directeur de régie, régisseur de recettes, est un agent public
T. confl., 13 janv. 2020, n° 4177, A. c/ Cne de Saint-Hilaire du Touvet. L’intéressé a été recruté en qualité de chef d’exploitation, en vue de succéder, à compter de février 2009, au directeur de la régie. Le règlement intérieur de la régie prévoyait la nomination de son directeur comme régisseur de recettes, l’intéressé s’est lui-même prévalu de sa qualité de directeur dans différents documents, il en a exercé les attributions et aucun autre agent n’a été nommé en qualité de directeur de la régie. Il doit ainsi être regardé comme ayant assumé les fonctions de directeur de la régie, sans qu’aient d’incidence les circonstances que son contrat de travail n’ait pas été modifié et fasse, comme ses bulletins de salaire, référence à une convention collective et que la commune ait suivi la procédure de licenciement prévue par le Code du travail. L’intéressé ayant la qualité d’agent public, le litige relatif à son licenciement relève de la compétence de la juridiction administrative.
Pas de droit de communication si le document est disponible sur un espace numérique personnel
CE, 10e et 9e ch., 30 janv. 2020, n° 418797, Sté Cutting Tools Management Services. Dès lors que des documents administratifs sont disponibles sur un espace de stockage numérique hébergé sur une plate-forme, mis à la disposition de la personne qu’elle concerne par l’administration, auquel cette personne peut librement accéder sur internet grâce à un identifiant et un code et à partir duquel il lui est loisible de télécharger le document demandé, elle doit en principe être regardée comme détenant ces documents, au même titre que l’administration. Par suite, elle n’est pas fondée à demander à l’administration de lui en donner accès au titre des articles L. 311-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration, sauf si des circonstances particulières, notamment des difficultés de connexion à son espace personnel, font obstacle à l’accès effectif à ces documents.
Maire en situation de conflit d’intérêts : qui représente la commune ?
CE, 10e et 9e ch., 30 janv. 2020, n° 421952, Cne de Païta. Il résulte de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et de l’article 5 du décret du 31 janvier 2014 pris pour son application, qu’un maire qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts doit prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désigner, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer. Il résulte des dispositions du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, notamment de son article L. 122-12, que lorsque les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune dans un litige donné ou pour la signature ou l’exécution d’un contrat, seul le conseil municipal est compétent pour désigner un autre de ses membres soit pour représenter la commune en justice soit pour signer le contrat ou intervenir dans son exécution. Lorsque le maire estime ne pas devoir exercer ses compétences à raison d’un conflit d’intérêts, il ne saurait désigner la personne habilitée soit à représenter la commune en justice dans un litige donné soit à signer ou exécuter un contrat que si ses intérêts ne se trouvent pas en opposition avec ceux de la commune. Lorsqu’une telle opposition ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, il appartient au juge de relever d’office l’irrecevabilité de la demande de la commune représentée par son maire ou par une personne qui n’a pas été légalement désignée.
En se bornant à relever, pour juger irrecevable la demande de la commune représentée par le premier adjoint au maire, qu’en dépit de l’arrêté par lequel le maire avait délégué à son premier adjoint ses compétences en matière d’urbanisme, seul le conseil municipal de la commune avait compétence pour désigner un autre de ses membres pour ester en justice en son nom, sans rechercher si les intérêts du maire se trouvaient, dans ce litige, en opposition avec ceux de la commune, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit.
Rejet des requêtes relatives aux élections au Parlement européen de 2019
CE, 2e et 7e ch., 31 janv. 2020, n° 431143, L. et a. Si les dispositions de l’article L. 52-6-1 du Code électoral prévoient que le mandataire financier désigné par le candidat a droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix ainsi qu’à la mise à disposition des moyens de paiement et services bancaires nécessaires à son fonctionnement, elles n’ouvrent pas un droit au crédit. L’octroi d’un emprunt à un parti politique ou à un candidat résulte de la libre discussion entre le parti ou le candidat demandeur et l’établissement de crédit ou la société de financement sollicité, le cas échéant, avec l’appui d’une conciliation exercée par le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques en vertu du II de l’article 28 de la loi du 15 septembre 2017. Par suite, le grief tiré de l’existence de discriminations illégales dans l’accès à l’emprunt par les listes candidates doit en tout état de cause être écarté.
L’article L. 11 du Code électoral fixe les conditions pour être inscrit sur les listes électorales. En vertu de l’article L. 16 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2019, la liste électorale de la commune, et à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement, est désormais extraite d’un répertoire électoral unique et permanent, qui est tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). À cet effet, le maire transmet à l’INSEE l’ensemble des informations utiles. Si en vertu de l’article L. 18 du Code électoral, le maire est compétent pour radier, à l’issue d’une procédure contradictoire, les électeurs qui ne remplissent plus les conditions d’attache communale, l’INSEE procède directement, conformément à l’article L. 16 du même code, aux radiations des électeurs inscrits sur plusieurs listes électorales, en maintenant l’inscription sur la liste électorale la plus récente, ainsi qu’aux radiations ordonnées par l’autorité judiciaire, aux radiations des électeurs décédés et des électeurs qui n’ont plus le droit de vote.
S’il est soutenu que de nombreux électeurs auraient fait l’objet de radiations abusives qui seraient consécutives à un dysfonctionnement du répertoire électoral unique, les requérants n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations. À cet égard, la seule circonstance qu’un requérant n’ait pas pu voter au motif allégué qu’il aurait été irrégulièrement rayé des listes électorales n’est pas de nature à établir que de nombreux électeurs se seraient trouvés dans la même situation.
Si sont contestées les couleurs des logos figurant sur les circulaires des listes « Les oubliés de l’Europe » et « Pour l’Europe des gens contre l’Europe de l’argent », ces logos doivent être regardés comme l’emblème d’un parti ou groupement politique au sens de l’article R. 27 du Code électoral.
Communication du dossier : les PV d’audition de témoins doivent en principe être joints
CE, 6e et 5e ch., 5 févr. 2020, n° 433130, M. B. Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, le rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.

Fautes des services de secours, partage d’attributions et partage de responsabilité
CE, 5e et 6e ch., 5 févr. 2020, n° 423972, Cne de Courbevoie. Il résulte de l’article L. 2212-1, du 5° de l’article L. 2212-2 et de l’article L. 2216-2 du Code général des collectivités territoriales que, si la responsabilité de la commune, à laquelle incombe notamment le soin de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours, est susceptible d’être engagée par toute faute commise dans l’exercice de ces attributions, celles des fautes qui seraient commises, dans cet exercice, par un service relevant d’une autre personne morale que la commune, sont de nature à atténuer la responsabilité de cette dernière, sous réserve que la commune ou les victimes du dommage aient mis en cause la responsabilité de ce service devant le juge administratif.
Lorsqu’il assure, dans une commune du département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, les missions qui lui sont attribuées par ces dispositions, le préfet de police y exerce des missions de police municipale prévues par les dispositions de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales. La responsabilité de l’État peut, par suite, être recherchée pour les fautes éventuellement commises dans l’exercice de ces missions dans les conditions fixées par l’article L. 2216-2 du même code.
Une annulation pour excès de pouvoir peut ouvrir droit à des intérêts moratoires
CE, 3e et 8e ch., 7 févr. 2020, n° 420567, D. L’article 1er du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 ouvre droit à la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement de transport à tous les personnels civils des collectivités et établissements qu’il vise, au nombre desquels figurent les agents vacataires. Par ailleurs, l’article 7 du même décret ne prévoit une modulation de cette prise en charge qu’en fonction du nombre d’heures travaillées, indépendamment du statut des agents.
Le tribunal a annulé pour excès de pouvoir la décision du maire refusant de requalifier en contrat d’agent non titulaire le contrat du requérant et enjoint à la commune de reconnaître à l’intéressé la qualité d’agent non titulaire relevant du décret du 15 février 1988 et de lui verser les sommes qu’il aurait perçues si cette qualité lui avait été reconnue depuis le 1er janvier 2011. En jugeant que le requérant ne pouvait prétendre, en exécution de ce jugement, au bénéfice d’intérêts moratoires sur la somme qui lui a été allouée au titre de la régularisation de sa rémunération, au motif que, par ce jugement, le tribunal avait seulement tranché un litige d’excès de pouvoir et qu’il ne pouvait dès lors constituer une condamnation à une indemnité au sens de l’article 1153-1 du Code civil et une condamnation pécuniaire au sens de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, la cour a commis une erreur de droit1.
Injonction de modifier les dispositions du Code de l’environnement relatives à la mutagénèse
CE, 3e et 8e ch., 7 févr. 2020, n° 388649, Confédération paysanne et a. Il résulte de l’arrêt de la Cour de justice du 25 juillet 2018 que doivent être inclus dans le champ d’application de la directive 2001/18/CE les organismes obtenus au moyen de techniques ou méthodes de mutagénèse qui sont apparues ou se sont principalement développées depuis l’adoption de la directive le 12 mars 2001. Les techniques de mutagénèse aléatoire in vitro soumettant des cellules de plantes à des agents mutagènes chimiques ou physiques sont apparues postérieurement à la date d’adoption de la directive 2001/18/CE ou se sont principalement développées depuis cette date.
L’annulation du refus d’abroger les dispositions de l’article D. 531-2 du Code de l’environnement implique nécessairement que le Premier ministre modifie ces dispositions.
Il y a lieu d’enjoindre au Premier ministre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative (CJA), de procéder à cette modification dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision.
En outre, l’annulation du refus d’abroger les dispositions contestées de l’article D. 531-2 du Code de l’environnement implique nécessairement aussi qu’il soit enjoint aux autorités compétentes, sur le fondement de l’article L. 911-2 du CJA, d’identifier, dans un délai de 9 mois à compter de la notification de la présente décision, au sein du catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, celles de ces variétés, en particulier parmi les variétés rendues tolérantes aux herbicides, qui y auraient été inscrites sans que ne soit conduite l’évaluation à laquelle elles auraient dû être soumises compte tenu de la technique ayant permis de les obtenir et d’apprécier, s’agissant des variétés ainsi identifiées, s’il y a lieu de faire application du 2 de l’article 14 de la directive 2002/53/CE du 13 juin 2002, relatif à l’annulation de l’admission au catalogue de certaines variétés, ainsi que des articles L. 535-6 et L. 535-7 du Code de l’environnement, relatifs aux disséminations volontaires ayant lieu sans avoir fait l’objet de l’autorisation requise.
En saisissant le Premier ministre, le 10 décembre 2014, les requérants lui ont demandé de décider un moratoire sur l’utilisation et la commercialisation des semences ou plants de variétés rendues tolérantes aux herbicides (VRTH). Il appartenait au Premier ministre de rechercher s’il existait, en lien avec leurs caractéristiques ou les modalités d’utilisation qui leur sont propres, des éléments circonstanciés de nature à accréditer l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé. Si cette condition était remplie, il lui incombait de veiller à ce que des procédures d’évaluation du risque identifié soient mises en œuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle et de vérifier que, eu égard, d’une part, à la plausibilité et à la gravité du risque, d’autre part, à l’intérêt que représentent ces variétés, des mesures de précaution soient prises, allant le cas échéant jusqu’aux interdictions sollicitées, afin d’éviter la réalisation du dommage. Il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre une quelconque mesure, et au vu de l’argumentation dont il est saisi, de déterminer si l’application du principe de précaution est justifiée à la date à laquelle il se prononce, et dans l’affirmative, quelles sont les mesures qui doivent être ordonnées au titre de ses pouvoirs d’injonction.
Il importe d’améliorer la connaissance des pratiques associées aux VRTH et de sensibiliser les agriculteurs à l’égard de celles qui sont susceptibles d’induire des risques d’apparition et de développement des résistances des adventices aux herbicides.
Dès lors qu’il est constant que l’usage des VRTH doit s’accompagner de pratiques culturales destinées à limiter l’apparition de résistances, l’annulation du refus implicite […] implique nécessairement de mettre en œuvre la procédure prévue par le 2 de l’article 16 de la directive 2002/53/CE du 13 juin 2002, pour être autorisé à prescrire des conditions de culture appropriées pour les VRTH issues de la mutagénèse utilisée en France. Il y a lieu d’enjoindre au Premier ministre d’y procéder dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision.
Une requête présentée hors délai Czabaj peut être rejetée par ordonnance, même après ouverture de l’instruction
CE, 7e et 2e ch., 10 févr. 2020, n° 429343, C. Lorsque, dans l’hypothèse où l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours n’a pas été respectée, ou en l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, le requérant entend contester devant le juge une décision administrative individuelle dont il a eu connaissance depuis plus d’1 an, il lui appartient de faire valoir, le cas échéant, que, dans les circonstances de l’espèce, le délai raisonnable dont il disposait pour la contester devait être regardé comme supérieur à 1 an. En l’absence de tels éléments, et lorsqu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges que le requérant a eu connaissance de la décision depuis plus d’1 an, la requête peut être rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative (CJA), sans que le requérant soit invité à justifier de sa recevabilité.
L’article R. 611-7 du CJA prévoit que son premier alinéa, qui impose d’informer les parties lorsque la décision paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, n’est pas applicable lorsque le juge rejette une demande par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du même code, sans réserver le cas où cette ordonnance interviendrait alors que l’instruction a été ouverte.
Précisions sur la prescription des actions en responsabilité médicale
CE, avis, 5e et 6e ch., 12 févr. 2020, n° 435498, Mme H. et a. Le législateur a entendu inclure dans le champ d’application de la prescription décennale que prévoit la loi du 26 janvier 2016, non seulement les actions susceptibles d’être engagées contre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) sur le fondement des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 du Code de la santé publique (CSP), mais aussi celles susceptibles de l’être sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 du même code.
Lorsque, en application de l’article L. 1142-7 du CSP, la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a suspendu le délai de prescription applicable à l’action indemnitaire, il résulte de l’article 2238 du Code civil, qui est applicable, que ce délai recommence à courir pour la durée restant à courir ou, si celle-ci est inférieure à 6 mois, pour une durée de 6 mois.
Si la demande a été présentée à la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux au titre de la procédure amiable, le délai de prescription recommence à courir, dans le cas où la commission conclut à l’absence de droit à réparation, à compter de la date à laquelle cet avis de la commission est notifié à l’intéressé. Dans le cas où la commission estime que le dommage est indemnisable par un établissement de santé ou au titre de la solidarité nationale, si l’intéressé reçoit une offre d’indemnisation de l’assureur de la personne considérée comme responsable ou de l’ONIAM, le délai recommence à courir à compter de la date de réception de cette offre.
Si la demande a été présentée au titre de la procédure de conciliation, le délai de prescription recommence à courir à la date à laquelle l’intéressé reçoit le courrier de la commission l’avisant de l’échec de la conciliation, ou à la date à laquelle le document de conciliation partielle mentionné à l’article R. 1142-22 du CSP est signé par les deux parties.
En prévoyant, à l’article L. 1142-28 du CSP issu de la loi du 26 janvier 2016, que les règles de la prescription extinctive prévues au titre XX du livre III du Code civil s’appliquent au régime spécifique de prescription décennale, le législateur a entendu fixer l’ensemble des causes interruptives inhérentes à ce régime et exclure, par suite, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2016, pour les litiges de responsabilité médicale mettant en cause des personnes publiques, l’application des causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968.
Or, à la différence de ce que prévoit la loi du 31 décembre 1968, aucune disposition du titre XX du livre III du Code civil ne prévoit qu’une demande de paiement ou une réclamation adressée à une administration ait pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai de prescription.
Par suite, une demande indemnitaire présentée à l’administration n’est pas de nature à suspendre ou interrompre le délai de prescription prévu par l’article L. 1142-28 du CSP2.
Demande d’annulation d’une mesure d’éviction et demande d’indemnité constituent des litiges distincts
CE, 4e et 1re ch., 12 févr. 2020, n° 416007, C. Un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre3. En l’espèce, le tribunal n’avait été saisi par le requérant, dans l’instance ayant donné lieu au jugement dont l’exécution était demandée à la cour administrative d’appel, que de conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du recteur de l’académie prolongeant la suspension de ses fonctions. La contestation relative à la réparation des conséquences pécuniaires de cet arrêté relevait ainsi d’un litige distinct4, qui ne se rapportait pas à l’exécution du jugement du tribunal, comme l’a jugé la cour, sans commettre d’erreur de droit ni entacher son arrêt d’irrégularité en s’abstenant de répondre à une argumentation inopérante.
Absence de prescription quadriennale pour une décision de justice
CE, 4e et 1re ch., 12 févr. 2020, n° 432598, B. Il résulte des articles 1 et 7 de la loi du 31 décembre 1968 que l’administration n’est pas fondée, pour justifier son refus de verser les sommes mises à sa charge par des décisions du Conseil d’État, à opposer l’exception de prescription quadriennale à la demande du requérant tendant au paiement de ses créances.
Dès lors que l’article L. 911-9 du Code de justice administrative permet à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’État est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
Refus de titularisation en fin de stage : contrôle du juge
CE, 3e et 8e ch., 24 févr. 2020, n° 421291, Cne de Marmande. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne5.
L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
Recours contre une suspension pour dopage : office du juge de l’excès de pouvoir
CE, 2e et 7e ch., 28 févr. 2020, n° 433886, A. Lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’une mesure de suspension provisoire prise à titre conservatoire sur le fondement de l’article L. 232-23-4 du Code du sport, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de cette décision à la date de son édiction et, s’il la juge illégale, en prononce l’annulation. Eu égard à l’effet utile d’un tel recours, il appartient en outre au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions en ce sens, d’apprécier la légalité de la décision à la date où il statue et, s’il juge qu’elle est devenue illégale, d’en prononcer l’abrogation.
Si l’article L. 232-23-4 du Code du sport ne prévoit pas de durée maximale pour la mesure de suspension provisoire, il résulte de ses termes mêmes que la suspension prend fin lorsqu’intervient la décision de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Il appartient en outre au président de l’Agence, sous le contrôle du juge, de lever la suspension dans l’hypothèse où la mesure se prolonge au-delà d’un délai raisonnable sans que la commission des sanctions n’ait adopté de décision. Il en va de même dès qu’il apparaît que cette mesure conservatoire n’est plus justifiée, notamment si les premiers résultats de l’analyse sont infirmés ou au vu d’éléments nouveaux le cas échéant produits par le sportif concerné, tels qu’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.
Il ne résulte pas de l’article L. 232-23-4 du Code du sport que le président de l’AFLD serait tenu d’attendre les résultats de l’analyse du second échantillon, lorsque celle-ci est demandée par le sportif, avant de pouvoir prendre légalement une mesure de suspension à titre conservatoire.
Portée de l’obligation de porter les conclusions à la connaissance des parties
CE, 7e et 2e ch., 10 févr. 2020, n° 427282, Me B., liquidateur judiciaire de la sté Les Compagnons Paveurs. Avant la tenue de l’audience, le rapporteur public a porté à la connaissance des parties le sens des conclusions qu’il envisageait de prononcer dans les termes suivants : « Annulation partielle du jugement – Réformation partielle du jugement ». Une telle mention, qui ne permettait pas de connaître la position du rapporteur public sur le montant précis de l’indemnisation qu’il proposait de mettre à la charge de la communauté de communes, au bénéfice du requérant, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’article R. 711-3 du Code de justice administrative (CJA)6.
Alors même que l’avocat du requérant, présent à l’audience, ne s’est plaint de l’imprécision de cette mention ni dans les observations orales qu’il a présentées à la suite des conclusions du rapporteur public ni dans une note en délibéré, l’arrêt de la cour a été rendu au terme d’une procédure irrégulière, l’exigence posée par l’article R. 711-3 du CJA étant prescrite à peine d’irrégularité de la procédure7.
Notes de bas de pages
-
1.
Ab. jur. CE, 28 juill. 2000, n° 191373, Roca : Lebon T., p. 1172.
-
2.
V., sous l’empire du droit antérieur à L. n° 2016-41, 26 janv. 2016 : CE, 23 juill. 2014, n° 375829, Mme X : Lebon, p. 241.
-
3.
CE, ass., 7 avr. 1933, n° 04711, Deberles : Lebon, p. 439 – CE, sect., 6 déc. 2013, n° 365155, Cne d’Ajaccio : Lebon, p. 306.
-
4.
CE, 22 avr. 1992, n° 108058, Iban : Lebon T., p. 1084 et 1094 – CE, 9 févr. 2000, nos 209256 et 211729, Samoy : Lebon T., p. 1178.
-
5.
CE, sect., 3 déc. 2003, n° 236485, Mansuy : Lebon, p. 469.
-
6.
CE, 5e et 6e ch., 28 mars 2019, n° 415103, G. et a. : Lebon T.
-
7.
CE, sect., 21 juin 2013, n° 352427, Cté d’agglo. du pays de Martigues : Lebon, p. 167 – CE, 4e et 5e ch., 30 mai 2016, n° 381274, Rollet : Lebon, T., p. 802, 806 et 890.