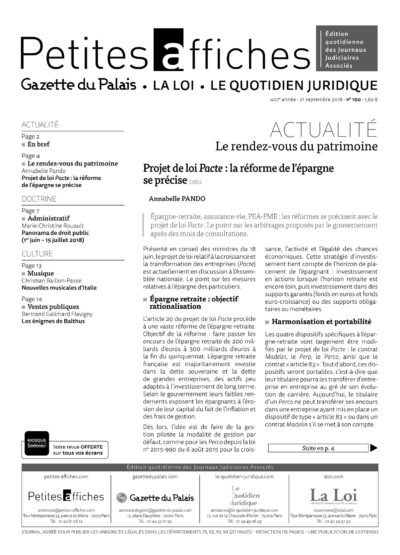Panorama de droit public (1er juin – 15 juillet 2018)
Le choix des arrêts lus durant la période du 1er juin au 15 juillet 2018 a porté notamment sur des jugements ayant majoritairement trait à l’emploi public, au contentieux administratif, à la laïcité et aux contrats. Une décision complète la jurisprudence Commune de Douai, en matière de biens de retour en fin de concession et une autre indique quel est le mode de scrutin en cas de vote sur le maintien en fonctions d’un adjoint au maire.
Transfert à une personne publique d’un salarié protégé : contrôle de l’Administration
CE, 6 juin 2018, n° 391860, Mme B. D’une part, en vertu de l’article L. 1224-3 du Code du travail interprété à la lumière de l’article 4 de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 qu’il transpose, dans le cas où la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé résulte de son refus d’accepter le contrat qu’une personne publique lui propose en application de l’article L. 1224-3, cette rupture doit être regardée comme intervenant du fait de l’employeur.
D’autre part, en application du Code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent. À ce titre, leur licenciement, ou toute autre forme de rupture de leur contrat de travail, suppose, dès lors qu’il doit être regardé comme intervenant du fait de l’employeur, l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Lorsque ce licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. En outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé qui fait suite à son refus d’accepter le contrat qu’une personne publique lui propose en application des dispositions de l’article L. 1224-3 du Code du travail est soumise à l’ensemble de la procédure prévue en cas de licenciement d’un salarié protégé et est, dès lors, subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative préalable. À ce titre, il appartient à l’inspecteur du travail ou, le cas échéant, au ministre du Travail, saisi par la voie du recours hiérarchique, de vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, que les conditions légales de cette rupture sont remplies, notamment le respect par le nouvel employeur public de son obligation de proposer au salarié une offre reprenant les clauses substantielles de son contrat antérieur sauf si des dispositions régissant l’emploi des agents publics ou les conditions générales de leur rémunération y font obstacle, d’autre part, que la mesure envisagée n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale et, enfin, qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à ce que l’autorisation soit accordée.
Mesure préparatoire et décision faisant grief
CE, 25 juin 2018, n° 419227, B., avis. La lettre par laquelle l’Administration informe un militaire qu’il doit rembourser une somme indûment payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours.
La lettre par laquelle l’Administration informe un militaire qu’il doit rembourser une somme indûment payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, cette somme sera retenue sur sa solde est, en revanche, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours de plein contentieux.
Il résulte de l’article R. 4125-1 du Code de la défense et des articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que la lettre par laquelle l’Administration informe un militaire de son intention de procéder à une retenue sur sa solde n’est pas au nombre des exceptions énumérées au III de l’article R. 4125-1 du Code de la défense et doit donc faire l’objet d’un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires.
Dans l’hypothèse où l’Administration procéderait directement à une retenue sur la solde d’un militaire sans information préalable, la décision révélée par cette opération de dépense régie par l’article 128 du décret du 7 novembre 2012 devrait également être précédée d’un recours devant cette commission.
En revanche, en cas de notification au militaire d’un titre de perception, l’opposition à ce titre, émis en application des dispositions de l’article 117 du même décret, doit être précédée, conformément aux dispositions du 2°, du III, de l’article R. 4125-1 du Code de la défense, d’une réclamation au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer, et non d’un recours devant la commission des recours des militaires.
Un ministre d’un culte peut être président d’université
CE, 27 juin 2018, n° 419595, Syndicat de l’enseignement supérieur SNESUP-FSU. Le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la constitution garantit. Notamment, il en résulte la neutralité de l’État, le respect de toutes les croyances et l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion.
Il résulte ainsi du principe constitutionnel de laïcité que l’accès aux fonctions publiques, dont l’accès aux fonctions de président d’université, s’effectue sans distinction de croyance et de religion. Par suite, il ne peut, en principe, être fait obstacle à ce qu’une personne ayant la qualité de ministre d’un culte puisse être élue aux fonctions de président d’université, celle-ci étant alors tenue, eu égard à la neutralité des services publics qui découle également du principe de laïcité, à ne pas manifester ses opinions religieuses dans l’exercice de ses fonctions ainsi qu’à un devoir de réserve en dehors de l’exercice de ces fonctions.
Compétence du pouvoir réglementaire pour déterminer les conditions de recrutement des aumôniers
CE, 27 juin 2018, n° 412039, Union des associations diocésaines de France et Monseigneur Pontier, archevêque de Marseille. En application de l’article L. 4121-2 du Code de la défense et des articles 2 et 3 de la loi du 8 juillet 1880 relative à l’abrogation de la loi des 20 mai-3 juin 1874 sur l’aumônerie militaire, il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer par un décret en Conseil d’État les conditions de recrutement des ministres du culte attachés aux armées. Ces conditions de recrutement sont fixées par le décret du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires, que le décret du 3 mai 2017 a complété.
Les aumôniers des établissements hospitaliers étant recrutés dans le cadre de contrats, il est loisible au pouvoir réglementaire de déterminer par un décret en Conseil d’État les conditions de recrutement de ces agents, en dérogeant, le cas échéant, aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de ces établissements.
En application de l’article 26 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les deux premiers alinéas de l’article D. 439 du Code de procédure pénale prévoient que les aumôniers des établissements pénitentiaires sont agréés par le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis du préfet, sur proposition de l’aumônier national du culte concerné. L’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’État donne à l’autorité compétente la faculté d’inscrire au budget les dépenses relatives à des services d’aumônerie dans les établissements pénitentiaires, mais ne l’y oblige pas, dès lors que le libre exercice du culte y est assuré. L’indemnité créée par le décret du 3 mai 2017, qui se substitue à l’indemnité allouée aux ministres du culte des aumôneries de ces établissements par le décret du 8 décembre 2005, qu’il abroge, est destinée à permettre aux aumôniers agréés d’assurer les missions qui leur sont confiées. La création et la définition des conditions d’octroi d’une telle indemnité relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire.
Compte tenu de leur ministère religieux, les aumôniers militaires et les aumôniers hospitaliers ne peuvent être recrutés par l’Administration que sur proposition d’une autorité représentative de leur culte. Il en va de même pour les aumôniers pénitentiaires, qui ne sont agréés par l’État que sur proposition de l’aumônier national du culte concerné. Cette règle ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire soumette leur recrutement ou, pour les aumôniers pénitentiaires, leur indemnisation, d’une part, aux conditions applicables à la catégorie d’agents publics dont, le cas échéant, ils relèvent, pour autant que ces conditions ne soient pas incompatibles avec leur ministère, d’autre part, à des conditions particulières liées aux exigences propres aux services publics au sein desquels ils interviennent et aux publics auxquels ils s’adressent.
La mission des aumôniers militaires, des aumôniers hospitaliers et des aumôniers pénitentiaires est d’assurer le libre exercice du culte ainsi qu’un soutien spirituel auprès des militaires des armées et des formations rattachées, des patients des établissements hospitaliers et des personnes détenues. En imposant une obligation de détention d’un diplôme de formation civile et civique pour les aumôniers recrutés par les armées ou les établissements hospitaliers et pour ceux des aumôniers des établissements pénitentiaires bénéficiaires d’une indemnité, le pouvoir réglementaire a ajouté une condition supplémentaire au recrutement ou à l’indemnisation de ces aumôniers, qui repose sur la poursuite d’objectifs d’intérêt général et de sauvegarde de l’ordre public en lien avec la mission de ces aumôniers, qui interviennent dans des lieux fermés ou isolés, auprès d’agents ou de publics dont la liberté de mouvement est limitée, afin de leur permettre le libre exercice de leur culte.
L’institution d’une telle condition n’a par ailleurs pour effet ni d’encadrer l’exercice des cultes au sein des armées ou des formations rattachées, des établissements hospitaliers et des établissements pénitentiaires, ni de substituer l’appréciation de l’Administration à celle de l’aumônier national ou des autorités cultuelles, auxquels il appartient de proposer les candidats aux fonctions d’aumônier. La formation en matière civile et civique visée par le décret, qui ne porte pas sur leur ministère religieux, mais sur l’environnement social, institutionnel et juridique dans lequel s’exerce leur activité d’aumônier et n’implique pas que l’Administration, comme les enseignants y participant, porte une appréciation sur le contenu des croyances concernées, peut, par suite, être assurée, financée ou réglementée par une collectivité publique sans méconnaître le principe posé par l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905. En conséquence, en instituant cette condition de diplôme, le pouvoir réglementaire ne s’est pas immiscé dans l’organisation des cultes ni entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
L’anonymat ne dispense pas de respecter l’obligation de réserve
CE, 27 juin 2018, n° 412541, B. Dans le cadre d’activités extraprofessionnelles, l’intéressé, capitaine de la gendarmerie nationale, qui commandait, au moment des faits ayant motivé la sanction contestée, un escadron de gendarmerie mobile, a publié, sous un pseudonyme, sur plusieurs sites internet relayés par les réseaux sociaux, de nombreux articles critiquant en des termes outranciers et irrespectueux l’action de membres du gouvernement et la politique étrangère et de défense française. Il s’est prévalu, dans ces publications, de sa qualité d’ancien élève de l’école Saint-Cyr et de l’école des officiers de la gendarmerie nationale. Alors pourtant qu’il avait été mis en garde à ce sujet, il a poursuivi ces publications. Ces faits, même s’ils ont été commis en dehors du service et sans utiliser les moyens du service et si l’intéressé ne faisait pas état de sa qualité de militaire, sont constitutifs d’une violation de l’obligation de réserve à laquelle sont tenus les militaires à l’égard des autorités publiques, même en dehors du service et fût-ce sous couvert d’anonymat. Les manquements reprochés à l’intéressé, dont l’inexactitude matérielle n’est pas établie, étaient constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Contentieux de l’acte de régularisation d’un document d’urbanisme
CE, 29 juin 2018, n° 395963, Cne de Sempy. Il résulte de l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme que les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l’acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l’acte pris par l’autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu’elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l’annulation de cet acte1. Elles peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation2.
Les biens nécessaires au fonctionnement du service public acquis par le concessionnaire avant la signature de la concession sont des biens de retour
CE, sect., 29 juin 2018, n° 402251, ministre de l’Intérieur. Dans le cadre d’une concession de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique. Le contrat peut attribuer au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d’une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s’opposer à la cession, en cours de concession, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée.
À l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Le contrat qui accorde au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d’une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de concession.
Lorsque la convention arrive à son terme normal ou que la personne publique la résilie avant ce terme, le concessionnaire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, lorsqu’ils n’ont pu être totalement amortis, soit en raison d’une durée du contrat inférieure à la durée de l’amortissement de ces biens, soit en raison d’une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement. Lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d’une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus3.
Ces règles trouvent également à s’appliquer lorsque le cocontractant de l’Administration était, antérieurement à la passation de la concession de service public, propriétaire de biens qu’il a, en acceptant de conclure la convention, affectés au fonctionnement du service public et qui sont nécessaires à celui-ci. Une telle mise à disposition emporte le transfert des biens dans le patrimoine de la personne publique, dans les conditions énoncées ci-dessus. Elle a également pour effet, quels que soient les termes du contrat sur ce point, le retour gratuit de ces biens à la personne publique à l’expiration de la convention, dans les conditions énoncées ci-dessus. Les parties peuvent prendre en compte cet apport dans la définition de l’équilibre économique du contrat, à condition que, eu égard notamment au coût que représenterait l’acquisition ou la réalisation de biens de même nature, à la durée pendant laquelle les biens apportés peuvent être encore utilisés pour les besoins du service public et au montant des amortissements déjà réalisés, il n’en résulte aucune libéralité de la part de la personne publique.
Dans l’hypothèse où la commune intention des parties a été de prendre en compte l’apport à la concession des biens qui appartenaient au concessionnaire avant la signature du contrat par une indemnité, le versement d’une telle indemnité n’est possible que si l’équilibre économique du contrat ne peut être regardé comme permettant une telle prise en compte par les résultats de l’exploitation. En outre, le montant de l’indemnité doit, en tout état de cause, être fixé dans le respect des conditions énoncées ci-dessus afin qu’il n’en résulte aucune libéralité de la part de la personne publique.
Applicabilité dans le temps des lois de procédure
T. confl., 2 juill. 2018, n° 4123, Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie CFE-CGC (FIECI CFE-CGC) et a. Si le droit de former un recours contre une décision est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue, les règles qui régissent les formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé, y compris celles relatives à la compétence des juridictions et aux pouvoirs des juges, ne sont pas, à la différence des voies selon lesquelles ce droit peut être exercé ainsi que des délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, des éléments constitutifs de ce droit. Ainsi, et à moins qu’une disposition expresse y fasse obstacle, un texte modifiant les règles qui déterminent la juridiction compétente s’applique, dès son entrée en vigueur, aux recours introduits avant cette date.
La décision de la DIRECCTE de la région Île-de-France, en tant qu’elle a dit que la société intéressée constituait un seul établissement pour les élections du comité d’entreprise, a été prise sur le fondement non pas de l’article L. 2327-7 du Code du travail, mais de l’article L. 2322-5 du même code qui, jusqu’à son abrogation par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, s’appliquait à la détermination, par l’autorité administrative, de l’existence et du nombre d’établissements distincts nécessaires à la constitution des comités d’établissement.
L’article 18, III, de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur le 10 août suivant, a complété ce texte par un alinéa rédigé en ces termes : « La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ». Cette règle nouvelle, qui transfère de l’ordre administratif vers l’ordre judiciaire la compétence pour connaître des recours contre les décisions prises par l’autorité administrative sur le fondement de l’article L. 2322-5 du Code du travail, ne porte pas en elle-même atteinte à la substance du droit au recours des parties intéressées. Dès lors, elle s’applique au recours formé contre la décision prise par la DIRECCTE (compétence judiciaire).
Contrôle sur le choix d’inscrire un enseignement au programme des collèges
CE, 4 juill. 2018, n° 392400, Association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque. Le choix d’inscrire, dans le programme d’histoire en classe de troisième, l’enseignement des faits et événements s’étant déroulés en 1915 au sein de l’empire ottoman n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requérante soutient que l’arrêté du 15 juillet 2008 fixant le programme d’histoire-géographie-éducation civique pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du collège porte atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves, ainsi qu’à la neutralité du service public de l’éducation, en raison de l’usage de l’expression « génocide des Arméniens » et de l’orientation que celui-ci confère à l’enseignement des faits en question. D’une part, la seule utilisation de ces termes, qui se bornent à reprendre une formulation courante, notamment de la part d’historiens, et d’ailleurs reprise par la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien, n’est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte à ces principes. D’autre part, l’objet même du programme d’histoire, tel que le fixe l’arrêté litigieux, est de faire enseigner aux élèves l’état des savoirs tel qu’il résulte de la recherche historique, laquelle repose sur une démarche critique, fondée sur la liberté de soumettre à débat toute connaissance. Par suite, la prescription d’un tel enseignement par l’arrêté attaqué est, en elle-même, insusceptible de porter atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves, ou de méconnaître la neutralité du service public de l’éducation.
Modalités de vote sur le maintien dans ses fonctions d’un adjoint au maire
CE, 5 juill. 2018, n° 412721, Cne de Mantes-la-Jolie. Les délibérations du conseil municipal sur le maintien d’un adjoint dans ses fonctions sont votées dans les conditions de droit commun prévues par l’article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, alors même que les délibérations relatives à la désignation d’un adjoint le sont dans le cadre des dispositions spéciales des articles L. 2122-7 à L. 2122-7-2, qui imposent toujours le vote au scrutin secret.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Cependant, les dispositions de l’article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales définissant les conditions du scrutin secret, dont la méconnaissance constitue une irrégularité substantielle, ne sont pas relatives à une procédure administrative préalable à la délibération du conseil municipal, mais définissent les modalités de vote de la délibération elle-même.
Responsabilité du fait du défaut par le préfet de mandater une dépense d’office
CE, 5 juill. 2018, n° 406671, ministre de l’Intérieur. Il résulte de l’article L. 1612-16 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, qu’une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire l’objet d’un mandatement d’office que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et son montant et découlant d’une loi, d’un contrat ou de toute autre source d’obligations. Si le représentant de l’État s’abstient de faire usage des prérogatives qui lui sont ainsi conférées, le créancier de la collectivité territoriale est en droit de se retourner contre l’État en cas de faute lourde commise dans l’exercice de ce pouvoir.
Pour juger que le préfet a commis une faute lourde en ne procédant pas au mandatement d’office des sommes litigieuses, la cour s’est fondée sur la circonstance que les échéances fixées par l’accord de partenariat revêtaient le caractère d’une dépense obligatoire et que les créances du département correspondaient à des dettes échues, certaines, liquides et non sérieusement contestées ni dans leur principe, ni dans leur montant. Cependant, un différend opposait la ville et le département sur le respect de l’économie générale de l’accord de partenariat, notamment sur l’échéancier des règlements, ainsi que le maire de cette commune en a notamment fait part au préfet par courriers. Les termes de ce différend nécessitaient de porter une appréciation sur le point de savoir si la dette pouvait être regardée comme échue à la date du refus litigieux, compte tenu des interrogations relatives à la portée juridique et l’interprétation de l’accord de partenariat. Ainsi, en jugeant que l’absence de mandatement d’office par le préfet avait constitué une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’État, la cour a inexactement qualifié les faits dont elle était saisie.
Le refus opposé par le préfet aux demandes de mandatement d’office n’a pas constitué, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la difficulté à déterminer la portée juridique de l’accord de partenariat en ce qui concerne l’échéancier des règlements et d’apprécier, en conséquence, si la dette de la ville pouvait être regardée comme échue à la date du refus de mandatement d’office, une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’État envers le département.
Exécution d’une décision du juge du contrat : quel juge ?
CE, 11 juill. 2018, n° 407865, Cne d’Isola et syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000. Si, en principe, il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un contrat administratif en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’Administration lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’Administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle, notamment après l’expiration des relations contractuelles. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant de l’Administration, une condamnation, éventuellement sous astreinte à une obligation de faire4.
Les dispositions du livre IX du Code de justice administrative ne s’appliquent qu’aux injonctions et astreintes que, depuis la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995, les juridictions administratives peuvent prononcer à l’encontre d’une personne morale de droit public ou d’un organisme privé chargé de la gestion d’un service public. Elles ne sont, en revanche, pas applicables lorsque le juge du contrat, saisi par l’Administration en vue de prononcer une obligation de faire à l’encontre de l’ancien cocontractant de l’Administration, fait application du principe général selon lequel les juges ont la faculté de prononcer une injonction assortie d’une astreinte en vue de l’exécution de leurs décisions.
La juridiction compétente pour connaître d’une demande d’exécution du jugement d’un tribunal administratif est le tribunal qui a rendu cette décision ou, en cas d’appel, la juridiction d’appel, alors même que cette dernière aurait rejeté l’appel formé devant elle. La seule circonstance qu’un jugement ou un arrêt ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation est sans incidence sur la compétence du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel pour prononcer les mesures qu’implique l’exécution de ce jugement ou de cet arrêt. Toutefois, il en va différemment dans l’hypothèse où un jugement ou un arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et où le Conseil d’État règle l’affaire au fond, y compris lorsque le jugement ou l’arrêt n’a fait l’objet que d’une annulation partielle.
Notes de bas de pages
-
1.
V. CE, sect., 22 déc. 2017, n° 395963, Cne de Sempy : Lebon, p. 308, concl. Burguburu J.
-
2.
Comp. CE, 18 juin 2014, n° 376760, Sté Batimalo et a. : Lebon, p. 164.
-
3.
V. CE, ass., 21 déc. 2012, n° 342788, Cne de Douai : Lebon, p. 417.
-
4.
V. CE, sect., 17 mars 1956, n° 37656, OPHLM du dpt de la Seine : Lebon, p. 343 – CE, 15 juin 2018, n° 418493, ADEME : sera mentionné aux tables du Lebon.