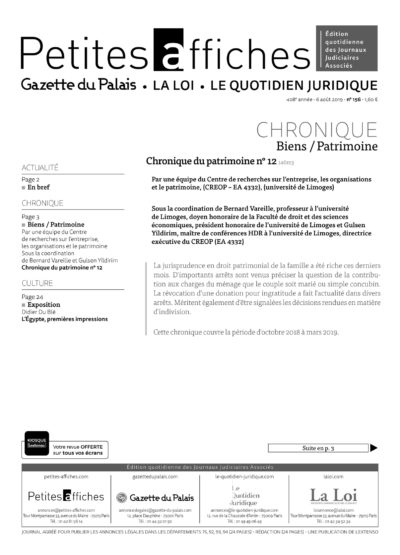Chronique du patrimoine n° 12
La jurisprudence en droit patrimonial de la famille a été riche ces derniers mois. D’importants arrêts sont venus préciser la question de la contribution aux charges du ménage que le couple soit marié ou simple concubin. La révocation d’une donation pour ingratitude a fait l’actualité dans divers arrêts. Méritent également d’être signalées les décisions rendues en matière d’indivision.
Cette chronique couvre la période d’octobre 2018 à mars 2019.
I – Régimes matrimoniaux : règles communes à tous les régimes
A – Séparation de biens, contribution aux charges du mariage, acquisition indivise
Dans le régime de la séparation de biens, les juges doivent déterminer la contribution de chaque époux aux charges du mariage au regard de leurs conditions de vie et de leurs revenus respectifs avant de rejeter la demande de l’époux qui a assumé les mensualités d’un emprunt finançant l’acquisition indivise du logement de la famille (Cass. 1re civ., 16 janv. 2019, n° 18-10459).
1. Une évolution sur une épineuse question ? Question désormais classique dans le régime de la séparation de biens1, le financement de l’acquisition du logement de la famille2 ou d’une résidence secondaire3 peut faire partie de la « contribution aux charges du mariage » prévue à l’article 214 du Code civil. Par conséquent, lorsque ce bien est indivis, l’époux coïndivisaire qui a payé sur ses deniers personnels le remboursement des arrérages de l’emprunt ayant permis son financement, perd le bénéfice d’une action en remboursement sur le fondement de l’article 815-13 car ce paiement correspond à l’exécution de son obligation de contribution.
L’année 2018 a toutefois été marquée par plusieurs arrêts4 qui interrogent sur l’orientation prise par la Cour de cassation au point de se demander si elle n’a pas opté pour un lent revirement de sa jurisprudence très critiquée par la doctrine.
2. Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision du 16 janvier 2019, les faits étaient similaires à tous ceux qui ont fait la une de l’actualité judiciaire depuis 2013. Pour rejeter la demande présentée par le mari au titre du paiement des échéances du prêt contracté pour financer l’acquisition du logement familial, la cour d’appel constate que les époux ont pris soin de faire figurer dans l’acte d’acquisition qu’ils étaient acquéreurs conjoints et solidaires, chacun pour moitié, de sorte que le remboursement de l’époux doit être considéré comme sa contribution aux charges du mariage.
L’arrêt est cassé sur ce point : « en déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, quelle était la contribution de chaque époux aux charges du mariage au regard de leurs conditions de vie et de leurs revenus respectifs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 214 ».
3. L’importance de l’excès de contribution. La décision commentée impose aux juges du fond, avant de rejeter le recours de l’époux solvens, de mesurer l’étendue de l’obligation de chacun. On perçoit l’intérêt d’une telle démarche. En effet, l’objectif est de caractériser un éventuel excès de contribution de l’époux. Dans un arrêt du 11 avril 20185, la Cour de cassation avait déjà approuvé les juges de décider que, dès lors que le mari alimentait avec ses revenus l’ensemble des comptes de la famille et qu’il réglait en plus la part d’emprunt de l’épouse sur le logement familial, il excédait sa contribution normale aux charges du mariage. Le critère de la sur-contribution devient ainsi la seule issue de l’époux solvens qui cherche à être remboursé.
4. Cette confirmation du critère de l’excès6 n’est pas non plus la panacée. Caractériser cette sur-contribution relève du casse-tête probatoire et surtout du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Il nécessitera plusieurs étapes : dans un premier temps, de récapituler les charges du mariage auxquelles le ménage a dû faire face durant l’union en fonction du train de vie et de calculer, dans un deuxième temps, les facultés respectives de chacun en tenant compte de leurs revenus ou d’autres formes, ce qui permettra de déterminer la proportion de dépenses à supporter par l’un et l’autre. Dans un troisième temps, il faudra déduire de cette proportion la contribution effective de chacun en tenant compte des apports en numéraire ou en industrie.
Ainsi, une fois ce long chemin parcouru, l’excès apparaîtra ou non… Comme le précise un auteur, « rien n’interdit aux juges d’appel qui trouveraient la jurisprudence de la Cour de cassation quelque peu malencontreuse de se montrer bienveillants sur ce point »7.
5. Et la clause de présomption de contribution ? L’arrêt ne dit rien de l’absence ou de l’existence de la fameuse clause usuelle de présomption de contribution que l’on retrouve dans de nombreux contrats de mariage de séparation de biens. Pour rappel, grâce à cette clause, « les époux sont réputés avoir fourni au jour le jour leur part contributive dans les charges du mariage, de sorte qu’ils ne sont assujettis à aucun compte entre eux ni à requérir à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre ». Or sera-t-il possible de prouver cet excès en présence d’une telle clause ? Rien n’est moins sûr car le débat s’est souvent concentré sur le caractère irréfragable ou simple de la présomption.
Un arrêt du 3 octobre 2018 semble néanmoins accepter le fait que l’excès de contribution puisse être invoqué malgré l’existence d’une telle clause. Cette décision a pu faire dire à un auteur que si la sur-contribution est démontrée, c’est tout simplement que l’on est en dehors du domaine de l’article 214 et que la clause n’est plus applicable8. Cette interprétation permettrait certes de contourner la difficulté du caractère irréfragable de la clause mais manque de certitude. En effet, dans cette hypothèse, elle ne résout pas la question de savoir si l’établissement de compte entre les époux, indispensable pour caractériser l’excès, demeure possible.
6. En somme, le vent tourne sur cette épineuse question des acquisitions immobilières et de l’obligation de contribuer aux charges de mariage. D’aucuns diront que l’arrêt est toujours non publié au Bulletin9 mais ce n’est pas le premier en la matière. Le sillon creusé par la première chambre civile doit être certes confirmé mais surtout approuvé. Une solution qui dénature complètement le régime de la séparation au point d’en faire un régime plus communautaire que celui de la communauté ne pouvait perdurer.
Quelques lueurs d’espoir apparaissent pour l’époux (souvent le mari), un temps généreux, pris par la suite dans les affres d’un divorce…
Gulsen YILDIRIM
B – Régimes matrimoniaux, charges de la vie courante, concubins
Chaque concubin supporte les dépenses de la vie courante qu’il a engagées (Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 18-12311, PB).
Aucune obligation pour les concubins de contribuer aux charges du ménage. Si la loi reconnaît aujourd’hui le concubinage en le définissant10, il n’existe toujours pas de statut légal de l’union libre, qui reste une situation de fait et ne produit, en principe, aucun effet de droit. En particulier, il a toujours été jugé que les règles propres au mariage ne peuvent être appliquées aux concubins. C’est ce que rappelle une fois encore la Cour de cassation dans cet arrêt du 19 décembre 201811. L’affaire était classique. Un couple de concubins se sépare et se déchire sur la répartition des dépenses exposées au cours de la vie commune. L’homme exigeait le remboursement de sommes dépensées pour la création du commerce de sa compagne. La cour d’appel rejette sa demande au motif que la concubine détenait à son égard une créance représentant la moitié des frais de logement et d’électricité exposés au cours de leur vie commune, laquelle se compensait avec sa dette envers son compagnon. Cela revenait donc à imposer au concubin une contribution pour moitié à de telles charges du ménage. L’arrêt d’appel est sans surprise12 cassé au visa de l’article 214 du Code civil, texte régissant la contribution aux charges du mariage entre époux13. La Cour de cassation refuse donc toujours d’admettre un raisonnement par analogie qui conduirait à appliquer aux concubins des droits et obligations comparables à ceux édictés pour les personnes mariées.
Ainsi, quant à la contribution aux dettes entre concubins, c’est la règle du chacun pour soi. Chacun doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées. La haute cour réserve bien sûr la possibilité d’un accord entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune. On peut néanmoins craindre qu’une telle convention ne soit rare en pratique, les concubins prenant généralement conscience de la précarité de leur statut uniquement en situation de crise générée par une rupture ou un décès.
Difficultés liquidatives consécutives. Cette jurisprudence est irréprochable juridiquement. Toutefois, elle met en lumière les difficultés liquidatives auxquelles sont souvent confrontés les ex-concubins. La vie commune entraîne nécessairement mises en commun et partage. Or, les concubins n’ont aucun régime matrimonial qui permette de liquider leurs intérêts. La rupture du couple révèle donc souvent d’importantes désillusions et parfois de flagrantes inéquités. Le recours aux règles édictées pour les époux est, comme on le voit ici, voué à l’échec, la Cour de cassation refusant fermement toute assimilation du concubinage au mariage. C’est ce qui explique que la jurisprudence recherche depuis longtemps des palliatifs tirés du droit commun pour assurer à chaque concubin, en équité, un minimum de protection en cas de rupture. En particulier, les juges utilisent parfois la technique de la société créée de fait ou encore celle de l’enrichissement injustifié. Mais ces solutions demeurent restrictives et difficiles à mettre en œuvre. Les difficultés liquidatives restent donc entières face à cette jurisprudence intransigeante, mais difficilement condamnable. Mieux informer les intéressés serait souhaitable, mais sans doute illusoire face à des couples qui font précisément le choix de la liberté.
Nadège MOULIGNER
II – Régimes matrimoniaux : propriété des biens
A – Communauté, biens communs, plus-values d’un bien propre, distinction fruits et revenus et plus-values
La plus-value d’un propre ne constitue pas des fruits et revenus entrant en communauté (Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 18-11794, publié).
Plus-value réalisée lors de la vente d’un propre. Deux ex-époux communs en biens s’opposent sur la liquidation de leurs intérêts pécuniaires, en particulier sur la qualification de la plus-value réalisée par l’ex-mari à l’occasion de la vente d’un immeuble propre. L’ex-épouse revendique l’entrée en communauté de la plus-value. L’origine de cette plus-value est quelque peu obscure : est-elle due exclusivement à des circonstances extérieures ou pour partie à des travaux réalisés par le mari lui-même ? Il semble que des travaux aient été réalisés par le mari car une récompense au profit de la communauté est réclamée. La demande de récompense est rejetée car il ne peut être justifié du financement de travaux par la communauté. En revanche, les juges du fond retiennent que la plus-value réalisée à l’occasion de la vente doit augmenter l’actif de communauté. L’arrêt d’appel est cassé au motif que « le prix de vente qui remplace le bien propre cédé est lui-même un propre, ce qui exclut que la plus-value due à l’évolution du marché ou l’érosion monétaire, résultant de cette opération, puisse être assimilée à des fruits et revenus entrant dans la communauté ».
Subrogation du prix de vente. Nul n’a jamais contesté que le prix de vente d’un bien propre soit lui-même un propre. La qualification de propre trouve son fondement dans l’article 1406 du Code civil, lequel prévoit que les créances et indemnités qui remplacent les propres sont elles-mêmes des propres par subrogation, il s’agit là d’un cas de subrogation automatique14. La question posée est en réalité celle de savoir si l’on peut en quelque sorte extraire une partie du prix de vente, partie correspondant à la plus-value procurée pendant le cours de la communauté. Pareille question appelle nécessairement une réponse négative à raison de la nature même de la plus-value.
Nature de la plus-value. Le rapprochement parfois réalisé entre les plus-values et les fruits tient à ce que les uns et les autres consistent en un accroissement de la chose.
Néanmoins, la plus-value est un supplément de valeur qui, à la différence des fruits et revenus du bien, n’a pas d’existence propre15 ; elle représente une constatation comptable d’un supplément de capital16. Elle est donc inséparable du capital lui-même et ne peut en être détachée en vue de lui conférer une qualification distincte.
L’ex-épouse a tenté de revivifier des solutions anciennes ayant accordé les plus-values liées à l’activité d’un époux à la communauté17. Peine perdue. Quand bien même la plus-value serait due au travail de l’un des époux, elle emprunte la nature du bien auquel elle est rattachée18. On observera cependant que la Cour de cassation ne vise explicitement que la plus-value due à l’évolution du marché ou à l’érosion monétaire : doit-on en tirer un argument en faveur d’une possible extraction de la plus-value industrielle ? On peut légitimement en douter.
L’intérêt du présent arrêt est de confirmer explicitement le refus de toute assimilation de la plus-value aux fruits et revenus du bien dans une hypothèse où la plus-value est plus aisément identifiable, et même détachable, puisqu’elle représente une fraction déterminée ou du moins déterminable du prix de vente du bien propre.
Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS
B – Séparation de biens, présomption de propriété, preuve contraire
La preuve contraire pour renverser la présomption de propriété incluse dans un contrat de séparation de biens incombe à celui qui conteste la propriété déterminée par la clause (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-14150, PB).
1. Preuve en présence de présomptions de propriété. Dans le régime de la séparation de biens, la pratique a imaginé de longue date des présomptions de propriété insérées dans les contrats de mariage19. Celles-ci indiquent, de manière variée, celui des époux qui sera réputé être propriétaire de certains biens, essentiellement mobiliers (meubles meublants, vêtements…). L’article 1538 du Code civil issu de la loi du 13 juillet 1965 a reconnu la validité de ces clauses. Aux termes de son alinéa 2, « les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers, aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu ». Ainsi dans notre affaire, le contrat de mariage comportait une clause qui présumait appartenir à chacun des époux, dans la proportion de moitié, tous les produits de consommation tels que vins, combustibles et autres provisions existant au jour de la dissolution du mariage ainsi que les meubles meublants. Les juges d’appel rejettent pourtant le caractère indivis des meubles en relevant que l’époux ne justifiait pas de l’existence de mobilier indivis, l’habitation ayant été meublée avant le mariage.
2. Sans grande surprise, la première chambre civile casse la décision au motif du renversement de la charge de la preuve. En effet, la clause litigieuse visait tous les biens cités existant au jour de la dissolution du mariage. C’est donc à ce moment que l’on doit se placer pour reconnaître leur caractère indivis, peu importe qu’ils aient été acquis avant ou pendant le mariage. Certes la présomption instaurée n’est jamais irréfragable puisque l’alinéa 2 de l’article 1538 poursuit en précisant que la preuve contraire est « de droit » et qu’elle « se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux ». Toutefois les juges se sont emmêlé les pinceaux car la preuve contraire incombe à celui qui conteste la propriété déterminée par la clause. Ainsi, dans notre espèce, ce n’est pas à l’époux de démontrer que les biens étaient indivis puisque la clause suffit ; c’est à celui qui revendique la propriété personnelle de la prouver par exemple en démontrant par tout moyen que les meubles ont été acquis par lui avant le mariage20.
3. L’importance de la rédaction de ces clauses. Cette décision illustre l’importance de la rédaction de ces clauses. En l’espèce, le notaire aurait dû peut-être conseiller la présomption de propriété personnelle des biens meubles si, au jour du mariage, ces derniers appartenaient exclusivement à l’un des époux, à charge pour l’autre de combattre la présomption. De plus, si ces clauses veulent être souvent de simples règles de preuve, elles peuvent tendre aussi à favoriser l’un des époux et, dès lors, permettre des libéralités de l’un à l’autre. La vigilance doit donc être de mise pour le rédacteur, ce qui suppose de ne pas se limiter aux formules toutes prêtes de quelques logiciels…
Gulsen YILDIRIM
III – Régimes matrimoniaux : gestion active et passive
A – Régimes matrimoniaux, communauté légale, passif, emprunt
Les crédits à la consommation contractés par un époux sans le consentement exprès de l’autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils ont été souscrits dans son intérêt personnel (Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, n° 17-26713, F-PB).
L’emprunt souscrit par un seul époux est commun à titre définitif. Tel est le principe qui est rappelé par la Cour de cassation dans cet arrêt du 17 octobre 201821. En l’espèce, un époux commun en bien avait contracté, sans le consentement de son épouse, des prêts à la consommation auprès de quatre organismes de crédit différents. À la suite du divorce du couple un contentieux est né sur le sort liquidatif de ces dettes. La cour d’appel décida d’exclure trois des emprunts du passif définitif de la communauté. Cette décision est cassée au visa de l’article 1409 du Code civil. Pour la Cour de cassation les dettes « résultant d’un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel ».
Cette solution, déjà fermement établie22, ne surprend pas et relève d’une analyse pertinente de la distinction entre obligation et contribution à la dette en régime légal. En effet, si les emprunts font l’objet d’un régime dérogatoire quant à l’obligation à la dette23, ils ne font en revanche pas partie, au plan de la contribution, des exceptions ouvrant droit à récompense pour la communauté mises en avant par le Code civil. Ces dettes font dès lors partie par principe du passif définitif de la communauté. Cette règle a d’importantes répercutions pratiques, en particulier à l’heure de l’établissement des comptes de récompenses, puisqu’on en déduira que l’époux débiteur aura droit à récompense si la dépense a été financée sur ses deniers propres, alors qu’en revanche aucune récompense ne sera due si des fonds communs ont été utilisés.
Sauf s’il est démontré qu’il a été contracté dans l’intérêt personnel de l’époux débiteur. La formulation de l’arrêt est claire : le principe doit céder s’il est démontré que l’emprunt a été en réalité contracté dans l’intérêt personnel de l’époux débiteur. Mais que recoupe cette notion d’intérêt personnel et comment l’établir ? Certaines situations ne font pas de doute, comme, par exemple, dans le cas où un prêt a été souscrit pour l’acquisition d’un bien propre24. Mais l’on peut craindre que la plupart du temps la démonstration soit plus délicate, spécialement concernant les crédits à la consommation qui permettront souvent en pratique l’acquisition de biens communs, mobilier ou électroménager, par exemple. On peut augurer que la preuve négative de l’absence d’intérêt de la dépense pour la communauté soit insuffisante. Il conviendra sans doute de démontrer d’une manière positive que seul l’époux débiteur, et non le couple, a tiré profit des dépenses réalisées au moyen de l’emprunt.
La jurisprudence semble toutefois admettre que la preuve de l’intérêt personnel puisse résulter du comportement fautif d’un époux, comme dans cette espèce de 201225 où une épouse avait souscrit, à l’insu de son mari, et en imitant sa signature, 25 prêts à la consommation sans pouvoir justifier de l’objet de ces emprunts.
Nadège MOULIGNER
En régime de communauté universelle, la veuve à laquelle a été attribuée la totalité de la communauté est tenue de la dette d’emprunt entrée en communauté du chef de son conjoint (Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 16-13323, FS-PBI).
Éviction de la protection de l’article 1415 du Code civil, règle d’obligation. Dans cet important arrêt abondamment commenté26 et généralement approuvé, la Cour de cassation rappelle la fameuse distinction entre obligation et contribution à la dette en régimes de communauté. En l’espèce, deux époux de nationalité allemande étaient soumis au régime de la communauté à titre universel français pour tous leurs biens immeubles en France, présents et à venir. Au cours de l’union le mari avait contracté un emprunt portant sur la coquette somme de 80 000 €. Il décède sans l’avoir remboursé. Sa veuve, bénéficiaire d’une clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant, entend bien échapper aux poursuites du prêteur. Elle se prévaut alors de l’article 1415 du Code civil en vertu duquel « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ». Au premier abord cette invocation aurait pu sembler pertinente. En effet, d’une part il est désormais acquis que ce texte est applicable à la communauté universelle27. D’autre part, ses effets y sont particulièrement protecteurs pour le couple. Si le texte ne remet pas en cause la validité de l’emprunt souscrit par l’époux seul, il limite le droit de poursuite du créancier aux seuls biens propres et revenus de l’époux emprunteur. Les biens communs du couple ne peuvent en revanche pas être saisis. Or, en régime de communauté universelle où les propres sont rares28, le gage du créancier sera particulièrement réduit, d’autant plus qu’on le sait, les revenus, généralement déposés sur des comptes bancaires, sont quant à eux difficilement saisissables29. Pourtant, dans notre affaire, les juges ont fermement écarté l’application de l’article 1415 du Code civil. La solution est logique. L’invocation de ce texte procédait en effet d’une confusion entre les règles d’obligation et de contribution à la dette, distinction fondamentale sur laquelle est basé le régime du passif. L’article 1415 protège le patrimoine conjugal des poursuites des créanciers au cours du régime au titre du passif provisoire. Il n’a pas vocation à s’appliquer ici alors que la communauté est dissoute et que le sort de la dette impayée relève désormais du passif définitif. Or, les règles le concernant sont autrement plus sévères pour la veuve.
Application implacable des règles de contribution. La Cour de cassation rejette les prétentions de la veuve sur le fondement des règles de contribution à la dette des articles 140930 et 1524 du Code civil. Du premier de ces textes les juges déduisent que la dette d’emprunt d’un époux non souscrite dans son intérêt personnel doit figurer au passif définitif de la communauté. Ensuite, ils affirment qu’il résulte du second que l’attribution de la communauté entière en cas de survie oblige l’époux qui en retient la totalité d’en acquitter toutes les dettes. Dès lors le sort de la veuve est scellé : elle devra désintéresser le créancier car, d’une part il n’est pas démontré que l’emprunt souscrit par son défunt époux l’avait été dans son intérêt exclusif, et d’autre part, la clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant a effectivement été mise en œuvre. Comme on le voit, cette solution est le fruit de l’application de règles purement matrimoniales et non successorales : renoncer à la succession du prémourant, comme la veuve avait d’ailleurs pris la précaution de le faire ici, n’y changera donc rien.
Cette décision rassurera les créanciers qui n’avaient pas pris la précaution d’exiger le consentement du conjoint, ainsi que la doctrine qui craignait que ces derniers ne soient sacrifiés sur l’autel de la protection de la communauté. Elle incitera sans doute également les praticiens à modérer l’enthousiasme des époux souvent enclins à adopter, comme c’était le cas dans cette affaire, une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale à la faveur d’un changement de régime matrimonial. Il est bien sûr humain de vouloir optimiser la transmission de l’actif pour protéger le survivant, mais le passif, cet arrêt nous le rappelle, se transmet aussi fort bien !
Nadège MOULIGNER
Sorts des dettes contractées « dans le cadre de la gestion d’une entreprise » en cas de divorce (Cass. 1re civ., 5 sept. 2018, n° 17-23120, FS-PB).
1. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 5 septembre 201831 est certes un peu ancien pour figurer dans les colonnes de cette chronique mais il mérite néanmoins qu’on lui consacre quelques développements car c’est dans cette décision que la Cour de cassation se trouve confrontée, pour la première fois, à l’application de l’article 1387-1 du Code civil, texte issu de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et dont les dispositions furent, dès son entrée en vigueur, durement critiquées par la doctrine32.
Rappelons d’emblée que selon ce texte, « lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d’une entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d’en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l’entreprise ».
2. Dans cette affaire, deux époux communs en biens avaient acquis au cours de leur union un fonds de commerce qui fut ensuite exploité par le mari sous la forme d’une entreprise individuelle avec l’aide de son épouse, alors déclarée en tant que « conjoint collaborateur ». Le partage des intérêts patrimoniaux, consécutif au divorce de ces époux, donna lieu à difficultés et le fonds fut finalement attribué au mari à charge pour lui de supporter toutes les dettes afférentes à l’entreprise.
N’acceptant pas de devoir supporter seul l’entier passif d’une entreprise dépourvue de valeur, le mari saisit la Cour de cassation. Le deuxième moyen de son pourvoi (le seul susceptible d’entraîner cassation) faisait grief à l’arrêt confirmatif de n’avoir donné « aucun motif » à l’appui de cette « condamnation » ; ainsi la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1387-1 du Code civil.
Ce moyen n’eut pas le succès escompté. Pour la première chambre civile, la cour d’appel a légalement justifié sa décision au regard des éléments relevés dans sa décision et dont elle a pu déduire « souverainement » que l’ex-mari devait supporter seul l’entier passif de l’entreprise.
En l’espèce, les juges du fond avaient retenu d’une part, que le patrimoine professionnel de l’entreprise avait été attribué au mari « selon l’accord des parties » et d’autre part, plusieurs éléments attestant, si l’on peut dire, de la mauvaise gestion du mari : passif largement supérieur aux actifs de l’entreprise, prélèvements personnels du mari disproportionnés au regard de la situation financière de l’entreprise…
3. Appréciation souveraine des juges du fond. Au-delà de l’obligation pour les juges du fond de motiver leur décision, l’apport de l’arrêt du 5 décembre 2018 tient à ce que les circonstances qui permettent de faire supporter l’entier passif de l’entreprise à son attributaire sont appréciées souverainement par les juges du fond.
Il pouvait difficilement en être autrement, si l’on s’en tient à la lettre de l’article 1387-1 qui ne conditionne l’attribution du passif qu’à trois conditions objectives : un divorce, l’existence de dettes ou sûretés « consenties (…) dans le cadre de la gestion d’une entreprise » et la conservation du « patrimoine professionnel » par l’un des époux.
L’objectif poursuivi par les rédacteurs de l’article 1387-1 était limité : « protéger » l’ex-conjoint de l’entrepreneur en liant le passif d’une entreprise à son attribution, sans même tenir compte de la logique du droit des contrats et du droit des régimes matrimoniaux ou même envisager les répercussions que de telles dispositions pourraient avoir vis-à-vis des créanciers de l’entreprise.
4. Obligation ou contribution aux dettes professionnelles ? Comme le relèvent la plupart des commentaires publiés au sujet de cette décision, la Cour de cassation aurait pu, à l’occasion de cette affaire, donner quelques indications quant à la portée de l’article 1387-1 qui ne précise pas si le fait de « faire supporter la charge exclusive » des dettes professionnelles à l’un des ex-époux concerne l’obligation ou la contribution aux dettes professionnelles. Il est vrai qu’en l’espèce le litige ne portait que sur les rapports entre les époux (et donc la contribution aux dettes) et non les rapports entre les époux et les créanciers de l’entreprise (et donc l’obligation aux dettes).
Il faudra donc faire preuve de patience, même si l’on peut supposer, ou comme certains auteurs, déduire du silence de la Cour de cassation, que la décharge de passif prévue par l’article 1387-1 ne peut viser que la contribution à la dette.
Thierry LÉOBON
IV – Régimes matrimoniaux : dissolution et ses conséquences
Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. Par conséquent, à l’occasion d’un divorce, la liquidation englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris ceux du temps où ils étaient concubins (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-14150, PB).
1. Compétence exclusive du juge aux affaires familiales. L’arrêt du 30 janvier 2019 rendu à propos de la séparation de biens apporte une précision utile en matière de procédure à l’occasion d’un divorce. On se souviendra que depuis la loi de 200933, le juge aux affaires familiales (JAF) s’est vu attribuer une compétence assez étendue pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des couples, qu’ils soient mariés ou non34.
Dans l’affaire traitée, pour rejeter la demande du mari au titre de créances antérieures au mariage, l’arrêt d’appel reconnaît l’incompétence de ce juge pour statuer sur l’indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale. Par conséquent, ces créances n’ont pas vocation à être intégrées dans les comptes de la liquidation du régime matrimonial.
2. Cette interprétation ne résiste pas à la cassation. Le JAF, juge spécialisé, traite de toutes les questions patrimoniales qui peuvent se poser dans un couple, quel qu’il soit35. Ainsi dans notre cas, les époux avaient connu une période de concubinage avant de se marier. Point d’importance puisque le JAF peut être saisi pour des difficultés liées à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des couples non mariés. Une fois le couple marié, le JAF demeure compétent pour connaître des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux36. Or c’est le régime matrimonial qui fixe la propriété de l’ensemble des biens, y compris ceux acquis antérieurement au mariage ou qui détermine l’existence d’une éventuelle créance entre époux37.
S’agissant de l’indivision, là encore, le JAF est tout spécifiquement chargé de celle existant entre partenaires ou concubins38 et la référence « au partage des intérêts patrimoniaux des époux »39 permet de soumettre à sa compétence le partage de toutes les indivisions existant entre les époux, quelle qu’en soit l’origine, antérieure au mariage ou née en cours d’union.
3. Cette concentration du contentieux patrimonial entre les mains du JAF est opportune car elle évite les incertitudes quant à la saisine du juge. D’ailleurs cette compétence spéciale n’est pas subordonnée à la séparation du couple. Les difficultés liées à la liquidation d’une indivision entre époux séparés de biens ou concubins en cours d’union relèvent de ce même juge alors même qu’aucune procédure de divorce ou de séparation n’a été enclenchée40.
4. Liquidation globale. Cette compétence exclusive, sous réserve de celle du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles41, permet surtout d’avoir une liquidation globale de la situation patrimoniale du couple. C’est ce que rappelle la première chambre civile en précisant que « la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et qu’il appartient à l’époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l’établissement des comptes s’y rapportant ».
En d’autres termes, il revient au JAF de dénouer l’enchevêtrement de tous les intérêts patrimoniaux nés d’une vie commune d’abord en tant que concubins puis de personnes mariées. Il devient ainsi « un guichet unique »42 qui en théorie satisfait. En a-t-il les moyens en pratique ? C’est une autre affaire…
Gulsen YILDIRIM
Pour caractériser le recel, les juges du fond doivent examiner les relevés de comptes bancaires avant le mariage et à la dissolution de celui-ci, ainsi que les relevés intermédiaires produits par l’époux (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-10212).
1. Rappel des conditions du recel. Sanctionnant tout comportement dont l’objectif est de porter atteinte à l’égalité dans le partage, le recel de communauté prive l’époux coupable de sa portion sur les effets de communauté détournés ou recelés. Comme l’a indiqué le doyen Cornu, l’article 1477 du Code civil « applique au receleur la loi du talion en lui faisant subir, dans le partage, l’inégalité dont il voulait profiter »43. Face à une telle sévérité, la qualification de recel exige la preuve d’un élément matériel qui consiste en la soustraction d’un bien de la masse commune et d’un élément intentionnel qui suppose une intention frauduleuse.
Dans notre affaire, tout portait à croire que ces conditions étaient satisfaites. En effet, l’épouse avait procédé, entre le 25 août et le 2 septembre 2009, soit peu de temps avant l’ordonnance de non-conciliation du 2 novembre suivant, au virement sur son compte courant de sommes importantes appartenant à la communauté pour un montant de 47 204, 03 € et en émettant immédiatement des chèques pour un total de 45 893 €, suivi d’un retrait de 1 000 €. Elle ne fournissait aucune explication, ni aucun justificatif des destinataires des chèques ou de l’usage des retraits pour une somme aussi importante et elle ne démontrait pas en quoi les nécessités de la vie courante et les besoins de l’enfant rendaient indispensables des dépenses aussi considérables. Le fait qu’elle n’ait pas mentionné le montant litigieux au titre de l’actif manifestait son intention de soustraire ces sommes du partage.
Pourtant l’arrêt retenant le recel est cassé. En effet, les juges auraient dû, même sommairement, examiner les relevés de comptes bancaires avant le mariage et à la dissolution de celui-ci, ainsi que les relevés intermédiaires produits par l’épouse à l’appui de sa prétention.
2. La preuve du caractère commun du bien détourné ou recelé. Le fait matériel nécessaire pour caractériser le recel de communauté doit aboutir à réduire la masse commune. Ainsi entendu, le recel ne peut exister si aucun bien commun n’a été détourné ou recelé. En reprochant aux juges de ne pas avoir examiné les relevés de comptes, la première chambre civile exige de vérifier si les sommes prélevées n’étaient pas propres car le recel ne sera jamais constitué si l’époux prétendument receleur dissimule un bien qui s’avère ultérieurement être pour lui un bien propre.
Y compris dans le recel, la détermination du caractère propre ou commun des biens s’effectue selon les règles du régime légal. Or, sur ce point, la décision surprend à première vue. La présomption de communauté est d’une redoutable efficacité pour les deniers figurant sur un compte bancaire. En effet, sauf preuve contraire, le solde d’un compte quel qu’il soit doit figurer dans l’actif de la communauté44 et la nature propre des fonds versés ne peut être déduite du seul fait qu’ils provenaient d’un compte personnel. D’ailleurs, s’agissant de sommes propres versées sur un compte personnel, la présomption de communauté risque de contaminer le compte tout entier, dès lors que des sommes communes y sont inscrites.
Par principe, l’époux peut revendiquer une récompense mais la preuve dépendra de la nature du compte. Certes selon une jurisprudence bien établie, il n’est plus nécessaire de prouver que la communauté s’est enrichie ou a tiré profit des deniers propres, l’encaissement suffit à faire naître le droit à récompense45 mais ce profit ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux46.
Tous ces éléments incitaient à penser que les sommes prélevées par l’épouse étaient bien communes.
3. Combinaison avec les règles de preuve du recel. On assiste néanmoins à un télescopage entre les règles de preuve de la communauté avec celles du recel. S’agissant de ce dernier, par principe, la bonne foi se présume. Par conséquent, il appartient à celui qui se prétend victime d’un recel de rapporter la preuve non seulement de la réalité des éléments matériels mais encore de l’intention frauduleuse 47. Or l’examen des relevés de compte aurait pu révéler l’existence d’une épargne antérieure au mariage. Dans ce cas, le prélèvement de l’épouse aurait pu être interprété comme une reprise de ces sommes, sans avoir réellement l’intention de rompre l’égalité dans le partage.
Le fait que les juges n’aient pas pris la peine de regarder ces documents génère inévitablement un doute. Or en matière de recel, le doute profite au prétendu receleur. Est donc sanctionnée dans cette décision la négligence des juges car un examen même sommaire, comme le précise la Cour de cassation, aurait suffi à lever ce doute.
Gulsen YILDIRIM
Liquidation judiciaire et partage au cours d’une indivision post-communautaire (Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-27272)48.
1. Après le divorce de deux époux communs en biens, l’un d’entre eux fut placé en liquidation judiciaire et c’est durant l’indivision post-communautaire que le liquidateur, autorisé par le juge-commissaire, procéda à la « cession » du fonds de commerce que les ex-époux avaient acquis au cours de leur union.
Afin que lui soit versée la moitié du prix fonds cédé, l’ex-épouse assigna le liquidateur devant le tribunal de commerce. En défense, ce dernier souleva une exception d’incompétence car, pour lui, l’action de l’ex-épouse devait s’analyser en une demande de partage judiciaire relevant de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales.
En appel, l’exception d’incompétence fut à nouveau rejetée au motif que les anciens époux avaient déjà procédé au partage amiable de tous leurs intérêts patrimoniaux.
Les juges d’appel n’ayant cependant pas pris en considération le fait que la liquidation judiciaire était en cours au moment du prétendu partage amiable, la cassation devait être prononcée. En effet, placé en liquidation judiciaire, l’ex-époux était dessaisi du pouvoir d’administrer et de disposer de ses biens et ne pouvait pas, par conséquent, consentir à un partage amiable.
2. Principe et portée du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire. Rappelons que de son prononcé jusqu’à sa clôture, la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur. Ses droits et actions « concernant son patrimoine » sont alors en principe « exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur »49.
Le droit de consentir à un partage ne fait pas partie des droits dont le débiteur en liquidation judiciaire conserve l’exercice puisqu’il ne s’agit pour lui ni d’un « droit propre » ni d’un « droit exclusivement attaché à sa personne » ou encore, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, d’un droit « non compris dans la mission du liquidateur »50.
La solution n’est pas vraiment nouvelle puisque la première chambre civile applique ici au partage de l’indivision post-communautaire une solution déjà retenue par la chambre commerciale à propos d’un partage successoral51. Un partage amiable auquel serait intervenu personnellement un débiteur en liquidation judiciaire ne serait pas nul mais seulement inopposable à la procédure collective52.
3. Cession ou licitation-partage du fonds indivis ? Ce qui paraît plus surprenant dans cette affaire c’est le fait que la cession du fonds de commerce indivis par le liquidateur ait pu être autorisée par le juge-commissaire. Rappelons à nouveau que dans le cas présent, la liquidation judiciaire est intervenue au cours de l’indivision post-communautaire. Il convenait donc ici d’appliquer les règles posées par des deuxième et troisième alinéas de l’article 815-17 du Code civil et non par le premier alinéa de ce texte. Le liquidateur n’a pas le pouvoir de demander au juge-commissaire de l’autoriser à vendre ce que le débiteur ne peut pas lui-même céder, tout au moins sans l’accord de son ex-conjoint devenu coïndivisaire53.
Dans ce cas de figure, le liquidateur ne peut agir qu’en licitation-partage soit en usant des droits du débiteur dessaisi, en application de l’article 815 du Code civil, soit en usant des droits de ses créanciers, cette fois-ci en application du troisième alinéa de l’article 815-17 du même code. On notera à ce propos que les fonds provenant d’un tel partage n’entrent dans l’actif de la procédure collective que dans la proportion des droits du débiteur défaillant54.
Bien sûr, la solution aurait été différente si la procédure de liquidation judiciaire avait débuté avant la retranscription du jugement de divorce. Si le fonds avait été cédé par le liquidateur avant que le divorce ne soit opposable à la procédure collective, il n’aurait pas été nécessaire de recueillir le consentement du conjoint du débiteur, alors même que l’article 1424 du Code civil prévoit que les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner un fonds de commerce dépendant de la communauté. L’on sait en effet que dans ce cas « les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint in bonis en vertu des articles 1421 et suivants du Code civil ne peuvent plus s’exercer »55.
Thierry LÉOBON
Le traitement d’un « compte d’exploitant » dans le calcul du patrimoine final de l’entrepreneur individuel marié sous le régime de la participation aux acquêts (Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-26222, F-PB).
1. Lorsque divorcent deux époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts et que l’un d’entre eux exploite un fonds de commerce, faut-il tenir compte, dans le patrimoine final de ce conjoint, du solde créditeur de son compte d’exploitant ? C’est précisément à cette question que l’arrêt rendu le 7 novembre dernier par la première chambre civile de la Cour de cassation56 apporte une réponse claire mais laconique.
Pour la cour d’appel, d’abord confrontée à cette question, il n’y avait pas lieu de tenir compte des sommes inscrites au compte d’exploitant car celles-ci « ont été utilisées pour l’entreprise et ne sont plus disponibles », d’autant plus, toujours selon la cour d’appel, que ces sommes n’auraient pu être récupérées, en l’espèce, « que par prélèvement sur le produit de la vente du fonds ».
C’est au visa des articles 1572, alinéa 1er, et 1574 du Code civil que cette décision est censurée. Pour la Cour de cassation, la somme figurant au solde créditeur du compte de l’exploitant lui appartient et doit par conséquent « être retenue pour la détermination de la consistance de son patrimoine final et son évaluation… ».
2. Prise en compte à l’actif du compte de l’exploitant. Le raisonnement suivi par la Cour de cassation est a priori imparable puisque le solde créditeur du compte de l’exploitant constitue bel et bien un actif de l’entrepreneur individuel. En effet, selon le plan comptable général, le compte de l’exploitant (compte 108) enregistre en cours d’exercice les apports ou les retraits personnels de l’exploitant et en fin d’exercice, le solde de ce compte est viré au compte 101 « capital individuel »57.
3. Prise en compte au passif du compte de l’exploitant. Le raisonnement suivi par la cour d’appel dont l’arrêt est censuré n’est cependant pas foncièrement erroné au plan comptable puisque le solde créditeur de ce compte trouve sa contrepartie à l’actif de l’entreprise ; même si celle-ci est diffuse (les fonds apportés en compte par l’entrepreneur financent les actifs immobilisés et/ou les actifs circulants inscrits au bilan de l’entreprise). Mais un raisonnement comptable n’est pas un raisonnement juridique.
Comment alors appréhender juridiquement le fait que si le compte de l’exploitant est bien un actif de l’ex-époux, il n’en demeure pas moins inscrit au passif du bilan de l’entreprise individuelle ?
Il ne faut pas perdre de vue qu’une entreprise individuelle ne dispose pas de la personnalité juridique et que seul l’entrepreneur est titulaire d’un patrimoine. Cela signifie que le compte de l’exploitant est à la fois un actif et un passif de l’entrepreneur ; bref, le compte d’exploitant n’est qu’une abstraction comptable.
Autrement dit et en définitive, si le solde créditeur du compte d’exploitant doit bien être retenu, pour la détermination de la consistance et l’évaluation du patrimoine final, c’est à la fois en tant qu’actif et en tant que passif.
On notera pour en terminer que la solution est toute autre lorsqu’un époux qui exploite une entreprise sous une forme sociale dotée de la personnalité juridique est titulaire d’un compte courant d’associé. Paradoxalement, les choses sont beaucoup plus simples dans ce cas car la valeur des droits sociaux (parts sociales ou actions) de ce conjoint, qui doit être prise en compte dans l’évaluation de son patrimoine final, est très souvent déterminée à partir de l’actif net corrigé de la société et donc déduction faite des dettes de la société, en ce compris d’éventuels comptes courants d’associés.
Thierry LÉOBON
V – Libéralités : notion et conditions de validité
La modicité du prix de cession de parts sociales ne permet pas à elle seule d’établir l’intention libérale du disposant (Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 18-10234).
1. Le litige est né à la suite du divorce de deux époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Plus précisément, le partage des intérêts patrimoniaux de ces ex-époux posait difficulté car l’ex-mari contestait l’entrée en communauté de la valeur de parts de SCI que sa mère lui avait cédées, pendant le mariage, pour le prix d’1 €. Pour lui, l’acte de cession devait être requalifié soit en donation déguisée, soit en donation indirecte.
La cour d’Aix-en-Provence lui ayant donné tort, l’ex-mari saisit la Cour de cassation. Dans son pourvoi, celui-ci reprochait aux juges du fond d’avoir dénaturé les termes du litige en retenant que la preuve d’un déguisement n’avait pas été rapportée alors qu’il ne sollicitait pas uniquement la requalification de l’acte de cession en donation déguisée mais aussi en donation indirecte, ce qui ne nécessitait en rien la preuve d’une simulation.
Le pourvoi reprochait également à la cour d’appel de ne pas avoir pris en considération différents éléments établissant que le prix des parts sociales était très largement inférieur à leur valeur réelle ; ce qui, selon l’auteur du pourvoi, caractérisait l’existence d’une donation indirecte.
La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Pour les hauts magistrats, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en estimant que l’intention libérale de la mère de l’ex-mari n’était pas établie ; la modicité du prix de cession « ne pouvant suffire à la définir ».
2. Une décision sans surprise. La décision rendue par la première chambre civile est des plus classiques. Rappelons que l’intention libérale qui caractérise toute libéralité, et donc aussi bien les donations déguisées que les donations indirectes, ne se présume pas et doit être établie par celui qui revendique le bénéfice de la libéralité58. Rappelons également que l’intention libérale se prouve par tous moyens et que les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuves qui leur sont soumis59.
Concrètement, et si l’on s’en tient à la conception abstraite de l’intention libérale (qui ne tient pas compte des mobiles du disposant), l’ex-mari aurait dû démontrer que la cédante (sa mère) avait eu conscience, au moment de la transmission des parts, de percevoir un prix inférieur à leur valeur réelle et donc de s’appauvrir à son profit.
3. La modicité du prix et la preuve d’une donation. La modicité du prix de cession d’un bien permet d’établir l’élément matériel d’une donation quand elle traduit un déséquilibre entre les engagements réciproques des parties ou un appauvrissement de l’une et un enrichissement de l’autre.
Cependant, et abstraction faite d’un arrêt pour le moins ambiguë sur ce point60, les juges du fond ne peuvent déduire l’élément intentionnel de la donation « du seul déséquilibre constaté entre les engagements respectifs des contractants » sous peine de cassation pour manque de base légale61.
Si la modicité du prix n’établit pas ipso facto l’intention libérale du disposant, elle peut néanmoins, et tout particulièrement lorsque l’acte litigieux est intervenu entre proches parents, être l’indice de l’animus donandi. Rappelons, pour s’en convaincre, que la première chambre civile de la Cour de cassation a admis, il n’y a pas si longtemps, qu’une cour d’appel ait pu retenir, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, « que la sous-évaluation systématique du montant des transactions intervenues (…) et le caractère occulte des avantages ainsi consentis » démontraient la « volonté manifeste des époux X de gratifier » l’une de leurs filles62.
Thierry LÉOBON
La révocation de l’acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée lorsque les infractions n’ont pas été commises au préjudice des donateurs mais de sociétés dans lesquelles ils avaient des intérêts (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-10091 (98 F-PB)).
1. Préjudice subi non par le donateur mais par un tiers. La révocation pour ingratitude constitue la sanction du devoir de reconnaissance qui pèse sur le donataire. Toutefois l’article 955 du Code civil adopte une approche restrictive de l’ingratitude en énumérant de manière limitative trois types de comportements qui sont l’attentat à la vie du donateur, les sévices, délits et injures graves et le refus d’aliments. Dans l’arrêt du 30 janvier 201963, la question n’était pas de déterminer le comportement représentatif d’une ingratitude mais plutôt de caractériser la victime potentielle.
En l’espèce, le fils avait reçu par donation-partage la nue-propriété des actions d’une société constituée par son père. Ce même fils avait été condamné pour abus de biens sociaux, abus de confiance et complicité d’abus de confiance au préjudice de cette société. Les parents invoquent l’ingratitude pour obtenir la révocation de la libéralité alors que la victime du comportement du fils n’était autre que la société. On était donc en présence d’une « sorte d’ingratitude par personne interposée (la société) »64. Les juges d’appel estiment pourtant que le fils avait manqué à son obligation de reconnaissance envers ses parents qui l’avaient gratifié et prononcent la révocation de la donation.
La première chambre civile casse sur ce point. En effet, « la révocation d’un acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis à l’encontre du donateur ». En conséquence, la révocation est exclue lorsque les infractions n’ont pas été commises au préjudice des donateurs mais de sociétés dans laquelle ils avaient des intérêts.
2. Cette interprétation est conforme à la lettre du texte de l’article 957, 2°, qui précise « s’il s’est rendu coupable envers lui de (…) délits ». Autrement dit, pour être source de révocation, le délit doit être commis à l’encontre de l’auteur de la libéralité.
La haute juridiction avait déjà eu l’occasion de rappeler que l’ingratitude ne pouvait être retenue même si la société était détenue en pleine propriété par le donateur65. A fortiori, il en allait de même lorsque les parents avaient conservé l’usufruit des actions. La raison en est simple. La révocation d’une donation pour ingratitude fait figure d’exception au principe d’irrévocabilité spéciale des donations et, comme toute exception, elle doit être entendue strictement.
3. Rappel sur le délai d’exercice de l’action. Dans la même décision, la première chambre civile rappelle une précision sur le délai d’exercice de l’action en révocation. L’article 957 prévoit pour faire la demande un délai préfix d’un an66 « à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur ». S’agissant d’une infraction pénale, le point de départ d’exercice de l’action est retardé jusqu’au jour où l’existence de cette infraction a été reconnue par une juridiction pénale67.
En l’espèce, l’action des parents pouvait être exercée jusqu’au jour où la condamnation pénale établissant la réalité d’abus de biens sociaux, d’abus de confiance et de complicité d’abus de confiance est devenue définitive, « sans avoir à constater que le délai d’un an n’était pas expiré lors de la mise en mouvement de l’action publique dès lors que ce point n’était pas discuté ».
Ainsi, plus que la forme, c’est le fond qui justifiait la cassation de la décision d’appel.
Gulsen YILDIRIM
Révocation d’une donation d’œuvre d’art pour inexécution des charges (Cass. 1re civ., 16 janv. 2019, n° 18-10603).
L’interdiction de vendre dont est assortie la donation d’œuvres ne relevant pas du droit moral dévolu aux seuls descendants de l’artiste, le conjoint survivant peut, en sa qualité d’héritier, agir en révocation de la libéralité pour inexécution de la charge.
Faits et procédure. Un artiste consent à une association une donation portant sur 14 de ses œuvres en précisant dans une lettre adressée au vice-président de celle-ci, que « ces œuvres ne pourront en aucun cas être revendues et qu’elles ne pourront être utilisées que pour des accrochages ou des expositions à caractère non commercial et non publicitaire ». À son décès survenu 21 ans plus tard, il laisse pour recueillir sa succession son conjoint, bénéficiaire de l’attribution intégrale de la communauté universelle ainsi que de l’usufruit spécial de ses droits patrimoniaux d’auteur, et leurs 5 enfants, recevant la nue-propriété desdits droits et le droit moral de l’artiste. Ayant appris qu’une des œuvres données allait être vendue aux enchères publiques sur saisie d’un créancier du président de l’association, l’épouse survivante fait procéder avant la vente à une saisie-revendication et ayant découvert par ailleurs que d’autres œuvres avaient été vendues auparavant, elle agit en révocation de la donation pour inexécution des charges. L’action est rejetée par les juges du fond. La cour d’appel estime que la demanderesse est dépourvue de qualité pour agir car les « charges invoquées ne relèvent pas, par leur nature, de la propriété matérielle des supports des œuvres » mais « du droit moral de l’artiste », lequel a été dévolu aux enfants.
Problème de droit : nature des charges. L’épouse survivante ayant formé un pourvoi contre cette décision, la question posée à la Cour de cassation est celle de savoir quelle est la nature des charges grevant la donation des œuvres d’art : l’interdiction de vendre les œuvres données et l’obligation de ne les exposer qu’à des fins artistiques imposées par le donateur relèvent-elles du droit moral de l’artiste, auquel cas leur non-respect ne pourrait être invoqué aux fins d’obtenir la révocation des libéralités que par les seuls descendants du donateur en tant que titulaires du droit moral de leur auteur ou bien à l’inverse, constituent-elles des charges classiques de la donation, pouvant être invoquées par tout héritier du donateur après le décès de celui-ci ?
Solution : charges classiques. La Cour de cassation répond clairement en faveur de la seconde solution, balayant les velléités des juges du fond d’interposer les spécificités des droits de propriété intellectuelle pour faire échec aux règles de droit commun des donations. On rappellera que doivent être distingués en cette matière les droits patrimoniaux de l’auteur, lesquels consistent dans les droits d’exploitation des œuvres, des droits extrapatrimoniaux de l’auteur, lesquels correspondent aux droits moraux de l’artiste, dont le droit de divulgation constitue l’un des attributs, et qui sont exercés après son décès en priorité par ses descendants68.
Analyse des conditions de la donation. En l’espèce, la cour d’appel a considéré que l’interdiction de revente des œuvres et les modalités de leur exposition imposées par le de cujus constituent des conditions de divulgation de ses œuvres fixées par l’auteur et que, partant, leur respect relève du seul droit moral de l’artiste, dont ses descendants sont les titulaires uniques à son décès. C’était faire une confusion entre les notions – propriété matérielle des tableaux et propriété intellectuelle de l’œuvre69 – et les règles applicables. L’artiste donateur les ayant érigées en conditions de la libéralité par lui consentie, elles relevaient des seuls articles 953 et 954 du Code civil permettant à tout héritier du de cujus d’en invoquer le non-respect à des fins révocatoires.
Pour sa part, l’interdiction d’aliéner est une charge courante grevant les donations, laquelle ne peut être levée que par le donateur tant qu’elle est justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Le seul particularisme des œuvres artistiques conduisant sans doute à devoir admettre que la justification d’une telle charge puisse ne jamais être remise en cause, celle-ci étant attachée de manière indéfectible au bien en raison de la nature de celui-ci. C’est sans doute en cela qu’interfère le droit moral de l’artiste – protégé à son décès par ses descendants – qui peut légitimement s’opposer à ce que son œuvre passe avantageusement de mains en mains. Quant à l’obligation de n’utiliser les œuvres données que pour des expositions artistiques, le seul fait qu’elle soit propre aux œuvres d’art ne saurait justifier qu’elle échappe aux règles du droit des libéralités dès lors qu’elle a été érigée par le donateur en condition de la donation.
Nicole PÉTRONI-MAUDIÈRE
Nullité du testament-partage portant sur des biens communs (Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-17493).
« Si les ascendants peuvent partager, par anticipation, leur succession, cette faculté est limitée aux biens dont chacun d’eux a la propriété et la libre disposition et ne peut être étendue aux biens communs (…) ; les dispositions de l’article 1423 du Code civil ne peuvent s’appliquer qu’aux légataires et non aux héritiers, dont les parts doivent être déterminées au moment même du décès de l’ascendant et ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage ultérieur de la communauté ».
Utilité du testament-partage. Le testament-partage est un partage des biens fait par un testateur au profit de ses présomptifs héritiers. Il peut sembler être un moyen intéressant pour des parents souhaitant faire un partage anticipé de leurs biens entre leurs enfants à moindre coût, sans se démunir, avec la possibilité de le révoquer ou de le modifier en cas de changements patrimoniaux ou familiaux et en évitant ainsi bien des conflits entre leurs héritiers au moment de l’ouverture de leur succession. En théorie, l’idée est donc bonne, mais les chausse-trapes sont en réalité nombreuses. Cet arrêt montre quelques difficultés que peut présenter le testament-partage dans la pratique.
Application en l’espèce. Les époux testateurs avaient pourtant apporté beaucoup d’attention au partage testamentaire de leurs biens. Tout d’abord, ils avaient pris soin de rédiger leurs testaments séparément, se protégeant ainsi du couperet de la nullité du testament conjonctif70. Ensuite, le contenu des testaments rédigés par chacun d’eux était identique, ce qui permettait d’éviter les dispositions contradictoires. Cela n’a pas suffi pour échapper à l’invalidation des testaments. En effet, dans leur volonté de partager tous leurs biens entre leurs enfants, ils n’ont pas évité le piège des legs portant sur les biens de la communauté existant entre eux. Une autre difficulté était que dans un des testaments successifs rédigés, ils avaient légué la quotité disponible de leur succession à deux de leurs enfants.
Impossibilité d’inclure des biens communs. Une des différences essentielles entre un testament ordinaire et un testament-partage est la possible inclusion de biens communs – il en est de même des biens indivis – admise dans le premier et non dans le second. La justification en est simple bien que technique : lorsqu’un époux consent dans un testament ordinaire des legs de biens communs dans la limite de sa part dans la communauté71, les modalités d’exécution de ceux-ci dépendront des résultats du partage ultérieur de la communauté, selon que le bien tombera dans le lot des héritiers du testateur (exécution en nature) ou dans celui de son conjoint (exécution en valeur). En revanche, le testament-partage ne peut porter sur des biens communs en raison de sa nature d’acte répartiteur et non dévolutif. Parce qu’il opère le partage des biens qui en sont l’objet, ce partage doit être effectif au jour du décès du testateur. Il ne saurait dépendre des résultats du partage de la communauté qui sera nécessairement postérieur (en ce sens, la doctrine majoritaire et la jurisprudence72). La solution est d’autant plus gênante qu’elle ne peut être contournée par la rédaction d’un testament-partage conjonctif (rédigé ensemble par les deux époux) puisque le testament conjonctif est prohibé73. C’est aussi une différence essentielle avec l’autre forme de libéralité-partage, la donation-partage, qui peut comprendre des biens communs avec le consentement du conjoint74 et qui peut aussi être conjonctive (rédigée par les deux ascendants dans un seul acte) ou cumulative (opérée par le survivant des ascendants et portant sur l’ensemble du patrimoine – biens donnés par lui et biens hérités par les descendants) et donc comprendre la totalité des biens du couple.
Impossibilité d’inclure des biens propres du conjoint. Au surplus, tandis que le testament-partage ne peut avoir pour objet que des biens dont l’auteur est personnellement propriétaire – question qui était en outre posée dans l’affaire commentée, l’époux ayant inclus dans son testament des biens propres de son conjoint –, la donation-partage présente l’avantage indéniable de permettre aux disposants de fondre en une seule masse l’ensemble des biens – propres de chacun des époux et communs – en vue d’en opérer un partage global entre les descendants.
Qualification. L’autre fragilité du testament-partage, autrement plus prégnante, est la question de sa qualification. Celle-ci est en effet l’objet principal des contentieux portés par des héritiers qui se préféreraient légataires pour ne pas se voir imposer cet acte directif. La difficulté vient tout d’abord de ce que le testateur qualifie rarement le testament qu’il rédige. Quoi qu’il en soit, il doit manifester sa volonté d’imposer le partage opéré à ses héritiers présomptifs, autrement, il ne procéderait qu’à des legs d’attribution, en principe rapportables. Ensuite, se pose la question de l’objet du testament-partage. Le partage peut porter sur tout ou partie de la succession du testateur mais le fait de porter sur la totalité ou la majeure partie de celle-ci peut être un critère pour préférer la qualification de testament-partage75. De même, la jurisprudence a imposé pendant longtemps l’égalité entre les héritiers76, avant d’admettre la possibilité d’un partage inégal dès lors que le testateur n’avait pas l’intention d’avantager un de ses héritiers77. Dans le présent arrêt, elle semble bien avoir finalement admis que certains descendants peuvent être avantagés au moyen du legs de la quotité disponible.
Devant le risque accru de contentieux, doublé de l’incertitude quant à la qualification qui en sera retenue par les tribunaux, on ne peut qu’être particulièrement prudent sur l’usage de cet instrument d’anticipation successorale.
On finira par une remarque inspirée de l’espèce, portant sur l’invalidation des testaments successifs. En effet, seuls les premiers testaments contenaient le partage des biens des ascendants, les testaments suivants apportaient une modification concernant un bien et les derniers testaments, tout en confortant le partage opéré dans les testaments antérieurs, contenaient des legs de la quotité disponible des testateurs au profit de certains de leurs descendants. Pour sauver lesdites dispositions, ceux-ci faisaient valoir devant la Cour de cassation qu’elles émanaient d’un testament ordinaire. La haute juridiction a balayé l’argument au motif que l’analyse des différents testaments devait être globale et qu’il en résultait une qualification de testament-partage pour tous. Là encore, il convient d’être particulièrement méticuleux dans la rédaction des testaments afin d’éviter des annulations en cascade réduisant à néant la volonté des testateurs.
Nicole PÉTRONI-MAUDIÈRE
VI – Successions : vocation ab intestat et ordre public successoral
A – Successions, dévolution légale, droit viager au logement
La volonté de bénéficier du droit au logement prévu par l’article 764 du Code civil peut être tacite (Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-10171, FS-PB).
Cela va sans dire. L’article 764 du Code civil78 institue au bénéfice du conjoint survivant successible un droit d’habitation sur le logement que lui-même occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale. Et l’article 765-1 énonce que ce conjoint « dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d’habitation et d’usage ».
Dans l’assignation qu’elle fait délivrer à l’enfant d’un premier lit du défunt, une veuve indique son souhait de conserver « conformément à la loi » l’appartement qu’elle occupe. La cour d’appel juge la formule trop vague pour manifester, dans le délai requis, une volonté de bénéficier du droit d’habitation viager et du droit d’usage sur les meubles meublants.
L’arrêt est opportunément cassé par la première chambre civile, qui énonce à la faveur d’un attendu de principe que « cette manifestation de volonté peut être tacite ». En effet, le texte n’exige aucune formule sacramentelle. C’est donc la volonté du survivant qui doit être scrutée. Or la cour d’appel elle-même a constaté que la veuve s’est maintenue dans les lieux après avoir précisé, dans l’assignation, son souhait de conserver l’appartement, et qu’elle a déclaré, dans le projet d’acte de notoriété inabouti, confirmer sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement. De quoi encourir une inéluctable cassation.
Ce qui va sans dire… On ne peut qu’attirer l’attention de la pratique sur les conditions dans lesquelles un conjoint survivant doit se prévaloir du droit viager, et sur ce grand méconnu que demeure, plus de 17 ans après la réforme qui l’a institué, ce droit réel légal cependant très novateur.
Comme on le constate ici, l’acte de notoriété n’est pas le support idoine. En l’espèce, le beau-fils ayant refusé d’y participer, le choix de la veuve est quelque peu resté en suspens. Cette décision individuelle aurait été plus sûrement recueillie à la faveur d’un acte unilatéral d’option. En voulant la faire figurer, par souci d’économie sans doute, dans un acte inapproprié, le notaire a manqué une occasion de désamorcer un conflit sur l’interprétation de la volonté.
Il est vrai que le droit viager est un incompris. Trop de praticiens le jugent sans intérêt, dès lors que le conjoint survivant bénéficie soit de l’usufruit légal prévu par l’article 757 du Code civil, soit de l’usufruit libéral résultant d’une donation au dernier vivant, selon l’article 1094-1 du même code. C’est une erreur. L’usufruit légal ne résiste pas à l’apparition inopinée d’un enfant méconnu, qui renvoie le conjoint survivant à des droits en pleine propriété, en refermant l’option prévue par l’article 757 du Code civil. Quant à la donation de biens à venir, elle reste à la merci de quelque testament olographe ravageur exhumé d’un tiroir ou d’un coffre. En ce cas, le conjoint qui se croyait à l’abri dans ses pénates est exposé à vider les lieux sans retour. D’où la précaution élémentaire : faisons opter le veuf, dans le délai annal, en faveur de tout : droit viager, droit légal, droit libéral. Tout est bon à prendre. Et cela va encore mieux en le disant !
Bernard VAREILLE
B – La notion d’héritier dans les contrats d’assurance-vie
Le capital de l’assurance-vie souscrite au profit des héritiers doit être réparti à proportion des droits des héritiers déterminés par les dispositions testamentaires du souscripteur (Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, n° 17-23568).
La qualification d’héritier. La question de la portée de la clause par laquelle le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie désigne de manière générique ses « héritiers » comme bénéficiaires revient régulièrement devant les juridictions. Habituellement, les interrogations portent sur la qualification d’« héritier », en particulier lorsque le de cujus laisse des héritiers légaux et testamentaires : faut-il réserver le bénéfice de l’assurance aux premiers ou y associer les seconds, ou bien encore donner la prévalence à ces derniers ? Au fil de ses arrêts, la Cour de cassation a scindé la question entre d’une part la notion d’« héritier » et d’autre part la détermination des héritiers visés par la clause.
La notion d’héritier. S’agissant de la notion d’« héritier », laquelle s’apprécie lors de l’exigibilité du capital, c’est-à-dire au décès du souscripteur, la haute juridiction y a clairement intégré le légataire universel et indirectement le légataire à titre universel79. En leur qualité de continuateurs de la personne du de cujus, tenus ultra vires successionis des charges de la succession, ils sont de véritables successeurs. Mais elle a aussi considéré que l’institution par le souscripteur d’un de ses trois héritiers ab intestat (nièces) comme légataire universel ne pouvait pour autant faire perdre aux autres parents désignés par la loi, leur qualité d’héritier80.
L’intention du souscripteur. La cour régulatrice a ensuite précisé que la détermination des « héritiers » nécessite la recherche de l’intention du souscripteur81, et qu’« il convient (pour ce faire) de ne s’attacher exclusivement ni à l’acception du terme héritier dans le langage courant, ni à la définition de ce terme en droit des successions »82. Ce qui l’a amenée dans le cas de concours entre des héritiers légaux non réservataires et des légataires universels à approuver la cour d’appel d’avoir accordé la prééminence tantôt aux héritiers légaux83, tantôt aux légataires universels84.
Dans la recherche de la volonté rétrospective du souscripteur, un critère semble se dégager en jurisprudence : l’ordre chronologique du contrat souscrit et du testament. Lorsque le testament instituant un légataire universel (ou à titre universel) précède la souscription du contrat, la clause désignant sans autre précision « mes héritiers » s’analyse comme l’intention du souscripteur d’attribuer le bénéfice de son contrat à ses héritiers légaux. Inversement, s’il a institué son légataire universel après la souscription du contrat, il est probable qu’il a pensé plutôt désigner celui-ci85.
La répartition du capital. Une autre question qui se pose et qui est consubstantielle aux précédentes, est celle de la répartition du capital-décès entre les héritiers identifiés. C’était l’objet du contentieux porté devant la Cour de cassation dans l’arrêt sous analyse. En l’espèce, se trouvaient en concours en leur qualité d’héritiers réservataires trois enfants de la souscriptrice dont un avait été institué par ailleurs légataire de la quotité disponible. La cour d’appel avait procédé à un partage à égalité du bénéfice de l’assurance-vie entre les trois héritiers réservataires, retenant que celui-ci est hors succession. Or, l’article L. 132-8 du Code des assurances prescrit la répartition du bénéfice entre les héritiers à proportion de leurs droits héréditaires. En l’occurrence, les deux enfants non-légataires avaient donc droit à leurs parts réservataires, soit 1/4 chacun, tandis que leur cohéritier légataire pouvait prétendre à l’autre moitié (1/4 au titre de la réserve et 1/4 au titre de la quotité disponible).
La censure des juges du fond pour défaut de base légale au regard de l’article L. 132-8 du Code des assurances était donc inévitable. La lecture de la motivation de la Cour de cassation suscite toutefois une réserve : elle leur reproche de ne pas avoir recherché la volonté de la souscriptrice quant à la répartition du capital garanti. On peut admettre la nécessité de rechercher l’intention du souscripteur s’agissant de l’identification de « ses héritiers » en présence de dispositions de dernières volontés, on comprend mal qu’il faille procéder également à une telle recherche pour décider de la répartition du capital-décès entre eux. Une telle extension du domaine de l’interprétation des juges, de nature à ajouter encore un peu plus d’incertitude, serait particulièrement regrettable.
Nicole PÉTRONI-MAUDIÈRE
VII – Successions et libéralités : restitutions successorales, liquidations, et anticipation patrimoniale
A – Successions, action en réduction, action en retranchement, avantage matrimonial, réponse ministérielle
Il est possible de renoncer définitivement par anticipation à l’action en retranchement (Rép. min. n° 12380 : JOAN, 1er janv. 2019, p. 12456, Delpon M.).
Différé d’exercice du retranchement. L’article 1527, alinéa 3, du Code civil permet au réservataire de s’engager, du vivant même du de cujus, à différer l’exercice de l’action en retranchement des avantages matrimoniaux jusqu’au décès du conjoint survivant bénéficiaire. C’est là une liberté intéressante, qui tient compte de l’atmosphère particulière à certaines familles recomposées.
Voici un mari qui a souscrit un régime matrimonial avantageux pour son conjoint. Toutefois, ayant des enfants exclusifs, il sait d’avance qu’après sa disparition, l’avantage matrimonial sera exposé au retranchement, autrement dit à une réduction pour atteinte à la réserve. Or une assez bonne entente règne entre épouse en secondes noces et enfants du premier lit, loin de la sempiternelle malédiction qu’illustrent les contes de fées.
Dans ce cas, il est loisible aux enfants non issus du conjoint en secondes noces de renoncer par avance, mais de façon purement provisoire, à l’exercice de l’action en retranchement86. L’avantage matrimonial sera alors consolidé durant la vie du conjoint survivant. À son décès, en revanche, les réservataires recouvreront la faculté d’agir en retranchement pour réclamer à l’encontre de cette seconde succession une indemnité de réduction dans la succession de leur auteur. Des garanties énigmatiques sont prévues par la loi pour la sécurité de l’opération87.
Compatibilité avec la renonciation anticipée à l’action en retranchement. Cette mesure temporaire bien spécifique, qui retarde la demande en réduction, supplante-t-elle la classique renonciation anticipée à l’action en retranchement ? Autrement dit, la faveur accordée au réservataire de renoncer par anticipation à titre provisoire, interdit-elle implicitement de renoncer à l’action en retranchement pour de bon ?
C’est ce doute que lève la réponse ministérielle, en reconnaissant fort opportunément que la renonciation temporaire n’exclut en rien la renonciation définitive. En effet, quant au fond, pourquoi refuser cette liberté aux enfants non issus du survivant ? Si le beau-fils affectionne sa marâtre, il renonce à agir du vivant de cette dernière ; mais s’il l’adule, que ne pourrait-il abdiquer d’emblée définitivement toute action en réduction ? D’ailleurs, incline à cette analyse la lettre de l’article 1527, alinéa 2, du Code civil, qui autorise à renoncer à la « réduction » de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l’époux survivant. Réduction pour réduction, tout ce qui est dit de la renonciation anticipée pure et simple s’y applique de plano.
L’inverse n’est pas vrai : rien n’autorise à exporter la renonciation anticipée temporaire vers le droit commun88. En effet, elle n’est applicable qu’aux avantages matrimoniaux. Et c’est une exception à la prohibition des pactes sur succession future, justifiée par la situation de recomposition familiale. Si affaiblie qu’elle soit, la prohibition impérative impose une interprétation restrictive de toute exception.
Du bon usage de ces deux renonciations. En pratique, c’est l’importance de l’avantage matrimonial qui suggère, en raison inverse, le choix du modèle de renonciation. On déconseillera de créer un avantage important, ainsi une communauté universelle avec attribution intégrale, sans avoir obtenu des enfants d’un autre lit la renonciation provisoire à l’action. En présence d’un avantage circonscrit, la situation s’accommode plus aisément d’une renonciation anticipée définitive.
Bernard VAREILLE
B – Successions, rapport, don manuel, descendants du successible
Le descendant du successible n’est pas tenu au rapport des dons manuels qu’il a reçus (Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-13236, F-PB).
Seul l’héritier doit le rapport à son cohéritier. Un arrêt d’appel est censuré pour l’avoir oublié. Des parents entendaient donner la même somme à chacun de leurs trois enfants ; simplement, l’un des trois a préféré qu’elle fût remise à ses propres fils et fille. La cour d’appel se contente de ce rappel historique pour décider que les petits-enfants non appelés en doivent le rapport à la succession des grands-parents donateurs.
Inéluctable est la cassation. L’article 847 du Code civil énonce : « Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport ». Certes, en s’effaçant, l’enfant généreux n’avait sans doute pas voulu jouer ce mauvais tour à ses frères et sœurs. Le résultat peut même sembler bien injuste au regard des intentions égalitaires des donateurs, car le don manuel reflue inopinément sur la quotité disponible. Peu importe : rien ne saurait contrevenir aux dispositions légales, car les descendants de l’héritier sont exclus par lui de la succession.
La solution est très classique. Dans une précédente espèce, c’était l’épouse et la fille d’un enfant que la cohérie avait prétendu obliger à rapporter ce qu’elles avaient reçu, sans plus de succès89. À la vérité, tout cela est bien peu étayé. Il est une fois de plus étonnant que l’on aille jusqu’en cassation pour se faire donner lecture d’un texte aussi limpide.
Vieille histoire. Il est vrai que les abattements fiscaux des années 80 ont suscité un regain de donations de sommes d’argent consenties par les aïeux directement à leurs petits-enfants90.
Un premier inconvénient s’était fait jour en cas de prédécès de l’un des enfants du grand-parent donateur : orphelins, les petits-enfants issus de sa souche devaient le rapport à la succession grand-paternelle par représentation de leur auteur, alors que leurs bienheureux cousins, dont l’auteur était bien vivant, y étaient soustraits. Allez justifier cela ! Issu de la loi du 23 juin 2006, l’article 846 du Code civil a mis bon ordre, en prévoyant : « Le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession, ne doit pas le rapport ». Cela règle le cas des disposants qui n’avaient pas eu la présence d’esprit de stipuler une clause de préciput.
Le second inconvénient est qu’en pareil cas, la recherche d’égalité fait figure de gageure. En effet, si son affection est égale à l’égard de ses petits-enfants, le grand-père songe tout naturellement à dispenser une somme identique à chacun. L’arithmétique de l’abattement fiscal l’y encourage. Pourtant, la logique de souche, qui vient s’interposer, peut conduire tout au contraire à allouer à chacun de ses enfants une part imaginaire, ensuite fractionnée par tête entre les descendants de ce dernier ; en sorte que le petit-fils seul dans sa souche recevrait trois fois plus que ses trois cousins dans l’autre. À vrai dire, aucune des deux solutions ne satisfera tout le monde.
Donation-partage conjonctive transgénérationnelle. Comme chacun le sait, lorsqu’il a instauré la donation-partage transgénérationnelle, le législateur a choisi de faire prévaloir la souche. Ainsi eût-il été facile, dans notre affaire, de désamorcer tout contentieux en allotissant les petits-enfants en lieu et place du fils désintéressé, qui n’aurait pas manqué d’y consentir91. Personne n’aurait dû le rapport. La volonté répartitrice des parents eût été respectée. Somme toute, les dons manuels étant intervenus en 2010, les parents eussent été mieux inspirés de prendre en temps utile le conseil de leur notaire…
Bernard VAREILLE
VIII – Successions et libéralités : transmission successorale et partage
A – Successions, indivision, indivisions sur la nue-propriété de parts sociales, prérogatives des indivisaires
L’indivisaire en nue-propriété de parts sociales peut demander seul la désignation d’un administrateur provisoire de la société (Cass. 3e civ., 17 janv. 2019, n° 17-26695, PB).
Indivision en nue-propriété sur des parts sociales. Au décès de l’associé majoritaire gérant d’une SCI, sa veuve, déjà associée minoritaire, acquiert l’usufruit des parts sociales détenues par le défunt et ses trois enfants deviennent nus-propriétaires en indivision. Au cours d’une assemblée générale à laquelle tous les nus-propriétaires de parts ne sont pas présents, l’un des enfants nu-propriétaire est désigné comme gérant de la société. Cette désignation ne fait pas l’unanimité puisque le frère et la sœur de celui-ci exercent une action en vue d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire de la société. Au cours de l’instance, le frère demandeur cédera ses parts à son frère gérant.
Un associé indivisaire en nue-propriété et ne détenant qu’un tiers de la nue-propriété des parts sociales peut-il demander la désignation d’un administrateur provisoire de la société ? Ne doit-on pas retenir qu’une telle désignation est une mesure grave qui, conduisant à dessaisir le gérant de ses pouvoirs de gestion de la société, ne peut pas être présentée par un seul des indivisaires, au surplus associé minoritaire ? C’était là l’argument essentiel développé par la sœur demanderesse.
Incontestable qualité d’associé du nu-propriétaire en indivision. Il n’est aucunement douteux que le nu-propriétaire de parts sociales a la qualité d’associé et, en cas d’indivision entre nus-propriétaires, tous sont associés et ont par conséquent le droit de participer aux décisions collectives, conformément à l’article 1844, alinéa 1, du Code civil92. Ce point n’était d’ailleurs pas discuté en l’espèce.
Reste alors à fixer les prérogatives attachées à cette qualité, le droit de l’indivision étant susceptible d’affecter l’exercice habituellement exclusif des droits de tout associé93. Le texte du droit de l’indivision dont arguait la société était l’article 815-9 du Code civil : l’exercice des droits tirés de la qualité d’associé doit demeurer compatible avec les droits des autres indivisaires d’user et de jouir du bien indivis conformément à sa destination.
Prérogatives des associés nus-propriétaires. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l’indivisaire insatisfaite par la désignation en assemblée générale de son frère comme gérant unique, « nue-propriétaire indivise de droits sociaux, avait la qualité d’associée, la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’elle était recevable à agir en désignation d’un administrateur provisoire ». Le présent arrêt contribue à préciser la partition entre les prérogatives attachées à la qualité d’associé qui peuvent être mises en œuvre par un indivisaire seul, « dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires »94, et celles qui nécessitent leur intervention collective, par la voix d’un mandataire unique95. Il a été déjà jugé qu’un seul des associés en indivision peut réclamer l’intervention d’un expert de gestion96.
On sait désormais que chacun d’eux, pris isolément peut demander la désignation d’un administrateur provisoire de la société chargé de convoquer une nouvelle assemblée générale.
Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS
B – Successions, indivision, jouissance privative du bien indivis, abus de jouissance d’un indivisaire
Expulsion de l’indivisaire occupant privativement abusivement le bien indivis (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-12403, PB).
La liberté de chacun… Appliquée à l’indivision, la formule trouve un écho direct en matière d’usage et de jouissance du bien indivis. Chacun des indivisaires peut en effet user et jouir des biens indivis conformément à leur destination suivant les termes de l’article 815-9 du Code civil. Cette liberté d’usage et de jouissance se trouve ainsi déjà encadrée par le nécessaire respect de la destination du bien97. En présence d’un usage non conforme à cette destination, le juge peut faire cesser tout comportement devenu fautif, mais également allouer aux autres indivisaires des dommages et intérêts à raison du comportement d’un autre indivisaire. Il s’agit là d’un droit à réparation individuel, qui ne doit pas être confondu avec le droit à réparation pouvant être dû à l’indivision si le comportement de l’un des indivisaires a engendré une perte de valeur du bien indivis98. La réparation du préjudice subi par les autres indivisaires dans l’exercice de leur propre droit d’usage et de jouissance peut être demandée sans attendre le partage99.
Cesse là où celle des autres commence… L’article 815-9 subordonne expressément le droit d’usage et de jouissance du bien indivis reconnu à tout indivisaire au respect des droits concurrents des autres indivisaires. Le droit individuel d’usage et de jouissance doit s’exercer « dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires ». Le présent arrêt, rendu dans une affaire d’indivision post-communautaire consécutive à un divorce, rappelle que le maintien dans les lieux de l’un des indivisaires peut s’avérer, à raison des circonstances dans lesquelles il est exercé, incompatible avec les droits des autres indivisaires100.
En l’espèce, l’ex-épouse occupait l’immeuble indivis sans avoir versé aucune somme au titre de l’indemnité d’occupation, alors même que celle-ci avait été fixée depuis plus de 10 ans ; un jugement ayant ordonné la licitation de ce bien, elle n’avait répondu à aucun des courriers adressés par le notaire lui demandant de procéder ou de le laisser procéder aux diagnostics immobiliers nécessaires ; elle ne s’était pas davantage manifestée auprès de l’huissier de justice qui s’était rendu sur les lieux sans pouvoir la rencontrer. Les juges du fond retiennent que le maintien dans les lieux de l’ex-épouse est incompatible avec les droits concurrents de l’autre indivisaire. Le trouble manifestement illicite est caractérisé. L’ordonnance de référé autorise l’expulsion avec le concours de la force publique à défaut d’évacuation volontaire. Le pourvoi contestant l’existence d’un trouble manifestement illicite est rejeté.
L’arrêt se situe dans le droit fil de la jurisprudence retenant que « tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire, qui ne respectent pas la destination de l’immeuble ou qui portent atteinte à leurs droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d’agir à cet effet »101.
La liberté d’usage et de jouissance cesse lorsque se profile un abus de jouissance.
Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS
Notes de bas de pages
-
1.
V. not. Champenois G., « Quelques observations sur le financement du logement familial indivis par des époux séparés de biens », in Mélanges en l'honneur du professeur Raymond Le Guidec, 2014, LexisNexis, p. 45 et. Karm A., « Financement du logement de la famille et contribution des époux séparés de biens aux charges du mariage », in Mélanges en l'honneur du professeur Raymond Le Guidec, 2014, LexisNexis, p. 98 et s.
-
2.
Cass. 1re civ., 15 mai 2013, n° 11-26933 : Bull. civ. I, n° 94 ; D. 2013, p. 1208 ; D. 2013, p. 2242, obs. Brémond V., Nicod M. et Revel J. ; D. 2014, p. 1342, obs. Lemouland J.-J. et Vigneau D. ; D. 1905, obs. Brémond V., Nicod M. et Revel J. ; AJ fam. 2013, p. 383, obs. Blanc-Pelissier S. ; RTD civ. 2013, p. 582, obs. Hauser J. ; RTD civ. 2014, p. 698, obs. Vareille B. ; Dr. famille 2013, comm. 10, obs. Beignier B. ; RJPF 2013/7-8, n° 19, note Vauvillé F. ; RLDC 2013, p. 107, note crit. Revel J. – Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21892 : Bull. civ. I, n° 189 ; D. 2013, p. 2682, note Molière A. ; D. 2014, p. 1342, obs. Lemouland J.-J. et Vigneau D. ; D. 1905, obs. Brémond V., Nicod M. et Revel J. ; AJ fam. 2013, p. 647, obs. Hilt P. ; RTD civ. 2013, p. 821, obs. Hauser J. ; RTD civ. 2014, p. 698, obs. Vareille B. ; RTD civ. 2014, p. 703, obs. Vareille B. ; Dr. famille 2014, comm. 38, obs. Beignier B. ; Gaz. Pal. 29 oct. 2013, n° 152f0, p. 19, note Casey J. – Cass. 1re civ., 1er avr. 2015, n° 14-14349 ; Cass. 1re civ., 1er avr. 2015, n° 14-13795 et Cass. 1re civ., 1er avr. 2015, n° 14-12938 : D. 2015, p. 1408, obs. Lemouland J.-J. et Vigneau D. ; AJ fam. 2015, p. 297, obs. Casey J. ; RTD civ. 2015, p. 362, obs. Hauser J. ; RTD civ. 2015, p. 687, obs. Vareille B. ; RLDC 2015, n° 56, obs. Jaoul M.
-
3.
Cass. 1re civ., 18 déc. 2013, n° 12-17420 : Bull. civ. I, n° 249 ; D. 2014, p. 527, note Viney F. ; D. 2014, p. 1342, obs. Lemouland J.-J. et Vigneau D. ; D. 1905, obs. Brémond V., Nicod M. et Revel J. ; AJ fam. 2014, p. 129, obs. Hilt P. ; RTD civ. 2014, p. 698, obs. Vareille B. ; RTD civ. 2014, p. 704, obs. Vareille B. ; Dr. famille 2014, comm. 61, obs. Beignier B. ; RJPF 2014/21-20, obs. Égea V. ; Gaz. Pal. 16 sept. 2014, n° 192b3, p. 30, obs. Casey J.
-
4.
Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, n° 17-17457 : AJ fam. 2018, p. 406, obs. Casey J. ; RTD civ. 2018, p. 956 – Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-25858 (912 F-D) : AJ fam. 2018, p. 697, obs. Casey J.
-
5.
Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, n° 17-17457.
-
6.
En ce sens Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n° 13-21005 : les juges d’appel auraient dû rechercher si l’époux « prouvait que sa participation avait excédé ses facultés contributives ».
-
7.
Vareille B., obs. préc.
-
8.
En ce sens Casey J., obs. précitées.
-
9.
V. aussi Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-14571.
-
10.
La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 est intervenue pour définir le concubinage à l’article 515-8 du Code civil. Ce texte dispose : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
-
11.
Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 18-12311, PB : Dr. famille 2019, comm. 40, note Ben Hadj Yahia S. ; RJPF 2019/3, obs. Jaoul M. ; Gaz. Pal. 19 févr. 2019, n° 341y3, p. 20, obs. Mirabail S.
-
12.
La solution est classique et de nombreuses fois affirmée, v., par ex., déjà en ce sens Cass. 1re civ., 19 mars 1991, n° 88-19400 : Bull. civ. I, n° 92 ; RTD civ. 1991, p. 507, note Hauser J. ; Defrénois 15 sept. 1991, n° 35088, p. 942, note Massip J. – Cass. 1re civ., 17 oct. 2000, n° 98-19527 : Dr. famille 2000, comm. 139, note Beignier B. ; JCP G 2001, II 10568, note Garé T. ; D. 2001, p. 497, note Cabrillac R. – Cass. 1re civ., 28 nov. 2006, n° 04-15480 : Dr. famille 2007, comm. 32, note Larribau-Terneyre V. – Cass. 1re civ., 24 sept. 2008, n° 06-11294 : Bull. civ. I, n° 211 ; AJ fam. 2008, p. 431, obs. Chénedé F. ; RTD civ. 2008, p. 660, obs. Hauser J. ; D. 2009, p. 140, note Lemouland J.-J.
-
13.
L’article 214 du Code civil dispose que si les époux n’ont pas eux-mêmes réglé les modalités de leur contribution aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
-
14.
Sur la subrogation automatique s’agissant des biens propres, v. Yildirim G., Encyclopédie Dalloz, V° Communauté légale, actif des patrimoines, n° 69 et s., actualisation janvier 2019.
-
15.
Sur cette distinction en droit patrimonial de la famille, v. Chamoulaud-Trapiers A., Les fruits et revenus en droit patrimonial de la famille, 1999, Pulim, n° 38 et s.
-
16.
Fiorina D., note sous Cass. 1re civ., 25 mai 1987 : Gaz. Pal. Rec. 1988, 2, p. 794.
-
17.
Encore s’agissait-il de plus-values liées à l’activité professionnelle : CA Paris, 8 avril 1869 : D. 1869, 2, p. 236 : « Les 7 000 francs dont la valeur de l’office (office de notaire), c’est-à-dire la clientèle, a augmenté durant l’exercice de L. constituent un acquêt résultant de travaux et d’une application qui, bien que personnels au mari, n’en doivent pas moins tourner à l’utilité commune des époux ».
-
18.
V. déjà en ce sens : Cass. 1re civ., 14 févr. 1984, n° 83-12003 : Bull. civ. I, n° 61 – Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 88-10532 : Bull. civ. I, n° 134 ; RTD civ. 1991, p. 589, obs. Lucet F. et Vareille B.
-
19.
Savatier R., « Des clauses de présomption de propriété dans le régime de séparation de biens », Defrénois 1934, art. 24006 ; Savatier R., « La propriété des acquêts réalisés par des époux séparés de biens », D. 1979, chron. 194. ; Savatier R., « Les clauses pouvant aujourd’hui, dans le contrat de mariage, accompagner le régime de la séparation de biens », Defrénois 1973, art. 30289, p. 417.
-
20.
Parmi les preuves contraires admises, les époux peuvent rédiger une convention en cours de régime reconnaissant à l’un d’eux la propriété personnelle de certains biens. Un tel acte ne constitue pas une convention modificative du régime matrimonial. En ce sens Cass. 1re civ., 30 juin 1993 : D. 1993, IR, p. 212 ; JCP G 1993, IV 2255, p. 272 ; Defrénois 15 déc. 1993, n° 35673, p. 1449, note Champenois G. ; RTD civ. 1993, p. 873, obs. Lucet F. et Vareille B. ; JCP N 1994, II 236, obs. Storck M. ; JCP 1994, I 3733, obs. Storck M. ; JCP N 1994, II 42, note Le Guidec R. et JCP N 1994, II 248, note Desbarats G. – Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, n° 17-26354 : AJ fam. 2019, p. 47 ; RTD civ. 2019, p. 175, obs. Nicod M.
-
21.
Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, n° 17-26713, F-PB : Dr. famille 2019, n° 9, note Beignier B. ; JCP N 2019, act. 852, obs. Bernard S. ; Defrénois 28 mars 2019, n° 147h8, p. 30, obs. Dauriac I. ; RJPF 2019/1, obs. Deschamps V. ; JCP G 2018, doctr. 1355, obs. Tisserand-Martin A.
-
22.
Cass. 1re civ., 31 mars 1987 : JCP N 1988, II 66, Simler P. ; Bull. civ. I, n° 114, arrêt qui énonce que des emprunts faits par le mari auprès de sa famille doivent, faute de preuve contraire, être présumés avoir été employés au bénéfice de la communauté plutôt que des biens propres – Cass. 1re civ., 19 sept. 2007, n° 05-15940 : JCP G 2007, I 208, n° 13, Simler P. ; Bull. civ. I, n° 278 ; D. 2007, p. 3112, note Barabé-Bouchard V. ; D. 2008, p. 2247, obs. Brémond V. ; Defrénois 15 nov. 2008, n° 38854, p. 2207, note Champenois G. ; AJ fam. 2007, p. 438, obs. Hilt P. ; RJPF 2007/11, p. 18, obs. Vauvillé F., arrêt qui décide que l’emprunt souscrit par un seul époux est commun à titre définitif sauf s’il est démontré qu’il a été contracté dans l’intérêt personnel du débiteur – Cass. 1re civ., 8 juill. 2010, n° 09-14230 : JCP N 2011, 1001, n° 17, Simler P. ; Bull. civ. I, n° 166 ; Defrénois 26 févr. 2011, n° 39206, p. 388, obs. Champenois G. ; AJ fam. 2010, p. 436, obs. David S. ; AJ fam. 2010, p. 443, obs. Hilt P. ; Defrénois 30 oct. 2010, n° 39163, p. 2024, obs. Massip G., la dette résultait ici d’un découvert bancaire souscrit par un époux sans l’accord de l’autre.
-
23.
Exclus par principe du champ de la solidarité ménagère de l’article 220 du Code civil (sauf hypothèse exceptionnelle des emprunts ménagers portant sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, et dont le montant cumulé des sommes, en cas de pluralité d’emprunts, n’est pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage), les emprunts sont soumis quant à l’obligation à la dette à l’article 1415 du Code civil. Ce texte limite le droit de poursuite des créanciers aux biens propres et aux revenus de l’époux débiteur lorsque l’un des conjoints a souscrit seul une telle dette.
-
24.
V. par ex., s’agissant de l’acquisition d’un immeuble propre : Cass. 1re civ., 5 nov. 1985 : JCP N 1986, II 97, Simler P. ; Bull. civ. I, n° 284 ; Defrénois 1986, art. 33700, p. 465, obs. Champenois G. ; D. 1987, p. 26, note Le Guidec R. La communauté aura dès lors droit à récompense si elle a financé le remboursement du capital (les intérêts font au contraire partie du passif définitif de la communauté) de l’emprunt.
-
25.
Cass. 1re civ., 14 mars 2012, n° 11-15369 : AJ fam. 2012, p. 290, obs. Briand L.
-
26.
Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 16-13323 : D. 2019, p. 627, obs. Bouchard V. ; Defrénois 28 mars 2019, n° 147j0, p. 33, obs. Dauriac I., RJPF 2019/1 obs. Dubarry J. ; AJ fam. 2019, p. 45, note Houssier J. ; Dr. famille 2019, n° 51, note Torricelli-Chrifi S. ; Gaz. Pal. 2 avr. 2019, n° 346j8, p. 62, obs. Vergara O.
-
27.
Cass. 1re civ., 3 mai 2000 : Bull. civ. I, n° 125 ; D. 2001, Somm., p. 693 obs. Aynès L. ; JCP N 2001, p. 26 note Casey J. ; Defrénois 30 oct. 2000, n° 39171, p. 1185, obs. Champenois G. ; JCP N 2000 p. 1615, note Piedelièvre S. ; JCP G 2000, I 257, n° 5, obs. Simler P. ; D. 2000, p. 546, note Thierry J. ; Dr. famille 2000, n° 88, note Tougne S. ; RTD civ. 2000, p. 889, obs. Vareille B. – Cass. 1re civ., 28 janv. 2003 : Dr. famille 2003, n° 62, note Beignier B. ; JCP N 2003, p. 1603, obs. Casey J. ; JCP G 2004, I 176, n° 17, obs. Simler P. ; RJPF 2003/15, p. 17 obs. Vauvillé F.
-
28.
Uniquement les biens propres par nature de l’article 1404 du Code civil.
-
29.
En particulier, le créancier saisissant devra prouver que le compte bancaire est alimenté exclusivement par les revenus de l’époux caution ou emprunteur. Ainsi, un compte alimenté par les revenus des deux époux n’est pas saisissable (v., par ex., Cass. 1re civ., 3 avr. 2001, n° 99-13733 : Bull. civ. I, n° 92 ; Dr. famille 2001, comm. 75, note Beignier B., JCP G 2002, II 10080, note Bourdaire C. ; Defrénois 15 oct. 2001, n° 37406-78, p. 1129, obs. Champenois G. ; D. 2001, Somm., p. 2933, obs. Nicod M. ; JCP G 2002, I 103, n° 13, obs. Simler P. ; Defrénois 15 août 2001, n° 37390, p. 939, obs. Théry P. ; RTD civ. 2001, p. 943, obs. Vareille B., arrêt qui décide qu’un compte joint alimenté par les revenus des deux époux ne peut pas être saisi – Cass. 1re civ., 17 févr. 2004, n° 02-11039 : Bull. civ. I, n° 45 ; Dr. famille 2004, comm. 84, note Beignier B. ; D. 2004, p. 2260, obs. Brémond V. ; Defrénois 15 nov. 2004, n° 38043-90, p. 1476, obs. Champenois G. – Cass. 1re civ., 17 janv. 2006, n° 02-20636 : Bull. civ. I, n° 13 ; D. 2006, p. 1277, note Bonnet ; JCP G 2006, I 193, n° 13, obs. Simler P. ; RTD civ. 2006, p. 359, obs. Vareille B.).
-
30.
Le créancier devra également démontrer que les sommes déposées sur le compte ne sont pas devenues des acquêts de communauté (Cass. 1re civ., 14 janv. 2003, n° 00-16078 : Bull. civ. I n° 2 ; D. 2003, p. 2793, note Barabé-Bouchard V. ; Dr. famille 2003, n° 48, obs. Beignier B. ; Defrénois 30 avril 2003, n° 37712-29, p. 544, obs. Champenois G. ; JCP G 2003, II 10019, concl. Sainte-Rose J. ; JCP G 2003, I 158, n° 9, obs. Simler P. ; RTD civ. 2003, p. 534, obs. Vareille B.).
-
31.
Le choix de ce texte du régime légal, et donc non spécifique à la communauté universelle, peut paraître surprenant, mais il est vrai que l’article 1497 du Code civil dispose que « les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n’ont pas fait l’objet de la convention des parties ».
-
32.
LPA 29 oct. 2018, n° 139n6, p. 11, note Legrand V. ; RTD civ. 2018, p. 959, obs. Nicaud M. ; D. 2018, p. 2292, note Lotti B. ; AJ fam. 2018, p. 610, obs. Thouret S. ; BJS déc. 2018, n° 119f9, p. 682, note Naudin E. ; Gaz. Pal. 8 janv. 2019, n° 339j6, p. 56, note Fathi S. ; Dr. famille 2018, comm. 262, note Torricelli-Chrifi S. ; RJPF 2018/10, note Dekeuwer-Défossez F. ; JCP G 2018, doctr. 1355, n° 13, obs. Tisserand-Martin A.
-
33.
V. not. Crocq P., « Les bons sentiments ne font pas les bons textes », D. 2005, tribune 2025 ; Piedelièvre S., « Le nouvel article 1387-1 du Code civil (ou l’utilisation d’un pavé par un ours) », D. 2005 ; Champenois G., « Pour l’abrogation de l’article 1387-1 du Code civil », JCP G 2007, n° 2, hors-série ; Larribau-Terneyre V., « Le créancier se trouva fort dépourvu quand le divorce fut venu… ou le nouvel article 1387-1 du Code civil », Dr. famille 2005, étude 21.
-
34.
L. n° 2009-526, 12 mai 2009, dite « de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures ».
-
35.
COJ, art. L. 213-3, 2°.
-
36.
Buat-Ménard E., « La compétence liquidative en cas de séparation du couple », AJ fam. 2015, p. 456.
-
37.
COJ, art. L. 213-3, 1°.
-
38.
En ce sens Cass. 1re civ., 12 juill. 2017, n° 16-20482 : AJ fam. 2017, p. 555, obs. Hilt P.
-
39.
COJ, art. L. 213-3, 1°.
-
40.
COJ, art. L. 213-3, 2°.
-
41.
Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 15-28344 : AJ fam. 2017, p. 487, obs. Casey J. V. Pierre N. et Pierre-Maurice S., « Compétence du JAF pour ordonner le partage de l’indivision entre époux hors divorce : précision apportée par la Cour de cassation », D. 2017, p. 2012.
-
42.
COJ, art. L. 213-3, 1°. En ce sens Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 17-27145 : D. 2019, p. 7 ; Procédures 2019, comm. 42, obs. Strickler Y., sur la compétence à titre incident du tribunal de grande instance sur certaines questions notamment pour statuer sur la composition de la communauté.
-
43.
Casey J., obs. préc.
-
44.
Cornu G., Les régimes matrimoniaux, 1997, PUF, coll. Thémis, p. 623.
-
45.
Cass. 1re civ., 9 juill. 2008, n° 07-16545 : Dr. famille 2008, comm. 145, Beignier B. ; JCP G 2008, I 202, n° 7, Simler P. ; RTD civ. 2009, p. 158, obs. Vareille B.
-
46.
Cass. 1re civ., 8 févr. 2005, n° 03-13456 : JCP N 2005, act. 170 ; JCP G 2005, I 163, n° 12, Tisserand A ; JCP N 2005, 1351, Pilleboult J.-F. ; Dr. famille 2005, comm. 80, Beignier B. ; Bull. civ. I, n° 65 ; D. 2005, p. 592 ; RLDC 2005, n° 631, obs. Léandri F. ; AJ fam. 2005, p. 149, obs. Hilt P. ; RTD civ. 2005, p. 255, obs. Vareille B. ; RJPF 2005, p. 14, obs. Vauvillé F.
-
47.
Cass. 1re civ., 15 févr. 2012, n° 11-10182 : Dr. famille 2012, comm. 70, Beignier B. ; JCP N 2012, 1376, Tisserand-Martin A. – Cass. 1re civ., 19 déc. 2012, n° 11-26054 : JCP N 2013, 721, Tisserand-Martin A.
-
48.
Cass. 1re civ., 24 nov. 1976 : Bull. civ. I, n° 367.
-
49.
Rev. proc. coll. 2019, n° 2, comm. 50, obs. Dumont M.-P. ; Gaz. Pal. 9 avr. 2019, n° 346z1, p. 46, obs. Cordeiro A.
-
50.
C. com., art. L. 641-9-I, al. 1er et C. com., art. L. 622-9, al. 1er anc.
-
51.
C. com., art. L. 641-9-I non applicable en l’espèce.
-
52.
Cass. com., 13 janv. 2015, n° 13-12590 : Bull. civ. IV, n° 2 ; D. 2015, Actu., p. 204.
-
53.
Cass. com., 23 mai 1995, n° 93-16930 : Bull. civ. IV, n° 150 ; D. 1995, Jur., p. 413, note Derrida F. – Cass. com., 9 janv. 2001, n° 96-20161 : Bull. civ. IV, n° 3; D. 2001, AJ, p. 630, obs. Lienhard A.
-
54.
C. civ., art. 815-3 – Sur ce point, v. Saintourens B. et Cazajus M., « Le notaire face à la vente du bien indivis en liquidation judiciaire », BJE nov. 2015, n° 112v2, p. 384.
-
55.
Saintourens B. et Cazajus M., « Le notaire face à la vente du bien indivis en liquidation judiciaire », BJE nov. 2015, n° 112v2, p. 384, n° 11.
-
56.
À propos de la conclusion d’un « bail précaire » par l’épouse d’un débiteur en liquidation judiciaire, Cass. com., 4 oct. 2005, n° 04-12610 : Bull. civ. IV, n° 193 ; D. 2005, AJ, p. 2592, obs. Lienhard A.
-
57.
RTD civ. 2019, p. 176, obs. Vareille B. ; Defrénois 28 mars 2019, n° 147j3, p. 36, note Champenois G. ; Dr. famille 2019, n° 2, comm. 31, obs. Torricelli-Chrifi S.
-
58.
PCG, art. 941-10.
-
59.
V. par ex. Cass. 1re civ., 28 févr. 1984, n° 83-10310 : Bull. civ. I, n° 78 ; Defrénois 1985, p. 521, obs. Breton A. – Cass. 1re civ., 15 déc. 2010, n° 09-68503 ; Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 15-16275.
-
60.
Cass. 1re civ., 17 mai 2017, n° 16-12310 ; Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-24926 : Bull. civ. I, n° 225 ; JCP N 2016, n° 1, p. 1005, obs. Collard F.
-
61.
Cass. 1re civ., 30 mars 2004, n° 00-22447.
-
62.
Cass. 1re civ., 14 févr. 1989, n° 87-14205 : Bull. civ. I, n° 79.
-
63.
Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-24926, préc.
-
64.
AJ fam. 2019, p. 160, obs. Levillain N. ; Dalloz actualité, 25 févr. 2019, obs. Mikalef-Toudic V.
-
65.
AJ fam. 2016, p. 603, obs. Casey J.
-
66.
Cass. 1re civ., 19 oct. 2016, n° 15-25879 : AJ fam. 2016, p. 603, obs. Casey J. ; D. 2016, p. 2167 ; D. 2017, p. 470, obs. Douchy-Oudot M. ; RTD civ. 2017, p. 105, obs. Hauser J. ; RTD civ. 2017, p. 108, obs. Hauser J.
-
67.
Sur le caractère de délai préfixe, Cass. 1re civ., 18 déc. 2013, n° 12-26571 : Dalloz actualité, 14 janv. 2014, obs. Marrocchella J. ; AJ fam. 2014, p. 122, obs. Levillain N. – Cass. 1re civ., 1er févr. 2012, n° 10-27276 : D. 2012, p. 436 ; AJ fam. 2012, p. 148, obs. Levillain N.
-
68.
Cass. 1re civ., 22 nov. 1977 : JCP 1979, II 19023, note Surun F. ; Defrénois 1979, p. 581 (2e esp.), note Ponsard A. ; D. 1978, IR, p. 241 (2e esp.), obs. Martin D.
-
69.
CPI, art. L. 121-2, al. 2.
-
70.
Pollaud-Dulian F., « Donation d’œuvres d’art avec charge à une association : des pratiques bien étranges et une curieuse indulgence », note sous CA Versailles, 1re ch., sect. 1, 22 déc. 2017, n° 16/04455, HantaÏ : RTD com. 2018, p. 334.
-
71.
V. en dernier lieu Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, n° 17-22934 : LEFP oct. 2018, n° 9, p. 5.
-
72.
C. civ., art. 1423, al. 1.
-
73.
Cass. 1re civ., 16 mai 2000, n° 97-20839 : Bull. civ. I, n° 149 – Cass. 1re civ., 6 mars 2001, n° 99-11308 ; Cass. 1re civ., 3 févr. 2010, n° 08-18196.
-
74.
C. civ., art. 968.
-
75.
C. civ., art. 1422 pour la donation ordinaire.
-
76.
CA Lyon, 6 juill. 1950, n° S. 1951.2.45.
-
77.
Cass. 1re civ., 30 mars 1955 : Bull. civ. I, n° 152 – Cass. 1re civ., 4 janv. 1980 : JCP G 1980, IV 105.
-
78.
Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-13801.
-
79.
Sur ce texte, v. not. : Vauvillé F., « Les droits au logement du conjoint survivant », Defrénois 30 oct. 2002, n° 37608, p. 1277 ; Sauvage F., « Le logement de la veuve », Dr. & patr. 2003, p. 36 ; Vareille B., « Variations futiles sur les droits au logement du conjoint survivant », in Mélanges en l’honneur de Michel Prieur, 2007, Dalloz, p. 1721.
-
80.
Cass. 1re civ., 4 avr. 1978, n° 76-12085 : Bull. civ. I, n° 138 : « La cour d’appel a retenu à juste titre (…) que le terme “héritier” englobait tous les successeurs » – Cass. 1re civ., 1er juin 2011, n° 10-16285.
-
81.
Cass. 2e civ., 12 mai 2010, n° 09-11256.
-
82.
Cass. 1re civ., 10 févr. 2016, nos 14-27057 et 14-28272 : Bull. civ. I, n° 926.
-
83.
Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-27206.
-
84.
Cass. 1re civ., 10 févr. 2016, nos 14-27057 et 14-28272, préc.
-
85.
Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-27206, préc.
-
86.
Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-27206, préc.
-
87.
Dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1 du Code civil.
-
88.
L’article 1527, alinéa 3 in fine du Code civil renvoie par erreur, pour caractériser un privilège mobilier, à l’article 2374, 3°, du même code, qui décrit un privilège immobilier.
-
89.
V. en ce sens, Gaudemet S., obs. sous la présente réponse ministérielle, Defrénois 3 mai 2019, n° 148p4, p. 32.
-
90.
Cass. 1re civ., 10 oct. 1995, n° 93-17610 P : Bull. civ. I, n° 359, p. 250 ; JCP N 1996, p. 277 ; RTD civ. 1996, p. 448, obs. Patarin J.
-
91.
Ainsi l’abattement fiscal dit Sarkozy et ses suites, l’article 790 B actuel du Code général des impôts prévoit : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 865 € sur la part de chacun des petits-enfants ».
-
92.
En ce sens, Levillain N., obs. précit. sous l’arrêt.
-
93.
Cass. com., 21 janv. 2014, n° 13-10151 : Bull. civ. IV, n° 16.
-
94.
V. explicitement en ce sens, Cass. 1re civ., 6 févr. 1980, n° 78-12513 : Bull. civ. III, n° 49 ; Rev. sociétés 1980, p. 52, note Viandier A. – adde Cass. com., 9 oct. 1972, n° 70-13919 : Bull. civ. IV, n° 234.
-
95.
Flour Y., « La qualité d’actionnaire et l’indivision », Rev. sociétés 1999, p. 569, spéc. n° 12.
-
96.
Mandataire unique prévu à l’article 1844, alinéa 1 du Code civil.
-
97.
Cass. com., 4 déc. 2007, n° 05-19643 : Bull. civ. IV, n° 259 ; D. 2008, p. 1251, note Godon L. ; D. 2008, AJ, p. 78, obs. Lienhard Y. ; RTD com. 2008, p. 133, obs. Le Cannu P. et Dondero B.
-
98.
Albiges C., Rép. civil Dalloz, v° Indivision : régime légal, mars 2011, actualisation févr. 2019, n° 89-91.
-
99.
Article 815-13, alinéa 2 du Code civil : « (…) l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
-
100.
Cass. 1re civ., 15 avr. 1980, n° 78-15245 : Bull. civ. I, n° 109 ; D. 1981, p. 101, note Breton A. ; D. 1981, IR, p. 231, obs. Robert A. ; RDI 1980, p. 406, obs. Bergel J.-L. ; RTD civ. 1981, p. 173, obs. Giverdon C.
-
101.
V. déjà dans le même sens, Cass. 1re civ., 26 oct. 2011, n° 10-21802 : Bull. civ. I, n° 183 ; JCP 2012, n° 31, § 3, obs. Coutant-Lapalus C. et Lamarque J., avec des faits similaires à ceux du présent arrêt : l’immeuble indivis avait été occupé depuis plus de 15 ans sans que l’indivisaire occupant ait versé une quelconque somme au titre de l’indemnité de jouissance privative ; un mandat de vendre avait été donné tardivement au notaire en dépit d’un accord amiable constaté judiciairement.
-
102.
Cass. 1re civ., 12 mai 2010, n° 09-65362 : Bull. civ. I, n° 116 ; JCP 2010, p. 559 ; AJ fam. 2010, p. 336, obs. Vernières C. ; RTD civ. 2010, p. 587, obs. Revêt T. ; JCP G 2010, I 1162, n° 14, obs. Périnet-Marquet H. ; Defrénois 30 déc. 2010, n° 39184-6, p. 2387, obs. Chamoulaud-Trapiers A.