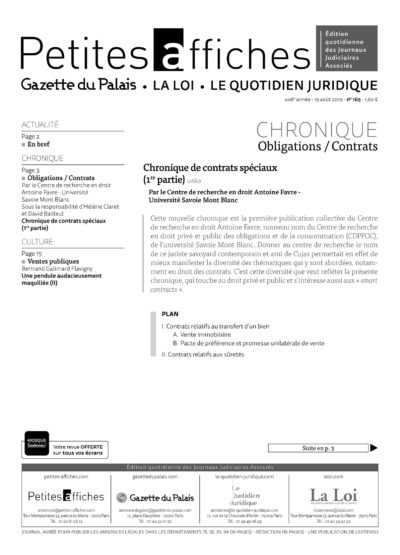Chronique de contrats spéciaux(1re partie)
Cette nouvelle chronique est la première publication collective du Centre de recherche en droit Antoine Favre, nouveau nom du Centre de recherche en droit privé et public des obligations et de la consommation (CDPPOC), de l’université Savoie Mont Blanc. Donner au centre de recherche le nom de ce juriste savoyard contemporain et ami de Cujas permettait en effet de mieux manifester la diversité des thématiques qui y sont abordées, notamment en droit des contrats. C’est cette diversité que veut refléter la présente chronique, qui touche au droit privé et public et s’intéresse aussi aux « smart contracts ».
I – Contrats relatifs au transfert d’un bien
A – Vente immobilière
Quelques précisions sur les effets de l’exercice de la faculté de rachat
Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 14-25005, PB. L’appellation « vente à réméré ou avec faculté de rachat » est doublement trompeuse. Non seulement elle laisse à penser qu’elle emporterait conclusion d’une nouvelle vente, mais également qu’elle emprunterait ainsi à la vente ses conditions de formation et ses modalités d’exécution. Or il est largement admis que, dès le droit romain1, le pacte de réméré devait être considéré comme une possibilité offerte au vendeur de résoudre la vente en remboursant le prix et certains frais à l’acheteur. Il ne saurait dès lors s’agir que d’une condition résolutoire2 : il n’y a pas « novus contractus », mais « distractus »3. Cette conception est confirmée à demi-mot par l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux qui résume les quatorze articles consacrés au mécanisme dans le Code en trois alinéas et qui précise que « la vente avec faculté de rachat ouvre au vendeur la faculté de résoudre la vente »4. Les conditions dans lesquelles la vente se trouve résolue et les effets de cette résolution n’apparaissent cependant pas avec limpidité à la lecture des différentes dispositions tant de droit positif que prospectif. Si des premiers éléments de réponses peuvent être découverts à la lecture de l’article 1673 du Code civil, qui prévoit que le vendeur ne saurait retrouver la possession qu’après la restitution à l’acheteur du prix principal et de certaines sommes5, l’interprétation de cette disposition est une gageure. C’est ce qu’illustre l’arrêt sous commentaire rendu le 8 novembre 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
I. En l’espèce, une SCI vend un immeuble avec faculté de rachat à une autre SCI. Le vendeur exerce sa faculté de rachat, mais un désaccord naît sur le montant des indemnités à reverser (en particulier quant à la question de savoir si outre le remboursement des factures de reconstruction du bien liées à sa destruction par un incendie, le vendeur devait indemniser l’acheteur du montant de la régularisation de TVA à laquelle se trouvait soumis ce dernier à la suite de l’exercice du réméré). Le vendeur assigne alors l’acquéreur en fixation des sommes en question. Le prix fixé par les premiers juges est payé par le vendeur qui interjette cependant appel, non sans avoir, au préalable, enjoint aux locataires du bien objet du réméré de lui verser désormais les loyers. La cour d’appel condamne le vendeur à restituer à l’acheteur le montant des loyers en question au motif que le transfert de propriété n’intervient qu’à la date où le prix, définitivement arrêté par une décision ayant autorité de chose jugée, aura été versé effectivement et dans son intégralité. Au visa des articles 1659 et 1673 du Code civil, la Cour de cassation confirme la solution en affirmant qu’à « défaut d’accord des parties, le vendeur qui use du pacte de rachat ne peut entrer en possession de l’immeuble qu’après avoir réglé le prix et les frais définitivement fixés judiciairement ». La lettre de l’article 1673 est donc affinée. En effet, en cas de désaccord des parties, seul le juge est en mesure de fixer définitivement les sommes dues par le vendeur. Or puisque seul le paiement de ces sommes permet au vendeur de retrouver la possession du bien, tant que le processus judiciaire n’est pas achevé, le retour en possession n’est guère possible. La cassation est néanmoins prononcée, la cour d’appel n’ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations : la somme payée par le vendeur après la décision des premiers juges était d’un montant supérieur à celle à laquelle il avait été condamné en appel. Quoi qu’il en soit, au-delà du rappel de principe, la solution est riche d’enseignements pratiques et théoriques. La Cour de cassation déjuge en partie la doctrine de Pothier relative à la perception des fruits produits par la chose entre la manifestation de volonté du vendeur déclarant mettre en œuvre la faculté de rachat et le remboursement effectif des sommes dues. Pour ce dernier, « l’acheteur sur qui on exerce le réméré ne doit rendre les fruits que du jour des offres qui lui sont faites par le vendeur de lui rendre le prix. C’est une suite du principe établi, que le réméré n’opérant résolution du contrat de vente que pour l’avenir, tout ce qui est provenu de la chose vendue jusqu’au réméré, doit appartenir à l’acheteur »6.
II. Au cœur de la solution se pose la question du moment auquel le vendeur redevient propriétaire de la chose vendue à réméré et, plus précisément, d’une éventuelle dissociation entre le (re)transfert de propriété et la reprise de possession de la chose. L’article 1673 du Code civil n’envisage, en effet, pas directement la nouvelle mutation du droit de propriété, mais uniquement l’entrée en possession du vendeur. Après avoir imposé au vendeur de rembourser à l’acheteur le prix, les différents frais de la vente et le montant des réparations nécessaires, il prévoit qu’il « ne peut entrer en possession qu’après avoir satisfait à toutes ces obligations ». Le retour en possession de la chose est donc subordonné au paiement, celui-ci ne pouvant être réalisé – c’est tout l’apport de l’arrêt commenté – en cas de désaccord sur son montant entre les parties, qu’après une fixation définitive opérée par le juge. À cet égard, on peut relever une différence assez significative entre les termes employés par la cour d’appel et ceux retenus par la Cour de cassation. La première visait le moment du transfert de propriété, alors que la seconde, reprenant en substance la lettre de l’article 1673, se contente de préciser la date du retour en possession. Le refus de se prononcer quant à la date du transfert de propriété se conçoit pourtant aisément dès lors que le litige portait sur l’attribution des fruits de la chose. Or cette question est tranchée par les règles de la possession qui attribuent les fruits au possesseur de bonne foi7.
Pour autant, la question du moment du transfert de propriété, sans avoir égard à celle du moment du retour en possession, n’est pas sans conséquence. Comme il a pu être relevé, « la question peut présenter quelque intérêt si le vendeur tarde à effectuer les remboursements. L’acquéreur peut-il estimer qu’il reste propriétaire de la chose, tant qu’il n’est pas désintéressé, ou bien n’est-il qu’un créancier investi d’un droit de rétention et qui doit s’adresser au tribunal pour acquérir la propriété » ?8
De deux choses l’une : soit le transfert de propriété s’est réalisé au moment où le vendeur a fait part de sa décision d’exercer la faculté de rachat, soit au contraire ce transfert n’est susceptible d’intervenir qu’au moment où le vendeur aura exécuté les obligations mises à sa charge par l’article 1673. Tout dépend donc de ce qu’il convient d’entendre dans l’idée de réalisation de la condition. S’agit-il de la volonté de reprendre le bien ou, au contraire, du remboursement des sommes dues ? L’alternative entre un transfert de propriété s’opérant par l’effet de la volonté du vendeur et un transfert par l’effet de l’obligation fut, d’ailleurs, au cœur d’une saisissante controverse entre les auteurs de l’exégèse.
Pour les premiers, appliquant littéralement l’article 1673, la vente serait résolue et la propriété retournerait au vendeur dès la manifestation de sa volonté de reprendre le bien, traduite par une offre de remboursement à l’acheteur9. Plus précisément, puisqu’en vertu de l’article 1583 du Code civil le transfert de propriété intervient solo consensu, il ne saurait en aller différemment à l’occasion de l’exercice du réméré. La volonté du vendeur aurait donc un double effet : résoudre la vente et opérer le retour de la propriété à ce dernier10. Aussi, entre la réalisation de l’offre et le paiement des sommes, l’acheteur n’étant plus que possesseur devrait-il être considéré comme un rétenteur ; celui-ci pouvant refuser de restituer la chose dans l’attente de l’exécution de son obligation par le vendeur11. D’autres auteurs, retenant une logique sensiblement similaire, proposent de considérer que « par l’exercice du réméré au moyen d’un acte extrajudiciaire portant déclaration de la volonté du vendeur, la propriété n’était revenue à celui-ci que sous condition suspensive, sous la condition de faire les restitutions et remboursements prescrits par la loi, et qu’elle est censée ne pas lui être revenue s’il n’accomplit pas cette condition »12.
Pour les seconds, au contraire, la seule déclaration du vendeur d’exercer le rachat, ou la simple offre de remboursement, serait sans effet13 ou n’aurait pour seul effet que de ne plus craindre d’être prescrit du délai de cinq ans imposé par le code14. Seul le remboursement des sommes, et par conséquent l’exécution de son obligation par le vendeur, consommerait la résolution et, partant, permettrait d’opérer le transfert de propriété. La décision de mettre en œuvre la faculté de rachat serait donc inefficace, seule la restitution des sommes anéantissant la vente. Telle est la position retenue par la Cour de cassation dans des arrêts rendus par la chambre des requêtes les 14 janvier 187315 et 19 octobre 1904 à l’occasion desquels il avait pu être affirmé que tant que « la condition indispensable de la restitution et du remboursement exigés par les articles 1659 et 1673 du Code civil (…) manquait, la vente n’était point résolue et la propriété continuait à résider sur la tête de l’acquéreur »16. D’un point de vue purement pratique la solution se comprend parfaitement en ce qu’elle dispense l’acquéreur d’une demande en justice, si après avoir déclaré exercer le réméré, le vendeur ne restitue jamais17 et qu’elle évite l’écueil d’un éclatement des pouvoirs entre un vendeur redevenu propriétaire et un acheteur simplement possesseur. D’un point de vue théorique, la mise à l’écart d’un transfert de propriété opérant par le seul effet du consentement n’est guère choquante. Par définition, l’exercice du réméré n’est pas une nouvelle vente, mais l’anéantissement de la vente ; or dans cette situation, aucune raison n’impose d’appliquer l’article 158318.
III. L’arrêt sous commentaire maintient donc cette position. Tant que les sommes n’ont pas été versées, la vente n’est point résolue et l’acheteur demeure propriétaire. La faculté de réméré doit être exercée dans les cinq ans de la vente, mais cette seule manifestation de volonté est insuffisante à résoudre le contrat. Elle a dès lors pour effet de prémunir le vendeur contre la forclusion et, corrélativement, d’accorder à l’acheteur une action en paiement des sommes dues. La position est désormais entendue, mais n’est imperméable à la critique. En effet, l’on peut tout à fait imaginer que les motifs ayant conduit le vendeur à céder son bien en se réservant la faculté de réméré n’aient pas disparu « et qu’à la veille d’avoir à renoncer à son bien, il ne se décide, en désespéré, à déclarer qu’il veut racheter, sans avoir les moyens d’y faire face »19. Il n’est pourtant pas à exclure que ce lien opéré entre le paiement des sommes et la résolution soit indispensable en ce qu’il serait de nature à remettre en cause le caractère potestatif de la condition résolutoire. Si la réalisation de la condition est subordonnée au paiement des sommes dues – au besoin fixées par le juge –, celle-ci ne dépend pas uniquement de l’« appréciation subjective et unilatérale »20 du vendeur, de « sa seule appréciation »21 ou de sa « seule volonté »22. Bien au contraire, la considération de la possibilité financière de rembourser les sommes et le remboursement effectif de ces sommes semblent tenir compte de « circonstances objectives, susceptibles d’un contrôle judiciaire »23, de nature à écarter la potestativité de la condition. Le système ici dégagé pourrait toutefois être remis en cause dans l’hypothèse où l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux était adopté en l’état. Faisant l’économie de la précision suivant laquelle le vendeur ne peut retrouver la chose (ou la propriété de la chose) qu’après avoir payé les sommes dues à l’acheteur, aucune précision n’est laissée quant au moment où la résolution opère effectivement. De même, rien n’est dit quant aux sommes que le vendeur doit restituer, l’avant-projet renvoyant ainsi implicitement au droit commun des restitutions, figurant depuis l’ordonnance de réforme du droit des contrats aux articles 1352 et suivants du Code civil. En apparence rien ne semblerait changer, l’article 1352-5 posant le principe suivant lequel « pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution ». À l’image de ce qui s’évince de l’article 1673 du Code civil, dès lors que l’acheteur devra restituer la chose acquise sous faculté de réméré, il pourra demander le remboursement des dépenses nécessaires et ayant augmenté la valeur de la chose. La restitution des frais de la vente n’est pas directement envisagée, mais pourrait être vue comme une conséquence de la rétroactivité de la résolution. La principale difficulté d’interprétation pourrait alors venir de la question de la restitution des fruits. L’article 1352-7 prévoit en effet que celui qui a reçu la chose de bonne foi (ce qui est assurément le cas de l’acheteur dans la vente à réméré) ne doit restituer les fruits qu’à compter de la demande. Appliquée à la résolution de la vente à réméré cette règle conduirait à une solution légèrement différente de celle retenue en l’espèce. Dans l’arrêt commenté, les fruits, en l’occurrence les loyers, n’avaient à être restitués qu’à compter du remboursement des sommes et par conséquent de la résolution de la vente. En application des articles 13 de l’avant-projet et 1352-7 du Code civil, l’acheteur pourrait se trouver contraint de les restituer dès la demande en justice de restitution et par conséquent beaucoup plus tôt, alors même que la vente n’aurait pas encore été résolue. Si la volonté de l’avant-projet de rendre plus lisible le droit des contrats spéciaux et de procéder à l’épure assumée de certains textes dépassés se conçoit, l’on peut regretter l’expédition en trois alinéas de la vente à réméré. Une précision complémentaire, rappelant que la vente n’est résolue qu’autant qu’ont été versées à l’acquéreur les sommes dues, n’apparaîtrait pas superflue.
Johann LE BOURG
B – Pacte de préférence et promesse unilatérale de vente
Des vicissitudes de la rencontre des volontés – À propos de deux arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 6 décembre 2018
Cass. 3e civ., 6 déc. 2018, n° 17-23321, 17-21170 et 17-21171. Bien que le recours aux avant-contrats soit généralement présenté comme le moyen de jalonner la voie du contrat définitif24, il s’en faut que de tels accords suffisent toujours à rétablir dans la rectitude de la ligne droite toutes les sinuosités de la période précontractuelle. En témoignent deux arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 6 décembre 2018, qui illustrent les aléas du mécanisme.
Dans la première espèce25, une personne s’était engagée le 28 octobre 1999, pour une durée de dix ans, à donner à sa compagne la préférence pour la vente de deux studios situés au rez-de-chaussée de la villa occupée par celle-ci26. Malheureusement, des rapports conflictuels s’étant établis entre les ex-époux à la suite de leur divorce, la bénéficiaire s’évertuait à entraver le processus menant à la vente en restant taisante face aux sollicitations de son ancien mari, pour la conclusion d’un contrat dont il avait manifesté l’intention de longue date. Face à cette situation, celui-ci avait donc pris le parti de repousser la conclusion du contrat définitif à l’échéance du droit de son ex-épouse en consentant, le 2 septembre 2009, une promesse unilatérale de vente au bénéfice d’un tiers, tout en ne lui ouvrant la possibilité d’opter qu’à compter du 29 octobre 2009. La vente est finalement conclue avec ce tiers le 16 novembre 2009 ; en violation du droit de préférence, selon la bénéficiaire du pacte.
Saisie de cette affaire, la cour d’appel de Fort-de-France a considéré que la chronologie des évènements préservait le promettant de toute violation du pacte, la rencontre des volontés consécutive à la promesse n’étant pas advenue pendant la durée d’efficacité de l’engagement de préférence. C’était partir du principe que « la lettre du pacte de préférence ne permet pas de conclure qu’en cas d’intention de vendre, l’obligation de laisser la préférence à la bénéficiaire grève le pré-contrat », et que « seule la date de l’échange des consentements est à prendre en considération ». La Cour de cassation choisit cependant de contester le raisonnement en sa prémisse, censurant ainsi la décision d’appel. Elle estime que « le pacte de préférence implique l’obligation, pour le promettant, de donner préférence au bénéficiaire lorsqu’il décide de vendre le bien ». Le contrat définitif sera donc finalement conclu, quoique ce soit en violation de l’engagement de préférence et avec un autre que son bénéficiaire…
Dans le second arrêt27, une promesse unilatérale de vente d’un bien immobilier était également en cause, dont les promettants – deux époux – avaient entendu repousser le délai d’option au décès de la précédente propriétaire du bien, qui s’était réservée sur l’immeuble un droit d’usage et d’habitation. Après le décès de cette dernière, l’option est levée, et tout se serait passé sans difficultés si l’épouse promettante, attributaire du bien après son divorce, n’avait préalablement décidé de se rétracter. La cour d’appel de Grenoble avait entrepris de passer outre cette rétractation en considérant que la promettante, « qui a donné son consentement à la vente, sans restriction, ne pouvait se rétracter et que l’acceptation de la promesse par les bénéficiaires a eu pour effet de rendre la vente parfaite ». La haute juridiction prend, ici encore, le contre-pied, aux motifs que « la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée ». Le contrat définitif ne sera donc finalement pas conclu avec le bénéficiaire de la promesse, malgré l’acceptation de l’offre par ce dernier…
Ces deux décisions invitent à s’orienter dans l’entrelacs des volontés et des engagements qui mèneront à l’avènement du contrat définitif28. Pour ce faire, il convient de suivre la trame qui leur est commune, rendant ainsi ces deux arrêts comparables : chaque situation mettait le juge en présence d’une promesse unilatérale, dont l’option avait été retardée pour tenir compte d’un engagement ou d’un droit préexistant (I), ce qui ne pouvait manquer d’influer sur les conséquences de son exercice postérieur, et la formation du contrat définitif (II).
I. Ouverture de l’option. Chacune des conventions de promesse unilatérale ici examinées avait prévu, par le mécanisme du terme suspensif, de repousser la faculté d’option du bénéficiaire à une échéance déterminée : respectivement, la date du 29 octobre 2009 et le décès de la précédente propriétaire du bien29. En chaque cas, il apparaissait que le recours à cette modalité poursuivait la même vocation de donner le temps d’une sorte de consolidation de la situation du promettant, nécessaire pour entrer dans les liens du contrat définitif, qui adviendrait à échéance du droit de préférence comme du droit d’usage et d’habitation naguère réservé sur le bien. Cette consolidation n’avait pourtant pas le même enjeu dans les deux cas, pour lesquels les conséquences de la situation préexistante à la promesse différaient.
Dans la première espèce, il s’agissait d’envisager la compatibilité de deux droits personnels30 : le droit d’option né de la promesse et le droit de préférence préexistant, né du pacte. On sait que le pacte de préférence ne constitue en soi qu’une avancée limitée vers la conclusion du contrat définitif31, mais que la jurisprudence n’en sanctionne pas moins tous les engagements qui seraient de nature à contrarier la priorité qui revient à son bénéficiaire32. Cette question était posée à propos de l’engagement né de la promesse unilatérale. Et l’on doit sans doute approuver la haute juridiction d’avoir retenu une telle incompatibilité, nonobstant le décalage temporel du droit d’option. Si, en garantissant que la vente avec le tiers ne pourrait se former pendant la durée d’efficacité du pacte, une telle modalité préservait d’une violation immédiate de l’engagement de préférence, il est admis que son inexécution peut prendre d’autres formes plus insidieuses33 ; ainsi, lorsque le promettant d’un pacte consent à un tiers, sur le bien objet du contrat, un bail rural conférant au preneur un droit de préemption d’origine légale, de nature à supplanter la préférence conventionnellement prévue34.
Le cas d’espèce était voisin35. La promesse unilatérale – à la différence de la promesse synallagmatique36 – n’emporte certes pas ipso facto la vente du bien ; mais la conclusion d’une telle convention n’en conduit pas moins, comme celle d’un bail rural, à verrouiller le processus de cession de la chose au profit d’un acquéreur déterminé – le bénéficiaire de la promesse, là où il est question du preneur à bail37 –, évinçant ainsi le bénéficiaire du pacte. Au cas particulier, la violation était d’autant plus caractérisée que contrairement à l’hypothèse de la conclusion du bail rural, il n’était pas question de savoir à qui la vente aurait vocation à être proposée en priorité38, mais de constater qu’elle avait déjà été proposée au bénéficiaire de la promesse, malgré l’engagement issu du pacte. L’inexécution de celui-ci découle en effet comme une conséquence nécessaire de ce que la promesse unilatérale suppose manifestée une intention de vendre de la part du promettant39, que l’engagement de préférence lui impose justement de faire connaître à son bénéficiaire par priorité à tout autre acquéreur potentiel40. Il apparaissait d’ailleurs assez peu opérant d’opposer à ce raisonnement le comportement du bénéficiaire qui avait, par le passé, laissé planer le doute sur ses desseins, pour opposer à cette manœuvre dilatoire – l’inaction du bénéficiaire de la préférence – une autre manœuvre dilatoire – le décalage des possibilités d’option, retardant la formation du contrat définitif –, alors qu’il aurait suffi d’enfermer les possibilités d’acceptation dans un délai déterminé41.
La situation du second arrêt ne se posait pas exactement dans les mêmes termes. L’exercice de l’option y avait été réservé pendant la durée d’un droit d’usage et d’habitation conservé par la précédente propriétaire sur l’immeuble proposé à la vente. Il ne s’agissait plus, ici, de s’assurer de la compatibilité de l’option avec un engagement préexistant du promettant, mais de consolider les droits de celui-ci sur la chose préalablement à sa vente. Contrairement à l’engagement de préférence, le droit d’usage et d’habitation présente en effet la nature d’un droit réel, amputant les prérogatives du propriétaire du bien42. Fallait-il, dès lors, être d’ores et déjà propriétaire plein et entier de l’immeuble pour en promettre unilatéralement la vente à autrui ? Si les conditions de la vente s’apprécient normalement, du côté du promettant, au moment de la promesse, il est admis que la perspective d’un transfert de droit advenant au moment de l’échange des consentements43 permet de temporiser l’application pratique de ce principe44. Sans doute pouvait-on considérer que le caractère viager du droit d’usage et d’habitation45 levait les obstacles à la conclusion d’un tel avant-contrat qui, tout comme la promesse de vente consentie par un nu-propriétaire, donne vocation, à terme, à une complète propriété46. L’emploi d’une modalité retardant les possibilités d’option n’en apparaissait pas moins pleinement justifié.
L’analyse croisée de ces deux arrêts nous porte donc à des conclusions opposées. Dans le premier cas, l’articulation des engagements dissimulait mal leur télescopage : l’aménagement temporel des modalités d’option y faisait figure d’artifice ayant pour effet de contourner l’engagement de préférence ; dans la seconde espèce, en revanche, l’articulation des droits permettait leur coordination, en tenant compte du droit réel d’usage et d’habitation grevant le bien. La marche vers le contrat définitif pouvait donc sembler plus ou moins bien assurée selon l’espèce en cause. Et pourtant, c’est dans la première espèce que la promesse unilatérale permettra finalement la conclusion de la vente, et pas dans la seconde. C’est dire que l’ouverture de l’option est une chose, sa réalisation en est une autre.
II. Réalisation de l’option. Dans chaque espèce soumise au commentaire, l’option avait finalement été levée par le bénéficiaire de la promesse. De nouveaux obstacles se dressaient cependant pour que l’acceptation ainsi intervenue puisse rencontrer l’offre préalablement émise. Dans le premier arrêt, la fragilité des bases de cet accord était en cause : l’offre en question avait été formulée en violation du pacte de préférence47. Dans le second arrêt, c’était davantage l’ébranlement de bases pourtant solides qui prêtait à une nouvelle discussion : l’offre en question avait été rétractée avant que le bénéficiaire ne fût mis en mesure de l’accepter. Dans les deux cas, la formation du contrat définitif était en péril.
On sait que le pacte de préférence accuse ses faiblesses sur la question des sanctions applicables lorsque sa violation est caractérisée48 : il y a certes là une faute contractuelle dans les rapports du promettant et du bénéficiaire49, mais, à l’égard des tiers, l’efficacité de la sanction bute sur l’effet relatif du contrat, qui empêche d’en faire valoir les pleins effets lorsque, comme en l’espèce, le promettant s’est soustrait à son engagement de préférence pour conclure avec un tiers50. Il est de règle que le bénéficiaire ne peut obtenir l’annulation du contrat passé avec le tiers et sa substitution dans les droits de celui-ci s’il n’est pas établi que ce tiers avait connaissance de l’existence du pacte et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir51. Or, c’était sur cette dernière preuve que l’action intentée par la bénéficiaire du pacte avait déjà achoppé en première instance. Sans doute était-ce là un juste retour des choses, face au mutisme de la bénéficiaire, qui constituait le point de départ du litige…
La réalisation de l’option ne suscitait pas les mêmes objections dans le second cas, seuls les rapports du promettant vis-à-vis du bénéficiaire étant en cause consécutivement à la rétractation par celui-là de son engagement. Avec cet arrêt, la Cour de cassation manifeste à nouveau52 qu’elle n’entend pas remettre en cause la ligne tracée depuis la jurisprudence Cruz53, entérinant ainsi, pour les promesses unilatérales de vente conclues avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016, la solution de l’efficacité de la rétractation ; ceci alors même que dans cette affaire, la troisième chambre civile avait été invitée à faire évoluer sa jurisprudence54, ce qui aurait permis d’adoucir la rupture d’avec les dispositions nouvelles55, lesquelles admettent la formation du contrat définitif au titre des sanctions de l’inexécution de la promesse56.
Les choses pourraient cependant s’avérer plus complexes qu’il n’y paraît. Il a en effet été remarqué que si l’application du nouvel article 1124 du Code civil ne souffre d’aucun doute lorsque le droit d’option est pur et simple, il pourrait en aller différemment lorsque ce droit est affecté d’une modalité, le texte prévoyant la réalisation forcée du contrat dans la seule hypothèse où la révocation de la promesse a lieu « pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter »57. Selon Monsieur Mekki, une résurgence de la solution d’espèce – et de la jurisprudence Cruz, qui en constitue le support – ne serait donc pas à exclure en des circonstances comparables, sous l’empire du droit nouveau58. Cela n’en serait pas moins consacrer une – nouvelle59 – exclusive à l’exécution forcée en nature qui, de l’avis de l’avocat général s’étant prononcé sur cette affaire, ne tomberait pas précisément sous le sens60. Car telle est, au fond, la question suscitée par cet arrêt lorsqu’on le met en perspective avec le droit actuel : en quoi la paralysie des facultés d’option pourrait-elle constituer un obstacle à la formation du contrat définitif en cas de rétractation anticipée ?61 C’est dire que l’application des nouveaux articles du Code civil est toujours lourde d’incertitudes, et que, malgré la réforme, la rationalité de la jurisprudence Cruz est encore plus que jamais en question62. Pour l’heure, elle semble toujours s’avérer aussi fuyante que la rencontre des volontés63…
Nicolas CLÉMENT
II – Contrats relatifs aux sûretés
Contrat de cautionnement : quatre moyens invoqués par une caution actionnée en paiement, une cassation partielle, une application plus souple du formalisme du cautionnement et la non-prise en compte d’un cautionnement antérieur jugé nul dans l’appréciation de la disproportion
Cass. com., 21 nov. 2018, n° 16-25128. Formalisme de l’acte, proportionnalité de l’engagement et information de la caution en cours d’exécution sont trois exigences applicables au cautionnement donné par une personne physique64. Dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 novembre 201865, ces moyens de défense furent opposés par une caution actionnée en paiement par une banque.
La caution avait conclu deux contrats : un cautionnement de tous les engagements d’une société consenti en 2009 et le cautionnement d’un prêt consenti par la banque à cette même société en 2011. La cour d’appel avait confirmé un jugement retenant la nullité du seul engagement de 2009. La caution se pourvoit donc en cassation afin d’obtenir la nullité du second engagement, et si ce n’est pas possible, de le faire priver d’effet ou d’engager la responsabilité de la banque. Pour cela, elle met en avant quatre arguments : l’inobservation des règles relatives au formalisme, un manquement à l’exigence de proportionnalité du cautionnement, une méconnaissance du droit à l’information de la caution et une violation de l’article L. 650-1 du Code de commerce.
Le demandeur obtient alors une cassation partielle de l’arrêt, la Cour de cassation sanctionnant seulement les juges du fond pour ne pas avoir justifié l’accomplissement des formalités liées à l’obligation d’information annuelle du Code de la consommation. La haute cour estime en effet que la preuve de l’exécution de l’obligation d’information due à la caution ne peut résulter que de la seule preuve de l’envoi des courriers. Les juges du fond doivent vérifier que l’information a bien été envoyée par le créancier, mais aussi qu’elle est conforme à ce qu’exige l’article L. 333-2 du Code de la consommation66.
Les trois autres moyens sont rejetés. Concernant le principe d’irresponsabilité de la banque pour soutien abusif, la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs »67. Les trois situations envisagées par l’article L. 650-1 du Code de commerce ne sont que des cas d’ouverture de la responsabilité du créditeur, mais encore faut-il constater au préalable le comportement fautif de l’établissement de crédit.
Nous étudierons plus particulièrement les deux moyens relatifs au formalisme (I) et à la disproportion (II) du cautionnement au regard notamment des nombreuses jurisprudences récentes.
I. Le formalisme du cautionnement. La caution invoquait deux manquements à l’article L. 331-1 du Code de la consommation qui impose l’insertion d’une mention manuscrite spécifique.
D’une part, elle reprochait aux juges du fond de ne pas avoir prononcé l’annulation du second cautionnement dont la signature de la caution précédait la mention manuscrite alors que c’est précisément ce motif qui avait permis à ces mêmes juges de retenir la nullité du premier cautionnement. En effet, la règle issue du Code de la consommation implique que la mention manuscrite précède la signature de la caution68, mais dans la mesure où cet argument n’avait pas été relevé concernant le second engagement de la caution devant les juges du fond, la Cour de cassation, qui n’a pas à relever d’office la nullité des actes, a écarté ce moyen.
D’autre part, la caution faisait valoir qu’elle avait, « dans la mention manuscrite, indiqué se porter caution « de la SARL » sans autre précision, de sorte que la personne du débiteur garanti n’était pas désignée dans ladite mention, et que celle-ci ne permettait pas à la caution de connaître le sens et la portée de son engagement ». La Cour de cassation exige en effet que « la lettre X de la formule légale [soit] remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti » et sanctionne l’utilisation du simple terme « bénéficiaire du crédit »69. Dans notre arrêt, les juges font toutefois preuve d’un peu de souplesse en précisant que « si la mention manuscrite indiquait que le dirigeant indiquait se rendre caution « de la SARL » sans autre précision, elle faisait également figurer à trois reprises la dénomination sociale complète du débiteur principal garanti ».
La Cour de cassation oscille ici entre une application très stricte de l’article L. 331-1 du Code de la consommation et une appréciation plus mesurée du formalisme du cautionnement dès lors que le critère du respect de la finalité informative de la mention manuscrite est rempli70. Un recul du formalisme du cautionnement tant jurisprudentiel que légal peut en effet être constaté. Ainsi, les cautionnements conclus sous la forme authentique ont été soustraits aux exigences de mention manuscrite par la jurisprudence71 puis par la loi72. Il en est de même de l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties qui dispense de toute mention manuscrite exigée par la loi73. La Cour de cassation a également effectué un revirement de jurisprudence en permettant qu’une caution illettrée fasse rédiger la mention manuscrite par une autre personne74. On peut également citer une décision du Conseil d’État soumettant l’acte de cautionnement par une personne physique d’un prêt consenti par une collectivité territoriale aux dispositions du Code de la consommation et qui valide la mention manuscrite de la caution, celle-ci n’énonçant le montant de la somme cautionnée que par référence aux sommes dues par le débiteur, dans la mesure où la caution avait, de sa main, écrit quelques lignes plus haut le montant de la somme cautionnée et « avait incontestablement appréhendé la nature, la portée et les conséquences de l’obligation contractée »75.
C’est surtout la loi ELAN du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique qui porte un coup important au formalisme du cautionnement en modifiant l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, relative aux baux d’habitation76. « Dans un souci de simplification du formalisme de l’acte de cautionnement et de dématérialisation de la procédure de location de logements », la loi abandonne ainsi l’exigence de mentions manuscrites ad validitatem77. Les mentions obligatoires des cautionnements de baux d’habitation conclus après le 25 novembre 2018 pourront désormais être simplement dactylographiées78 et signées par le garant. Cette disposition entraîne un amoindrissement de la protection de la caution79. Les risques de consentement non éclairé existent, notamment pour les garants qui ne prennent pas le temps de lire l’acte. La rédaction de la mention manuscrite avait au moins pour effet d’attirer l’attention de la caution. Comme certains auteurs l’ont préconisé, il aurait été intéressant de préciser que la mention obligatoire soit au moins stipulée de manière « apparente » dans l’acte80.
L’avant-projet de réforme du droit des sûretés de l’association Henri Capitant81 mettra peut-être un frein au recul du formalisme dans la mesure où il contient un article 2298 du Code civil qui prévoit que « la caution personne physique appose elle-même, à peine de nullité de son engagement, la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ». Cet article qui contient également une mention propre à l’engagement solidaire, aura vocation à s’appliquer à toute caution personne physique, quelle que soit la nature de l’obligation principale et que le créancier soit un professionnel ou non. Il en est de même du principe de proportionnalité de l’engagement consacré par le projet de réforme82.
II. La proportionnalité du cautionnement. Dans l’arrêt du 21 novembre 2018, le garant faisait valoir que « la disproportion d’un cautionnement doit s’apprécier en considération de tous les engagements souscrits par la caution envers le créancier, même s’ils ne sont pas mentionnés dans la fiche de renseignement complétée par la caution ». En effet, les juges prennent en compte des engagements de caution antérieurs pour calculer la proportionnalité d’un acte au moment de sa conclusion83, mais aussi pour apprécier la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée84. Bien que le créancier n’ait pas d’obligation de vérifier l’exactitude des informations données par la caution pour apprécier la proportionnalité de l’engagement de cette dernière, la banque peut se voir reprocher sa négligence en cas d’anomalie apparente85. Tel aurait pu être le cas en l’espèce dans la mesure où l’acte de 2009 avait été souscrit au profit de la même banque. La Cour de cassation a toutefois refusé d’appliquer l’article L. 332-1 du Code de la consommation86 dès lors que « si la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, il ne peut être tenu compte d’un cautionnement antérieur que le juge déclare nul, et qui est ainsi anéanti rétroactivement ».
Pour apprécier la disproportion d’un cautionnement, il n’est donc pas tenu compte des engagements de caution antérieurs qui auraient été rétroactivement annulés. La décision de la Cour de cassation semble être en contradiction avec la lettre même de l’article L. 332-1 du Code de la consommation qui dispose que la proportionnalité de l’engagement s’apprécie au moment de la conclusion de l’acte. C’est pourtant grâce à la rétroactivité de la nullité du premier acte que le second est valable87. Cette décision est donc favorable au créancier, tout comme celle qui retient que le cautionnement est proportionné peu important que l’engagement soit « pratiquement du montant du patrimoine » de la caution88 ou celle qui considère que « la consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération pour l’appréciation de sa capacité à faire face à son engagement au moment où elle est appelée n’est pas modifiée par les stipulations de la garantie (…) qui interdisent au créancier le recours à certaines procédures d’exécution forcée »89. Ainsi, dans cette affaire, la haute juridiction considère que bien que la banque n’ait pas la possibilité de saisir la résidence principale de la caution, la valeur de ce bien doit quand même être intégrée dans l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement.
Cette solution peut toutefois étonner dans la mesure où elle diffère de celle retenue à propos de cautionnements disproportionnés. Ainsi, la Cour de cassation a sanctionné une cour d’appel pour ne pas avoir pris en compte, pour apprécier la disproportion d’engagements par rapport aux biens et revenus des cautions, leurs cautionnements antérieurs « quand bien même elle les avait déclarés disproportionnés »90. Si effectivement la déchéance, contrairement à la nullité, n’entraîne pas l’anéantissement de l’acte, la banque pourrait être tentée de demander la nullité du premier engagement. Cela ne devrait cependant pas être possible dans la mesure où les juges décident que le manquement aux exigences de formalisme n’est sanctionné que par la nullité relative de l’acte, la caution pouvant confirmer son engagement en l’exécutant volontairement91. Le garant a donc peut-être intérêt à préférer demander la disproportion de tous ses cautionnements92 plutôt que de demander la nullité de ses actes antérieurs93. Cette recommandation est vraie aujourd’hui, mais la réforme du droit des sûretés pourrait changer la donne. En effet, l’article L. 332-1 du Code de la consommation sanctionne actuellement la disproportion par l’inefficacité du cautionnement à l’égard du créancier. Or le projet de réforme prévoit la possibilité de seulement réduire l’engagement pour le rendre proportionné. La sanction se révélerait alors moins sévère pour le créancier94. Les nombreuses décisions rendues notamment en 2018, parfois contradictoires ou étonnantes, rendent ainsi d’autant plus indispensable la réforme du droit des sûretés.
Delphine SASSOLAS
(À suivre)
III – Contrats publics
A – Délégation de service public
B – Marchés publics
IV – Contrats et numérique
A – La garantie de l’échange
B – L’optimisation de l’alliance
Notes de bas de pages
-
1.
V. par ex., Accarias C., Précis de droit romain, t. 2, 3e éd., 1882, n° 613 ; Contra, Duranton A., Cours de droit français suivant le Code civil, t. 16, 4e éd., 1844, n° 389, estime pour sa part qu’en droit romain, le « pactum de retrovendendo était simplement une convention par laquelle l’acheteur s’obligeait à revendre la chose au vendeur, si celui-ci le demandait », cette opinion voyant dans le pacte de réméré une nouvelle vente, est néanmoins largement démentie par la doctrine du XIXe siècle et notamment, avec particulièrement de force, par Troplong R.-T., Le droit civil expliqué, De la vente, t. 2, 5e éd., 1856, nos 693 et s.
-
2.
Comp. Bories A., Le réméré, Thèse, Montpellier, 2004, not. nos 645 et s., qui, rejetant la qualification tant de droit réel que de droit personnel pour le vendeur, voit dans le réméré un droit potestatif d’option ne s’analysant pas comme une condition ; en ce sens Adde, Latina M., « La condition dans l’ordonnance du 10 février 2016 », JCP G 2016, 875 : « (…) si la condition qui dépend de la seule volonté du débiteur est prohibée, nombreux sont les droits potestatifs qui, au contraire, sont parfaitement valables. Pourtant, c’est se payer de mots que de considérer que les clauses de dédit, les clauses de résiliation unilatérale, ou encore le réméré sont autre chose que des conditions purement potestatives ».
-
3.
Pothier R.-J., in Œuvres, par Bugnet M., t. 3, Traité du contrat de vente, 1861, n° 411, et Pothier de poursuivre au n° 429 : « Le vendeur qui, en exécution de cette clause, rentre dans l’héritage qu’il avait vendu, ne l’acquiert pas proprement de nouveau ; le réméré est plutôt une résolution et une cessation de l’aliénation qu’il en avait faite, qu’une nouvelle acquisition ».
-
4.
Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, art. 13. « La vente avec faculté de rachat ouvre au vendeur la faculté de résoudre la vente. À peine de nullité de plein droit, la faculté de rachat doit être convenue par écrit, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Le rachat anéantit les droits des tiers auxquels il est opposable, à l’exception de ceux qui ont été consentis avec l’accord du vendeur ».
-
5.
C. civ., art. 1673 : « Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu’après avoir satisfait à toutes ces obligations ».
-
6.
Pothier R.-J., in Œuvres, par Bugnet M., t. 3, Traité du contrat de vente, 1861, n° 405. L’auteur justifie encore le principe au numéro 410, lorsqu’il exclut l’obligation du vendeur de procéder à des offres réelles et consignation, en précisant qu’« il doit être fait raison au vendeur, dans le cas du réméré, de tous les fruits perçus depuis ces offres, quoiqu’elles n’aient pas été suivies de consignation. L’acheteur ne doit pas profiter de sa demeure, et des mauvaises contestations qu’il a faites sur la demande de réméré, pour se conserver la jouissance d’un héritage qu’il était obligé de délaisser aussitôt que la demande lui en a été faite. Il ne peut pas se plaindre d’être, pendant le temps qu’a duré le procès, privé tout à la fois de la jouissance de l’héritage et du prix, puisqu’il n’a tenu qu’à lui de recevoir le prix qui lui était offert, et de ne pas faire de procès ».
-
7.
C. civ., art. 549. L’on peut cependant préciser que l’article 549 prévoit que seul le possesseur de bonne foi fait les fruits siens. Par conséquent seul doit restituer les fruits le possesseur de mauvaise foi. Or si l’on considérait que la seule manifestation de volonté du vendeur d’exercer le réméré lui avait retransféré la propriété, l’acquéreur ne serait plus de bonne foi (sachant désormais qu’il possédait le bien d’autrui) et devrait dès lors les restituer. En estimant donc que les fruits revenaient à l’acheteur jusqu’au complet paiement des sommes par le vendeur, la Cour de cassation considère que jusqu’à cette date l’acheteur était un possesseur de bonne foi et, partant, que le transfert de propriété n’avait pu se produire par la seule manifestation de volonté d’exercer le réméré.
-
8.
Planiol M. et Ripert G., Traité pratique de droit civil français, t. X, Contrats civils, 1re partie, 1932, LGDJ, n° 207.
-
9.
Guillouard L., Traités de la vente et de l’échange, t. 2, 1890, n° 664, estime que l’offre de payer les sommes n’est même pas nécessaire : « des offres, même verbales, et à plus forte raison des offres réelles, sont inutiles, et (…) il suffit, pour éviter la déchéance de l’article 1662, que le vendeur ait manifesté n’importe comment sa volonté d’exercer le réméré, sauf à payer plus tard à l’acheteur les sommes qu’il lui doit par suite de cet exercice ». Il précise néanmoins au point suivant que « la volonté du vendeur de résoudre le contrat n’est efficace et ne peut produire effet qu’à la condition que le vendeur réalise les obligations que cette volonté lui impose. Jusque-là le contrat est en suspens : le droit du vendeur est sauvegardé par sa déclaration, mais la résolution n’est consommée que par le paiement, et s’il ne paie pas dans le délai qui lui sera imparti, il est définitivement déchu de son droit au réméré » ; Adde, Laurent F., Principes de droit civil, t. XXIV, 1887, n° 307, le vendeur « fait une déclaration de volonté ; il n’a donc rien à offrir ni à consigner. C’est seulement après que le contrat est résolu par sa déclaration, qu’il s’agira de procéder aux restitutions réciproques ».
-
10.
V. not. Troplong R.-T., Le droit civil expliqué, De la vente, t. 2, 5e éd., 1856, n° 723 : « Dans le système général du Code Napoléon, la volonté suffit pour former un contrat et pour déplacer la propriété. C’est ainsi que par l’article 1583 nous avons vu la vente parfaite par le consentement et la propriété transférée sans que la chose ait été livrée et prix payé. Est-il possible qu’il en soit autrement lorsqu’il s’agit de dissoudre le contrat de vente par l’effet du réméré ? Ce pacte contient une clause résolutoire dépendante de la volonté du vendeur. Il suffit donc que le vendeur témoigne de sa volonté de remettre les choses au même et semblable état qu’elles étaient avant la vente. Par là il use évidemment du droit du pacte de rachat, il ressaisit la chose, et de même qu’il l’avait aliénée par son consentement seul, de même il la recouvre par un consentement contraire, manifesté en temps utile. Quant au paiement et à la remise de la chose, ce sont là des actes d’exécution qui peuvent ne venir qu’après le délai de grâce ».
-
11.
Cass. req., 5 févr. 1856 : DP 56, 1, p. 132 ; Adde, Laurent F., Principes de droit civil, t. XXIV, 1887, n° 396, « La faculté de rachat est une condition résolutoire, mais potestative ; la condition est expresse, puisqu’elle est écrite au contrat. (…). Elle opère de plein droit ; le contrat est résolu par la seule volonté des parties contractantes (…). Le caractère potestatif de la condition exerce une influence sur la manière dont la condition opère ; elle exige une manifestation de volonté, puisque la condition consiste dans un acte de volonté. Ainsi la faculté de rachat donne un droit au vendeur, il peut user du pacte ou n’en pas user ; il faut donc, pour que la condition se réalise, qu’il déclare sa volonté d’exercer son droit. Dès que le vendeur a fait cette déclaration, la condition est accomplie et, partant, la vente est résolue, avec une restriction toutefois, c’est que le vendeur est tenu à certaines obligations. (…). Mais, à notre avis, l’exécution de ces obligations réciproques ne constitue pas la condition. C’est plutôt la suite de l’accomplissement de la condition ».
-
12.
Baudry-Lacantinerie G. et Saignat L., Traité théorique et pratique de droit civil, De la vente et de l’échange, 1900, n° 617.
-
13.
V. not. Toullier C.-B.-M. et Duvergier J.-B., Le droit civil français suivant l’ordre du Code, t. XVII, Continuation, t. II, 1835, n° 27 : « La vente à réméré est une vente résoluble sous condition, c’est-à-dire dont l’existence dépend d’un événement futur et incertain ; cet événement quel est-il ? C’est la restitution, par le vendeur, et dans un délai fixé, du prix principal et le remboursement de certaines prestations. Or la condition sera censée défaillie si le temps expire, sans que l’événement soit arrivé, c’est-à-dire sans que le remboursement ait eu lieu ».
-
14.
Guillouard L., Traités de la vente et de l’échange, t. 2, 1890, n° 665 : « la volonté du vendeur de résoudre le contrat n’est efficace et ne peut produire effet qu’à la condition que le vendeur réalise les obligations que cette volonté lui impose. Jusque-là le contrat est en suspens : le droit du vendeur est sauvegardé par sa déclaration, mais la résolution n’est consommée que par le paiement, et s’il ne paie pas dans le délai qui lui sera imparti, il est définitivement déchu de son droit au réméré ».
-
15.
Cass. req., 14 janv. 1873 : S. 1873, I, p. 134 ; D. 1873, I, p. 185.
-
16.
Cass. req., 19 oct. 1904 : DP 1904, p. 426 – Adde, Cass. 3e civ., 20 déc. 2006, n° 06-13078 : « la cour d’appel (…) a énoncé à bon droit qu’il résultait de la combinaison des articles 1659 et 1673 du Code civil que la vente n’était pas résolue et que l’acquéreur restait propriétaire tant que le vendeur n’avait pas satisfait à l’obligation de rembourser le prix et les frais qui lui incombait du fait de l’usage du pacte de rachat ».
-
17.
En ce sens, v. Planiol M. et Ripert G., Traité pratique de droit civil français, t. X, Contrats civils, 1re partie, 1932, LGDJ, n° 207.
-
18.
Contra, Witz C. et Gérardin L., JCl. Notarial formulaire 2013, V° Réméré, n° 118, « On peut tout de même regretter, sur un plan davantage théorique que pratique, la dissociation juridique entre l’exercice du réméré stricto sensu et la résolution consécutive qu’aucun des articles régissant la vente à réméré n’autorise. Le pragmatisme de la solution jurisprudentielle qui aboutit à une sanction originale de la défaillance du vendeur, heurte aussi le principe général du consensualisme en matière de transfert de propriété ».
-
19.
Carbonnier J., obs. sous Cass. civ., 23 févr. 1949 : RTD civ. 1950, p. 196.
-
20.
Cass. com., 28 juin 1965 : Bull. civ. IV, n° 405.
-
21.
Cass. soc., 27 mars 2017, nos 11-23168 et 11-23169.
-
22.
Selon la définition de la condition potestative retenue par l’article 1304-2 du Code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. L’on peut noter à cet égard que selon certains auteurs, la formulation de ce nouvel article, ne distinguant pas la condition suspensive de la condition résolutoire, serait de nature à remettre en cause la validité des clauses de réméré ; en ce sens, v. par ex. Chénedé F., Le nouveau droit des contrats et des obligations, Consolidations – innovations – perspectives, 2e éd., 2018, Dalloz, n° 211.42.
-
23.
Cass. 2e civ., 2 avr. 2009, n° 07-14900.
-
24.
On les inscrit souvent dans la perspective d’une « Formation échelonnée » du contrat (Puig P., Contrats spéciaux, 7e éd., 2017, Dalloz, HyperCours, n° 124, p. 145 ; l’auteur souligne) ou d’un « (…) contrat par étapes » (Terré F., Simler P., Lequette Y. et Chénedé F., Droit civil, Les obligations, 12e éd., 2019, Dalloz, Précis, n° 246 et s., p. 272 et s., spéc. n° 254 et s., p. 282 et s.).
-
25.
Cass. 3e civ., 6 déc. 2018, n° 17-23321 : D. 2019, Pan., p. 279, obs. Mekki M. ; D. 2019, p. 294, note Tisseyre S. ; AJCA 2019, p. 79, note Pillet G. ; Dr. sociétés 2019, comm. 42, note Mortier R. ; Constr.-Urb. 2019, comm. 12, note Sizaire C. ; Gaz. Pal. 22 janv. 2019, n° 339x9, p. 21, note Waltz-Teracol B.
-
26.
Pour le détail des faits, on pourra également se reporter à la décision d’appel : CA Fort-de-France, 25 avr. 2017, n° 15/00530.
-
27.
Cass. 3e civ., 6 déc. 2018, nos 17-21170 et 17-21171 : D. 2019, Pan., p. 279, obs. Mekki M. ; D. 2019, p. 298, avis Brun P. ; D. 2019, p. 301, note Mekki M. ; JCP E 2019, 1109, n° 9-10, note Mainguy D.
-
28.
Sans doute ces deux décisions s’avèrent-elles intéressantes à plusieurs titres. On nous autorisera cependant, compte tenu des multiples études déjà consacrées à ces arrêts, à nous focaliser sur le seul aspect mentionné au texte, qui nous paraît fonder l’axe d’une comparaison. Nous renverrons donc, pour les autres éléments, aux notes et observations précitées.
-
29.
Cornu G. (dir.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 11e éd., mise à jour 2015, PUF, Quadrige, V° Suspensif (terme) : « Évènement à la réalisation duquel est subordonnée l’exigibilité d’une obligation qui existe bien tant que le terme court, mais dont l’exécution ne peut être exigée jusqu’à l’arrivée du terme (…) » ; v. C. civ., art. 1185 anc. et s. ; Comp. C. civ., art. 1305 et s. (non applicables en l’espèce). Le recours au terme était explicite dans la seconde espèce ; il ressortait des prétentions des parties, et, implicitement, de l’organisation du litige dans la première espèce.
-
30.
La nature du droit d’option est discutée, mais la jurisprudence l’analyse traditionnellement comme un droit personnel : sur les éléments de ce débat, v. spéc. Bénac-Schmidt F., Le contrat de promesse unilatérale de vente, Préf. Ghestin J., t. 177, 1983, LGDJ, Bibliothèque de Droit privé, nos 137 et s., p. 112 et s., et les références citées ; Adde, modifiant la perspective pour placer l’analyse sur le terrain de la « norme contractuelle » : Ancel P., « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat, » RTD civ. 1999, p. 771, spéc. nos 21 et s.
-
31.
V. ainsi Terré F., Simler P., Lequette Y. et Chénedé F., Droit civil, Les obligations, 12e éd., 2019, Dalloz, Précis, n° 260, p. 291 : « Parmi les différents avant-contrats qui préparent la conclusion du contrat définitif, le pacte de préférence constitue la figure la moins contraignante, au point qu’on a pu parler à son propos d’“avant avant-contrat” ».
-
32.
Sur ce point, v. not. Ghestin J. (dir.), Traité de droit civil, La formation du contrat, t. I : « Le contrat – Le consentement », par Ghestin J., Loiseau G. et Serinet Y.-M., 4e éd., 2013, LGDJ, nos 807 et s., p. 582 et s. et nos 812 et s., p. 586 et s. ; Mignot M., JCl. Civil Code, « Fasc. unique : Contrat. – Formation du contrat. – Pacte de préférence », Art. 1123, nos 42 et s. et nos 61 et s.
-
33.
Ibid.
-
34.
Cass. 3e civ., 10 mai 1984, n° 82-17079 : Bull. civ. III, n° 96 ; JCP 1985, II 20328, note Dagot M. ; Defrénois 1985, p. 1234, note Olivier J.-M.
-
35.
Nous avons constaté après l’achèvement de ce commentaire que cette comparaison avait déjà été exploitée par M. Pillet (Pillet G., note préc.). Nous invitons donc le lecteur à comparer les propos qui suivent, au texte, avec le travail de cet auteur.
-
36.
C. civ., art. 1589, al. 1er : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ».
-
37.
V. ainsi C. rur., art. L. 412-1, al. 1er : « Le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s’il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente ».
-
38.
Selon MM. Ghestin, Loiseau et Serinet, Traité de droit civil, La formation du contrat, Ghestin J. (dir.), t. I, 4e éd., 2013, LGDJ, n° 808, p. 583-584, « (…) l’objet direct du pacte de préférence étant de conférer une priorité de rang dans la perspective de la conclusion éventuelle d’un contrat futur, il peut être considéré que seuls sont empêchés, pour garantir ce droit de préférence, les actes susceptibles de l’affecter en soi, en conférant à un tiers un droit de préférence de meilleur rang » ; au nombre desquels les auteurs classent le bail rural (ibid.).
-
39.
Selon la présentation doctrinale classique du mécanisme, en concluant la promesse « Le promettant a d’ores et déjà donné son consentement à la vente tandis que le bénéficiaire ne s’est pas engagé à acheter (…) » (Puig P., Contrats spéciaux, 7e éd., 2017, Dalloz, HyperCours, n° 178, p. 180).
-
40.
Rappr. Pillet G., note préc. ; Adde C. civ., art. 1123, al. 1er (non applicable en l’espèce) : « Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter ».
-
41.
V. ainsi Cass. 2e civ., 1er févr. 2006, n° 05-12254.
-
42.
Cass. 3e civ., 23 juin 1981, n° 80-11425 : JCP 1983, II 19928, note Pillebout J.-F.
-
43.
C. civ., art. 1583 : La vente « (…) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
-
44.
En ce sens, v. Ghestin J. (dir.), Traité de droit civil, La formation du contrat, t. I, 4e éd., 2013, LGDJ, n° 826, p. 601-602, spéc. p. 602.
-
45.
Cass. 1re civ., 24 févr. 1987, n° 85-13682 : Bull. civ. I, n° 66 ; JCP N 1987, II 165, note Pillebout J.-F.
-
46.
Cass. 3e civ., 28 janv. 2009, n° 08-12649 : Bull. civ. III, n° 27 ; D. 2009, Pan., p. 2300, obs. Mallet-Bricout B. ; RTD civ. 2009, p. 346, note Revet T. ; JCP N 2009, 1250, n° 35, note Deville S.
-
47.
V. supra.
-
48.
Sur ce thème, v. not. Ghestin J. (dir.), Traité de droit civil, La formation du contrat, t. I, 4e éd., 2013, LGDJ, nos 812 et s., p. 586 et s. ; Mignot M., JCl. Civil Code, « Fasc. unique : Contrat. – Formation du contrat. – Pacte de préférence », nos 75 et s.
-
49.
V. par ex. Cass. 1re civ., 16 juill. 1985, n° 84-13745 : Bull. civ. I, n° 224 ; RTD civ. 1987, p. 88, obs. Mestre J. ; JCP 1986, II 20595, note Dagot M.
-
50.
V. Puig P., Contrats spéciaux, 7e éd., 2017, Dalloz, HyperCours, n° 143, p. 157.
-
51.
Cass. ch. mixte, 26 mai 2006, n° 03-19376 : D. 2006, Pan., p. 2638, obs. Amrani-Mekki S. ; D. 2006, p. 1861, note Gautier P.-Y. ; D. 2006, p. 1864, obs. Mainguy D. ; Rev. sociétés 2006, p. 808, obs. Barbièri J.-F. ; RTD civ. 2006, p. 550, obs. Mestre J. ; JCP E 2006, 2378, note Delebecque P. ; JCP 2006, II 10142, note Leveneur L. ; JCP N 2006, 1256, note Thullier B. ; Gaz. Pal. 5 sept. 2006, n° G1894, p. 11, note Bérenger F. ; Gaz. Pal. 27 juill. 2006, n° G1664, p. 12, note Dagorgne-Labbe Y.
-
52.
V. déjà Cass. 3e civ., 13 juill. 2017, n° 16-17625 : D. 2018, Pan., p. 371, obs. Mekki M. ; RDC déc. 2017, n° 114s0, p. 40, note Chauviré P.
-
53.
Cass. 3e civ., 15 déc. 1993, n° 91-10199 : Bull. civ. III, n° 174 ; D. 1994, p. 507, note Bénac-Schmidt F. ; D. 1994, p. 230, obs. Tournafond O. ; D. 1995, p. 87, note Aynès L. ; AJDI 1996, p. 568, note Stapylton-Smith D. ; RTD civ. 1994, p. 584, obs. Mestre J. ; AJDI 1994, p. 351, note Azencot M. ; JCP 1995, II 22366, note Mazeaud D. ; Defrénois 15 juin 1994, n° 35845-61, p. 795, obs. Delebecque P.
-
54.
Brun P., avis préc. Il importe de souligner, avec MM. Chantepie et Latina, qu’« à suivre les dispositions transitoires de l’ordonnance du 10 février 2016, les promesses unilatérales de contrat conclues avant le 1er octobre 2016 devraient rester soumises à la jurisprudence Cruz, tandis que celles conclues après le 1er octobre 2016 seront régies par l’article 1124 du Code civil », sans exclure qu’une mise en conformité puisse advenir par voie d’interprétation (Chantepie G. et Latina M., Le nouveau droit des obligations, Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., 2018, Dalloz, n° 265, p. 229).
-
55.
Brun P., avis préc.
-
56.
C. civ., art. 1124, al. 2 : « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ».
-
57.
Mekki M., « Réforme des contrats et des obligations : la promesse unilatérale de contrat », JCP N 2016, Act. 1071, n° 40 ; du même auteur, AJCA 2017, p. 462 ; du même auteur, obs. préc. sur cet arrêt, D. 2019, p. 279 et note préc. sous cet arrêt, D. 2019, p. 301.
-
58.
Mekki M., obs. préc. sur cet arrêt, D. 2019, p. 279 et note préc. sous cet arrêt, D. 2019, p. 301.
-
59.
V. déjà C. civ., art. 1221 : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier » (nous soulignons). Rappelons que la sanction de l’exécution forcée en nature n’a pas valeur de principe dans le dispositif réformé : v. ainsi rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, p. 16 : l’article 1217 du Code civil « (…) énumère en son premier alinéa l’ensemble des sanctions à la disposition du créancier d’une obligation non exécutée. L’ordre de l’énumération n’a aucune valeur hiérarchique, le créancier victime de l’inexécution étant libre de choisir la sanction la plus adaptée à la situation » (nous soulignons).
-
60.
Brun P., avis préc., qui considère que : « (…) les éventuels états d’âme postérieurs du promettant ne devraient pas être pris en compte et sa rétractation devrait être purement et simplement ignorée. Peu importe en outre que comme en l’espèce, la révocation intervienne à un moment où le bénéficiaire n’était pas en mesure d’exercer l’option : on serait même tenté de dire que l’irrévocabilité de l’engagement du promettant est alors d’autant plus indispensable qu’à ce moment, le bénéficiaire pourtant titulaire d’un droit potentiel d’option n’est pas encore en mesure de l’exercer… ». Et l’auteur de noter ensuite la rectification opérée par l’article 1124, alinéa 2 du Code civil, « (…) quitte à observer avec le demandeur au pourvoi, qui s’emploie à en tirer parti, qu’une interprétation littérale du texte porterait à considérer que la révocation n’est neutralisée qu’autant qu’elle intervient pendant que l’option est pendante, une restriction échappant pourtant à toute justification » (ibid. ; nous soulignons).
-
61.
On peut cependant noter, au passage, qu’une telle solution, adoptée sur le plan de la promesse unilatérale, ne serait pas sans rapprocher le régime de cet avant-contrat de celui de l’offre, qui se trouve elle-même librement rétractable tant que son destinataire n’est pas en mesure de l’accepter (C. civ., art. 1115).
-
62.
Comp. Mainguy D., note préc.
-
63.
V. cependant Mainguy D., « L’efficacité de la rétractation de la promesse de contracter », RTD civ. 2004, p. 1.
-
64.
C. consom., art. L. 331-1 et s.
-
65.
Blandin Y., « Appréciation des engagements de la caution personne physique : précision », Dalloz actualité 5 déc. 2018 ; Cattalano G., « Encore l’appréciation de la disproportion : les cautionnements nuls ne comptent pas », LEDC janv. 2019, n° 116z6, p. 3 ; Legeais D., « Cautionnement disproportionné : il ne peut être tenu compte d’un cautionnement antérieur anéanti rétroactivement », JCP E 2019, 1007 ; Mignot M., « La disproportion en cas de cautionnement antérieur annulé », LEDB janv. 2019, n° 111w6, p. 6 ; Séjean M., « Quatre moyens et une cassation partielle : le créancier cautionné ne perd plus toujours à la fin », BJS févr. 2019, n° 119m1, p. 45.
-
66.
C. consom., art. L. 333-2 : « Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ».
-
67.
Cass. com., 27 mars 2012, n° 10-20077 : JCP G 2012, 636, Boucard F. ; RD bancaire et fin. 2012, comm. 114 Crédot F.-J. et Samin T. ; D. 2012, p. 1455, Dammann R. et Rapp A. ; LPA 10 mai 2012, p. 9, Dadoun A. ; Demeyère D. ; Rev. proc. coll. 2012, étude 25 ; BJE mai 2012, n° 79, p. 176, Favario T. ; LPA 24 juill. 2012, p. 18, Garaud E. ; JCP E 2012, 1274 ; RTD com. 2012, p. 384, Legeais D. ; RLDC 2012, n° 96, Netter E. ; JCP E 2012, 635, Piedelièvre S. ; BJS juin 2012, n° 256, p. 493, Pétel P. ; RLDA 2012, n° 73, Robine D. ; Rev. sociétés 2012, p. 398, Roussel-Galle P. ; Gaz. Pal. 4 août 2012, n° J6004, p. 16, note Routier R.
-
68.
Cass. com., 22 janv. 2013, n° 11-22831.
-
69.
Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-24400.
-
70.
Crocq P., « Chronique de droit des sûretés », D. 2018, p. 1884.
-
71.
Cass. 3e civ., 9 juill. 2008, n° 07-10926.
-
72.
Article 11 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées qui a créé un nouvel article 1317-1 du Code civil (aujourd’hui l’alinéa 3 de l’article 1369 du Code civil). Désormais, l’alinéa 3 de l’article 1369 du Code civil dispose au sujet de l’acte authentique que « lorsqu’il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ».
-
73.
C. civ., art. 1374.
-
74.
Cass. com., 20 sept. 2017, n° 12-18364.
-
75.
CE, 3e-8e ch. réunies, 25 mai 2018, n° 406332.
-
76.
Article 134 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : La première phrase du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigée : « La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article » ; sur cette loi, v. Damas N., « La loi ELAN et les baux d’habitation », AJDI 2019, p. 26 ; Vial-Pedroletti B., « La loi Élan et le bail d’habitation », Loyers et copr. 2019, dossier 2.
-
77.
La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l’égalité et à la citoyenneté, avait déjà supprimé l’exigence.
-
78.
Voir sur ce point, Juillet C., « La fin de la mention manuscrite ad validitatem dans le cautionnement des dettes locatives », RLDC 2019, n° 166. À moins que, comme le soulève l’auteur, le cautionnement de baux d’habitation par une personne physique reste soumis aux exigences des articles L. 331-1 et L. 341-1 du Code de la consommation qui imposent toujours la mention manuscrite et pourraient donc rendre sans application la disposition de la loi Elan lorsque le bailleur peut être qualifié de professionnel.
-
79.
Dans ce sens, Juillet C., « La fin de la mention manuscrite ad validitatem dans le cautionnement des dettes locatives », RLDC 2019, n° 166.
-
80.
V. en ce sens, Gouëzel A., « Mention manuscrite et cautionnement d’un bail d’habitation : entre étonnement et interrogations », D. 2018, p. 2380, spéc. n° 7 ; Juillet C., « La fin de la mention manuscrite ad validitatem dans le cautionnement des dettes locatives », RLDC 2019, n° 166, spéc. n° 7.
-
81.
La réforme des sûretés est envisagée dans le projet de loi PACTE qui habilite le gouvernement à modifier le régime des sûretés par ordonnance. L’avant-projet est consultable sur le site de l’Association Henri Capitant ; v. également, Grimaldi M., Mazeaud D. et Dupichot P., « Présentation d’un avant-projet de réforme des sûretés », D. 2017, p. 1717.
-
82.
Article 2301 de l’avant-projet de réforme : « Le cautionnement souscrit par une personne physique est réductible s’il était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, à moins que celle-ci, au moment où elle est appelée, ne soit en mesure de faire face à son obligation ».
-
83.
Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-24812.
-
84.
Cass. com., 17 oct. 2018, n° 17-21857.
-
85.
Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-25651.
-
86.
C. consom., art. L. 332-1 : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
-
87.
Cattalano G., « Encore l'appréciation de la disproportion : les cautionnements nuls ne comptent pas », LEDC janv. 2019, n° 111z6, p. 3.
-
88.
Cass. com., 28 févr. 2018, n° 16-24841.
-
89.
Cass. com., 17 oct. 2018, n° 17-21857.
-
90.
Cass. com., 29 sept. 2015, n° 13-24568.
-
91.
Cass. com., 5 févr. 2013, n° 12-11720.
-
92.
Il s’agit alors d’un moyen de défense au fond qui échappe à la prescription : Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-24092.
-
93.
Dans ce sens, Séjean M., « Quatre moyens et une cassation partielle : le créancier cautionné ne perd plus toujours à la fin », BJS févr. 2019, n° 119m1, p. 45.
-
94.
Pour une critique de ce texte, v. Gouëzel A. et Bougerol L., « Le cautionnement dans l’avant-projet de réforme du droit des sûretés : propositions de modification », D. 2018, p. 678.