À Bagnolet, un lieu pionnier pour accueillir les jeunes femmes violentées
C’est un lieu baigné de soleil, situé entre Bagnolet et Montreuil. Les murs sont de couleur pastel, la décoration acidulée. Sur la table du salon, un bocal est rempli de bonbons. Dans le couloir, les jeunes filles ou travailleuses sociales sont souriantes. Pourtant, sous ces dehors conviviaux, le lieu d’accueil et d’orientation, ouvert à Bagnolet depuis 18 mois, répond à une mission difficile : sortir les très jeunes femmes du cycle de la violence. Sa responsable, Amandine Maraval, ancienne éducatrice et ancienne chargée de la Mission droits des femmes à Bagnolet, nous a présenté ce lieu pionnier, unique en France.
Actu-Juridique : Pouvez-vous nous présenter le lieu d’accueil et d’orientation (LAO) ?
Amandine Maraval : Il s’agit d’un accueil de jour, sans hébergement, créé à titre expérimental pour 3 ans. Les retours des associations et les enquêtes sur les droits des femmes montraient que les femmes de moins de 25 ans étaient à la fois les premières victimes de violences et les dernières à aller vers les structures de droit commun.
Ces jeunes femmes sont souvent sans aucune ressource : elles sont trop jeunes pour avoir accès au RSA et, pour nombre d’entre elles, elles ont quitté un foyer violent qu’elles ne peuvent pas réintégrer. Tant qu’elles n’ont pas d’enfants, elles ne sont pas prioritaires dans les structures de droit commun. C’est rare de les y voir et quand par hasard elles y arrivent, elles ne sont pas à leur place. Elles ne s’identifient pas aux femmes qui sont là, qui sont plus âgées et ont des enfants. Elles n’ont pas envie de se projeter dans cet avenir-là. Elles restent donc dans leur situation de violence, ou si elles tentent de fuir, se retrouvent à la rue et se marginalisent. Quand, à 20 ans, on sort d’un système familial violent, on ne peut pas revenir en arrière. Le LAO permet d’éviter à des jeunes femmes de vivre à la rue.
Pour la première fois, un projet interdépartemental a été monté pour leur proposer un accompagnement spécifique. Paris et la Seine-Saint-Denis se sont réunies pour financer ce projet, soutenu également par l’État, des fonds européens, et la ville de Bagnolet qui a mis ces locaux à notre disposition.
AJ : C’est à ce jour le seul lieu en France dédié exclusivement à ces jeunes femmes. Comment l’expliquez-vous ?
A.M. : Nous espérons que d’autres ouvriront. Cela ne fait pas si longtemps qu’on parle des violences faites aux femmes. Distinguer les femmes en fonction de leur âge est quelque chose de clivant. Pourtant, chaque âge a sa spécificité. Il faut en tenir compte, et d’ailleurs la question ne se pose pas que pour les jeunes femmes. Quand on regarde dans le détail des victimes de féminicides, on voit que les femmes d’un certain âge de milieu rural sont surreprésentées. Elles ont du mal à partir. Ce n’est pas la même chose de quitter le domicile pour une jeune femme qui a encore des projets d’avenir que pour une femme d’un certain âge qui y a passé toute sa vie et y a tous ses souvenirs…
AJ : Quelle est la spécificité des jeunes femmes ?
A.M. : Nous recevons des femmes ayant des profils et des parcours variés, mais 84 % d’entre elles sont victimes de violences intrafamiliales. Beaucoup sont passées par les foyers de l’Aide sociale à l’enfance, et certaines ont erré dans la rue pendant des années. Contrairement aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale de Paris, nous accueillons également des jeunes femmes qui font de hautes études. Cela n’empêche pas qu’elles aient une histoire jalonnée de violences.
Les victimes de violences intrafamiliales sont fragilisées, elles n’ont pas le même seuil de tolérance que les autres et tombent plus facilement entre les griffes de conjoints violents, qui les repèrent. Certains hommes cherchent des femmes ayant une haute position sociale, que j’appelle « victimes de violences conjugales à haut potentiel ». En les cassant, ils arrivent à leur hauteur, et ont l’impression de s’élever. Ces jeunes femmes ont pour elles d’avoir une grande capacité de rebond. Elles savent qu’un avenir est possible. Même si certaines ont fait des tentatives de suicide, se mutilent ou ont des conduites à risques, elles y croient. Celles qui viennent à nous ont décidé d’en finir avec les violences.
AJ : En quoi ce lieu est-il adapté à ces jeunes femmes violentées ?
A.M. : Tout est pensé pour elles, depuis les locaux, qui sont très cocooning, jusqu’à la communication. On ne communique pas avec les plus jeunes comme avec leurs aînées. Ces dernières vont vers des structures de droit commun, elles vont se rendre chez l’assistante sociale ou au centre de quartier. On arrive à les toucher, à l’exception des victimes de milieux aisés, qui ne vont pas chez l’assistante sociale et subissent une emprise d’autant plus grande que leur conjoint a généralement du pouvoir, un réseau, et qu’il s’en sert pour exercer un chantage sur sa partenaire.
Pour parler aux jeunes femmes, nous passons par les réseaux : Facebook, Instagram, etc. Nous avons un partenariat avec #NousToutes et leur chat en ligne. Cela fonctionne. Au bout de 18 mois d’existence, la structure a atteint les résultats attendus lors de sa troisième année. Nous faisons une distinction entre celles qui viennent simplement pour un atelier ou demandent des contacts au téléphone, et nous comptons aujourd’hui 234 jeunes femmes accompagnées et près de 400 jeunes femmes accueillies.
AJ : Qui compose l’équipe du LAO ?
A.M. : Nous sommes quatre. C’est très peu pour accueillir autant de jeunes filles. Je suis une ancienne éducatrice. J’ai travaillé dans le milieu du handicap, dans celui de la prostitution, dans le domaine de la protection de l’enfance – qui n’a de protection que le nom –, et dans un centre d’hébergement d’urgence pour des femmes victimes de violences. Dans tous ces domaines, la question des violences conjugales doit être posée, et donne souvent une tout autre lecture aux situations. J’ai également été chargée de la Mission droits des femmes à la ville de Bagnolet.
Quand le LAO a ouvert, on m’a demandé d’en prendre la tête. J’ai une assistante qui, en plus de m’aider pour la gestion administrative, s’occupe du premier contact téléphonique et physique avec les jeunes filles. C’est hyper important. Si cela ne passe pas, la démarche de la jeune fille s’arrête net. Elle fait également des suivis individuels et anime tous les groupes collectifs. Nous avons aussi deux éducatrices spécialisées, et espérons en avoir bientôt quatre pour faire face à l’affluence. Nous proposons des permanences tenues par une psychologue, une conseillère conjugale et une juriste. Nous avons aussi, pour un an, une intervenante en développement personnel et professionnel. Nous devrions enfin avoir un médecin une fois par semaine.
AJ : Quels accompagnenements proposez-vous ?
A.M. : Le mercredi après-midi, nous proposons un café-débat. C’est un temps d’échange pour toutes les femmes de 15 à 25 ans, qu’elles soient ou non victimes de violences. Elles peuvent discuter, écouter de la musique. Elles créent du lien, et petit à petit, certaines vont pousser la porte des éducatrices pour leur demander de les accompagner.
Nous avons mis en place une prise en charge holistique des violences. Nous concentrons nos efforts sur ce sujet, que nous abordons de manière pluridisciplinaire. L’éducatrice, la psychologue, la juriste, se voient et travaillent de concert. C’est important car les victimes ont tendance à se disperser, et quand le suivi est éclaté ou, pire, que les professionnels se contredisent, elles le vivent mal.
La jeune femme est au cœur du projet d’accompagnement. On ne fait rien sans elle. Si une jeune majeure souhaite revenir au domicile conjugal et reprendre la vie commune avec un homme violent, elle le fait. On lui demande alors simplement de taire notre adresse. On lui explique que le jour où il se passera quelque chose – ce jour ne manquera pas d’arriver car l’expérience montre que les violences ne s’arrêtent pas –, elle pourra revenir et être accompagnée. On insiste sur le fait que si elle donne notre adresse, elle se privera de cette possibilité de repli dans un lieu sûr. Elles le comprennent et reviennent, à chaque fois. Cela peut paraître une approche audacieuse mais il nous semble fondamental de remettre cette jeune fille, qui a tant été mise à une place d’objet, en position de sujet. Nous essayons de tendre vers cela même pour les mineures, pour lesquelles nous devons faire un signalement ou une information préoccupante si on estime qu’elle prend un risque.
AJ : Quelle est votre mission ?
A.M. : Nous assurons une triple mission. En plus de l’accompagnement, nous proposons des formations pour les professionnels et promouvons une démarche d’empowerment pour les jeunes filles.
Notre premier rôle est de permettre le repérage des jeunes femmes victimes de violence. Nous assurons un soutien technique auprès des professionnels de terrain. Nous sommes en lien avec les enseignants, les éducateurs. Nous sommes en relation avec la coordination des établissements scolaires. Les missions locales peuvent nous appeler et nous dire quels sont leurs besoins. Nous ne pouvons pas intervenir partout mais nous connaissons toutes les associations qui œuvrent sur ces thématiques et pouvons les mettre en relation. Les enseignants peuvent conseiller à des jeunes filles de venir le mercredi après-midi pour assister au café-débat.
Enfin, passé la première phase de reconstruction, nous faisons un travail d’« empowerment ». Les jeunes femmes assistent aux activités du mercredi après-midi où on va déconstruire les idées reçues. On part du terrain, et on réfléchit ensemble. L’idée n’est pas de changer leur façon de penser mais de leur donner des outils pour nourrir leur réflexion. Elles prennent une place au sein d’un groupe, participent à des projets collectifs. Cela contribue à contrer la stratégie d’isolement de l’agresseur. Quand lui essaye de couper la jeune fille de ses proches, nous faisons en sorte qu’elle se fasse des copines. Quand il lui fait porter la responsabilité de la situation, nous lui rappelons le cadre légal. Elle reprend confiance en elle et repart plus outillée dans les espaces de droit commun.
AJ : Que pouvez-vous faire quand il faut les mettre à l’abri ?
A.M. : 75 % des jeunes femmes accueillies demandent à être mises en sécurité immédiatement. Cela implique de faire le lien avec les autres structures. La difficulté est qu’elles souhaitent être hébergées dans un lieu n’accueillant que des femmes, si possible jeunes. Or seul le Centre d’hébergement et d’action sociale accueille ce type de public, et il ne dispose que de 60 lits. Après le Grenelle des violences conjugales, on nous a demandé de gérer 49 places d’hébergement d’urgence. Je gère ce lieu dont l’adresse est tenue secrète, en plus du LAO. Cela nous permet de faire un lien entre les deux structures. Les lieux sont dissociés. À l’hôtel, les jeunes femmes peuvent penser à autre chose qu’aux violences. Cette période d’hébergement nous permet d’envisager la suite. Celles qui sont enceintes peuvent être réorientées en centre maternel, celles qui travaillent vers un foyer de jeunes travailleurs, voire en logement pérenne si elles gagnent bien leur vie. On a un mois et demi pour mettre les jalons. Même avec ce nouveau centre, les places manquent. J’ai une équipe d’acharnées qui trouve toujours des places, mais c’est une prouesse à chaque fois.
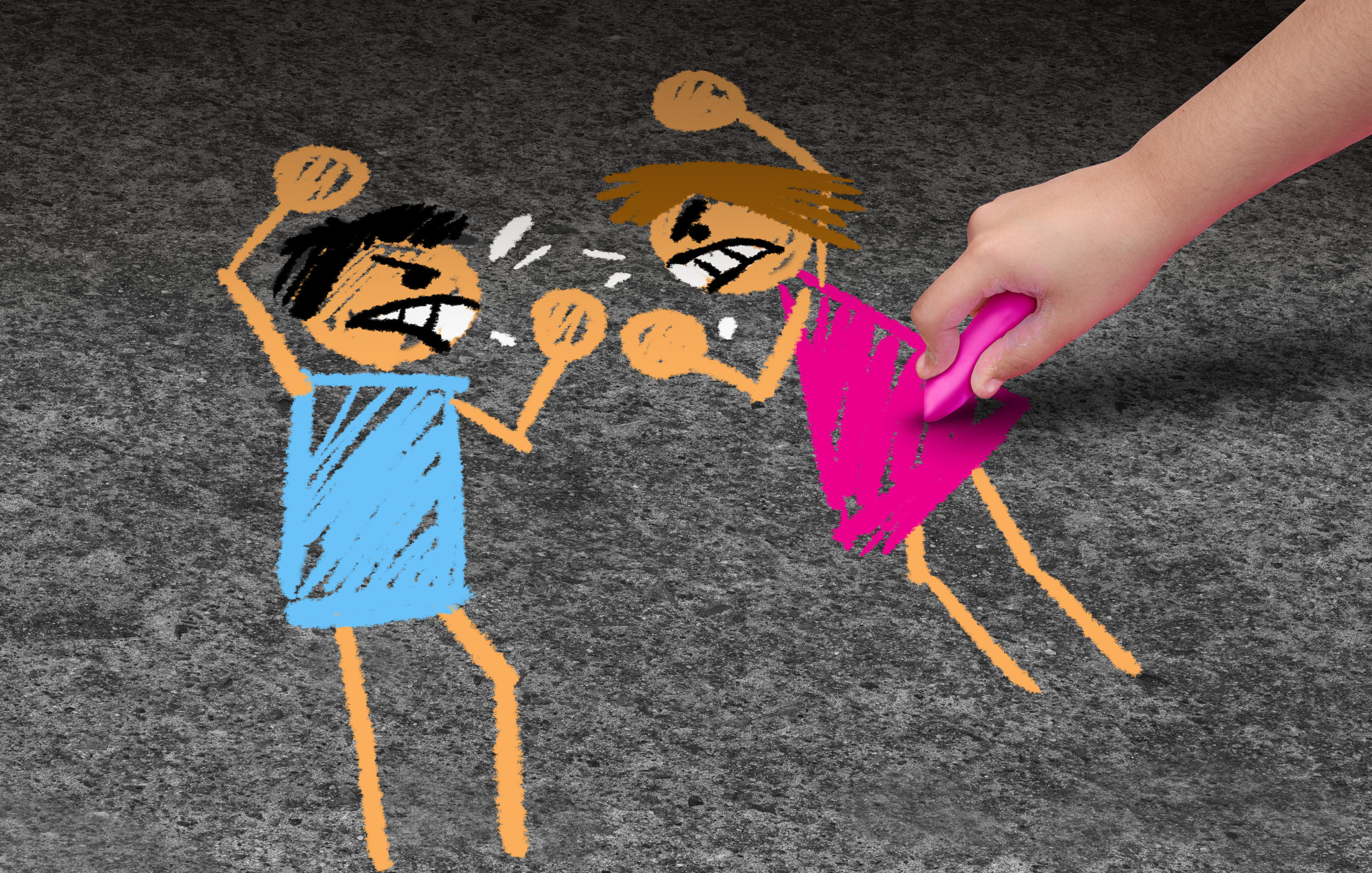
AJ : Le département de la Seine-Saint-Denis alerte sur les mariages forcés. Voyez-vous souvent des jeunes femmes dans cette situation ?
A.M. : Un tiers des jeunes filles que nous accueillons viennent en effet pour fuir un mariage forcé. Elles savent toutes qu’elles sont trop jeunes pour se marier, ne veulent pas l’être et connaissent la loi. Ce qui est difficile pour elles est de réaliser que ceux en qui elles ont confiance ne les protègent pas, et de faire honte à leur famille. Le regard de l’autre est très prégnant dans ces histoires. Des parents marient des jeunes filles qui ont été victimes de viol au premier venu pour que personne ne sache qu’elles ne sont plus vierges. Il arrive souvent que la jeune fille ne souhaite pas rompre avec sa famille, qu’elle parte faire sa vie un temps de son côté et renoue les liens ultérieurement.
AJ : Quelles sont les situations les plus difficiles à résoudre ?
A.M. : La prostitution est pour moi le point d’orgue des violences. Comme dans les situations de violences conjugales, l’emprise est très forte. Il est très difficile d’avoir accès aux jeunes femmes qui se prostituent. Qui dit prostitution dit souvent drogue. Elles sont influencées par la téléréalité et ont l’illusion d’une certaine liberté. La prostitution des jeunes femmes est en plein essor sur les réseaux sociaux. Au bout d’un an et demi d’activité, on commence tout juste à avoir accès à certaines jeunes femmes qui veulent en sortir.
AJ : Comment vivez-vous la crise sanitaire ?
A.M. : Le LAO a ouvert ses portes en septembre 2019. Le mouvement des Gilets jaunes a commencé juste après, suivi de la grève des transports puis de la crise sanitaire. Les allées et venues étaient si compliquées que j’ai dû loger une partie de l’équipe chez moi. Cela a consolidé la base. Pendant les trois premières semaines de confinement strict, en mars 2020, nous n’avons eu aucun appel. Les femmes avaient tellement peur du Covid qu’elles restaient chez elles, malgré la violence. Cela nous a laissé du temps pour nous organiser, alors que les hôtels étaient fermés. Et puis, elles ont toutes appelé en même temps, quand elles ont eu moins peur du virus. On les a retrouvées dans un état très critique. Elles attendaient la dernière minute pour partir, il fallait aller les chercher, leur donner des vêtement, trouver un hébergement. Il n’y a pas eu plus de violence sur cette période, mais il s’agissait de violences plus graves. La structure s’est depuis fait connaître et nous avons de plus en plus de monde depuis le mois de juillet dernier.
Référence : AJU000f7





