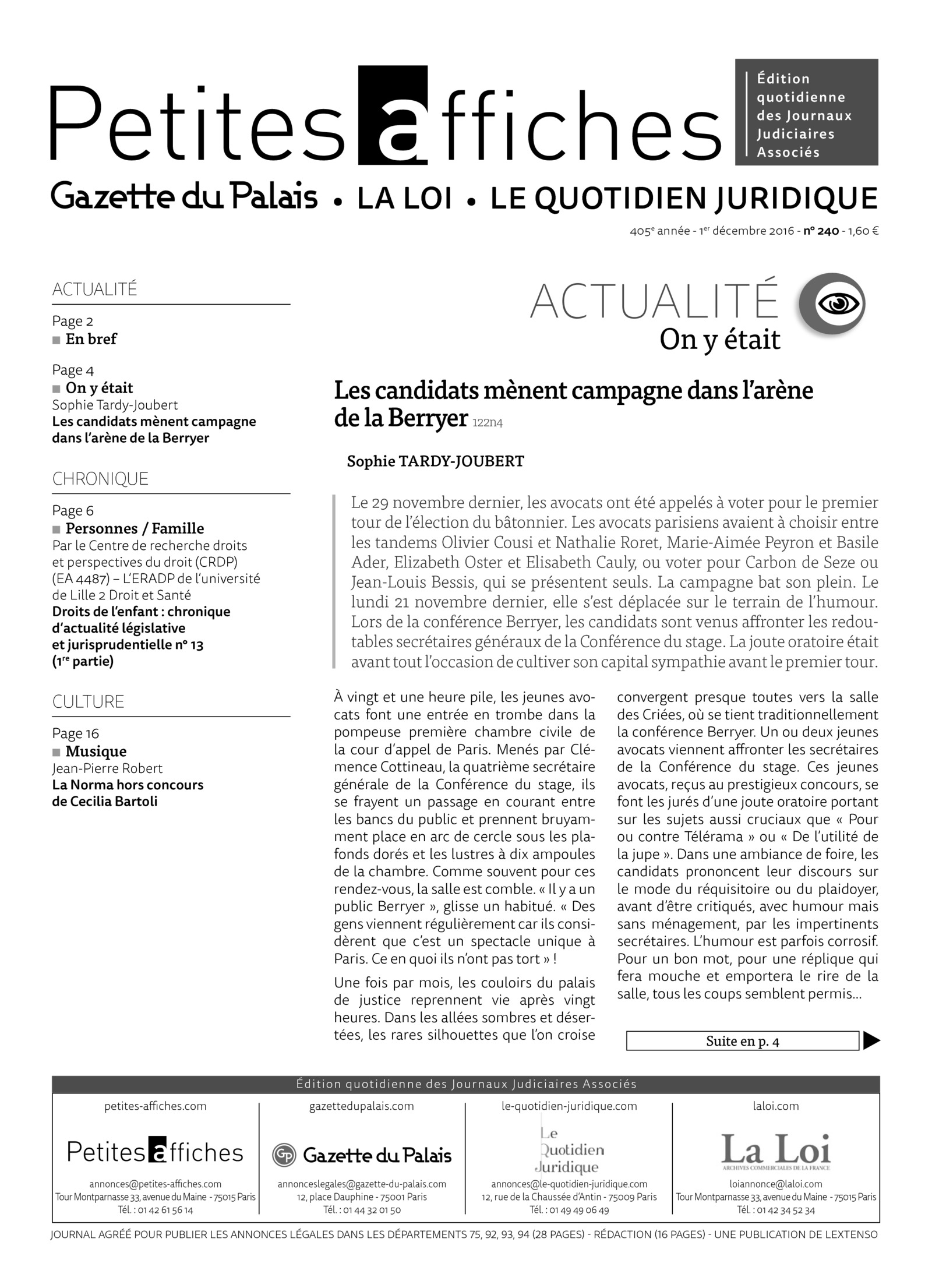Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 13 (1re partie)
En droit de la famille, l’office du juge connaît deux modalités différentes selon le type de contentieux : soit il se doit d’appliquer la loi qui intègre déjà la considération abstraite de l’intérêt de l’enfant, soit il doit se livrer à un contrôle concret de l’intérêt de l’enfant, qui conditionne l’application de la loi. Les décisions étudiées dans cette chronique nous offrent l’occasion de vérifier si le juge remplit correctement son office.
Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, no 14-23724, PB
BGH (Cour fédérale de justice allemande), 23 sept. 2015, n° XII ZR 99/14
CJUE, 3e ch., 16 juill. 2015, no C-184/14
Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, no 13-27983, PB
Cass. 1re civ., 28 mai 2015, no 14-16511, PB
Cass. 1re civ., 10 juin 2015, no 14-12592, PB
Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, no 14-22636, D
CA Paris, 18 juin 2015, no 15/00864
Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, nos 14-16425 et 14-24267, PB : RJPF 2015, 12/21, p. 33-34, note Meyzeaud-Garraud M.-C.
CA Toulouse, 7 juill. 2015, nos 15/673 et 14/06754
Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, no 14-15472, D
CA Caen, ch. civ. et com. 2, 22 oct. 2015, no 14/04093
Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, no 13-27586, PB
Cass. 1re civ., 10 juin 2015, nos 14-10377 et 14-12553, PB
Cass. 1re civ., 10 juin 2015, no 14-20790, D
CA Metz, 24 mars 2015, no 15/00165
Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, no 14-14702, PB
CA Reims, 13 mars 2015, no 14/01057
CA Colmar, 16 juin 2015, no 13/00995
Prolégomènes : Le contrôle de l’intérêt de l’enfant et l’office du juge
La précédente chronique1, à laquelle celle-ci fait écho, envisageait l’enfant comme sujet de droit actif (sujet de droit national, de droit européen et même de droit international) : l’enfant est titulaire de droits qu’il défend en justice. La présente chronique envisage l’enfant comme sujet passif – figure la plus courante en jurisprudence. L’enfant est bien sujet de droit, mais il n’agit pas lui-même : il est l’enjeu d’un litige entre adultes portant soit sur le gouvernement de sa personne, soit sur la gestion de son patrimoine, soit sur sa filiation. Il n’est alors plus tant question de l’effectivité des droits de l’enfant et du courage du législateur, que du contrôle de son intérêt et de l’office du juge.
Si le pragmatisme est une qualité appréciée chez le législateur, c’est a priori un défaut chez le juge qui se doit de rester légaliste. Toutefois, dans cette législation pédocentrique qu’est le droit de la famille, le législateur prescrit souvent au juge d’être pragmatique en soumettant l’application de la loi à l’intérêt de l’enfant que ce dernier apprécie souverainement, afin que sa décision soit la mieux adaptée à la situation. Ainsi, en droit de la famille, l’office du juge connaît deux modalités différentes selon le type de contentieux : soit il doit appliquer la loi, qui intègre déjà la considération abstraite de l’intérêt de l’enfant, soit il doit se livrer à un contrôle concret de l’intérêt de l’enfant, qui conditionne l’application de la loi. Les décisions étudiées dans cette chronique nous offrent l’occasion de vérifier si le juge remplit correctement son office…
1. Commençons, tout d’abord, par le contentieux du gouvernement de la personne de l’enfant. En ce domaine règne l’intérêt de l’enfant. Mais ce n’est qu’en cas de désaccord parental que le juge est amené à le contrôler. C’est que la loi accorde une confiance de principe aux parents légaux, confiance qui s’incarne dans le principe de coparentalité conçu comme une garantie pour l’enfant : le législateur investit chaque parent du rôle de contre-pouvoir, comptant sur l’opposition de l’un si l’autre envisage un acte jugé non conforme à l’intérêt de l’enfant. En somme, le principe de coparentalité repose sur une présomption : si la décision a été prise par les parents d’un commun accord, elle est présumée conforme à l’intérêt de l’enfant2.
Ce système légal, pragmatique, fait pleinement ses preuves, par exemple, dans cette affaire dans laquelle un père violent voulait faire baptiser ses deux enfants âgés de 6 et 7 ans contre la volonté de leur mère : la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du père, rappelant que « le conflit d’autorité parentale relatif au baptême des enfants devait être tranché en fonction du seul intérêt de ces derniers » (Cass. 1re civ., 23 sept. 20153). La loi permet au juge d’aller plus loin : en cas de désaccord parental, il peut écarter le principe de coparentalité, « si l’intérêt de l’enfant le commande », en ordonnant l’exercice unilatéral de l’autorité parentale par le parent dont l’appréciation de l’intérêt de l’enfant concorde avec celle du juge. Néanmoins, le juge pèche parfois par excès de pragmatisme, comme c’est le cas dans cette affaire où la mère, séparée du père, s’opposait à ce dernier quant aux mesures médicales à prendre pour identifier la nature du handicap dont l’enfant était atteint (la mère suspectant un trouble autistique et le père, un trouble de l’attention). Pour écarter la mère du pouvoir de décision, la cour d’appel ordonne, au bénéfice du père, la mesure radicale de l’exercice unilatéral de l’autorité parentale, au nom de l’intérêt de l’enfant, mais tout en prononçant une mesure de résidence alternée, au nom de ce même intérêt de l’enfant4 ! À l’incohérence, que la Cour de cassation ne relève pas, s’ajoute la confusion, quant à elle sanctionnée par la cassation : pour déterminer la part contributive maternelle à l’entretien de l’enfant, les juges du fond avaient tenu compte des ressources du riche concubin de la mère, alors que seules importaient les ressources de celle-ci, sans profession. C’était faire du concubin de la mère un débiteur alimentaire de l’enfant, en dehors de tout lien de filiation (Cass. 1re civ., 21 oct. 20155).
Confusion pour le juriste français… mais pragmatisme pour le juge allemand. Se prononçant sur l’obligation d’entretien d’un enfant issu d’une insémination artificielle hétérologue, le Bundesgerichtshof6 condamne l’homme qui a consenti à l’insémination au paiement d’aliments pour l’entretien de l’enfant qui en est issu, comme s’il en était le père légal, en l’absence de tout lien de filiation (BGH, 23 sept. 20157). À ce pragmatisme assumé du juge suprême allemand, on est tenté de rapprocher celui, non moins assumé, du juge communautaire. Il est vrai que, dans l’affaire considérée, il eût été difficile pour lui de jouer la carte du légalisme tant l’articulation des textes applicables – résultat du processus d’européanisation du droit international privé de la famille – est problématique. Cela n’enlève rien au mérite de la CJUE qui a privilégié une interprétation des textes respectueuse de l’intérêt de l’enfant : est compétent, pour fixer la pension alimentaire due à l’enfant dont les parents divorcent, non pas le juge du divorce, mais le juge de la responsabilité parentale qui est le juge de la résidence habituelle de l’enfant, i.e. le juge le plus proche de l’enfant et qui maîtrise toutes les données du litige (de la garde de l’enfant aux aliments) (CJUE, 16 juill. 20158).
Cette parenthèse exotique refermée, lorsque le juge est saisi, il doit apprécier l’intérêt de l’enfant en vérifiant, notamment, l’absence d’instrumentalisation par ses parents. Donner la parole à l’enfant est un moyen de démasquer cette instrumentalisation et c’est l’une des raisons pour lesquelles le législateur accorde à l’enfant un droit d’expression dans toute procédure le concernant (C. civ., art. 388-1). Mais de là à ce que le juge qui ordonne un droit de visite délègue ses pouvoirs à l’enfant en subordonnant l’exécution de la mesure à son bon vouloir, il y a un pas que la Cour de cassation refuse de franchir de jurisprudence constante (Cass. 1re civ., 28 mai et Cass. 1re civ., 23 sept. 20159). Il est vrai, à leur décharge, que les juges du fond sont en prise directe avec le réel : comment contraindre un adolescent à entretenir des relations avec le parent qu’il rejette ? C’est ce même souci de réalisme qui anime les juges qui subordonnent l’exécution du droit de visite « médiatisé » aux habitudes de fonctionnement du service désigné, conscients qu’ils sont des difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux espaces de rencontre, particulièrement sollicités par les juridictions. Pour autant, le juge du droit censure systématiquement de telles délégations de pouvoirs : il y a là aussi un excès de pragmatisme du juge (Cass. 1re civ., 28 janv. et 10 juin 201510).
La lutte contre l’instrumentalisation de l’intérêt de l’enfant passe parfois, pour le juge, par un rappel aux « fondamentaux » adressé à certains parents épris d’égalitarisme : ce qui constitue l’âme du principe de coparentalité, c’est l’intérêt de l’enfant, et non pas l’égalité des parents. C’est tout le sens de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 juin 201511 rendu dans une affaire assez particulière opposant un père et une mère – ayant eu recours à un site de « coparentalité » pour concevoir et élever ensemble un enfant en dehors de toute relation de couple – dans un conflit parental portant sur diverses questions quotidiennes. Selon les juges parisiens, le principe de coparentalité « n’est pas un concept déconnecté de toute réalité, imaginé pour satisfaire les revendications égalitaires des adultes ». Le principe de coparentalité « déconnecté » de l’intérêt de l’enfant dénie effectivement à l’enfant le statut du sujet de droit pour le réduire à celui d’objet de droit.
Jusque-là, nous n’avons envisagé que le cas de l’enfant élevé par ses deux parents légaux. Quid en cas de défaillance des père et mère de l’enfant ? Le principe de coparentalité est nécessairement hors-jeu, l’enfant étant pris en charge, notamment, par des substituts parentaux publics. Prennent alors le relais d’autres mécanismes légaux, comme les droits de recours attribués à certaines catégories de personnes pour contrebalancer les pouvoirs accordés aux substituts. Ces droits sont institués par la loi en considération de l’intérêt de tout enfant privé de parents : il suffit au juge d’appliquer la loi ; autrement dit, il ne peut ouvrir un droit de recours à telle personne parce que tel serait l’intérêt de cet enfant particulier. Malheureusement, le législateur n’est pas toujours cohérent… On saluera l’interprétation audacieuse, par le juge toulousain, des articles 1239-3 du Code de procédure civile et 430 du Code civil à la lumière du CASF, lui permettant de justifier la recevabilité de l’appel exercé par la famille d’accueil relais d’une enfant pupille de l’État contre la décision par laquelle le conseil de famille avait rejeté leur requête en adoption plénière, au mépris évident de l’intérêt de l’enfant (CA Toulouse, 7 juill. 201512). Espérons que la Cour de cassation valide cette interprétation pragmatique de la loi.
Si le contrôle concret de l’intérêt de l’enfant n’a guère sa place dans l’examen de la recevabilité du recours, il réapparaît au stade de l’examen de son bien-fondé. Ainsi, l’article L. 224-8 V du CASF subordonne l’annulation de l’arrêté d’admission de l’enfant comme pupille de l’État à l’intérêt de l’enfant que le juge apprécie souverainement. C’est donc peine perdue pour cette grand-mère qui voulait se voir confier la garde de l’enfant… qu’elle n’avait pas vue depuis presque quatre ans ! Elle ne bénéficiera que d’un droit de visite parce que, justement, tel est l’intérêt de l’enfant en l’espèce (Cass. 1re civ., 23 sept. 201513).
Quid en cas de défaillance partielle de l’un des parents qui rechigne à verser à l’autre parent la pension alimentaire due au titre de l’obligation d’entretien ? Les pouvoirs publics prennent le relais en versant au parent qui a la charge effective de l’enfant l’allocation de soutien parental sous forme d’avance. La CAF est alors subrogée dans les droits du créancier et gare au parent s’il réussit à obtenir le recouvrement de la contribution litigieuse auprès du parent récalcitrant, après avoir sollicité les services d’un huissier ! La CAF est prioritaire et peut récupérer sur le créancier les sommes versées au titre de l’ALS (Cass. 2e civ., 9 juill. 201514). Et peu importe l’établissement d’un plan de surendettement au bénéfice du débiteur : la subrogation étant totale, la créance de la CAF est exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement (CA Caen, 22 oct. 201515). En cette matière, nul contrôle concret de l’intérêt de l’enfant par le juge : le pragmatisme du législateur allié au légalisme du juge assure la pleine efficacité de ce dispositif social.
2. Voyons, ensuite, le contentieux de la gestion du patrimoine de l’enfant. Tant qu’il n’est question que du gouvernement de la personne de l’enfant, le législateur fait confiance, pour apprécier l’intérêt de l’enfant, aux parents, à titre principal, et au juge, à titre subsidiaire (i.e. en cas de litige). La règle n’est plus aussi absolue lorsqu’il est question de la gestion du patrimoine de l’enfant. Certes, le législateur vient d’abandonner sa méfiance de principe à l’égard des parents exerçant seuls l’autorité parentale, en supprimant le contrôle judiciaire auquel ils étaient soumis. Cependant, il est à craindre que cet alignement du régime de la gestion du patrimoine de l’enfant sur celui du gouvernement de la personne de l’enfant ait eu raison du principe de coparentalité, principal garant de l’intérêt de l’enfant. Espérons que le juge sera suffisamment pragmatique pour gommer l’effet automatique de cette réforme égalitariste16.
C’est en revanche à une évacuation directe du contrôle concret de l’intérêt de l’enfant que l’on assiste dans le contentieux relatif à l’exclusion du parent de l’administration légale des biens de l’enfant qui hérite de l’autre parent – exclusion décidée par ce dernier de son vivant et résultant soit d’une clause d’administration des biens par un tiers, soit d’un mandat à effet posthume (Cass. 1re civ., 11 févr. et 10 juin 201517).
Que constate-t-on à la lecture de ces arrêts ? Les dernières dispositions du défunt ne sont pas motivées par le souci de l’intérêt de l’enfant (les tiers désignés ne sont pas plus compétents que le parent survivant en matière de gestion), mais par la volonté de régler ses comptes post-mortem avec l’ex-partenaire (hors de question que ce dernier profite du patrimoine que le défunt laisse à l’enfant par le biais de la jouissance légale !). Autant dire que le défunt instrumentalise le patrimoine de l’enfant pour faire perdurer le conflit conjugal par-delà la mort. Pas dupes, les juges du fond sont manifestement enclins à tenir compte de l’intérêt de l’enfant pour neutraliser la volonté du défunt d’évincer les règles légales de protection de l’enfant. Dans l’un des deux arrêts, la cour d’appel, prudente, n’invoque pas directement l’intérêt de l’enfant, mais dénie la qualification de legs qui conditionne l’efficacité de la clause litigieuse. Dans l’autre, la cour d’appel joue, pour justifier la révocation du mandat, sur la notion légale d’intérêt légitime et sérieux qui lui permet de réintroduire le contrôle de l’intérêt de l’enfant. Qu’à cela ne tienne : dans les deux affaires, la Cour de cassation a cassé les arrêts des juges du fond, faisant preuve d’un curieux pragmatisme pour sauver l’efficacité de la clause et du mandat litigieux : non seulement, la qualification de legs doit être retenue, ce qui est juridiquement discutable, mais en plus l’intérêt de l’enfant est soit hors-sujet, soit insuffisant à caractériser un intérêt légitime et sérieux. Bref : en matière patrimoniale, la volonté du défunt prime l’intérêt de l’enfant, évacué !
3. Abordons, enfin, le contentieux de la filiation de l’enfant. Ce thème a déjà été abordé dans la chronique maintes fois : à s’en tenir aux règles du Code civil, il n’est jamais question, pour le juge, d’effectuer un contrôle concret de l’intérêt de l’enfant. Plus généralement, l’établissement ou la contestation de la filiation d’un enfant ne saurait dépendre d’un quelconque contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence. Non pas que ceux-ci soient indifférents mais, en cette matière, le législateur entend garder la main : il procède lui-même à la pesée des intérêts, dont le résultat forme la substance de la règle de droit. Il s’agit donc nécessairement d’un contrôle abstrait des intérêts en présence, exclusif de tout contrôle concret par le juge.
Bien sûr, l’applicabilité directe de la Convention EDH et de la CIDE a changé la donne concernant l’office du juge. Longtemps réfractaire, le juge français se laisse petit à petit gagner par ces nouveaux modes de raisonnement qui impliquent, sur le terrain de l’article 8 de la Convention EDH, d’effectuer un contrôle de proportionnalité (hypothèse de l’enfant majeur), et sur le terrain de l’article 3-1 de la CIDE, de faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant (mineur). Ainsi, tout pousse le juge de la filiation à subordonner l’application de la loi au contrôle concret de l’intérêt de l’enfant.
Certains juges du fond résistent, comme dans cette affaire qui a donné lieu à l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 10 juin 201518. En l’espèce, la mère et l’enfant (majeur) souhaitaient détruire la filiation qui s’était établie automatiquement à l’égard du premier mari de celle-ci pour établir la filiation à l’égard du second mari, père biologique de l’enfant, décédé entre-temps. Malheureusement, l’action en contestation était vouée à l’échec car prescrite en application de l’article 333, alinéa 2 du Code civil. Qu’à cela ne tienne : la mère et l’enfant tentent leur chance en saisissant, sur le fondement de l’article 336, le ministère public, lequel accepte d’agir en contestation. La cour d’appel, en bon juge légaliste, rejette l’action, motif pris que le texte n’était à l’évidence pas applicable (ni indices rendant invraisemblable la filiation, ni fraude). Malgré cet argument de poids, la Cour de cassation casse la décision déférée. Certes, son arrêt n’a pas les honneurs d’une publication au Bulletin, mais sa lecture a de quoi surprendre : le juge d’appel aurait dû répondre aux conclusions des parties qui « faisaient valoir qu’un juste équilibre devait être ménagé, dans la mise en œuvre de l’article 8 de la Convention EDH, entre le droit revendiqué par l’enfant de voir établir sa filiation biologique et les intérêts des filles du père biologique décédé, qui opposaient un refus à ce qu’il hérite de ce dernier ». C’est donc que, pour la Cour de cassation, ces éléments étaient déterminants pour l’application de la loi.
Nul besoin de recourir à ce contrôle de proportionnalité pour évincer la prescription de l’action en recherche de paternité, lorsque la filiation de l’enfant majeur relève de la loi allemande. En effet, l’argument tiré de l’ordre public international français, intégrant l’intérêt de l’enfant (en l’occurrence celui de voir sa filiation véritable établie) au rang des principes fondamentaux qu’il garantit, ne s’oppose pas à l’application d’une loi étrangère plus libérale ne prévoyant aucun délai de prescription en matière de déclaration judiciaire de paternité (Cass. 1re civ., 7 oct. 201519). C’est également le raisonnement que la cour d’appel avait tenu, mais avec quelques scrupules : les demanderesses, précise-t-elle, ont de toute façon agi dans les dix ans du décès du père biologique, qui est le délai prévu par l’article 330 du Code civil concernant l’établissement de la filiation par la possession d’état. Digression hors-sujet certes, mais au moins les mécanismes élémentaires du droit international privé sont maîtrisés – ce qui n’est pas toujours le cas (CA Metz, 24 mars 201520).
D’autres juges du fond finissent par céder, mais on sent le manque d’expérience dans le maniement des instruments internationaux… Ainsi, dans l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 13 mars 201521 déclarant bien fondée l’action en contestation diligentée dans les délais légaux par le père biologique contre le mari de la mère de l’enfant mineur, le juge affirme, après avoir rappelé la teneur de l’article 3-1 de la CIDE, que « l’intérêt supérieur de l’enfant ne commande pas que soit maintenue une filiation mensongère alors que l’article 7 de la même convention reconnaît à l’enfant dans la mesure du possible le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ». Il n’est pas certain que le juge ait compris le sens de l’article 3-1 de la CIDE : ce texte invite le juge à effectuer un contrôle concret de l’intérêt de l’enfant, dont il pourrait très bien ressortir que l’intérêt de cet enfant particulier commande, dans cette affaire particulière, le maintien du lien mensonger ! Au lieu de cela, par cette formulation générale, le juge semble bien avoir défini abstraitement l’intérêt de l’enfant. Le même reproche peut être adressé à l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 16 juin 201522 : la mère de l’enfant mineur agit en contestation contre l’auteur de la reconnaissance, frère du père biologique, qui a reconnu l’enfant « par générosité » ; l’action sera déclarée recevable et bien fondée. Pour autant, comme dans l’arrêt précédent, le juge d’appel se permet cette digression : « conformément à l’article 8 de la Convention EDH, l’intérêt supérieur de l’enfant est de connaître son identité personnelle, en l’occurrence sa filiation réelle, et de pouvoir établir un lien juridique avec son géniteur ». Là encore, le juge définit théoriquement plus qu’il n’apprécie concrètement l’intérêt de l’enfant. Et quelle définition ! Dans les deux cas, il s’agit d’une mauvaise compréhension de la jurisprudence de la CEDH23 (que le troublant arrêt Mandet c/ France du 14 janvier 2016 n’a vraisemblablement pas remis en cause24).
Quoi qu’il en soit, si le fait, pour le juge, d’introduire un contrôle concret de l’intérêt de l’enfant en matière de filiation est, dans notre tradition juridique, assez dérangeant, on a fini par s’en accommoder car ce type de contrôle permet de corriger des injustices individuelles, sans remettre en cause les choix du législateur (un peu d’« huile » dans l’application mécanique de la loi…). Cependant, le fait pour le juge de passer à un contrôle abstrait, qui plus est en définissant l’intérêt de l’enfant comme étant celui de voir sa filiation biologique établie légalement, dépasse les limites de l’admissible : le juge se prend alors pour le législateur, et un juge-législateur visiblement acquis à la « conception bouchère de la filiation »25, ce qui n’est pas le choix du droit français.
Christine DESNOYER
MCF-HDR à l’université de Lille 2,
Droits et Perspectives du droit (EA 4487) – L’ERADP
I – Le gouvernement de la personne de l’enfant : l’empire du contrôle concret de l’intérêt de l’enfant
A – L’intérêt de l’enfant élevé par ses deux parents
1 – Le principe de coparentalité, garant de l’intérêt de l’enfant
Conflit d’autorité parentale et choix religieux : l’intérêt de l’enfant doit toujours primer
Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, n° 14-23724, PB. Le conflit d’autorité parentale relatif au baptême de l’enfant doit être tranché en fonction du seul intérêt de ce dernier. C’est sans méconnaître la liberté de religion du père que les juges du fond ont souverainement déduit que sa demande, formée contre l’opposition de la mère, de faire baptiser leurs enfants âgés de 6 et 7 ans, alors que ces derniers avaient manifesté leur souhait de ne pas y procéder car ils ne comprenaient pas le sens de cette démarche, et ne souhaitaient pas revoir leur père, n’était pas guidée par leur intérêt supérieur et devait dès lors être rejetée.
L’éducation religieuse de l’enfant relève traditionnellement de l’exercice commun de l’autorité parentale ; l’enfant n’a donc qu’un rôle passif quant à ce choix qui le concerne pourtant directement. Ce n’est que si un désaccord des parents surgit sur la question que ce dernier se retrouvera considéré à l’aune de la recherche de son intérêt supérieur. C’est ce qu’affirme une décision du 23 septembre 2015 de la première chambre civile de la Cour de cassation au sujet du baptême de deux enfants âgés de 6 et 7 ans.
La demande de baptême était en l’espèce initiée par le père, contre l’opposition de la mère, alors que les enfants avaient été placés auprès des services de l’ASE du fait du climat conflictuel préoccupant entre les parents. Ces derniers demeuraient conjointement titulaires de l’autorité parentale, mais les droits de visite du père avaient été suspendus suite à son comportement menaçant et violent. Le juge aux affaires familiales refusa d’accéder à la requête du père qui n’apparaissait pas guidée par l’intérêt supérieur des enfants, décision qui se trouva confortée en appel. La Cour de cassation rejeta le pourvoi du père, approuvant les juges du fond d’avoir exactement rappelé que « le conflit d’autorité parentale relatif au baptême des enfants devait être tranché en fonction du seul intérêt de ces derniers » et d’avoir, en conséquence, souverainement déduit du refus exprimé par les enfants de se faire baptiser car ils ne comprenaient pas le sens de cette démarche, ainsi que de leur souhait de ne pas revoir leur père, que la demande de baptême était contraire à leur intérêt supérieur et devait être rejetée, sans que la liberté de conscience et de religion du père soit pour autant méconnue.
Si le recours à l’intérêt supérieur de l’enfant pour trancher un conflit d’autorité parentale relatif à sa religion était prévisible26 (I), la lecture de l’arrêt laisse perplexe tant il souffre d’un manque de précision, inévitable au vu de la complexité de la question, sur ce que recouvre l’intérêt supérieur de l’enfant en la matière (II).
I. L’intérêt supérieur de l’enfant au secours du conflit d’autorité parentale relatif à son baptême
En érigeant l’intérêt supérieur de l’enfant en référentiel exclusif d’arbitrage du conflit des parents quant au choix de sa religion, la Cour de cassation semble revenir sur la position, établie depuis un arrêt du 11 juin 199127, qui consistait à résoudre ce conflit par référence au maintien d’un statu quo ante28.
Pour autant, plus que d’un revirement, cette décision œuvre plutôt pour une adaptation inévitable de la jurisprudence à l’évolution du droit de l’enfance. En juin 1991, la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) venait en effet d’être adoptée mais n’était pas applicable en l’espèce29. La solution était alors conforme à la seule règle de l’époque de l’ancien article 372-1-1 du Code civil30 qui disposait qu’en cas de désaccord des parents quant à l’exercice de l’autorité parentale, la pratique qu’ils avaient précédemment pu suivre en la matière leur tiendrait lieu de siège31. Cette résolution des litiges avait le mérite de permettre au juge de trancher le conflit sans s’immiscer dans la sphère privée de l’éducation parentale32. Mais une telle position, qui faisait fi de l’avis personnel de l’enfant, ne pouvait légitimement perdurer sauf à occulter totalement l’évolution du droit de l’enfance, qui tend à accorder au mineur un rôle de plus en plus important dans les décisions qui le concernent33.
L’évolution du contrôle opéré par la Cour de cassation quant au règlement du conflit d’autorité parentale relatif au baptême de l’enfant est donc logique, bien que certains aient pu regretter « la sagesse de la solution du statu quo ante »34. Ceci dit, il n’est pas certain que cette dernière solution soit totalement abandonnée. Elle pourrait notamment rejaillir si elle correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant35. Dans l’affaire commentée, les enfants, âgés de 6 et 7 ans, avaient exprimé leur hostilité à se faire baptiser36, ce qui avait été déterminant dans l’appréciation de leur intérêt supérieur. Mais qu’en aurait-il été s’ils n’avaient rien exprimé sur ce point, soit qu’ils n’en aient pas eu le souhait, soit qu’ils en eurent été dans l’incapacité37 ? Dans une telle hypothèse, le maintien du statu quo pourrait être le plus à même de satisfaire l’intérêt supérieur de l’enfant afin de préserver une continuité dans son éducation religieuse. Cette éventuelle résurgence ne devrait cependant s’opérer que par défaut, car l’intérêt de l’enfant commande de prendre prioritairement en compte sa parole chaque fois qu’il aura pu s’exprimer38.
Cette considération de la parole de l’enfant par le truchement du recours à son intérêt supérieur marque un tournant des conceptions sur la religion du mineur. Tant au temps de la puissance paternelle qu’après le passage à l’autorité parentale, les préoccupations des juges ont toujours été d’accorder un pouvoir aux deux parents dans le choix de la religion de leur enfant39. Aucun égard n’était porté à l’avis de ce dernier sur cette question qui lui est pourtant personnelle. L’adoption de la CIDE a paru pouvoir changer les choses puisqu’elle fait du mineur un sujet de droit et de liberté à part entière, et lui reconnaît notamment une liberté de religion en son article 14. Certains ont pensé que la convention allait innover en accordant aux enfants « l’exercice direct sans passer par l’intermédiaire du choix parental (…) de droits extrapatrimoniaux relevant de l’autorité parentale »40.
Mais cette effectivité juridique de la convention, et en particulier de l’article 1441, était en pratique vouée à l’échec car appelée à se heurter à l’incapacité du mineur d’ester en justice42. L’article 375 du Code civil lui offre, certes, la possibilité de saisir le juge des enfants, mais ce dernier n’a qu’une mission de protection ; sa compétence est donc tributaire d’une mise en danger de l’enfant. Or, « la décision de faire baptiser un enfant (…) ne lui fait pas courir un danger. En conséquence, elle ne relève pas de la compétence matérielle du juge des enfants et doit échapper à son contrôle »43.
Il résulte de cet état du droit qu’en cas de consensus des parents sur la question de l’éducation religieuse de l’enfant qui ne le mettrait pas en danger, aucun juge ne sera saisi et l’enfant pourra se voir imposer une religion quand bien même il n’y adhérerait pas44. En revanche, lorsqu’un désaccord à ce sujet amène les parents à saisir le JAF, un changement semble désormais acquis : le conflit doit se résoudre en fonction du seul intérêt de l’enfant et celui-ci commande notamment45 d’entendre son avis. S’opère alors un passage du choix religieux pour l’enfant au choix religieux de l’enfant.
La démarche se conforme à l’esprit de la CIDE : d’une part, expressément, car elle est dictée par la recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant46 ; d’autre part, implicitement puisqu’elle donne une effectivité à la liberté de religion de l’enfant telle qu’énoncée en son article 14. L’alinéa 1er de celui-ci consacre en effet le droit de l’enfant à la liberté de religion, tandis que son second alinéa affirme le droit et devoir des parents de le guider dans cet exercice. Le droit et devoir d’éclairage de ces derniers doit donc être au service du droit de l’enfant à sa libre religion47. En l’espèce, l’opinion personnelle des enfants a permis de pallier le désaccord des parents et leur défaillance dans leur rôle de guide.
Cette parole donnée à l’enfant ne porte pas atteinte au droit des parents de lui transmettre des valeurs religieuses48 précisément parce que ces droits ne peuvent aboutir à « imposer un “jusqu’au-boutisme” familial »49. Et pour cause : si l’attribution aux parents des prérogatives d’éducation religieuse de l’enfant vise à protéger ce dernier des totalitarismes religieux50, il serait paradoxalement choquant que ces protecteurs lui imposent des pratiques confessionnelles qui lui sont hostiles51. En réalité, la Cour reconnaît ici que la liberté de religion de l’enfant existe à part entière et qu’elle ne peut être simplement calquée sur celle des parents, ce pourquoi elle affirme de manière laconique que c’est sans méconnaître la liberté de religion du père que les juges du fond lui ont refusé de procéder au baptême de ses enfants.
Cet apport de la solution reste cependant moindre si l’on considère parallèlement les difficultés qu’elle pourrait engendrer. En effet, la référence à l’intérêt supérieur de l’enfant suppose de le déterminer ; or cela paraît très délicat en matière de choix religieux du mineur.
II. La délicate détermination de l’intérêt de l’enfant en matière de religion
Le recours à l’intérêt supérieur de l’enfant pose systématiquement la question de la nature du contrôle qui en sera opéré par les juges. La Cour de cassation reconnaît ici une appréciation in concreto de l’intérêt supérieur de l’enfant à se faire ou non baptiser puisqu’elle renvoie au pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Cela semble a priori de bon sens car la religion relève de l’intime conviction et de la foi personnelle. Selon l’article 14, § 2 de la CIDE, les parents doivent d’ailleurs guider l’enfant en fonction du développement de ses capacités. L’intérêt de l’enfant concerné appelle donc logiquement une appréciation concrète. Pourtant, l’absence de toute appréciation in abstracto pourrait avoir des conséquences regrettables, comme le suggère l’analyse des motifs ayant permis en l’espèce de conclure au refus du baptême.
Les juges du fond ont d’abord retenu le refus des enfants de se faire baptiser car ils ne comprenaient pas le sens de cette démarche. Or, cet argument n’est pas sans rappeler a contrario celui qu’avaient tenu les juges de la cour d’appel de Douai dans une décision du 8 janvier 201352 selon lequel le baptême demandé par la mère ne pouvait être écarté au seul motif « que l’enfant n’y mettrait aucun sens alors même que la plupart des baptêmes (…) touche des nourrissons ou de très jeunes enfants pour lesquels aucune question sur leur faculté de discernement n’est posée »53. Le risque pourrait donc être de constater une discordance des décisions rendues selon qu’un juge aura estimé nécessaire de considérer la parole de l’enfant ou qu’un autre aura jugé le contraire54. N’aurait-il pas mieux valu apprécier, in abstracto, que l’intérêt supérieur de l’enfant commande de ne pas lui imposer une religion lorsque ses aveux révèlent qu’il y est défavorable ou qu’il ne dispose pas de discernement suffisant pour y adhérer55 ? Une distinction est ici opportune : lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant est érigé par une règle de droit en condition d’application de cette dernière56, il est traditionnellement admis57 qu’il fasse l’objet d’une appréciation in concreto, alors qu’il fera l’objet d’une appréciation in abstracto lorsqu’il s’agira en revanche de déterminer si telle solution juridique générale se conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant58. Or, si les règles applicables aux cas de conflit dans l’exercice de l’autorité parentale évoquent bien l’intérêt supérieur de l’enfant59, il ne constitue pas pour autant une condition d’application de ces règles de droit. Une appréciation abstraite de l’intérêt de l’enfant à ne pas se faire baptiser contre son gré est donc envisageable, et aurait le mérite d’introduire un contrôle de la Cour de cassation sur la question, mais pourrait néanmoins encourir la censure de la CEDH, a priori partisane en la matière d’une appréciation concrète l’intérêt de l’enfant60.
Quant à l’argument tenant au refus des enfants de revoir leur père suspendu de ses droits de visite pour violence, il est possible de s’interroger sur sa pertinence. La prise en compte de cet état de fait n’apparaît pas évidente, aussi répréhensible soit l’attitude du père, lorsqu’il s’agit de statuer sur un conflit dans l’exercice d’une autorité dont le père ne se trouve pas déchu61. La motivation emporte la confusion car tant que le JAF n’attribue pas à l’un seul des parents l’exercice de l’autorité parentale, le père tout autant que la mère est légitime à demander que son choix pour l’éducation religieuse de ses enfants soit pris en considération, sauf à supposer, ce que semble faire l’arrêt, que son comportement immoral induise un désaveu de cette légitimité dans son devoir de « guide » vers la foi. Quel modèle tirer en effet d’un père violent et menaçant, et quelle transmission de valeurs attendre de lui ?
L’appréciation de l’intérêt de l’enfant pourrait s’avérer d’autant plus complexe qu’au-delà du baptême en particulier, c’est la liberté religieuse de l’enfant en général qui se trouve concernée ; or celle-ci engage différentes religions pouvant être diversement invasives pour l’enfant. Se posera alors nécessairement la question de savoir jusqu’à quel point il est possible de considérer la parole de l’enfant. Les faits de l’espèce étaient simples. Les juges étaient confrontés à un cas de « contrainte positive »62, c’est-à-dire un choix religieux imposé à l’enfant par ses parents63. Il était alors aisé de s’appuyer sur l’absence, chez l’enfant, de discernement suffisant à comprendre le baptême pour le refuser64. La solution aurait-elle été aussi facile si, dans le cas inverse, le conflit d’autorité parentale avait révélé l’existence d’une « contrainte négative »65, c’est-à-dire une religion voulue par l’enfant contre la volonté parentale ? Si les enfants avaient reconnu comprendre et adhérer au baptême malgré le désaccord de leur mère, l’on peut raisonnablement penser que les juges auraient accédé à la demande du père, d’autant que le baptême est un acte relativement sans conséquence66. Mais d’autres religions peuvent apparaître plus contraignantes et impliquer une appréciation différente de l’intérêt supérieur de l’enfant à y adhérer. La cause des Témoins de Jéhovah, notamment, peut être perçue comme intolérante et incompatible avec l’épanouissement normal d’un enfant. Dans l’arrêt précité du 11 juin 199167, une enfant de 16 ans souhaitait s’y rallier de concert avec son père et contre sa mère, ce qui lui avait été refusé sous réserve d’attendre sa majorité pour exercer un tel choix. Sous l’égide de son intérêt supérieur, aurait-elle été entendue aujourd’hui ? Si l’on considère que la suprématie est donnée à la parole de l’enfant, cela serait possible, mais poserait alors en cascade la question de son discernement quant à la cause qu’il entend épouser. Un mineur de 16 ans est certainement capable de plus de lucidité68 sur la question qu’à 6 et 7 ans, mais cela dépend en réalité de la maturité de chacun et il est impossible de s’accorder sur des généralités69. Il semble dès lors délicat de s’en référer systématiquement à la parole de l’enfant surtout si se trouve en jeu son adhésion à une cause religieuse totalitaire contre laquelle son incapacité en droit français vise justement à le protéger70. Le juge pourrait donc avoir égard à des considérations d’un autre ordre pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, mais il paraît alors épineux de s’atteler à cette tâche sans procéder à un jugement de valeur sur une religion donnée. Une décision allemande avait ainsi suscité un vif émoi en considérant que la circoncision était objectivement contraire à l’intérêt de l’enfant en ce qu’elle implique une atteinte corporelle permanente et irréversible71.
Le recours à l’intérêt supérieur de l’enfant pour arbitrer le conflit d’autorité parentale relatif à sa religion pourrait donc s’avérer périlleux. Il n’est pas évident de concilier liberté de religion de l’enfant et intérêt supérieur de ce dernier tant le libre exercice de la première n’est pas nécessairement conforme au second. L’alerte avait déjà été donnée : « le juge ne peut pas apprécier ici l’intérêt de l’enfant [ ;] dans notre société il n’y a pas de bonne ou de mauvaise religion »72. Il y est pourtant désormais invité. Il reste donc à espérer que, face à cette délicate question à la marge d’appréciation glissante, il fasse preuve de prudence et de précision dans ses motivations.
Sophie VISADE
Doctorante Droits et Perspectives du droit (EA 4487) – L’ERADP
2 – Le juge, garant du principe de coparentalité
B – L’intérêt de l’enfant dont les parents sont défaillants
1 – L’intérêt du pupille de l’État
2 – L’intérêt de l’enfant non entretenu par le parent séparé
II – La gestion du patrimoine de l’enfant : l’évacuation du contrôle concret de l’intérêt de l’enfant
III – La filiation de l’enfant : vers un contrôle abstrait de l’intérêt de l’enfant par le juge ?
A – L’enfant majeur : le contrôle de proportionnalité validé par le juge du droit
B – L’enfant mineur : le contrôle de son « intérêt supérieur » dénaturé par les juges du fond
Notes de bas de pages
-
1.
« Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 12 », LPA 9 août 2016, n° 118z0, p. 6 à 21 ; LPA 10 août 2016, n° 120a7, p. 6 à 19 ; LPA 11 août 2016, n° 120a8, p. 6 à 22 ; LPA 12 août 2016, n° 120a9, p. 8 à 18.
-
2.
Les faits étant têtus (la décision commune peut contrarier l’intérêt de l’enfant), la présomption est simple ; mais encore faut-il que le juge soit saisi pour pouvoir exercer son contrôle. Par définition, il ne le sera pas par les parents mais, par exemple, par l’enfant devenu majeur. C’était le cas dans cette affaire, qui a donné lieu à l’arrêt du Conseil d’État du 23 mars 2015 (commenté dans la chronique n° 12 par Richard Ouedraogo), dans laquelle les parents avaient consenti, au nom de l’enfant, à la libération de ses liens d’allégeance envers la France pendant sa minorité ; l’argument de l’intérêt de l’enfant n’avait certes pas été soulevé, mais sa pertinence était évidente : il s’agissait pour les parents de permettre au père de remplir les conditions prévues pour bénéficier d’une aide publique réservée aux seuls travailleurs étrangers.
-
3.
Commentaire par Sophie Visade.
-
4.
Et selon une justification alambiquée : « Au cas où la résidence de l’enfant se trouverait fixée au domicile de son père, la disponibilité de sa mère ne pourrait permettre de lui refuser, actuellement, la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement élargi en milieu de semaine qui contraindrait l’enfant à des changements incessants de résidence ».
-
5.
Commentaire par Mathilde Livoir.
-
6.
La Cour fédérale de justice allemande.
-
7.
Commentaire par Annie Bottiau.
-
8.
Commentaire par Gaëlle Widiez Rasolonomenjanahary.
-
9.
Commentaire par Blandine Mallevaey.
-
10.
Commentaire par Blandine Mallevaey.
-
11.
Commentaire par Jean-Christophe Duhamel.
-
12.
Commentaire par Amélie Niemiec.
-
13.
Commentaire par Amélie Niemiec.
-
14.
Commentaire par Dominique Everaert-Dumont.
-
15.
Commentaire par Dominique Everaert-Dumont.
-
16.
V. chron. n° 12, comm. Dekeuwer-Défossez F., sous CA Paris, 24 sept. 2015, n° 14/11767 ; CA Nancy, 12 oct. 2015, nos 15/02014 et 15/00441 ; CA Nancy, 30 oct. 2015, nos 15/02197 et 14/03397.
-
17.
Commentaire par Delphine Autem.
-
18.
Commentaire par Cathy Pomart.
-
19.
Commentaire par Éric Kerckhove.
-
20.
Commentaire par Éric Kerckhove.
-
21.
Commentaire par Fanny Vasseur-Lambry.
-
22.
Commentaire par Fanny Vasseur-Lambry.
-
23.
V. « La place de la vérité biologique dans la jurisprudence européenne relative à l’article 8 de la Convention EDH en matière de filiation charnelle », in Mélanges en l’honneur du professeur Françoise Dekeuwer-Défossez, 2012, Lextenso éditions, p. 55-81.
-
24.
Dans cet arrêt, la CEDH valide le raisonnement suivant des juges du fond : « S’il est regrettable que l’action [en contestation diligentée par le père biologique] soit aussi tardive, alors que [l’enfant] a 9 ans, considère [l’auteur de la reconnaissance, mari de sa mère] comme son père et a noué avec lui des liens affectifs à l’évidence très forts, l’intérêt primordial de l’enfant est de connaître la vérité sur ses origines » (d’où l’absence de motifs légitimes justifiant le refus de prononcer l’expertise génétique demandée par le père biologique)… et pour la Cour européenne (déformant le raisonnement) d’« établir sa filiation réelle ». Et de conclure que ce raisonnement tenu par le juge national n’excède pas la marge nationale d’appréciation, ce qui permet de relativiser la portée de l’arrêt (Dekeuwer-Défossez F., « L’intérêt de l’enfant dans le droit de la filiation : les enseignements de l’affaire Mandet c/ France », RLDC 2016, p. 39).
-
25.
Legendre P., in Papageorgiou-Legendre A., Filiation, Leçon IV, suite 2, Fondement généalogique de la psychanalyse, 1990, Fayard, p. 208.
-
26.
Rappelons que la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant est devenu un principe matriciel en droit des mineurs et de la famille depuis que la Cour de cassation a reconnu l’applicabilité directe de l’article 3-1 de la CIDE : Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n° 02-20613.
-
27.
Cass. 1re civ., 11 juin 1991, n° 89-20278 : Bull. civ. I, n° 196 ; D. 1991, p. 521, note Malaurie P. ; RTD civ. 1992, p. 75, obs. Hauser J. ; RDSS 1992, p. 154, note Monéger F.
-
28.
Par cette décision du 11 juin 1991, jamais remise en cause jusqu’à la décision commentée, la première chambre civile de la Cour avait approuvé les juges du fond d’avoir réglé le désaccord parental sur la question de la reconversion aux témoins de Jéhovah de leur fille âgée de 16 ans par référence au statu quo existant avant la naissance du conflit. Cela avait alors conduit les juges à opter pour le maintien de l’éducation catholique dans laquelle avait été élevée l’enfant, jusqu’à ce que cette dernière, une fois majeure, puisse décider de sa reconversion.
-
29.
La Convention fut votée le 20 novembre 1989, ratifiée le 2 juillet 1990 par la France, mais n’est entrée en vigueur qu’après l’expiration d’un délai de trente jours suivant la ratification par les vingt autres États.
-
30.
C. civ., art. 372-1-1 ancien, abrogé par la loi Kouchner : « Si les père et mère ne parvenaient pas à s’accorder sur ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, la pratique qu’ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle ».
-
31.
Ainsi, si les parents s’étaient auparavant accordés sur une éducation religieuse donnée, celle-ci devait être maintenue ; si au contraire, du fait de leur discordance sur le choix de la foi de leur enfant, ils ne l’avaient élevé dans aucune religion, l’éducation adogmatique devait continuer.
-
32.
V. en ce sens, Lamarche M., « L’enfant, son intérêt supérieur et sa religion », Dr. famille 2015, alerte 69.
-
33.
Certes, le désormais article 373-2-11 du Code civil dispose toujours que le juge, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, prend notamment en considération la pratique antérieure des parents. Pour autant, ces litiges ne peuvent plus aujourd’hui se résoudre en ignorant la question de l’intérêt de l’enfant. D’une part, parce que notre droit interne lui-même reconnaît à l’article 371-1 du Code civil que l’autorité parentale a pour finalité cet intérêt, mais d’autre part et surtout, parce que l’article 3, § 1, de la CIDE consacre la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant et la nécessité d’en faire une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent.
-
34.
JCP G 2016, doctr. 35, spéc. nos 1-2, Lamarche M.
-
35.
V. par exemple une décision de la cour d’appel de Paris dans laquelle les juges avaient notamment tenu compte, pour trancher le conflit d’autorité parentale, d’un accord antérieurement conclu entre les parents prévoyant la non-participation de l’enfant aux pratiques religieuses du père (témoins de Jéhovah) pour conclure que l’intérêt de l’enfant commandait de ne pas le mêler à ce culte auquel le père voulait le rallier : CA Paris, 26 sept. 2013, n° 12/19176, note Mallevaey B. : LPA 4 août 2014, p. 6.
-
36.
Ils ne s’étaient cependant pas exprimés dans le cadre de l’article 388-1 du Code civil qui prévoit d’entendre l’enfant dans toutes les procédures le concernant, mais s’étaient exprimés auprès de l’ASE qui avait recueilli leur sentiment.
-
37.
Quid de l’enfant en bas âge ou de l’enfant incapable de discernement ? L’article 388-1 du Code civil ne prévoit d’entendre par exemple que le mineur capable de discernement.
-
38.
C’est ce que commandent les articles 12 du CIDE et 388-1 du Code civil au sujet de l’enfant capable de discernement.
-
39.
V. not. Gareil L., L’exercice de l’autorité parentale, 2004, Paris, LGDJ, p. 82-83.
-
40.
Neirinck C., Le droit de l’enfance après la convention des Nations Unies, 1993, Paris, Belfond, p. 150.
-
41.
Précisons qu’en droit interne, la liberté religieuse, à la différence de la liberté syndicale, n’est pas reconnue au mineur contrairement à certains droits étrangers qui la lui reconnaissent sous condition de majorité religieuse spécifique (c’est le cas du droit allemand, anglais et suisse).
-
42.
En effet, en vertu de l’article 372-8 du Code civil, seuls les parents et le ministère public ont la capacité de saisir le JAF.
-
43.
Neirinck C., « Le baptême de l’enfant placé en assistance éducative », Dr. famille 2013, comm. 69, p. 29, sous CA Douai, 8 janv. 2013, n° 12/03506.
-
44.
V. not. l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 8 janvier 2013, où les juges rappellent que la question de la religion de l’enfant relève de l’exercice de l’autorité parentale, ce pourquoi il ne pouvait être refusé à la mère, seule titulaire de cette autorité, de procéder au baptême de son enfant malgré le refus exprimé par ce dernier : CA Douai, 8 janv. 2013, n° 12/03506 : Dr. famille 2013, comm. 69, Neirinck C. ; LPA 4 août 2014, p. 6, note Mallevaey B.
-
45.
D’autres motifs ont justifié la décision et seront examinés infra (II, A).
-
46.
En vertu de l’article 3, § 1, de la CIDE : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
-
47.
Ce qui limite leur intervention dans l’exercice de ce droit par l’enfant puisque si « le guide peut conseiller, orienter, montrer une direction (…) il ne saurait imposer un choix », v. Neirinck C., Le droit de l’enfance après la convention des Nations Unies, 1993, Paris, Belfond, p. 151.
-
48.
Ce droit à la transmission des valeurs est reconnu à l’article 9 de la CEDH ; par le protocole n° 1, article 2, du 20 mars 1952 ; à l’article 18-4 du PIDCP ; à l’article 5 de la Déclaration de l’assemblée générale des Nations Unies du 25 novembre 1981 sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction.
-
49.
Boulanger F., « Autorité parentale et formation religieuse des mineurs (essai comparatif) », Dr. famille 2013, étude 14.
-
50.
La prudence de la CIDE dans la reconnaissance de la liberté religieuse, qui doit être guidée, et l’absence de reconnaissance de cette liberté en droit français s’expliquent en effet par la volonté de protéger l’enfant de l’emprise de secte qui profiterait de son jeune âge.
-
51.
Dekeuwer-Défossez F., Les droits de l’enfant, 2006, PUF, Que sais-je ?, p. 72.
-
52.
Précisons cependant que les termes du litige ne se posaient pas ici dans le même contexte puisqu’il n’était pas question d’un conflit d’autorité parentale, la mère demandant le baptême agissant en tant que seule titulaire de cette autorité.
-
53.
CA Douai, 8 janv. 2013, n° 12/03506 : Dr. famille 2013, comm. 69, Neirinck C. ; LPA 4 août 2014, p. 6, note Mallevaey B.
-
54.
Face à une décision bien motivée, dans un cas comme dans l’autre, la Cour de cassation, dénuée de contrôle hors de toute appréciation abstraite, ne pourra pas censurer les juges du fond dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation. V. sur ce point : Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, n° 14-23724, « Conflit parental : l’intérêt supérieur de l’enfant et son baptême », LPA 15 janv. 2016, p. 13, note Kobina Gaba H.
-
55.
Il s’agirait alors dans ce cas de rejeter objectivement, par une appréciation abstraite, ce que la doctrine a pu qualifier de « contrainte positive », par laquelle les parents imposent un choix religieux à leur enfant grâce au jeu de l’exercice de l’autorité parentale. V. sur cette distinction doctrinale : Dekeuwer-Défossez F., Les droits de l’enfant, 2006, PUF, Que sais-je ?, p. 73.
-
56.
C’est le cas par exemple de l’article 371-4 du Code civil qui prévoit expressément que c’est « si tel est l’intérêt de l’enfant » que le JAF peut aménager les relations de l’enfant avec ses ascendants ; de même, l’article 373-2-1 du Code civil dispose que c’est « si l’intérêt de l’enfant le commande » que le juge peut aménager l’exercice de l’autorité parentale entre les parents. Ces deux formules impliquent de déterminer au cas d’espèce cet intérêt.
-
57.
V. Rials S., « Les standards, notions critique du droit », in Perelman C. et Vander Elst R., Les notions à contenu variable en droit, 1984, Bruylant, p. 42.
-
58.
V. Gouttenoire A., « Le contrôle exercé par la Cour de cassation sur l’intérêt supérieur de l’enfant », in Mélanges en l’honneur du professeur Françoise Dekeuwer-Défossez, Dupuis M. (dir.), 2013, Montchrestien, p. 147 et s.
-
59.
En effet, l’article 373-2-6 du Code civil, qui fonde la compétence du JAF en la matière, en fait un objectif à sauvegarder, et l’article 373-2-11, listant les éléments que le JAF doit prendre en considération pour la résolution de tel conflit, fait apparaître en filigrane qu’il est veillé à son respect mais sans jamais l’évoquer expressément.
-
60.
La Cour européenne des droits de l’Homme a en effet sanctionné des États membres, dont la France, lorsque les juges du fond avaient opéré une appréciation abstraite de l’intérêt de l’enfant à ne pas résider chez un de ses parents du fait de l’appartenance religieuse de ce dernier (CEDH, 23 juin 1993, n° 12875/87, Hoffmann c/ Autriche : D. 1994, p. 326, obs. Hauser J., confirmée par CEDH, 16 déc. 2003, n° 64927/01, Palau-Martinez c/ France : D. 2004, p. 1261, obs. Hauser J.).
-
61.
Mais les considérations d’ordre général qu’il était reproché aux juges d’avoir tenu portaient sur la religion même et relevaient pratiquement dès lors d’un jugement de valeur, ce qui est proscrit au regard de l’interdiction des discriminations posée à l’article 14 de la convention. Or, tenir des considérations d’ordre général sur la nécessité de consentir à épouser une foi n’induirait pas un tel jugement de valeur sur la religion dont l’adhésion est en question. La question reste donc posée.
-
62.
En effet, comme le souligne Lamarche M., « la référence au comportement du père et à ses relations avec les enfants relève bien davantage des mesures que peut prendre le juge pour organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale ou restreindre le droit de visite et d’hébergement d’un parent, que de l’intérêt à ne pas être baptisés », sur Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, n° 14-23724 ; Lamarche M., « L’enfant, son intérêt supérieur et sa religion », Dr. famille 2015, alerte 69, p. 3.
-
63.
Distinction doctrinale initiée par le professeur Françoise Dekeuwer-Défossez dans Dekeuwer-Défossez F., Les droits de l’enfant, 2006, PUF, Que sais-je ?, p. 73.
-
64.
Selon cette doctrine, la « contrainte positive » est rendue possible par les règles de l’exercice commun de l’autorité parentale. Dans l’affaire de l’arrêt du 23 septembre 2015, le père, à défaut d’accord commun avec la mère, tentait d’imposer cette contrainte unilatéralement, en sollicitant des juges qu’ils le confortent dans ce conflit d’autorité parentale.
-
65.
Cette hostilité de l’enfant justifiait de le préserver libre de tout endoctrinement religieux, ce qui aboutissait à une solution facile car neutre pour l’enfant.
-
66.
Ibid., p. 73.
-
67.
Tout au plus existe-t-il des registres cléricaux répertoriant les baptisés.
-
68.
V. supra I.
-
69.
V. sur la question du mineur de 16 ans, Hauser J., « Adhésion à une secte et autorité parentale. En cas de désaccord des parents, le choix religieux doit attendre la majorité de l’enfant », RTD civ. 1992, p. 75.
-
70.
Les législations ayant opté pour la reconnaissance d’une majorité religieuse, qui empêche l’enfant de prendre une décision en ce domaine avant de l’avoir atteinte, n’ont d’ailleurs pas toutes arrêté la même limite d’âge : 14 ans en Allemagne, 12 ans en Angleterre, 16 ans en Suisse.
-
71.
Il est admis qu’il convient d’accepter la contrainte positive bien avant la contrainte négative, v. Dekeuwer-Défossez F., Les droits de l’enfant, 2006, PUF, Que sais-je ?, p. 73.
-
72.
V. sur cette décision du tribunal de grande instance de Cologne rendue le 7 mai 2012 : Libchaber R., « Circoncision, pluralisme et droits de l’Homme », D. 2012, p. 2044. Les juges avaient estimé que la modification corporelle permanente qu’implique la circoncision est contraire à l’intérêt de l’enfant qui réside dans la possibilité de choisir lui-même son orientation religieuse ultérieurement. Une telle position est contestable par la stigmatisation religieuse dont elle procède.
-
73.
Malaurie P., « Une mineure doit attendre sa majorité pour exercer un choix religieux auquel un de ses parents s’oppose », D. 1991, p. 522, note sous Cass. 1re civ., 11 juin 1991, n° 89-20278 : Bull. civ. I, n° 196.