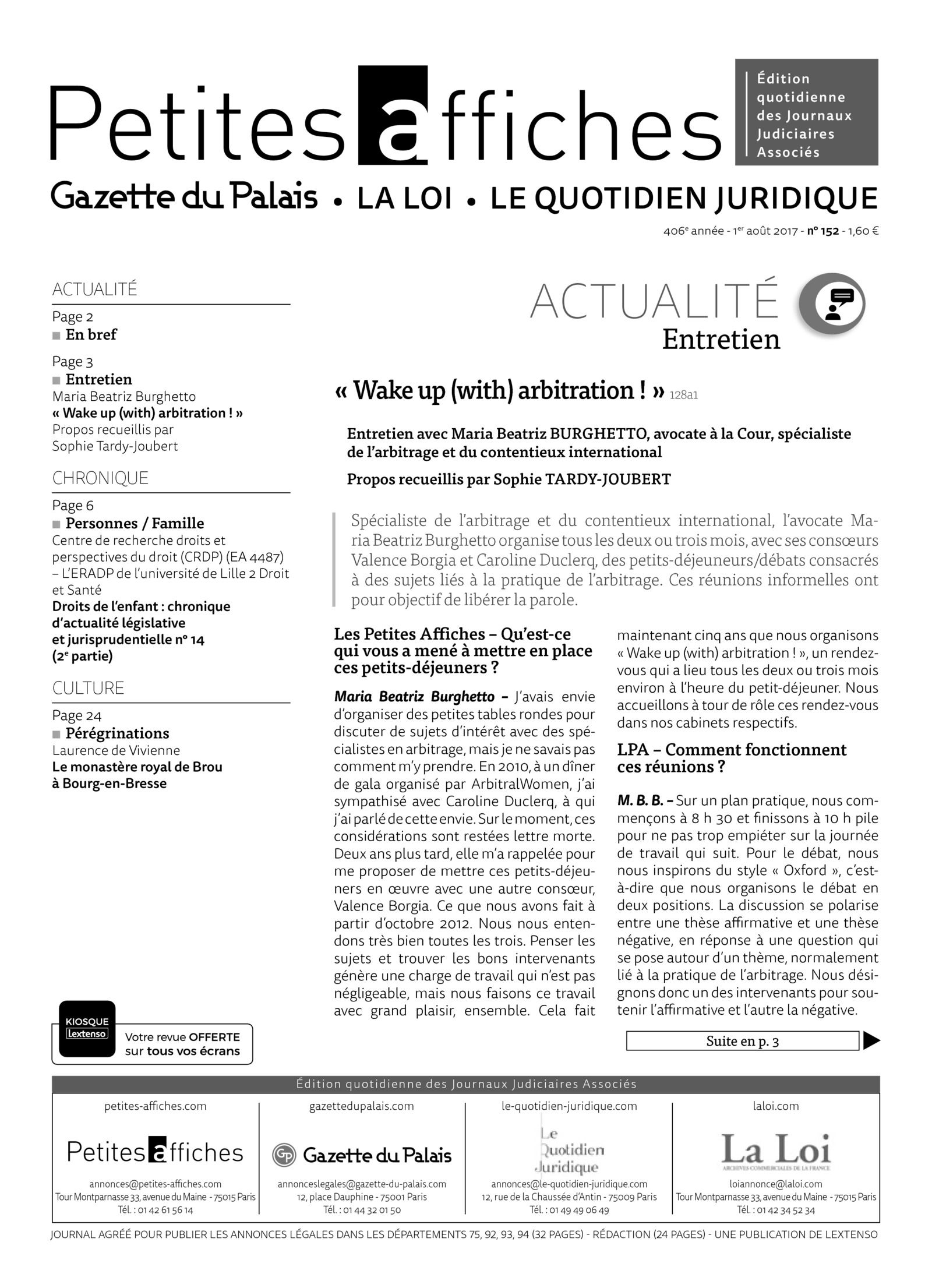Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 14 (2e partie)
Phénomène majeur qui a marqué notre droit depuis l’avènement de la Ve République, la subjectivisation du droit porte en germe deux révolutions que la législation et le contentieux actuels en matière familiale rendent de plus en plus visibles, comme le montre cette chronique : la déjuridictionnalisation du droit et la juridictionnalisation de notre juge judiciaire du droit, la Cour de cassation. Si la conversion de la Cour de cassation au contrôle de proportionnalité ne peut que contribuer à renforcer l’effectivité des droits de l’enfant, en revanche, la déjuridictionnalisation du droit de la famille entretient des rapports pour le moins ambigus avec les droits de l’enfant.
Droits de l’enfant, déjuridictionnalisation du droit de la famille et juridictionnalisation de la Cour de cassation
I. La déjuridictionnalisation du droit de la famille en marche : les motivations d’ordre économique derrière le paravent des droits de l’enfant ?
II. La révolution de la juridictionnalisation de la Cour de cassation en perspective : l’espoir d’une effectivité plus grande des droits de l’enfant
A.
B.
C.
Christine DESNOYER
I – La déjuridictionnalisation du droit de la famille en marche : les motivations d’ordre économique derrière le paravent des droits de l’enfant ?
Divorce sans juge et droits de l’enfant. V. l’article de Blandine Mallevaey, « l’intérêt de l’enfant et la réforme du divorce par consentement mutuel », LPA 29 juin 2017, n° 127p1, p. 6
I. Scepticisme quant à la capacité à atteindre l’objectif fixé
II. Scepticisme autour de la qualification d’acte usuel
II – La révolution de la juridictionnalisation de la Cour de cassation en perspective : l’espoir d’une plus grande effectivité des droits de l’enfant
A – Les modèles : juge administratif, juge européen, juge allemand
1. Hébergement d’urgence des mineurs étrangers isolés, carences des pouvoirs publics et libertés fondamentales devant le juge administratif (TA Lille, ord., 1er sept. 2016, n° 1606080 ; TA Lille, ord., 6 mai 2016, n° 1603113, 4 ordonnances, 1res espèces ; CE, 1re/6e ch. réunies, 27 juill. 2016, nos 400055 à 400058, 2e espèce)
2. Intérêt de l’enfant à une scolarisation complète permettant une intégration sociale réussie et convictions religieuses des parents devant le juge européen (CEDH, 10 janv. 2017, n° 29086/12, Osmanoğlu et Kocabaș c/ Suisse)
3. Sort des embryons congelés et « droit à l’enfant » devant le juge allemand (BGH, 24 août 2016, n° XII ZB 351/15, 1re espèce et OLG Munich, 22 févr. 2017, n° 3 U4080/16, 2e espèce)
I. Pas de reconnaissance prénatale
II. Pas d’insémination posthume
B – Les inconstances actuelles de la Cour de cassation en matière de contrôle de conventionnalité
1. Le contrôle accepté : la question de la motivation
a) Motivation pédagogique : la prescription en matière de filiation (Cass. 1re civ., 9 nov. 2016, n° 15-25068, PB)
I. Évolution possible (latente ?) du point de vue des droits de l’enfant
II. Évolution acquise du point de vue du droit de la filiation
b) Motivation lapidaire : Expertise génétique hors procès en filiation (Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n° 15-16696, PB)
L’arrêt du 8 juin 20161, qui rappelle l’interdiction des référés-expertise génétique, est aussi l’épilogue d’une affaire qui a donné lieu à pas moins de trois arrêts de la Cour de cassation ! L’obstination du plaideur, facilitée par l’obtention de l’aide juridictionnelle, permet ainsi d’être définitivement fixé sur une question qui n’avait jamais été posée de manière aussi claire.
En l’espèce, un enfant naît le 7 janvier 2010. Un homme, Elvio X, sollicite du juge des référés qu’il ordonne une expertise génétique afin qu’il puisse savoir s’il doit ou non reconnaître l’enfant. Dans la mesure où l’article 145 du Code de procédure civile ne permet pas les expertises de simple curiosité, mais exige qu’elles soient destinées à préétablir une preuve en vue d’un futur litige, il allègue vouloir se préparer à une éventuelle action en recherche de paternité diligentée par la mère. Cependant, il affirme également avoir l’intention de reconnaître l’enfant si cette expertise est positive.
Le juge des référés, puis la cour d’appel rejetteront sa demande, motif pris de ce que l’article 16-11 du Code civil n’autorise ce type d’expertise qu’« en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soir à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides ». Ce premier arrêt d’appel (CA Aix-en-Provence, 29 déc. 2011) sera cependant cassé (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-19528) parce que le demandeur n’avait pas eu communication des conclusions du ministère public.
Devant la cour de renvoi, Elvio X souleva une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 16-11 du Code civil, qui fut rejetée par la Cour de cassation comme non « sérieuse », puisque cette disposition « ne prive pas une personne de son droit d’établir un lien de filiation avec un enfant ni de contester une paternité qui pourrait lui être imputée », ce qui exclurait qu’elle porte une quelconque atteinte à un droit constitutionnellement garanti2.
Ce troisième arrêt de la Cour de cassation donne donc enfin une réponse au fond à la question posée par M. Elvio X, et, sans surprise, il approuve la cour d’appel d’avoir exclu la possibilité d’obtenir une ordonnance de référé prescrivant une expertise génétique. Il faut dire que toute autre réponse aurait complètement vidé l’article 16-11 du Code civil de sa substance, et modifié en profondeur la philosophie de la loi française relative à la reconnaissance d’enfant. Pourtant, l’examen de ses conséquences amène à douter de sa pertinence, autant dans les circonstances de l’arrêt (I) que dans d’autres hypothèses envisageables (II).
I. Le refus des expertises « de curiosité » préalables à une reconnaissance
Les faits qui ont amené la Cour de cassation à statuer sont précisément le genre de situations qui ont conduit le législateur de 1994 à limiter la possibilité de demander l’expertise génétique au cadre précis d’une instance au fond. Cette position a été adoptée dès les premières lois de bioéthique, conservée par la suite, et même assortie d’une sanction pénale, par la loi de bioéthique du 7 juillet 2011. En effet, l’article 226-28-1 du Code pénal énonce désormais que « le fait, pour une personne, de solliciter l’examen de ses caractéristiques génétiques ou de celles d’un tiers ou l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques en dehors des conditions prévues par la loi est puni de 3 750 € d’amende ».
La défense de cette interdiction est faite de manière particulièrement lumineuse par le professeur Hugues Fulchiron3 qui explique que la reconnaissance est un acte libre, dont la conformité à la vérité génétique n’est pas et ne peut pas être vérifiée, si ce n’est dans le cas d’un procès en matière de filiation : l’aléa, écrit-il, est la rançon de la liberté. Celui qui doute a la liberté de ne pas reconnaître, et ce sera alors à la mère de prendre ses responsabilités et d’attraire le géniteur en justice. Auquel cas l’expertise sera ordonnée par le tribunal ou par le juge de la mise en état4. La solution inverse fragiliserait les reconnaissances « de complaisance » ou simplement erronées, et la faculté de vérifier pourrait devenir une arme contre les hommes trop confiants qui ne l’auraient pas fait.
Ajoutons qu’autoriser les expertises génétiques sans s’assurer qu’elles pourront être suivies d’une transformation de leur résultat en filiation juridique, de manière volontaire ou judiciaire, ouvre la porte à des contestations qui, portées devant la Cour de Strasbourg, pourraient conduire à la condamnation de la France, comme dans l’affaire Pascaud5.
Il serait, en effet, particulièrement difficile de défendre devant la Cour de Strasbourg une interdiction d’établir la filiation juridique en contradiction avec la « vérité génétique ».
Reste que cette position laisse un sentiment mitigé : car si l’on veut bien comprendre qu’il n’est pas judicieux de favoriser l’attitude qui consisterait, pour les hommes, à subordonner systématiquement la reconnaissance d’enfant à vérification préalable, si l’on peut approuver la volonté d’éviter la confusion tentante entre vérité génétique et filiation juridique, il n’en demeure pas moins que les circonstances de la vie font qu’il peut arriver que la paternité d’un enfant soit douteuse, pour la mère comme pour le « père » par contrecoup. Il suffit d’imaginer une conception contemporaine d’une période de changement du partenaire de la mère, ou encore une situation d’adultère.
L’homme qui se demande de bonne foi s’il est ou non le géniteur de l’enfant a alors à sa disposition deux mauvaises solutions.
Il peut reconnaître l’enfant, puis contester ensuite sa reconnaissance devant le TGI, qui à cette occasion ordonnera l’expertise souhaitée. C’est la procédure qui lui est quasiment indiquée par la Cour de cassation elle-même : on conviendra qu’elle mobilise inutilement le tribunal ce qui est paradoxal en cette période de déjudiciarisation. Ce contentieux inutile qui ressemble aux anciens « divorces d’accord » est source de frais et met le père dans une posture procédurale contradictoire, qui peut lui être reprochée et même engendrer condamnation à des dommages-intérêts si la paternité est confirmée.
Le père peut aussi attendre que la mère agisse contre lui en recherche judiciaire de paternité, quitte à acquiescer à la demande dès que l’expertise aura attesté qu’il est bien l’auteur de l’enfant. Dans ce cas aussi, il n’est pas non plus à l’abri d’une demande d’indemnités pour la faute ayant consisté à ne pas reconnaître l’enfant. En effet, une jurisprudence de plus en plus fournie tend à punir le père qui n’a pas spontanément assumé ses engagements et le fait qu’il ait eu des raisons objectives de douter de sa paternité n’est pas toujours une cause suffisante d’exonération6.
Il est bien difficile de déterminer si l’intérêt supérieur de l’enfant serait mieux protégé par la possibilité d’effectuer des expertises amiables avant la reconnaissance, qu’il ne l’est par leur interdiction. Il est cependant peu niable que l’obligation d’intenter une action contentieuse, sans priver l’enfant ni son père de leur droit fondamental à l’identité, leur en rend cependant l’exercice plus difficile7. Serait-ce suffisant pour que la Cour de Strasbourg condamne la France ? Probablement pas. Il y a, au demeurant, très peu de chances qu’elle soit un jour saisie : la possibilité d’effectuer des expertises à l’étranger, facilitée par internet, permet aux intéressés de contourner l’interdiction légale française8. Et il a fallu toute l’obstination d’un homme bénéficiant de l’aide juridictionnelle et refusant par principe et par économie de contourner la loi française pour que la question soit posée à la Cour de cassation.
Mais dans d’autres situations, cette prohibition pourrait déboucher sur des impasses probatoires, beaucoup plus critiquables encore.
II. Les impasses probatoires résultant de l’interdiction des référés-expertise génétique
La jurisprudence, ancienne et contemporaine, atteste de nombreuses situations dans lesquelles une expertise génétique permet seule de préserver les droits d’une personne, alors qu’aucun procès en filiation n’est envisageable, tout au moins dans l’immédiat.
Le premier type de circonstances se produit lorsqu’un homme qui pourrait être le père d’un enfant se trouve en danger de mort. Il est alors urgent de préserver les preuves de la filiation biologique de l’enfant, et ceci d’autant plus que l’expertise post mortem est désormais interdite. La jurisprudence antérieure à la loi de bioéthique de 1994 atteste l’existence de telles hypothèses, dans lesquelles les tribunaux acceptaient d’ordonner en urgence des expertises à l’époque seulement biologiques et non pas génétiques9. Dès le lendemain de la loi de 1994, l’impossibilité d’effectuer des tests ADN dans ce genre de situation se manifesta10.
La parade qui fut trouvée par les juges du fond fut d’ordonner, non pas une expertise ADN interdite, mais le recueil de prélèvements sanguins, permettant une expertise simplement biologique (comparaison des groupes sanguins) et demeurant disponibles pour une expertise ADN ordonnée ultérieurement dans le cadre d’un procès de filiation11.
Ce palliatif est indispensable pour éviter la condamnation strasbourgeoise qui ne manquerait pas si l’interdiction des expertises ADN sur une personne mourante aboutissait à priver un enfant de sa filiation paternelle.
En tout état de cause, l’interdiction de l’expertise ADN amiable dans ce genre de situation oblige à une instance judiciaire, alors que la famille si elle est d’accord, pourrait parfaitement établir la filiation de l’enfant par un acte de notoriété si les tests génétiques pouvaient être faits. Ce qui gagnerait du temps et de l’argent tant pour les justiciables que pour les magistrats.
Une seconde hypothèse d’utilité des tests ADN en dehors de tout procès de filiation, a été révélée par une affaire d’accouchement anonyme. En l’occurrence, les parents d’une femme qui avait accouché « sous X », ayant eu connaissance de cette naissance, souhaitaient faire obstacle au placement de l’enfant et à son adoption, et l’élever eux-mêmes. Pour établir le lien avec l’enfant leur permettant d’attaquer l’arrêté d’admission comme pupille de l’État, comme le prescrivait l’article L. 224-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) dans sa rédaction de l’époque, ils avaient sollicité et obtenu sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile qu’une expertise ADN établisse leur lien de parenté génétique avec le bébé12. Personne, pas même le ministère public, ne s’avisa que l’expertise servant de base à la procédure n’aurait jamais dû être ordonnée… et l’on peut s’en féliciter dans l’intérêt de l’enfant.
La nouvelle rédaction de l’article L. 224-8 du CASF, dont le 2° ouvre la faculté de contester l’arrêté d’admission aux « membres de la famille » de l’enfant, ne modifie en rien l’intérêt de l’expertise ADN. En effet, ne pouvant s’appuyer sur l’identité de la femme qui a accouché, ceux qui pensent que l’enfant fait partie de leur famille – grands-parents, oncles ou tantes – ne peuvent compter que sur une expertise génétique pour l’attester. Et, comme ils ne sont pas habilités à intenter une action relative à la filiation de l’enfant puisque ces actions sont « attitrées » et réservées à ceux qui estiment être les parents, seul un test ordonné en dehors de tout procès de filiation peut donner une consistance réelle au droit de contestation ouvert par l’article L. 224-8, 2°, du CASF.
On conviendra que dans ce type de circonstances, l’interdiction des référés-expertise génétique, si elle était respectée, causerait un grave préjudice à l’enfant, et de manière irréparable.
Cette prohibition a encore été rappelée dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 janvier 201613. Il s’agissait, en l’espèce d’une affaire d’usurpation d’identité. À la suite d’une demande d’acte de naissance, il était apparu que l’acte correspondant à cette demande avait été précédemment délivré à une autre personne. L’affaire ayant été soumise au tribunal, celui-ci estima que des preuves suffisantes permettaient de confirmer l’identité de celui qui s’était vu délivrer l’acte de naissance, et refusa l’expertise biologique sollicitée par le demandeur. La Cour de cassation rejeta le pourvoi, au motif que « l’action destinée à obtenir la copie intégrale d’un acte de naissance n’est pas une action relative à la filiation, de sorte que l’expertise biologique, qui ne saurait être une expertise génétique réglementée par l’article 16-11 du Code civil, n’est pas de droit ».
Cette décision reprend donc la distinction entre les expertises biologiques, qui demeurent soumises au régime plus libéral dégagé autrefois par la jurisprudence en l’absence de texte spécifique, et les expertises génétiques, réglementées par l’article 16-11 du Code civil. Si cette distinction permet heureusement d’échapper au carcan des lois de bioéthique, elle n’en donne pas moins l’impression de se voir condamné à voyager en diligence à l’ère de la navette spatiale… On ajoutera ne pas percevoir l’intérêt de refuser l’expertise génétique dans ce genre d’affaires, puisqu’elle aurait permis de s’appuyer sur des certitudes alors que les juges ont dû se contenter de conjectures.
Cette affaire doit être rapprochée de plusieurs autres14 dans lesquelles l’expertise génétique fut vainement sollicitée pour confirmer des actes de naissance dressés à l’étranger dans des conditions douteuses, alors que la nationalité du demandeur dépendait de sa filiation.
Sans doute la Cour de cassation peut-elle rappeler (notamment dans l’arrêt du 23 septembre 2015) que l’établissement de la filiation n’a d’effet au regard de la nationalité que s’il a lieu pendant la minorité de l’intéressé. Toute action relative à la filiation, fût-elle couronnée de succès, eut été inapte à conférer à la demanderesse la nationalité revendiquée. Mais si des actes de naissance susceptibles d’établir cette filiation existent, tout en demeurant sujet à caution, pourquoi ne pas autoriser leur confirmation par un test génétique15 ? Sauf à vouloir délibérément faire du refus de la preuve génétique une arme juridique contre l’immigration, dans un cas où cela se justifie particulièrement mal, les demandeurs ne pouvant être tenus pour responsables de la médiocre qualité des états civils étrangers.
Les tests génétiques ont mauvaise presse en matière de nationalité : en témoigne la loi n° 2007-1631, du 20 novembre 2007, relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, dont l’article 13, codifié à l’article L. 111-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), avait introduit la possibilité de recourir aux tests génétiques dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. La possibilité de recourir à ces tests ADN, bien qu’ultra limitée, avait déchaîné les médias et aucun ministre n’a voulu signer le décret d’application indispensable à son application. L’article L. 111-6 du CESEDA est donc devenu caduc.
La réticence à l’égard des tests ADN s’explique par la volonté de ne pas soumettre l’ensemble des actes d’état civil à confirmation par expertise génétique : ce serait instiller une suspicion généralisée, dont les étrangers pourraient être les premières victimes.
Mais cette interdiction se retourne contre ceux qu’elle est censée protéger, en paralysant leur demande de confirmation par expertise génétique des documents incomplets ou douteux.
Il n’y a pas lieu de se méfier des tests génétiques plus que de tout autre moyen scientifique d’expertise. Tout dépend de la manière dont ils sont utilisés. L’obligation de solliciter leur réalisation par le juge des référés paraît un obstacle bien suffisant pour éviter les demandes incongrues ou nocives. Il est temps de réécrire l’article 16-11 du Code civil dans une version moins restrictive.
Françoise DEKEUWER-DÉFOSSEZ
Exercice de l’autorité parentale à l’épreuve de la détention provisoire du père (Cass. crim., 27 juill. 2016, n° 16-83271, PB)
L’exercice de l’autorité parentale n’échappe pas aux vicissitudes de la vie, notamment lorsque le titulaire fait l’objet de poursuites pénales, qui risquent d’affecter les conditions de vie du mineur, comme en témoigne l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 27 juillet 201616.
Depuis le décès de la mère, un père exerçait l’autorité parentale à titre exclusif sur sa fille de 12 ans. Le 19 avril 2016, il est mis en examen des chefs d’infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé. Lors de son interrogatoire de première comparution, il indique au juge d’instruction qu’il exerce seul l’autorité parentale sur sa fille. Une enquête rapide d’orientation est effectuée par une association habilitée. Le même jour, le juge des libertés et de la détention le place sous mandat de dépôt.
Le mis en examen interjette appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention invoquant une méconnaissance des dispositions de l’article 145-5 du Code de procédure pénale en l’absence d’enquête prévue par ce texte. Par arrêt du 26 avril 2016, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France confirme l’ordonnance litigieuse plaçant le père en détention provisoire au motif que, devant le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention, le père s’est abstenu de mentionner que sa fille de 12 ans vivait à son domicile, puisqu’il avait pris ses dispositions, au cours de la garde à vue, pour qu’elle soit prise en charge par sa sœur et il n’a pas davantage fait état de tracas liés à sa détention devant l’enquêteur social. Au demeurant, l’absence d’enquête prévue par l’article 145-5 dudit code n’est pas de nature à entacher de nullité l’ordonnance de placement en détention et les juges ont pu conclure qu’ils disposaient d’éléments suffisants pour établir que la santé, la sécurité et la moralité de l’adolescente n’étaient pas en danger ou que les conditions de son éducation n’étaient pas gravement compromises à raison de la détention de son père.
Le père se pourvoit en cassation, invoquant une violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 144, 145-5 et 593 du Code de procédure pénale.
Par arrêt du 27 juillet 2016, la chambre criminelle rejette le pourvoi au motif qu’« en statuant ainsi, et dès lors qu’une enquête a bien été diligentée avant le placement en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, conformément aux exigences des dispositions de l’article 145-5 du Code de procédure pénale, la chambre d’instruction, qui a apprécié souverainement l’ensemble des éléments soumis à son examen, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ».
La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que si l’enquête préalable est nécessaire (I), elle est à elle seule suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 145-5 du Code de procédure pénale (II).
I. L’enquête préalable, une condition nécessaire
Comme la mise en détention provisoire du titulaire de l’autorité parentale ne peut qu’influer sur la situation de l’enfant mineur, le législateur a introduit une disposition spécifique : l’article 145-5 du Code de procédure pénale.
Dans sa rédaction originelle, tirée de la loi n° 2000-516, du 15 juin 200017, l’article disposait que « le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d’une personne faisant connaître qu’elle exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez elle sa résidence habituelle ne peut être ordonné sans que l’un des services ou l’une des personnes visés au septième alinéa de l’article 81 ait été au préalable chargé de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention de l’intéressé ou à y mettre fin ».
Mais cette disposition a ensuite été modifiée par la loi n° 2002-307, du 4 mars 200218. Désormais, « le placement en détention provisoire d’une personne faisant connaître, lors de son interrogatoire par le juge d’instruction préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention, qu’elle exerce à titre exclusif l’autorité parentale sur un mineur de 16 ans au plus ayant chez elle sa résidence ne peut être ordonné sans que l’un des services ou l’une des personnes visés au septième alinéa de l’article 81 ait été chargé au préalable de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises ».
Pour autant, l’enquête préalable n’est pas réalisée automatiquement. Elle doit être sollicitée par le parent poursuivi. Celui-ci doit faire connaître expressément au juge d’instruction qu’il exerce seul l’autorité parentale sur l’enfant qui vit avec lui19. Et même si elle est demandée, l’enquête n’en reste pas moins soumise à des conditions strictes.
Tout d’abord, l’enfant doit être âgé de moins de 10 ans jadis, 16 ans aujourd’hui. En l’espèce, cette condition était remplie, puisque la fille était âgée de 12 ans.
Ensuite, le mineur doit résider chez le parent poursuivi. À l’origine, le dispositif de l’article 145-5 du Code de procédure pénale pouvait s’appliquer lorsque les parents vivaient ensemble ou séparément dès lors que la résidence de l’enfant était fixée chez le parent poursuivi. Était exclue l’hypothèse où l’enfant résidait chez l’autre parent en cas de séparation. En l’espèce, la fille résidait bien chez son père. Néanmoins, la condition de résidence n’est plus aujourd’hui à elle seule suffisante. Elle a été supprimée par la loi n° 2002-307, du 4 mars 2002, pour tenir compte de l’évolution résultant de la réforme de l’autorité parentale.
S’y ajoute, enfin, une condition relative à l’exercice de l’autorité parentale. Dans sa version originaire, la personne poursuivie devait exercer l’autorité parentale, mais elle pouvait l’exercer conjointement. Par conséquent, le texte s’appliquait non seulement lorsque les père et mère de l’enfant vivaient ensemble mais aussi en cas de séparation. Dorénavant, il ne vaut que si le parent mis en examen exerce l’autorité parentale à titre exclusif. Or, depuis la loi n° 2002-305 du 4 mars 200220, l’exercice exclusif de l’autorité parentale est devenu résiduel21, ce qui réduit considérablement le champ d’application du dispositif mis en place par l’article 145-5, et le limite aux seules hypothèses où le placement en détention provisoire menace directement la situation de l’enfant.
En effet, en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, si la mise en détention modifie les conditions de vie du mineur, celui-ci n’est pas pour autant en danger puisqu’il peut être pris en charge par l’autre parent. Lorsque les parents vivent ensemble, le placement en détention provisoire de l’un d’entre eux ne met pas en péril l’enfant qui vivra alors avec l’autre. De même, si l’enfant vit avec le parent qui va être mis en détention, rien ne s’oppose à ce que le mineur aille vivre chez l’autre parent, dès lors que les père et mère le décident d’un commun accord. Et, si au moment de la séparation, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l’enfant chez le parent poursuivi, l’autre parent pourra alors saisir le magistrat afin d’obtenir un changement de résidence. Si en principe, la stabilité pour l’enfant est un élément essentiel pour le magistrat, la mise en détention du parent chez lequel l’enfant résidait constituera souvent un élément nouveau justifiant le transfert de résidence.
En revanche, la situation est bien différente en cas d’exercice exclusif de l’autorité parentale : l’autre parent ne pourra pas forcément prendre le relais pour assurer la protection du mineur, soit parce qu’il a été privé judiciairement de l’exercice de l’autorité parentale – notamment en cas de séparation22 –, soit parce qu’il est décédé. Dans ces circonstances, il semble difficile – voire impossible – d’envisager que l’enfant aille vivre avec l’autre parent. Certes, le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale en reste titulaire – et conserve la possibilité de solliciter du juge aux affaires familiales une modification de l’exercice de l’autorité parentale23. Au demeurant, en matière d’assistance éducative, le juge des enfants ne peut-il pas lui confier l’enfant lorsqu’il est en danger24 ? Le mineur peut théoriquement être confié à l’autre parent, même s’il n’exerce pas l’autorité parentale, mais sous condition. D’une part, des circonstances nouvelles doivent démontrer une situation de danger – tel peut être notamment le cas lorsque l’enfant risque de se retrouver seul du fait de la mise en détention provisoire. D’autre part, encore faut-il que l’autre parent soit en mesure d’assurer la protection de l’enfant25. Ainsi, le parent qui est privé de l’exercice de l’autorité parentale a toujours vocation à ce que l’enfant revienne vivre avec lui, mais uniquement sous le contrôle du juge qui en appréciera l’opportunité dans l’intérêt de l’enfant. Mais encore faut-il alors s’assurer que ces conditions soient réunies. L’enquête préalable trouve alors tout son sens afin d’éviter que l’enfant ne puisse retourner vivre chez le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale sans aucun contrôle. En revanche, cette solution est purement et simplement exclue lorsque l’autre parent est décédé, comme en l’espèce. Dans ce contexte, l’enquête préalable a toute sa raison d’être, ce qui met clairement en exergue le changement de finalité de ladite enquête opéré par le législateur, rendant l’enquête préalable suffisante en l’espèce.
II. L’enquête préalable, une condition suffisante
À l’origine, la volonté du législateur était de rendre la détention exceptionnelle afin d’éviter la séparation entre l’enfant et l’un de ses parents26, et qu’il ne soit confié le cas échéant à l’aide sociale à l’enfance27. L’article 145-5 du Code de procédure pénale était une incitation forte à ne pas placer en détention les parents de jeunes enfants. Le service en charge de l’enquête devait proposer une alternative à la détention (contrôle judiciaire…) pour les personnes exerçant l’autorité parentale sur le mineur de moins de 10 ans. Le but était d’éviter que de jeunes enfants ne soient privés de leur père ou mère par une détention qui devait être prononcée28. Le recours à la détention n’était possible que si aucune solution de substitution n’était trouvée29. Louable en soi, cet objectif conduisait à opérer une distinction en fonction de la situation familiale des personnes poursuivies, distinction critiquable même si elle était objectivement justifiée par un souci de protection de l’enfance30.
Or la finalité du dispositif instauré par l’article 145-5 du Code de procédure pénale a changé31. Aujourd’hui, l’enquête ne tend plus à proposer des « mesures propres à éviter la détention »32, elle est clairement orientée sur la protection du mineur afin qu’il ne se retrouve pas seul33.
Preuve en est la rédaction de l’article 145-5 du Code de procédure pénale, résultant de la loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 : le service est dorénavant « chargé (…) de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises ». Cette nouvelle rédaction fait directement écho à l’article 375 du Code civil en matière d’assistance éducative, qui reconnaît au juge des enfants la compétence d’intervenir lorsque l’enfant est en danger34.
L’enquête préalable a bien pour objet principal la gestion du risque que peut générer la mise en détention du parent qui exerce à titre exclusif l’autorité parentale. Le service en charge de l’enquête doit désormais s’assurer que l’enfant qui résidait avec le parent susceptible d’être incarcéré n’est pas en danger du fait de la mise en détention envisagée, et proposer, le cas échéant, des mesures pour y remédier.
Souvent, la situation aura déjà été gérée au moment de l’arrestation et de la garde à vue. Elle a d’ailleurs pu l’être par le parent lui-même – en l’espèce le père avait pris ses dispositions afin que l’adolescente soit prise en charge par sa sœur. Cependant, cette solution peut n’être que temporaire et ne pas avoir vocation à se prolonger si la mise en détention du parent est prononcée. Tel pourrait être notamment le cas lorsque l’enfant est pris en charge temporairement par un(e) voisin(e) par exemple. C’est la raison pour laquelle le parent doit signaler la situation au juge d’instruction afin qu’une enquête soit alors réalisée. Le service en charge de l’enquête devra alors proposer des mesures afin que l’enfant puisse être pris en charge, éventuellement par le service de l’aide sociale à l’enfance.
Mais, dès lors que l’enquête satisfait à ces exigences, il faut éviter les éventuels détournements de procédure en veillant à ce que le parent poursuivi ne puisse pas se prévaloir du dispositif de l’article 145-5 du Code de procédure pénale instauré en faveur du mineur, pour remettre en cause la décision le plaçant en détention provisoire35. Comme l’enquête préalable n’a plus pour finalité de proposer des mesures propres à éviter la détention, elle ne constitue plus une condition préalable à son prononcé. Et c’est somme toute logique au regard de la position de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a toujours considéré que l’insuffisance de l’enquête n’est pas sanctionnée par une nullité36. De plus, le juge n’avait pas à surseoir en attendant les résultats de l’enquête37. A fortiori, il en va de même si l’enquête est justifiée par un souci de protection de l’enfance. En l’espèce, « une enquête avait bien été diligentée avant le placement en détention provisoire ». C’est dire que la finalité de l’enquête prime, ce qui rejaillit sur le plan formel.
La forme est nécessairement indifférente. D’un point de vue purement matériel, l’enquête peut donc avoir pour support l’enquête rapide d’orientation pénale réalisée au cours de la procédure. Évidemment, les enquêtes n’ont pas le même objet, même si elles peuvent être confiées au même service. Aussi, l’instrumentum importe peu dès lors que l’enquête contient expressément les éléments requis par l’article 145-5 du Code de procédure pénale et que la problématique spécifique tenant à la protection de l’enfant mineur y est abordée. Dans ces conditions, le juge de la détention et des libertés aura un document unique contenant l’ensemble des informations nécessaires pour se prononcer sur la mise en détention de la personne poursuivie et sur ses suites pour l’enfant de moins de seize sur lequel elle exerce seule l’autorité parentale…
Delphine AUTEM
2°/ Le contrôle non demandé : prescription et obligation d’entretien (Cass. 1re civ., 31 mars 2016, n° 15-14617, 1re espèce ; Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-17993, 2e espèce ; Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n° 14-26273, 3e espèce et Cass. 1re civ., 22 juin 2016, n° 15-21783, 4e espèce)
L’action en paiement de la contribution à l’entretien de l’enfant sous l’emprise du temps
Le devoir d’entretien et d’éducation de l’enfant, repris aux articles 203 et 371-2 du Code civil, est attaché à la maternité et à la paternité. Cette obligation d’entretien qui pèse sur les père et mère ne doit pas être considérée comme une stricte obligation alimentaire, tant son fondement que son régime juridique présentent des différences au regard du droit commun des aliments. Elle est marquée par l’unilatéralité, puisqu’il s’agit d’un devoir des parents envers leur enfant non soumis à réciprocité, ni exclusion d’indignité. Cette obligation ne mobilise que les parents, et rien qu’eux (pas les grands-parents38), tout en s’imposant aux deux parents, en fonction de leurs ressources respectives (C. civ., art. 371-2). Également, son objet dépasse largement le quantum de ce que l’on peut dire « alimentaire », même si les « simples aliments » ne se sont jamais résumés aux seuls frais de bouche. Avec l’obligation d’entretien, il ne s’agit pas que de nourrir, il faut aussi élever et éduquer. En l’absence de vie commune, l’obligation sera exécutée sous la forme d’une contribution qui permettra de faire accéder l’enfant à son niveau de vie, sans qu’il ait besoin de justifier d’un quelconque état de besoin. Sa vocation n’est pas d’apporter un secours, mais de partager un train de vie familial afin d’amener l’enfant à l’autonomie39.
« Qui fait l’enfant doit le nourrir » disait Loysel. Conçu comme une évidence, l’adage n’a pas perdu de sa force, aujourd’hui encore, même si l’obligation s’est constamment enrichie. Mais il est des évidences qui deviennent moins criantes quand il s’agit de les positionner dans le temps. Dès lors que l’obligation d’entretien est abordée sous l’angle du temps, elle soulève un contentieux qui s’est bien souvent cristallisé autour de cette question : jusque quand ? Une interrogation qui porte sur le terme de la contribution dont l’exigibilité ne s’arrête pas de plein droit à la majorité de l’enfant (C. civ., art. 371-2, al. 2). Le devoir d’entretien peut donc se poursuivre, non indéfiniment toutefois, ou être relayé par une obligation alimentaire à la nature plus étroite, qui colle davantage au contenu de l’adage40. Mais le bornage dans le temps suscite une autre interrogation qui peut paraître a priori plus incongrue : à partir de quand ? À première vue, la réponse ne semble pas poser de difficulté particulière puisque l’obligation d’entretien débute au moment où l’on devient parent, et ce moment coïncide avec la naissance de l’enfant. Il est pourtant des hypothèses où l’établissement du lien de filiation sera plus tardif, notamment dans le cas d’une paternité judiciairement déclarée. Cette paternité tardive n’en « fait » pas moins un père, avec tous les effets qui y sont attachés. Plusieurs décisions de la première chambre civile de la Cour de cassation ont eu à connaître de litiges engendrés par la rétroactivité des effets de la déclaration de paternité sur la contribution d’entretien. Dans toutes les espèces ici rapportées, les faits présentent d’importantes similitudes. À chaque fois, il s’agit d’enfants dont la filiation n’a été établie à la naissance qu’à l’égard de leur mère. Des années plus tard, une action est dirigée contre un homme en vue d’une déclaration judiciaire de paternité et, à l’occasion de celle-ci, est formulée une demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Liées dans le temps lors de leur déclenchement, l’action sur le fond et l’action en paiement sont-elles dissociables quant aux effets produits par l’écoulement du temps ? Faut-il plus précisément considérer que l’effet rétroactif attaché à la déclaration de paternité, en s’étendant à la contribution d’entretien, soumet cette dernière au même régime de prescription ? Le temps que l’on remonte commande-t-il le temps qui éteint ?
La réponse dépend pour beaucoup des caractères de la contribution d’entretien dont on peut affirmer l’autonomie (I) et la périodicité (II).
I. L’autonomie de la créance d’entretien
Le temps qui éteint la créance d’entretien n’est ni celui des aliments, ni celui de l’action relative à la filiation
A. Une autonomie par rapport au temps des aliments (2e et 4e espèces)
L’autonomie de l’obligation d’entretien au regard du droit des aliments commande-t-elle l’éviction de la règle « aliments ne s’arréragent pas » ?
-
La maxime « aliments ne s’arréragent pas » pose un cas de prescription instantanée reposant sur une logique : le créancier alimentaire qui n’a pas réclamé d’aliments est présumé ne pas en avoir eu besoin.
Le but est d’éviter d’imposer au débiteur alimentaire une charge disproportionnée au regard de ses capacités, lorsqu’il est amené à exécuter en un seul coup sa dette alimentaire avec l’intégralité de ses arriérés. À l’heure actuelle, les revenus sont pour beaucoup ceux du travail, ce qui rend difficile le déblocage de sommes importantes qui répondent davantage à une logique de capitalisation. Sous-jacente, l’idée est aussi de sanctionner la négligence du créancier en raison de la tardiveté de son action. Enfin, la règle permet de rester en cohérence avec la notion d’état de besoin qui doit être impérieuse, ce qui la distingue de la référence du train de vie.
-
Posée pour les « aliments », la maxime est-elle transposable à l’obligation d’entretien ? La réponse est négative.
Si l’on se reporte aux deux décisions présentées ci-dessus, les enjeux attachés à la prescription étaient considérables, la règle invoquée par les débiteurs à l’encontre des demandes de contribution portant sur de longues périodes : 21 ans pour l’espèce n° 2 (Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-17993), 23 ans pour l’espèce n° 4 (Cass. 1re civ., 22 juin 2016, n° 15-21783).
L’inapplication à l’obligation d’entretien de la maxime et de la prescription instantanée qu’elle porte est pourtant sans surprise. Il s’agit d’une position tenue de longue date41. Logiquement, la première chambre civile ne fait que confirmer ici une position bien établie : « la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à l’obligation d’entretien » (Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-17993, 2e espèce ; Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n° 14-26273, 3e espèce ; Cass. 1re civ., 22 juin 2016, n° 15-21783, 4e espèce). Ce rappel interroge toutefois face à la constance de la maxime qui continue à être invoquée pour des créances d’entretien en dépit d’une jurisprudence contraire. Les explications sont sans doute à trouver dans l’échappatoire qu’elle offre face à une charge financière rendue considérable par l’écoulement du temps. La divergence de nature de l’obligation d’entretien avec l’obligation alimentaire n’en est pas moins marquée. L’obligation d’entretien est dépourvue de caractère réciproque et ne peut être considérée que partiellement comme une dette d’aliments. Pour la détermination de la contribution, si l’on tient compte des besoins de l’enfant, il ne faut pas confondre cette référence avec l’état de besoin du créancier qui est la justification du droit aux aliments42. Ceci explique qu’on ne saurait étendre une règle de prescription fondée sur une présomption d’absence de besoins à une contribution tirée vers le haut par son attache au train de vie et sa nature éducative.
B. Une autonomie par rapport au temps de la filiation (3e espèce)
L’autonomie de l’obligation d’entretien commande-t-elle l’indépendance de l’action en contribution au regard de l’action au fond ?
-
En raison d’un mécanisme de rétroactivité, les effets attachés à la paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l’enfant. Il est ainsi fort logique de penser qu’il en va de même du devoir d’entretien, puisqu’il est un des effets attachés à la paternité. Pour l’enfant, le droit à la contribution paternelle remonte donc dès la naissance pour être reconnu à cette date. Théoriquement exigible, mais matériellement non exigée faute de paternité établie, la créance n’en subit pas moins l’érosion du temps. La reconnaissance rétroactive du droit se heurte à un effet inverse : celui de la prescription extinctive.
-
Le délai de prescription à appliquer à la créance d’entretien est-il celui de l’action portant sur la filiation ? C’était la position défendue par les juges du fond dans 3e espèce (Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n° 14-26273). Dans cette affaire, la mère d’un enfant mineur avait déclenché, presque 10 ans après la naissance de l’enfant, une action en recherche de paternité. La cour d’appel de Caen, le 18 septembre 2014, ayant suivi en ce sens le jugement déclarant la paternité, a fait remonter au jour de la naissance de l’enfant l’obligation de contribuer à son entretien et à son éducation à hauteur de 800 € par mois. Elle a écarté la prescription quinquennale invoquée par le débiteur au motif qu’il s’agissait « d’une action relative à la filiation ». Pour la cour d’appel, l’action en paiement était soumise au même délai de prescription que l’action sur le fond, à savoir celui de l’article 321 du Code civil (minorité de l’enfant, plus 10 ans)43.
Une telle solution n’était pas dépourvue d’inconvénients : pour le débiteur, de se trouver face à une charge financière importante, alors qu’il pouvait ne pas avoir été mis en mesure de s’exécuter auparavant (ignorance de sa paternité) ; pour le juge, d’avoir à reconsidérer a posteriori le rapport besoins / ressources, évolutif par nature ; pour la collectivité, d’être confrontée à l’enrichissement rétroactif du créancier, ce qui questionne la légitimité de certaines prestations familiales accordées pour absence de contribution paternelle ou faiblesse de ressources, alors que leur récupération est écartée ou limitée. La première chambre civile de la Cour de cassation a sanctionné l’analyse suivie par les juges du fond en distinguant l’action relative à la filiation et l’action portant sur la contribution qui est « une action en paiement ». En conséquence, les deux actions doivent être dissociées quant au régime juridique à leur appliquer.
Commandée par l’action sur le fond, la contribution d’entretien n’obéit toutefois pas à son régime de prescription, ni à celui des aliments. La périodicité de la créance peut éclairer sur le choix opéré.
II. La périodicité de la créance d’entretien
L’exécution successive questionne l’écoulement du temps qu’elle met à l’épreuve à chaque échéance.
A. Un délai de prescription adapté à la périodicité de la rente (2e et 4e espèces)
Une fois reconnu dans son principe, le devoir d’entretien devra encore se matérialiser en une créance d’entretien. Dès lors que celle-ci s’exécute sous forme d’une rente périodique, son exigibilité se heurte à la problématique des arrérages échus et de leur prescription.
-
La créance d’entretien doit-elle englober toutes les sommes qui auraient été dues à compter de la naissance ? Cette option commande l’application d’une rétroactivité sans obstacle. À partir du moment où l’action portant sur la filiation n’a pas été déclarée prescrite, la demande portant sur la contribution doit suivre le même sort. C’est la position qui a été tenue par les juges de la cour d’appel de Poitiers, le 11 mars 2015, dans l’affaire ayant donné lieu à cassation par la première chambre civile, le 25 mai 2016 (2e espèce). Leur décision entraînait le versement d’arriérés pour une période s’étalant sur 22 ans. La Cour de cassation a censuré le raisonnement au motif qu’ils auraient dû rechercher si « la demande n’était pas prescrite ». Elle distingue clairement, l’action sur le fond, la filiation, de l’action en contribution qu’elle qualifie « d’action en paiement ». Cette distinction permet de soumettre cette dernière à un autre régime de prescription extinctive : « l’action en paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil ».
-
Le choix de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil.
La réforme opérée par la loi n° 2008-561, du 17 juin 200844, a eu pour effet de faire disparaître l’ancien article 2277 du Code civil qui fixait à 5 ans le délai de prescription des créances périodiques. Devenu le délai de droit commun des actions personnelles ou mobilières, l’actuel article 2224 du Code civil intègre à présent les actions en paiement des rentes et pensions.
En ce qui concerne les arrérages échus, la première chambre civile les soumet, dans cette 2e espèce, à la prescription quinquennale, ce qui limite aux cinq années précédentes l’effet pour le passé de la condamnation portant sur l’entretien de l’enfant. La motivation est identique dans la 4e espèce (Cass. 1re civ., 22 juin 2016, n° 15-21783), à la différence toutefois que c’est un arrêt de rejet qui est rendu puisque les juges du fond avaient déjà fait application de la prescription de l’article 2224 du Code civil pour limiter le versement d’arriérés qui couraient ici sur une période de 23 ans.
La prescription quinquennale a été également appliquée dans la 3e espèce (Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n° 14-26273) qui a écarté la qualification « d’action relative à la filiation » au profit de celle « d’action en paiement »45.
Le raisonnement suivi par la première chambre civile de la Cour de cassation permet clairement de distinguer l’action sur le fond qui instaure une rétroactivité au jour de la naissance (effet déclaratif), de l’action en paiement qui se heurte à la prescription attachée à la nature de la créance, à savoir sa périodicité (effet extinctif).
B. Un déclenchement de la prescription opéré au jour de la demande
Tout délai de prescription pose la question de la détermination du point de départ auquel rattacher la computation du délai.
-
Peut-on choisir le jugement établissant la paternité comme point de départ de l’obligation de contribuer à l’entretien de l’enfant ? (1re espèce)
Opérer un tel choix signifie que l’on exclut d’emblée toute problématique liée à l’écoulement du temps, puisque cela revient à nier toute créance pour le passé. Rien à prescrire, la créance n’était pas née.
Dans la première espèce, les juges du fond ont suivi cette analyse en faisant courir le droit à contribution uniquement à compter de la date du jugement déclarant la paternité. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 8 juillet 2014, a ainsi écarté tout effet rétroactif concernant l’obligation d’entretien au motif que « cet état de droit est imputable à la mère qui a bénéficié des droits sociaux ouverts par cette situation ». Ce raisonnement est sanctionné par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 31 mars 2016, sur la base des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, car « les effets d’une déclaration judiciaire de paternité remontent à la naissance de l’enfant ».
Cette décision a le mérite de faire apparaître clairement les deux étapes du raisonnement qui doit être tenu :
-
première étape : le droit à la contribution est traité comme l’un des effets de la paternité et « mécaniquement » remonte au jour de la naissance de l’enfant par l’effet « déclaratif » du jugement de paternité ;
-
deuxième étape : la détermination de la contribution opérée par le jugement la fixe pour l’avenir et commande l’application de la prescription extinctive pour les échéances passées.
Il en ressort que la première étape ne saurait être contrariée dans son effet rétroactif, et ceci, même au nom de la volonté de sanctionner le comportement passé de la mère ayant à charge l’enfant mineur.
La référence faite par les juges du fond à « l’état de droit imputable à la mère » tendait à tirer les conséquences de l’attitude de la mère qui avait volontairement fait échec à la présomption de paternité en déclarant la naissance de l’enfant sous son nom de jeune fille, s’étant séparée de son mari dès le 3e mois de grossesse. L’autre aspect de leur motivation tiré de l’existence de droits sociaux, traduit toute la difficulté qu’il peut y avoir à reconsidérer a posteriori l’équation besoins/ressources, une partie des besoins de l’enfant ayant fait l’objet d’une prise en charge spécifique par la collectivité du fait même de l’absence de filiation paternelle. Mais la première chambre civile se refuse à entrer dans de telles considérations. En affirmant le principe de la rétroactivité des effets de la paternité à la naissance, elle écarte toute possibilité d’y porter exception.
La rétroactivité actée, la situation juridique a pu développer des effets dans le passé, que le déclenchement de la prescription extinctive peut encore venir limiter.
-
Le déclenchement de la prescription à compter de la date de la demande de contribution d’entretien (2e et 4e espèces)
Combinés au mécanisme de rétroactivité, les termes de l’article 2224 du Code civil auraient pu semer le doute quant à l’exact temps du déclenchement du délai de prescription. Selon la nouvelle rédaction issue de la réforme de 2008, le délai de cinq ans commence à courir « à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Est-ce au jour du jugement ayant déclaré la paternité ? Peut-on remonter plus en avant ? La jurisprudence est heureusement venue préciser la combinaison des temps à adopter en matière de créance à nature alimentaire. Depuis longtemps, il est établi que le droit aux aliments est dû à celui qui en réclame le paiement à compter de la demande en justice et non à compter du jugement lui-même46. Il en va de même du paiement de la contribution à l’entretien de l’enfant afin de ne pas lui faire subir les lenteurs de la procédure judiciaire. La date de l’assignation s’impose logiquement à la créance pour les échéances à venir, mais elle devient aussi le point de référence des arrérages passés pour lesquels il convient de faire jouer la prescription quinquennale. Il s’agit de la solution qui est appliquée par la première chambre civile dans l’ensemble des décisions commentées ici.
Particulièrement, à l’occasion de la deuxième espèce, elle a sanctionné le raisonnement des juges du fond qui ont intégré dans le calcul de la contribution l’ensemble des arrérages échus depuis la naissance de l’enfant « sans rechercher, comme elle (la cour) y était invitée, si la demande de Mme X n’était pas prescrite ». En revanche, elle approuve, dans la quatrième espèce, la cour d’appel « qui a relevé que la demande de Mme X portait sur la période du 11 janvier 1989 au 11 janvier 2007 et qu’elle avait été présentée la première fois que le 13 février 2012, en a exactement déduit que l’action était prescrite ». La prescription quinquennale limite ainsi les récupérations à cinq annuités d’arrérages échus à compter de la demande de paiement. L’assemblée plénière, le 10 juin 200547, avait déjà mis en lumière la distinction qui doit être opérée entre la prescription qui affecte l’exécution du jugement (le titre) et celle qui porte sur les arrérages (l’obligation) : « si le créancier peut poursuivre pendant 30 ans (10 ans aujourd’hui) l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2277 (2224 anc.) du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande »48.
Le jeu des prescriptions doit être manié avec précaution en matière de pension due pour l’entretien de l’enfant car si l’action relative à la filiation peut être déclenchée pendant 28 ans (la minorité de l’enfant, plus 10 ans), l’action pour faire exécuter le droit à contribution reconnu par jugement ne peut être exercée que pendant 10 ans (le titre) pour récupérer un nombre limité d’arrérages (5 annuités). En matière d’aliments, qu’on les prenne au sens strict comme au sens large, mieux vaut ne jamais tarder à agir.
Dominique EVERAERT-DUMONT
3. Le contrôle esquivé
Prestations familiales et mineurs étrangers (Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, n° 15-12598, PB)
Le contentieux relatif au refus d’attribution des prestations familiales aux parents étrangers d’un enfant né hors du territoire français n’en finit pas d’engorger les juridictions françaises. L’affaire soumise à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 11 février 201649 démontre une nouvelle fois le strict respect des règles légales françaises par la juridiction suprême.
Dans cette affaire, un père, de nationalité nigériane et résidant régulièrement en France depuis 2005, s’était adressé le 30 mars 2011 à la caisse d’allocations familiales de Valence afin de bénéficier de prestations familiales pour ses trois enfants mineurs entrés en France le 27 février 2011. Ces derniers étaient titulaires d’un visa D portant la mention « regroupement familial OFII », document délivré par l’ambassade de France au Nigeria. En revanche, le père des enfants n’était pas en mesure de produire le certificat de contrôle médical fourni en principe par l’Office français d’immigration et d’intégration (OFII) permettant de démontrer la régularité de l’entrée des enfants au titre de la procédure de regroupement familial. Aussi, la caisse d’allocations familiales opposa un refus à l’octroi des prestations au motif que les conditions légales n’étaient pas remplies. Le demandeur forma alors un recours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale. En parallèle, ce père avait également entamé des démarches pour bénéficier du regroupement familial auprès de l’OFII et régulariser ainsi l’entrée des mineurs sur le territoire français. Cette procédure implique une visite médicale des enfants gratuite qui permet d’identifier d’éventuels problèmes de santé. Toutefois, pour des raisons non mentionnées dans l’arrêt, le préfet de la Drôme et le directeur territorial de Lyon de l’OFII avaient refusé de procéder à ce contrôle médical par décisions en date d’avril 2011. Lesdites décisions avaient alors été contestées par les parents des enfants devant le tribunal administratif de Grenoble. Un jugement d’annulation avait été rendu et le tribunal administratif avait, dans le même temps, enjoint au préfet, sous réserve d’une modification dans les circonstances de droit et de fait, d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de l’épouse et des enfants du demandeur dans les deux mois suivant la notification du jugement.
Au regard de cette décision, la juridiction d’appel du contentieux de la sécurité sociale considéra que le tribunal administratif avait constaté la régularité de l’entrée et du séjour des enfants du demandeur et que cette constatation suffisait à lui permettre de bénéficier des prestations familiales en faveur de ses enfants ; l’absence du certificat de contrôle médical délivré par l’OFII ne lui étant pas imputable. La caisse d’allocations familiales de la Drôme forma alors un pourvoi en cassation qui aboutit à ce que l’arrêt d’appel soit cassé. Pour la haute juridiction, le jugement du tribunal administratif, même assorti d’une injonction à l’autorité préfectorale et à l’OFII, ne conférait aucun titre au père des enfants de sorte que celui-ci ne justifiait pas de la situation des mineurs au regard des articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette décision est l’occasion de revenir sur les conditions d’octroi des prestations familiales en faveur des parents étrangers d’un enfant né hors du territoire français (I) et sur la rigidité dont font preuve les juges concernant l’application des règles légales (II).
I. Les conditions d’octroi des prestations familiales au parent étranger du mineur né hors du territoire français
La jurisprudence était, à l’origine, plutôt favorable à l’octroi des prestations familiales en faveur d’un demandeur étranger pour son enfant né hors de France. Face à une législation peu claire en la matière – les articles du Code de la sécurité sociale étant sujets à deux interprétations – la Cour de cassation penchait vers une ouverture simplifiée aux prestations familiales : dès lors que le demandeur étranger démontrait la régularité de son séjour en France, cette condition n’était pas exigée pour l’enfant au titre duquel il souhaitait obtenir la prestation familiale50. La loi du 19 décembre 200551, en modifiant l’article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, ne permit plus aux magistrats de tenir une telle position : désormais, pour ouvrir un droit au bénéfice des prestations familiales, sauf exceptions, les enfants nés hors du territoire français devront en plus être entrés en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial, la preuve étant apportée par le certificat médical délivré par l’OFII.
En effet, soit la personne de nationalité étrangère est ressortissante d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse auquel cas les conditions de régularité de séjour ne sont pas exigées, soit la personne de nationalité étrangère est ressortissante d’un État avec qui la France est liée par une convention bilatérale de sécurité sociale auquel cas il est fréquemment stipulé que le ressortissant étranger sera traité comme le ressortissant français52, soit la personne de nationalité étrangère est ressortissante d’un État ne relevant pas des critères précédemment évoqués auquel cas ce sont les conditions spécifiques des articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale qui s’appliquent. Dans cette dernière hypothèse, l’enfant pour qui est demandée la prestation doit relever d’une des sept situations visées par cet article comme être né en France, être membre de la famille d’un réfugié ou encore être entré en France via une procédure de regroupement familial. Le justificatif demandé est différent selon la situation dans laquelle l’enfant se trouve : en ce qui concernait l’arrêt soumis aux juges de la Cour de cassation, le justificatif manquant était le certificat de contrôle médical de l’OFII, les enfants relevant d’une procédure de regroupement familial.
Malgré les nombreuses critiques à son égard53, la loi de 2005 a été validée par le Conseil constitutionnel54 et les juges prirent acte des nouvelles exigences posées par le Code de la sécurité sociale55. Arguant de la violation des articles 856 et 1457 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, deux affaires iront même devant la Cour européenne qui déclarera les requêtes irrecevables58. Les juges européens estimèrent qu’il existe effectivement une différence de traitement fondée sur un critère lié à la nationalité et au respect des règles légales concernant le regroupement familial entre les requérants et les parents percevant les prestations familiales mais que cette différence de traitement n’est pas exclusivement fondée sur la nationalité et intervient dans le domaine économique et social ce qui justifie la large marge d’appréciation laissée à l’État français. La décision européenne n’a fait que renforcer la position des magistrats français59 qui vérifient de manière rigoureuse si les conditions prévues au sein du Code de la sécurité sociale sont remplies ou non, et ce quelles que soient les circonstances.
II. La stricte application des conditions légales par les juridictions françaises
Les juges d’appel de Grenoble avaient fait preuve de souplesse quant à l’application des règles légales dans la situation qui leur était soumise : pour eux, le demandeur aux prestations familiales pouvait prétendre à celles-ci étant donné le contexte. En effet, même s’il n’était pas en mesure de produire le certificat de contrôle médical exigé aux articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale, d’une part, cette circonstance ne lui était pas imputable – la visite de contrôle avait été refusée par le préfet et le directeur territorial de l’OFII – et d’autre part, la juridiction administrative avait annulé la position des autorités administratives et enjoint les autorités administratives à délivrer une autorisation de regroupement familial en faveur de l’épouse du demandeur et de leurs trois enfants. Cette position justifiée par les circonstances de l’espèce a été annulée par la Cour de cassation. Pour les magistrats du quai de l’Horloge, le jugement du tribunal administratif ne pouvait pas se substituer à la pièce spécifique exigée par le Code de la sécurité sociale pour démontrer le respect de la procédure de regroupement familial. Il s’agira donc pour les juges du fond de devoir apprécier strictement la réunion des conditions légales.
Comme le rappelle un auteur, il est vrai que cette position n’aura pas d’effet sur le montant global des sommes versées60. En effet, dans une telle hypothèse, ce n’est pas la date où les conditions pour bénéficier des prestations familiales seront remplies qui ouvrira le droit auxdites prestations, ce qui constitue une exception à l’article R. 512-2 du Code de la sécurité sociale. La Cour de cassation a ainsi considéré que le certificat de contrôle médical permet seulement d’attester de la régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers du demandeur aux prestations et que par là même, il présente un caractère recognitif de sorte que le droit aux prestations est ouvert à la date d’effet de la décision d’admission par mesure de régularisation au bénéfice du regroupement familial61.
Cependant, la position jurisprudentielle appelle deux critiques. La première est qu’elle met potentiellement le demandeur en position de difficultés financières tant qu’il n’obtient pas le certificat de contrôle médical de l’OFII. Or les prestations familiales ayant vocation à garantir de meilleures conditions de vie aux mineurs, l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant62 relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant semble quelque peu oublié dans cette affaire. La seconde est qu’il n’est pas certain qu’elle respecte intégralement la décision de la Cour européenne des droits de l’Homme de 201563. En effet, dans les deux affaires soumises aux magistrats européens, les requérants n’avaient pas effectué de démarches sérieuses pour régulariser la situation des mineurs grâce à la procédure de regroupement familial. Aussi, la Cour avait soulevé le comportement contraire à la loi des demandeurs aux prestations familiales ; sa décision peut donc s’analyser comme une sanction. En revanche, dans l’arrêt de la Cour de cassation de 2016, l’attitude du requérant ne peut être sanctionnée : il avait fait les démarches nécessaires pour régulariser la situation de ses enfants. Il n’est donc pas certain que la position européenne serait transposable à cette affaire dans laquelle les juges français ont fait preuve d’une conception plus que restrictive du droit de la protection sociale64.
Amélie NIEMIEC
Motif légitime de refuser l’expertise biologique et intérêt supérieur de l’enfant (Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 15-22848)
Une fois n’est pas coutume, l’arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 2016, objet du présent commentaire, invite le lecteur à s’interroger sur le sens à donner à l’action en contestation de la filiation paternelle au regard de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’elle est préconisée par l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) aux termes duquel « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Si l’intérêt de l’enfant doit être l’un des premiers éléments à prendre en compte et peser son poids dans toutes les décisions concernant l’enfant et, en particulier, lorsqu’il s’agit de sa filiation, il est intéressant de voir comment les juges mobilisent ce critère. Les enjeux sont de taille car le lien de filiation va permettre de déterminer le statut de l’enfant dans sa famille et lui assigner une identité65.
Les faits de l’espèce témoignent de la difficulté qu’il peut y avoir à appréhender des situations familiales et personnelles pour le moins complexes où se mêlent amour, rancœur et séparation et dans lesquelles l’intérêt supérieur de l’enfant pourra résider soit dans le droit au maintien de sa filiation socio-affective, soit dans l’établissement de sa filiation réelle, fondée sur les liens du sang. Cette affaire nous replonge dans l’« éternel » débat entre vérité biologique et stabilité de la filiation66.
Le 31 août 2006, Mme Y épouse de M. X donne naissance à une petite fille qui a été déclarée à l’état civil comme étant la fille de M. X. En 2009, après avoir entretenu une relation de quelques mois avec M. Z, Mme Y et M. X se séparent, toutefois, une résidence alternée est mise en place pour les enfants du couple. Le 6 septembre 2010, M. Z assigne Mme Y et M. X devant le TGI de Metz en contestation de paternité de M. X et en établissement judiciaire de sa paternité. M. Z qui était un collègue de travail de Mme Y, prétend avoir entretenu une relation amoureuse avec celle-ci au temps de la conception de l’enfant.
Les premiers juges ont déclaré recevable l’action engagée par M. Z et ordonné avant-dire droit une expertise biologique sur l’ensemble des protagonistes aux fins de déterminer lequel des deux hommes est le père de la petite fille. Puis, tirant les conséquences du refus de Mme Y et de M. X de déférer à l’expertise biologique avec l’enfant, le TGI a en substance déclaré que M. X n’était pas son père, sans pour autant établir la filiation de l’enfant à l’égard de M. Z. L’ensemble des intéressés ont alors fait appel de cette décision.
Dans un premier temps, les magistrats de la cour d’appel de Metz67 ont infirmé le jugement en ses dispositions ayant ordonné une expertise biologique considérant que Mme Y et M. X « justifient de raisons légitimes pour s’y opposer, une telle mesure étant sollicitée dans le cadre d’une action tardive, et poursuivant une finalité qui bafoue l’intérêt supérieur de l’enfant concernée ». Les magistrats ont estimé que la finalité recherchée par M. Z n’était pas de faire triompher la vérité biologique, mais de se venger de Mme Y qui a refusé de renouer une relation amoureuse avec lui après son divorce, ce qui expliquerait la tardiveté de l’introduction en justice de l’action en contestation de la filiation de M. X. Puis dans un second temps, les magistrats ont rejeté le bien-fondé de la contestation de la paternité de M. X au vu des moyens de preuve soumis par M. Z, considérant ces moyens de preuve insuffisants car principalement fondés sur des témoignages non probants. Mais pour avoir ainsi apprécié les faits et érigé l’intérêt supérieur de l’enfant en obstacle légitime à la demande d’expertise biologique de M. Z, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel en lui reprochant d’avoir violé les articles 310-3 et 332, alinéa 2, du Code civil.
Si la décision de la Cour de cassation n’est pas en soi une surprise tant elle s’insère dans un mouvement jurisprudentiel considérant que l’intérêt supérieur de l’enfant ne saurait constituer en soi un motif légitime de ne pas procéder à une expertise biologique68, il est toutefois possible de reprocher à la Cour de cassation de s’en être tenue à une appréciation in abstracto de l’intérêt supérieur de l’enfant, alors que la cour d’appel de Metz s’est efforcée, peut-être maladroitement, de se livrer à une appréciation in concreto de cet intérêt. La qualité et la force de la motivation des juges du fond pourraient peut-être à terme inviter la Cour de cassation à reconsidérer la définition de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le procès de la filiation et le contentieux de l’expertise biologique, en lui donnant un contenu normatif plus fourni, plus positif qui permettrait ainsi une meilleure prise en compte des droits de l’enfant69. Cette évolution nous paraît souhaitable considérant que l’intérêt de l’enfant fait partie des finalités du droit de la filiation.
I. L’expertise biologique au cœur du procès de la filiation
Dans le cadre du procès relatif à la filiation, l’expertise biologique occupe aujourd’hui une place essentielle puisqu’elle peut confirmer ou infirmer un lien de filiation biologique. En ce sens, l’expertise est au service de la vérité biologique, tout particulièrement lorsque l’incertitude plane et que les éléments probants font défaut70.
Consciente de son importance et de son intérêt, la Cour de cassation a affirmé, dans le cadre d’une action en contestation de reconnaissance, que l’expertise est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder71. Cette solution a été réaffirmée notamment dans d’autres actions en contestation de reconnaissance72.
Généralisée depuis en tant que mode de preuve de la filiation, la place de l’expertise témoigne d’un changement de paradigme de notre société qui souhaite donner à l’enfant une filiation qui corresponde à la vérité biologique, au nom du droit à son ascendance et du droit de connaître sa filiation juridique, sur fond de droit au respect de la vie privée tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’Homme. Pour autant, la volonté du législateur est également de tenir compte du besoin de stabilité de l’enfant, volonté consacrée à l’article 333, alinéa 2, du Code civil73. La réforme du 4 juillet 2005 a certes rendu plus difficile la contestation de paternité, mais dès lors que la prescription n’est pas acquise, comme dans les faits de l’espèce, d’autres considérations peuvent être privilégiées. Face à des situations complexes, l’expertise peut apparaître comme étant la solution. Mais il serait illusoire de penser que l’expertise peut à elle seule résoudre toutes les difficultés et donc tarir le contentieux de la filiation. Le succès de ce mode de preuve suppose en effet que le juge l’ordonne, qu’elle soit réalisable et que les intéressés s’y soumettent74.
Parce que l’expertise biologique porte atteinte au principe constitutionnel de l’inviolabilité du corps humain, le principe est celui du consentement de la personne qui doit s’y soumettre. Toutefois, le juge peut déduire toute présomption qu’il appréciera d’un tel refus75. De l’avis de la Cour européenne des droits de l’Homme, si cette appréciation constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de celui contre qui elle est appréciée, cette ingérence est non seulement prévue par la loi, mais elle poursuit, au sens de l’article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l’Homme, un but légitime, à savoir le droit pour l’enfant de connaître son ascendance, ainsi que le droit à la reconnaissance juridique de sa filiation76. C’est une large marge d’appréciation qui est ici reconnue sans ambiguïté aux juges.
Toutefois, il est possible de faire échec à cette présomption : si l’expertise est en principe de droit, le droit de s’en prévaloir n’est pas pour autant absolu. Un motif légitime peut justifier le refus des juges de l’ordonner. Sur ce point, la Cour de cassation opère un contrôle de droit sur la motivation spéciale du refus77 et censure la décision des juges du fond lorsqu’elles sont insuffisamment ou non motivées78. L’examen de la jurisprudence révèle qu’un motif légitime de ne pas procéder à une expertise biologique résulte de l’existence d’une fin de non-recevoir à une action en contestation tirée de la prescription ou de la conformité du titre et de la possession d’état dans les conditions prévues par la loi79. Ce motif peut également résulter de la motivation du demandeur animé par la rancune et l’esprit de lucre80. Mais il est important de souligner que la Cour de cassation fait preuve de rigueur s’agissant de ces motifs légitimes81.
En l’espèce, la cour d’appel soutient que la finalité recherchée par M. Z n’était pas de faire triompher la vérité biologique, mais de se venger de la mère de l’enfant qui a refusé de renouer une relation amoureuse avec lui après le divorce de cette dernière. La tardiveté de l’action introduite par M. Z lui est donc opposée, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dès lors la question qui se pose est de savoir si l’intérêt de l’enfant peut constituer un motif légitime de ne pas ordonner l’expertise.
II. La légitimité du refus d’ordonner une expertise biologique et l’intérêt supérieur de l’enfant
Si ce motif semble prospéré chez les juges du fond82, comme en l’espèce, il n’en est pas de même devant la Cour de cassation83.
Il est important de souligner que dans les affaires où l’intérêt de l’enfant a trouvé grâce aux yeux des juges du fond, les conditions de recevabilité de l’action en contestation posées par le législateur étaient réunies, tout comme en l’espèce. En effet, le délai de prescription n’était pas expiré et le demandeur avait qualité et intérêt pour agir. L’absence de possession d’état constitue à n’en pas douter une brèche permettant de réajuster la filiation juridique à la vérité biologique supposée être plus favorable à l’enfant, conformément à l’intérêt supérieur de ce dernier. Mais force est d’admettre que l’intérêt supérieur de l’enfant, tel qu’il résulte de l’article 332, alinéa 2, du Code civil, s’apparente davantage à un postulat législatif qui permet à la vérité biologique de triompher, sans considération des situations particulières. Certes, en refusant d’ordonner l’expertise, les juges ont pu rejeter l’action en contestation de paternité sollicitée, alors que peut-être le père juridique n’est pas le père biologique. Mais dans chaque affaire, les juges ont pris le soin de relever et de préciser des éléments de fait légitimant selon nous leur refus d’ordonner l’expertise, afin de ne pas déstabiliser l’enfant en remettant en cause sa filiation socio-affective ou le priver de toute filiation paternelle.
En l’espèce, les magistrats de la cour d’appel de Metz se sont étonnés que le demandeur ait attendu quatre années avant d’introduire son action, alors qu’il prétend avoir passé beaucoup de temps avec la mère de l’enfant durant la grossesse et après la naissance et ce jusqu’en 2010. Les juges ont également relevé que dans les nombreux messages envoyés par M. Z à la mère de l’enfant juste après leur rupture amoureuse, il n’avait jamais évoqué l’enfant dont il prétend être le père, ce qui pour les juges dément l’attachement dont il se prévaut à l’égard de ce dernier et accrédite la thèse de la vengeance. Se livrant à une appréciation in concreto de l’intérêt supérieur de l’enfant, les juges du fond considèrent que la mesure d’instruction était sollicitée dans le cadre d’une action tardive et qu’elle poursuivait une finalité bafouant l’intérêt supérieur de l’enfant. Pourtant, on regrettera que les juges ne se soient pas davantage fondés sur la situation familiale de l’enfant. En l’espèce, M. Y s’est toujours conduit comme son père, et ce même après leur séparation puisqu’une garde alternée a été organisée par les époux. Dans ces conditions, il est permis de se demander si l’intérêt de cette enfant, âgée de 8 ans et demi au moment où la cour d’appel a statué, est de voir sa situation remise en cause, alors que les intentions de son père « présumé » apparaissent douteuses ? L’intérêt d’un homme de voir établir sa paternité judiciairement établie au nom de son droit à sa vie privée doit-il primer sur l’intérêt de l’enfant à mener une vie familiale normale ?
Alors que cette question suscite la réflexion et mérite d’être débattue, la Cour de cassation, confirmant sa jurisprudence, refuse d’y répondre. L’exercice par la Cour de cassation de son contrôle de droit sur la motivation du refus de l’expertise biologique l’a conduit à considérer le caractère tardif de l’action en contestation comme étant un motif inopérant et à refuser de considérer l’intérêt de l’enfant comme constituant un motif légitime de refus de l’expertise biologique. En censurant de la sorte la décision de la cour d’appel, sur la seule base de la violation des articles 301-3 et 332, alinéa 2, du Code civil, la Cour de cassation a clairement fait le choix d’une appréciation in abstracto de l’intérêt de l’enfant, la Cour n’ayant pas jugé utile de se prononcer, comme l’y invitait pourtant le second moyen de cassation, sur la portée du droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant. La rigueur de la Cour de cassation conduit finalement à ne satisfaire que le seul intérêt exclusif du père biologique présumé.
Il est patent de constater que les deux approches relatives à l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant continuent de s’affronter devant les juges et que le débat entre vérité biologique et stabilité de la filiation est loin d’être clos. Pourtant, l’approche défendue par les juges du fond qui refusent d’ordonner une expertise biologique au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, nous semble davantage correspondre à la philosophie de l’article 3 de la CIDE car elle correspond à un enfant et à une situation précise dans laquelle le doute devrait avant tout profiter à ce dernier indépendamment de la situation des adultes. Ce questionnement nous paraît d’autant plus pertinent depuis que la CEDH s’est prononcée dans l’arrêt Mandet c/ France84. L’opinion dissidente de la juge Nussberger est très éclairante sur le sujet puisqu’elle dénonce sans détour l’interprétation stéréotypée de l’intérêt supérieur de l’enfant, plaidant pour une appréciation in concreto qui a été pourtant réalisée à de nombreuses reprises par la CEDH elle-même85.
Fanny VASSEUR-LAMBRY
(À suivre)
C – Une invitation à prendre au sérieux la jurisprudence des juges du fond
1. La méthode proportionnelle sur prescription légale
a. L’« intérêt de l’enfant » à l’épreuve du droit à l’adoption (CA Toulouse, 8 mars 2016, nos 16/197 et 15/05526)
I. L’absence d’accord automatique à la demande d’adoption présentée par une famille d’accueil au conseil de famille des pupilles de l’État
II. Les possibilités ouvertes à la famille d’accueil pour contester la décision du conseil de famille des pupilles de l’État
b) Le terme raisonnable de l’obligation d’entretien (CA Nancy, 25 janv. 2016, nos 16/00212 et 15/00145)
I. L’insuffisance de la majorité de l’enfant comme cause de suppression de l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de celui-ci
II. L’insuffisance du mariage de l’enfant comme cause de suppression de l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de celui-ci
2. La méthode proportionnelle contra legem
a) La déformation de la notion de possession d’état (CA Rennes, 7 mars 2016, n° 15/05178)
I. L’effacement de la filiation de l’enfant admis en tant que pupille de l’État
II. La reconnaissance de la possession d’état à l’égard de l’ancienne assistante familiale de l’enfant majeur
b) La réécriture de l’article 377, alinéa 2, du Code civil (CA Paris, 6 oct. 2016, n° 16/04118 et CA Paris, 13 oct. 2016, n° 16/00656)
I. La démonstration par les services de l’aide sociale à l’enfance d’une tentative de rétablissement du lien familial : condition de preuve textuelle à la déclaration judiciaire de délaissement parental
II. La démonstration par les services de l’aide sociale à l’enfance d’une tentative de rétablissement du lien familial : condition de preuve prétorienne à la délégation forcée de l’autorité parentale
c. Les affres du raisonnement syllogistique en droit international privé
Adoption internationale : erreur sur la majeure (CA Fort-de-France, ch. civile, 12 janvier 2016, n° 13/00273)
Divorce international : pluralité de majeures (CA Paris, 12 avr. 2016, n° 14/06957)
I. Application de la loi française en tant que loi du for
II. Application de la loi désignée par la Protocole de La Haye
Notes de bas de pages
-
1.
D. 2016, p. 1310 ; AJ fam. 2016, p. 388, obs. Saulier M. ; RTD civ. 2016, p. 597, obs. Hauser J. ; Procédures 2016, comm. 267, note Douchy-Oudot M. ; Dr. famille 2016, comm. 173, obs. Fulchiron H.
-
2.
Cass. 1re civ., QPC, 16 déc. 2015, n° 15-16696 : D. 2016, p. 752, obs. Galloux J.-C. et Gaumont-Prat H. ; D. 2016, p. 857, obs. Granet-Lambrechts F. ; AJ fam. 2016, p. 213, obs. Chénedé F. ; RTD civ. 2016, p. 91, obs. Hauser J.
-
3.
V. obs. préc.
-
4.
Cass. 1re civ., 28 nov. 2007, n° 06-19157 : Bull. civ. I, n° 37 ; AJ fam. 2008, p. 36, obs. Chénedé F. ; RJPF 2008/2, n° 33, obs. Garé T. ; RTD civ. 2008, p. 284, obs. Hauser J.
-
5.
CEDH, 16 juin 2011, n° 19555/08) : Dekeuwer-Défossez F., « Le droit français de la filiation et la Cour européenne des droits de l’Homme : chronique d’une condamnation prévisible », RLDC 2011/86, n° 4399 ; D. 2011, p. 1758 ; AJ fam. 2011, p. 429, obs. Chénedé F. ; RTD civ. 2011, p. 526, obs. Hauser J. ; RJPF 2011/10, n° 41, obs. Garé T. ; Granet-Lambrechts F., « Panorama Droit de la filiation », D. 2012, p. 1432 – CEDH, 5e sect., 8 nov. 2012, n° 19535/08, Pascaud c/ France) : RJPF 2012/12, n° 33, obs. Garé T. ; RTD civ. 2013, p. 102, obs. Hauser J.
-
6.
Comp. Cass. 1re civ., 11 juin 2002, n° 00-18638 ; Cass. 1re civ., 2 avr. 2008, nos 07-13704 et 07-13756.
-
7.
En ce sens : Cass. 1re civ., QPC, 16 déc. 2015, n° 15-16696 : RTD civ. 2016, p. 91, obs. Hauser J.
-
8.
Lamarche M., « Tests de paternité « sauvages » : le droit et l’internationalisation des pratiques », Dr. famille 2007, alerte 22.
-
9.
Arcaute M.-J., « Le référé probatoire dans le droit de la filiation », Dr. famille 1999, chron. 11. Cass. 1re civ., 4 mai 1994, n° 92-17911 : D. 1994, p. 545, note Massip J. ; RTD civ. 1994, p. 575, obs. Hauser J. – CA Aix-en-Provence, 8 févr. 1996 : Dr. famille 1996, comm. 2, note Murat P.
-
10.
TGI Toulouse, 25 janv. 1995 : Gaz. Pal. Rec. 1995, 2, p. 361, note Olivier ; CA Riom, 19 juin 1997, n° 190697 : D. 1999, p. 333, obs. Gaumont-Prat H.
-
11.
CA Montpellier, 17 mai 2004, n° 170504 : Galloux J.-C. et Gaumont-Prat H., « Droits et libertés corporels Panorama de la législation, de la jurisprudence et des avis des instances éthiques », D. 2005, p. 536.
-
12.
TGI Angers, 8 oct. 2009, n° 09/00568 : JCP G 2009, 504, note Boulanger F. ; JCP G 2010, 34, obs. Gouttenoire A. ; AJ fam. 2009, p. 456, obs. Chénedé F. ; Dr. famille 2009, comm. 152, note Murat P. ; RJPF 2009/12, n° 28, note Le Boursicot M.-C. ; RLDC 2009/66, n° 3656, obs. Pouliquen É. ; RTD civ. 2009, p. 708, obs. Hauser J. Adde Dr. famille 2009 étude 32, note Salvage-Gerest P. Décision confirmée en appel : CA Angers, 26 janv. 2011, n° 10/01339 : D. 2011, p. 1053, note Garé T. ; D. 2011, p. 1585, obs. Granet-Lambrechts F. ; JCP G 2011, 161, note Gouttenoire A. ; Gaz. Pal. Rec. 2011, p. 834, note Weiss-Gout B. ; AJ fam. 2011, p. 156, obs. Chénedé F. ; Dr. famille 2011, comm. 37, obs. Neirinck C. ; RLDC 2011/80, n° 4181, obs. Gallois J. ; RDSS 2011, p. 329, obs. Moisdon-Chataigner S.
-
13.
Cass. 1re civ., 27 janv 2016, n° 14-25559 : Bidaud-Garon V., « Le recours à la preuve biologique dans les actions dont l’objet n’est ni l’établissement si la contestation d’un lien de filiation », Dr. famille 2016, étude 7.
-
14.
Cass. 1re civ., 23 sept 2015, n° 14-14539 ; Cass. 1re civ., 8 oct. 2014, n° 13-22468.
-
15.
En ce sens : Bidaud-Garon V., « Le recours à la preuve biologique dans les actions dont l’objet n’est ni l’établissement si la contestation d’un lien de filiation », Dr. famille 2016, étude 7.
-
16.
RJPF 2016/11, n° 32, note Mésa R. ; Dalloz actualité, 14 sept. 2015, obs. Priou-Alibert L. V. égal. : Renault-Brahinsky C., « Justification de la détention provisoire personne exerçant l’autorité parentale exclusive sur un mineur », Lexbase Hebdo n° 670, éd. privée.
-
17.
L. n° 2000-516, 15 juin 2000, renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes : JO, 16 juin 2000, p. 9038.
-
18.
L. n° 2002-307, 4 mars 2002, complétant L. n° 2000-516, 15 juin 2000, renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes : JO, 5 mars 2002, p. 4169.
-
19.
Cass. crim., 8 août 2001, n° 01-83790 : Dr. pén. 2002, comm. 22, note Maron A. – Cass. crim., 18 sept. 2001, nos 01-84647 et 01-84657 : Bull. crim., n° 181 ; Procédures 2001, comm. 237, note Buisson J. ; D. 2002, p. 1457, note Pradel J.
-
20.
L. n° 2002-305, 4 mars 2002, relative à l’autorité parentale : JO, 5 mars 2002, p. 4161.
-
21.
Sur le caractère exceptionnel de l’exercice exclusif de l’autorité parentale, v. not. : Bonfils P. et Gouttenoire A., Droit des mineurs, 2e éd., 2014, Précis Dalloz, p. 271, n° 491.
-
22.
C. civ., art. 373-2-1.
-
23.
C. civ., art. 373-2-13.
-
24.
. En vertu de l’article 375-3, 1°, du Code civil : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l’autre parent (…) ».
-
25.
Bernigaud S., « Dispositif judiciaire de protection de l’enfance en danger : l’assistance éducative » in Murat P. (dir.), Droit de la famille, 7e éd., 2016, Dalloz action, n° 242-231 ; Eschylle J.-F. et Huyette M., « Autorité parentale – Assistance éducative – modalités. Effets », JCl. Civil, art. 371 à 387, fasc. 21, n° 89.
-
26.
Caron D. et Gachi K., « Contrôle judiciaire et détention provisoire- Détention provisoire », JCl. Pr. pén., art. 137 à 150, fasc. 30, n° 29.
-
27.
Renault-Brahinsky C., « Justification de la détention provisoire personne exerçant l’autorité parentale exclusive sur un mineur », Lexbase Hebdo n° 670, éd. privée.
-
28.
Cass. crim., 18 sept. 2001, nos 01-84647 et 01-84657, préc. note 145.
-
29.
Circ. CRIM 00-16F1, 20 déc. 2000, n° 2.1.2.4.
-
30.
Dorsner-Dolivet A., « Les dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant les garanties judiciaires en matière de détention provisoire », Dr. pén. 2000, chron. 39.
-
31.
Circ., 19 mars 2002, DACG 2002-07 ; Circ. 2002-07E8, 19 mars 2002, JUSD0230056C : Présentation de la loi n° 2002-307, du 4 mars 2002, complétant la loi n° 2000-516, du 15 juin 2000, réformant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes ; Dray J., « Rapport sur la proposition de loi n° 3530 complétant la loi du 15 juin 2000 », Rapp. AN n° 3539, p. 27.
-
32.
Caron D. et Gachi K., « Contrôle judiciaire et détention provisoire- Détention provisoire », JCl. Pr. pén., art. 137 à 150, fasc. 30, n° 30.
-
33.
Pradel J., « La loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 : un placebo pour guérir les maux de la réforme du 15 juin 2002 sur la présomption d’innocence », D. 2002, p. 1696.
-
34.
En vertu de l’article 375, alinéa 1er, du Code civil, « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. (…) ».
-
35.
. Les modifications rédactionnelles de l’article 145-5 du Code de procédure pénale, opérées en 2002, avaient déjà précisément pour but d’éviter de tels détournements de procédure, la personne poursuivie révélant sa situation familiale devant le juge des libertés et de la détention, obligeant alors le magistrat à différer la mesure (Dray J., « Rapport sur la proposition de loi n° 3530 complétant la loi du 15 juin 2000 », Rapp. AN n° 3539, p. 7).
-
36.
. Cass. crim., 22 mai 2001, n° 01-81702 : Bull. crim., n° 129.
-
37.
. Cass. crim., 11 déc. 2001, n° 01-86564 : Bull. crim., n° 259.
-
38.
Cass. 1re civ., 28 mai 2014, n° 12-29803 : RTD civ. 2014, p. 875, obs. Hauser J.
-
39.
Cass. 1re civ., 22 mars 2005, n° 03-13135 : Everaert-Dumont D., « L’obligation alimentaire », Le Lamy Droit des Personnes et de la Famille, fasc. 477-80.
-
40.
Cass. 1re civ., 8 avril 2009, n° 08-13161 : LPA 11 sept. 2009, p. 12, obs Massip J. – Cass. 1re civ., 9 févr. 2011, n° 09-71102.
-
41.
Cass. 2e civ., 29 oct. 1980, n° 79-15301 ; Cass. 1re civ., 1er oct. 1996, n° 94-13217 ; Cass. 1re civ., 12 mai 2004, n° 02-17441 ; Cass. 1re civ., 5 déc. 2012, n° 11-19779.
-
42.
Cass. 1re civ., 6 févr. 2008, n° 07-14275.
-
43.
V. aussi : Cass. 1re civ., 16 févr. 1982, n° 80-15758.
-
44.
L. n° 2008-561, 17 juin 2008 : JO, 18 juin 2008 ; « La réforme du droit de la prescription, colloque Strasbourg, 7 nov. 2008 », LPA 2 avr. 2009, p. 7 ; Brenner C., « De quelques aspects procéduraux de la réforme de la prescription extinctive », RDC 2008, p. 1431.
-
45.
Pour une application de la prescription quinquennale antérieure à la réforme de 2008 : Cass. 1re civ., 4 oct. 2005, n° 03-13375 : AJ fam. 2005, p. 446, obs. Chénedé F. ; Hauser J., « Domaine de la courte prescription en matière alimentaire », RTD civ. 1998, p. 895.
-
46.
Cass. 1re civ., 1er juill. 1986, n° 84-14200 : Bull. civ. I, n° 189 ; Hauser J., « Prescription de l’action en condamnation à aliments et prescription de l’action en paiement de ces aliments », RTD civ. 2016, p. 601.
-
47.
Cass. ass. plén., 10 juin 2005, n° 03-18922 : Bull. civ. ass. plén., n° 6, p. 15 ; RTD civ. 2006, p. 320, obs. Mestre J. et Fages B.
-
48.
V. aussi : Cass. 1re civ., 5 juill 1988, n° 86-17031.
-
49.
Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, n° 15-12598, PB : JCP S 2016, 1112, note Jeansen (E.) ; RDSS 2016, p. 555 et s., note Isidro L.
-
50.
Cass. ass. plén., 16 avr. 2004, n° 02-30157 : Bull. civ. ass. plén., n° 8 ; Dr. famille 2004, comm. 135, note Devers A. ; Rev. crit. DIP 2005, p. 47 et s., note Klötgen P. ; RDSS 2004, p. 964 et s., note Daugareilh I. ; RJPF juin 2004/6, n° 37, note Bossu B. – Cass. 2e civ., 6 déc. 2006, n° 05-12666 : Bull. civ. II, n° 342 ; D. 2007, p. 2198, obs. Brunet L. ; Dr. famille 2007, comm. 74, note Devers A.
-
51.
L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, de financement de la sécurité sociale pour 2006 : JO, 20 déc. 2005, p. 19531.
-
52.
V. par ex. l’accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002. À ce sujet : Cass. ass. plén., 5 avr. 2013, nos 11-17520 et 11-18947 : Bull. civ. ass. plén., nos 2 et 3 ; D. 2013, p. 1298, note Bouvier O.-L. ; JCP S 2013, 1366, note Devers A. ; Rev. crit. DIP 2014, p. 370 et s., note Joubert N. ; RJPF 2013/6, n° 15, p. 19 et s., note Putman E. – Cass. ass. plén., 12 juill. 2013, n° 11-17520 : Bull. civ. ass. plén., n° 4 ; JCP G 2013, 911, obs. Dedessus-Le Moustier N. – Cass. 2e civ., 6 nov. 2014, n° 13-22687 : Bull. civ. II, n° 226 ; JCP S 2015, 1140, note Tauran Th. – Cass. 2e civ., 12 févr. 2015, n° 13-26821.
-
53.
Voir à ce sujet la délibération n° 2006-288, du 11 décembre 2006, de la Halde (remplacée depuis par le Défenseur des droits) ou la position de certains auteurs : Bugada A., « Droit de la protection sociale », JCP E 2011, 1710 ; Devers A., « Requiem pour les enfants étrangers entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial », Dr. famille 2011, comm. 140 ; Gouttenoire A., « Le bénéfice des prestations familiales réservée à certains enfants étrangers », AJ fam. 2012, p. 185.
-
54.
Cons. const., 15 déc. 2005, n° 2005-528 DC : Lebon, p. 157 ; RFDA 2006, p. 126 et s., note Schoettl J.-É.
-
55.
Cass. 2e civ., 15 avr. 2010, n° 09-12911 : Bull. civ. II, n° 85 ; D. 2010, p. 1910, obs. Gouttenoire A. ; Dr. famille 2010, comm. 140, note Devers A. ; JCP G 2010, II, 666, note Lhernould J.-P. – Cass. ass. plén., 3 juin 2011, nos 09-71352 et 09-69052 : Bull. civ. ass. plén., nos 5 et 6 ; AJ fam. 2011, p. 375 et s., note Sayn I. ; AJ fam. 2012, p. 183 et s., note Gouttenoire A. ; D. 2011, p. 2001 et s., obs. Gouttenoire A. ; Dr. famille 2011, comm. 140, note Devers A. ; JCP E 2011, 1710, obs. Bugada A. ; JCP G 2011, 695 ; RDSS 2011, p. 738 et s., note Tauran T. ; RJPF 2011/10, n° 13, note Putman E. ; RTD civ. 2011, p. 530 et s., note Hauser J. ; RTD civ. 2011, p. 735 et s., note Rémy-Corlay P.
-
56.
Selon cet article : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
-
57.
Cet article pose l’interdiction de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
-
58.
CEDH, 1er oct. 2015, nos 76860/11 et 51354/13, Okitaloshima Okonda Osungu et Selpa Lokongo c/ France : AJDA 2015, p. 1833 ; AJ fam. 2015, p. 689, obs. Siffrein-Blanc C. ; Dr. soc. 2015, p. 847, obs. Lhernould J.-P. ; JCP A 2015, 835 ; Niemiec A., « Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 12 (3e partie) », LPA 11 août 2016, n° 120a8, p. 6, note ; RDSS 2016, p. 555 et s., note Isidro L.
-
59.
Cass. 2e civ., 26 nov. 2015, n° 14-27973, D.
-
60.
Jeansen E., « L’allocataire étranger de prestations familiales : du contentieux administratif au contentieux de la sécurité sociale », JCP S 2016, 1112, note sous l’arrêt commenté.
-
61.
Cass. 2e civ., 11 oct. 2012, n° 11-26526 : Bull. civ. II, n° 170, Dr. famile 2013, comm. 19, note Devers A. ; JCP S 2012, comm. 1503, note Prétot X. ; RDSS 2012, p. 1145 et s., note Tauran T.
-
62.
D. n° 90-917, 12 oct. 1990, portant publication de la Convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : JO, 12 oct. 1990, p. 12363.
-
63.
CEDH, 1er oct. 2015, nos 76860/11 et 51354/13, Okitaloshima Okonda Osungu et Selpa Lokongo c/ France, préc.
-
64.
En ce sens, voir : Isidro L., « Le droit aux prestations familiales au profit des enfants étrangers entrés en dehors du regroupement familial dans l’impasse », RDSS 2016, p. 561 et s., note sous l’arrêt commenté.
-
65.
Dekeuwer-Défossez F., « Construction de l’identité et droit de la famille », in Mutelet V. et Vasseur-Lambry F. (dir.), Qui suis-je ? Dis-moi qui tu es. L’identification des différents aspects juridiques de l’identité, 2015, Artois Presses Université, spéc. p. 93 et s.
-
66.
Hauser J. « Prescription de l’action en contestation d’état de l’article 333 du Code civil : droit transitoire et droit substantiel », RTD civ. 2014, p. 101.
-
67.
CA Metz, 2 juin 2015, n° 13/02437.
-
68.
Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-15901 ; Cass. 1re civ., 14 janv. 2015, n° 13-28256 : Dr. famille 2015, comm. 51, obs. Neirinck C. – Cass. 1re civ., 26 oct. 2011, n° 10-19674.
-
69.
Gouttenoire A., « Le contrôle exercé par la Cour de cassation sur l’intérêt supérieur de l’enfant », in Mélanges en l'honneur du Professeur Françoise Dekeuwer-Défossez, 2012, Montchrétien, spéc. p. 158.
-
70.
CA Reims, 18 déc. 2015, nos 14/02688 et 14/02832 : Juris-Data n° 2015-028976.
-
71.
Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n° 98-12806 : Bull. civ. I, n° 103 ; D. 2000, p. 731, note Garé T. ; RTD civ 2000, p. 304, obs. Hauser J.
-
72.
Cass. 1re civ., 30 mai 2000, n° 89-16059 : D. 2001, p. 967, obs. Granet F. ; D. 2001, p. 1427, obs. Gaumont-Prat H. ; RTD civ. 2004, p. 73, obs. Hauser J. – Cass. 1re civ., 17 févr. 2004, n° 02-10245 : D. 2005, p. 1751, obs. Granet-Lambrechts F.
-
73.
« Nul “à l’exception du ministère public”, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement ».
-
74.
Dekeuwer-Défossez F. « L’intérêt de l’enfant dans le droit de la filiation : les enseignements de l’affaire Mandet », RLDC 2016/4, p. 39 ; Fulchiron H., « Pot-pourri autour de la contestation de la filiation », Dr. famille 2016, étude 4.
-
75.
Cass. 1re civ., 6 mars 1996, nos 94-11108 et 94-13015 : D. 1996, p. 529 note Lemouland J.-J.
-
76.
CEDH, 2 juin 2015, n° 22037/13, Canonne C/ France : AJ fam. 2015, p. 499, note Le Gac-Pech S. ; RTD civ. 2015, p. 596, obs. Hauser J. – CEDH, 14 janv. 2016 n° 30955/12, Mandet c/ France : Fulchiron H. « Droits de l’enfant, droit du père légal, droit du père biologique : droits opposés ou intérêts partiellement convergents ? », Dr. famille 2016, comm. 47 ; Dekeuwer-Défossez F. « L’intérêt de l’enfant dans le droit de la filiation : les enseignements de l’affaire Mandet », RLDC 2016/4, p. 39.
-
77.
Matocq O., « Le rapport d’expertise biologique dans le droit de la filiation deviendra-t-il le passage obligé ? », Dr. famille 2006, étude 7 ; Dr. famille 2005, comm. 182, obs. Murat P. ; D. 2005, p. 1751, note Granet-Lambrechts F.
-
78.
V. par ex. : Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-15901 : Juris-Data n° 2013-010927, dans une action en contestation de paternité.
-
79.
Granet-Lambrechts F., « Filiation. Actions en contestation de la filiation », JCl. Civil, fasc. unique, n° 53, art. 332 à 337.
-
80.
Cass. 1re civ., 30 sept. 2009, n° 08-18398 : JCP G 2009, 533, obs. Brusorio-Aillaud M. ; Dr. famille 2009, comm. 142, obs. Murat P.
-
81.
Malaurie P. et Fulchiron H., La famille, 5e éd., 2016, Lextenso, n° 1022.
-
82.
TGI Lyon, 1re ch. B, 5 juill. 2007, n° 04-08431 : D. 2007, p. 3052, note Gouttenoire A. ; RTD civ. 2008, p. 93, obs Hauser J. – CA Lyon, 1er avr. 2008, n° 05/00029 – CA Agen, 6 mars 2013, n° 12/00845 : Juris-Data n° 2013-008856 : « Attendu en droit qu’en application des articles 332 et suivants du Code civil, l’expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; que parmi les motifs légitimes, figure l’intérêt supérieur de l’enfant ».
-
83.
V. supra note n° 4.
-
84.
CEDH, 14 janv. 2016 n° 30955/12, Mandet c/ France.
-
85.
V. par ex. : CEDH, 18 févr. 2014, n° 28609/08, A.L. c/ Pologne ; CEDH, 25 févr. 2014, n° 12547/06, Ostace c/ Roumanie ; CEDH, 12 févr. 2013, n° 48494/06, Kristian Barnabas Tohth c/ Hongrie.