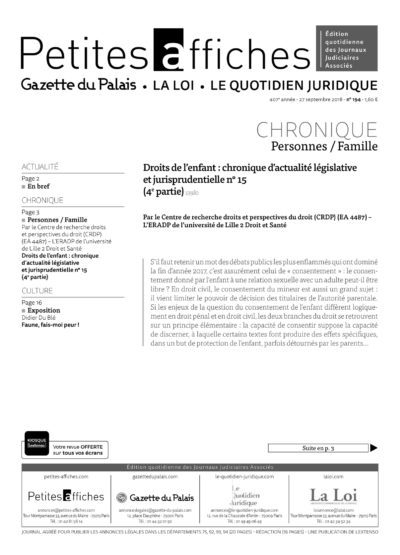Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 15 (4e partie)
S’il faut retenir un mot des débats publics les plus enflammés qui ont dominé la fin d’année 2017, c’est assurément celui de « consentement » : le consentement donné par l’enfant à une relation sexuelle avec un adulte peut-il être libre ? En droit civil, le consentement du mineur est aussi un grand sujet : il vient limiter le pouvoir de décision des titulaires de l’autorité parentale. Si les enjeux de la question du consentement de l’enfant diffèrent logiquement en droit pénal et en droit civil, les deux branches du droit se retrouvent sur un principe élémentaire : la capacité de consentir suppose la capacité de discerner, à laquelle certains textes font produire des effets spécifiques, dans un but de protection de l’enfant, parfois détournés par les parents…
I – La dignité de l’enfant en fin de vie
II – L’intégrité de l’enfant
A – L’intégrité corporelle de l’enfant
1 – Les vaccinations obligatoires
2 – Circoncision et intersexualité
3 – Droit d’asile et examen médical de non-excision
B – L’intégrité sexuelle de l’enfant
Article 2 du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles présenté le 21 mars 2018 au Conseil des ministres par la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes. Le contexte est à la vérité bien peu serein pour réfléchir à une loi nouvelle et surtout pour penser son articulation avec le corpus textuel préexistant. La réforme en cours de discussion est nécessairement appréhendée à l’aune de deux affaires extrêmement médiatisées qui ont pu choquer l’opinion publique : d’une part, l’affaire dite de Pontoise, à la faveur de laquelle le parquet a privilégié, dans un premier temps, une qualification délictuelle d’atteinte sexuelle sur mineure faute de parvenir à établir la contrainte exercée par l’auteur majeur des faits sur la fillette de 11 ans, décision qui a débouché sur une déclaration d’incompétence du tribunal correctionnel de Pontoise le 13 février 2018, avant qu’une nouvelle enquête pour viol ne soit finalement ouverte le 27 février 2018 ; d’autre part, l’affaire dite de Meaux, qui a vu la cour d’assises de la Seine-et-Marne prononcer, le 8 novembre 2017, l’acquittement d’un jeune majeur de 22 ans au moment des faits, poursuivi pour viol, faute de parvenir à prouver la contrainte sur la mineure de 11 ans.
Pourtant, rapidement et dans le tumulte de ces affaires (de même qu’en pleine affaire Weinstein), un projet de loi sur les violences sexuelles et sexistes a été annoncé pour fin mars 20181. Ce projet de texte a finalement fait l’objet d’une présentation en Conseil des ministres le 21 mars 2018. Précisons que nous nous attacherons uniquement au volet « infractions sexuelles sur mineurs » de la future loi. À l’aube de la réforme, des attentes réelles et des inquiétudes véritables s’expriment légitimement.
Si la nécessité de clarifier l’arsenal répressif français semble difficilement discutable, l’enfer étant pavé de bonnes intentions, il faudrait éviter de brouiller plus encore la donne2. Réfléchir à la réforme jusqu’à son terme semble capital, ce qui implique non seulement d’avancer des propositions satisfaisantes (de ce point de vue, la dernière mouture du texte apparaît plus rassurante sans doute grâce aux observations du Conseil d’État3), mais également de penser son intégration au sein de l’arsenal répressif de droit positif. À l’heure où les débats législatifs s’annoncent, il semble intéressant de faire le point sur les écueils à éviter (I) et les bonnes idées à exploiter (II).
I. Les écueils à éviter
S’agissant des dangers de la réforme annoncée, deux idées qui ont été au cœur de prises de position populaires, associatives, journalistiques et politiques semblent prudemment à écarter : la fausse bonne idée d’une présomption de non-consentement du mineur aux actes sexuels avec un majeur d’une part (A), et celle d’un seuil, en tant que tel, de consentement aux actes sexuels d’autre part (B).
A. La fausse bonne idée d’une présomption de non-consentement
La piste d’une présomption de non-consentement du mineur à l’acte sexuel avec un majeur a été portée ces mois derniers. Elle a notamment été avancée par le président de la République4 et le gouvernement (jusqu’à tout récemment) et confortée par l’avis exprimé par le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes dès octobre 20165 : ce dernier considère nécessaire d’introduire un seuil de non-consentement du mineur à l’acte sexuel avec un majeur – seuil qui devrait être fixé à 13 ans –, cette présomption irréfragable permettant selon lui de garantir la sécurité juridique.
L’idée de la consécration d’une telle présomption avait donc été concrétisée – à la faveur de la version initiale du projet de loi – par la création de deux nouvelles infractions qui avaient été envisagées. Le texte initial prévoyait en effet que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur un mineur de moins de 15 ans par un majeur » constituerait un viol « lorsque l’auteur connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime ». Le même type de rédaction devait être retenu pour l’infraction d’agression sexuelle sur mineur. Ces qualifications envisagées ne faisaient plus aucunement référence à la circonstance de « violence, contrainte, menace ou surprise » qui caractérise habituellement le viol et les agressions sexuelles6.
Cette présomption aurait abouti à systématiser le déclenchement de la qualification pénale de viol ou d’agression sexuelle pour des actes relevant aujourd’hui du délit d’atteinte sexuelle, ce que d’aucuns souhaitaient7. Des réserves nombreuses ont cependant été émises à l’endroit de cette proposition. Lorsqu’a été évoquée la piste de la présomption de non-consentement en dessous de 13 ou de 15 ans, les critiques ont fusé, notamment depuis les rangs de la magistrature. Ces critiques reposaient essentiellement sur la crainte que la présomption de non-consentement n’aboutisse à une présomption de culpabilité de viol ou d’agression sexuelle lorsqu’un majeur a une relation sexuelle avec un mineur. Ces craintes étaient naturellement renforcées dans l’hypothèse où la présomption devait être une présomption irréfragable. Ce risque d’automaticité de condamnations s’articule effectivement difficilement avec les jurisprudences tant constitutionnelle qu’européenne aux termes desquelles une présomption de culpabilité ne saurait être irréfragable8. Même dans le cas d’une présomption simple, la charge de la preuve aurait pesé sur l’auteur présumé, du fait d’un mécanisme de renversement de la charge de la preuve. Précisons cependant que ces qualifications ne visaient pas les relations entre mineurs.
Le mécanisme tel qu’il avait été envisagé ne doit pas être confondu avec une éventuelle présomption de contrainte. Les deux présomptions offrent un angle d’approche radicalement différent. Pour la présomption de non-consentement, on se place du côté de la victime (ce qui semble étrange s’agissant d’envisager une condamnation pénale) alors que pour la présomption de contrainte, on reste sur une appréciation du comportement de l’auteur des faits et sur la caractérisation des éléments constitutifs de l’infraction. Cette présomption de non-consentement qui devait permettre de caractériser l’infraction de façon plus automatique, voire systématique, aurait été délicate à articuler avec la circonstance aggravante existant en matière de viol tenant au fait que la victime soit un mineur de 15 ans, au point que certains envisageaient déjà son abrogation. Cette piste semble finalement aujourd’hui délaissée.
B. La fausse bonne idée de la détermination d’un âge seuil
En parallèle de la réflexion consistant à promouvoir une présomption de non-consentement du mineur aux actes sexuels avec un majeur, s’est développé un questionnement autour du choix délicat du seuil d’âge à retenir. Deux seuils ont notamment été évoqués : 13 ans et 15 ans9. Au terme d’une présentation rapide et erronée, le débat a souvent été résumé à la détermination d’une majorité sexuelle (ce qu’il n’est pas). Toute la difficulté consistait à déterminer l’âge en dessous duquel un mineur ne peut consentir en connaissance de cause à un acte sexuel. La doctrine française a parfois avancé le chiffre d’une douzaine d’années10. Elle voit surtout dans un tel seuil une opportunité de faciliter la preuve d’infractions sexuelles11. Cependant, la détermination de ce seuil n’est guère aisée. Les exemples de seuils retenus en droit comparé témoignent d’une absence d’harmonisation : 12 ans aux États-Unis et en Espagne, 13 ans en Angleterre et 14 ans en Allemagne et en Belgique. Par ailleurs, il faut bien comprendre que ledit seuil ne s’appliquerait que dans une relation entre un mineur et un majeur mais ne serait pas applicable entre mineurs (ce qui peut sembler complexe à justifier, a fortiori si on compare deux scenarii, le premier mettant en jeu un majeur de 18 ans, le second un mineur de 17 ans, ou si l’on songe à une relation débutée alors que les deux protagonistes étaient mineurs et qui se poursuivrait alors que l’un des deux franchirait le cap de la majorité). La détermination d’un tel seuil poserait en outre la question de l’articulation des seuils entre eux, notamment l’articulation avec le seuil civil de la majorité sexuelle et un seuil éventuel de responsabilité pénale. Pourrait-on par exemple imaginer affirmer une présomption de non-consentement du mineur de 15 ans aux actes sexuels d’une part (comme cela était envisagé), et considérer par ailleurs qu’un mineur peut être responsable pénalement dès lors qu’il est discernant (souvent avant 15 ans) ? Dans la dernière version du projet de loi, on relèvera un abandon de l’idée de seuil en tant que tel pour lui préférer une appréciation plus contextualisée. Les réserves émises par le Conseil d’État ont visiblement été entendues12. La proposition finale retient que « lorsque les faits sont commis sur un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de l’abus de l’ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes ». L’âge du mineur peut contribuer à démontrer la contrainte ou la surprise, élément constitutif d’un viol ou d’une agression sexuelle, mais participe plus largement de l’appréciation de la maturité ou du discernement de la victime.
Il peut sembler préférable d’axer le raisonnement autour du critère du discernement. Le juge n’est alors aucunement lié par un seuil d’âge déterminé a priori par le législateur. Il se détermine au cas par cas en fonction de la personnalité du mineur concerné et des circonstances de fait, dans le cadre d’un faisceau d’indices plus large. Préférer le critère du discernement permet en outre de s’inscrire dans le prolongement de l’évolution jurisprudentielle antérieure qui s’était développée sur la question de la preuve du défaut de consentement du mineur victime d’un viol ou d’une agression sexuelle. La question posée aux juges était de savoir dans quelle mesure la violence, la contrainte, la menace ou la surprise pouvaient se déduire du seul jeune âge de la victime. Dans un premier temps, la Cour de cassation avait affirmé que l’absence de consentement résultant de la surprise ne pouvait se déduire du seul jeune âge de la victime13. Elle avait également retenu qu’il n’était pas possible, pour caractériser la violence, la contrainte ou la surprise, de se fonder uniquement sur l’âge de la victime et sur la qualité des auteurs présumés (ascendant ou personne ayant autorité)14. Dans un second temps, la Cour de cassation avait cependant nuancé sa position en admettant la surprise lorsque le très jeune âge de la victime implique qu’elle n’a pas pu comprendre la portée des actes accomplis15. La Cour de cassation a pu, par la suite, confirmer cette position16. L’appréciation de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise ne peut s’envisager en faisant abstraction de l’âge de la victime, d’autant que si cet âge est très jeune, la victime ne prend pas la mesure des faits. La jurisprudence considérait en revanche que si le mineur était doué de discernement, le juge ne pouvait naturellement pas se fonder sur sa seule minorité pour admettre l’absence de consentement17. À la lumière de la proposition avancée en Conseil des ministres, cette jurisprudence ne devrait pas être remise en cause.
II. Les bonnes idées à promouvoir
Au titre des pistes intéressantes dont on suivra le devenir à la faveur des débats parlementaires, on peut évoquer la présomption de contrainte (A). Pourrait également être envisagée la suppression des deux qualifications pénales relatives aux atteintes sexuelles sur mineur si on souhaite vraiment introduire de manière cohérente la réforme dans l’arsenal répressif existant (B).
A. La présomption de contrainte
La nécessité de mieux définir la contrainte, la menace, la violence et la surprise a souvent été avancée et elle est apparue, de manière évidente, avec les affaires précédemment évoquées impliquant des mineurs. L’emploi de la contrainte, de la violence, de la menace ou de la surprise – caractéristique des infractions de viol et d’agression sexuelle – doit obligatoirement être constaté par le juge. La jurisprudence a notamment pu affirmer que ces circonstances ne se déduisaient pas de la seule minorité de la victime ou de la seule qualité de personne ayant autorité de l’auteur, ces éléments ne constituant que des circonstances aggravantes de l’infraction18. La constatation de l’un de ces procédés est indispensable pour établir que l’acte sexuel s’est accompli contre ou en l’absence de consentement de la victime.
La loi n° 2010-121 du 8 février 2010 a tenté de participer à la clarification des choses en proposant une définition légale de la notion de contrainte19. L’article 222-22-1 du Code pénal précise en effet que « la contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celle-ci exerce sur cette victime ». Le législateur avait, ce faisant, posé à l’article 222-22-1 une présomption de contrainte (critères objectifs de contrainte morale) s’agissant du mineur victime en consacrant la conception de la contrainte morale dégagée par la jurisprudence à propos de la preuve du défaut de consentement des victimes mineures20. Cette disposition a cependant été très critiquée par la doctrine dès lors qu’elle crée une confusion entre l’élément constitutif de l’infraction d’agression sexuelle et l’élément permettant d’établir la circonstance aggravante21, mais également par la pratique judiciaire22. En réalité, cette précision issue de la loi du 8 février 2010 n’a pas changé l’état du droit positif. Dans une décision n° 2014-448 QPC du 6 février 2015, le Conseil constitutionnel a notamment précisé que l’article 222-22-1 du Code pénal n’a « pas pour objet de définir les éléments constitutifs de l’infraction ». Ces dispositions ont été considérées comme présentant un simple caractère interprétatif23. Le rapport d’information de Marie Mercier va plus loin en considérant qu’aucune disposition n’empêche les juridictions de déduire la contrainte de la seule différence d’âge, même si les critères de l’article 222-22-1 du Code pénal peuvent apparaître cumulatifs. Le rapport considère que « la conjonction “et” peut avoir à la fois un emploi alternatif ou un emploi cumulatif »24. Quand bien même tout un chacun ne partagerait pas cette lecture audacieuse, force est de constater que l’article 222-22-1 précise que la contrainte morale peut résulter des deux critères évoqués sans fermer la porte à d’autres éléments25.
La proposition de loi récemment présentée semble avancer une nouvelle présomption de contrainte et même de surprise. Le texte a repris l’idée du rapport d’information du groupe de travail de la commission des lois du Sénat du 7 février 201826. La proposition finale précise que « lorsque les faits sont commis sur un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de l’abus de l’ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaires pour consentir à ces actes ». L’âge du mineur peut contribuer à démontrer la contrainte ou la surprise, éléments constitutifs d’un viol, dès lors que l’auteur des faits aura abusé de l’ignorance de la victime en profitant de son manque de maturité ou de discernement. Le Conseil d’État, dans son avis du 15 mars 2018, avait conseillé de travailler autour de la notion de « contrainte »27. Le Conseil d’État a considéré que la seule circonstance selon laquelle « l’auteur ne pouvait ignorer » l’âge de la victime est insuffisante pour caractériser une intention criminelle. Les juges administratifs avaient conseillé d’accompagner la démonstration des notions de « contrainte et surprise » lorsque la victime est âgée de moins de 15 ans. Les notions introduites dans la version finale du projet de loi (abus d’ignorance, maturité, discernement) sont celles que le Conseil d’État avait préconisées pour étayer le consentement ou l’absence de consentement à des actes sexuels.
B. La suppression des qualifications d’atteintes sexuelles sur mineur ?
L’enjeu à ce stade sera de ne pas complexifier l’arsenal répressif. Les qualifications d’atteintes sexuelles sur mineur se différencient des qualifications de viol et d’agression sexuelle dès lors que les actes sexuels sont accomplis sur un mineur sans violence, ni menace, ni contrainte ni surprise. Le législateur considère que les relations ou les actes de nature sexuelle avec une victime mineure pourtant consentante constituent une infraction soit parce que cette dernière est trop jeune (moins de 15 ans)28, soit, pour les mineurs de 15 à 18 ans, parce que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime, ce qui remet en cause la validité du consentement donné par cette dernière29. Il existe déjà finalement une présomption de non-consentement en droit pénal français pour le mineur de 15 ans via l’infraction d’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans (le consentement donné est présumé non éclairé).
Quelle évolution envisager pour ces qualifications à la lumière de la réforme qui se profile ? Ces qualifications ont toujours interrogé et peineront encore plus demain à convaincre. Une première difficulté tient à la nature correctionnelle des atteintes sexuelles qui ne parvient pas à satisfaire l’opinion publique. Pourtant, la peine prévue peut paraître cohérente si on garde à l’esprit que les atteintes sexuelles sans violence sur un mineur se réalisent avec le consentement de la victime mineure. Le projet de loi propose de doubler les peines encourues pour le délit d’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, avec ou sans pénétration, lors d’une relation consentie ou non, d’un maximum de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. La nature des infractions resterait délictuelle. Il n’est pas certain cependant que le maintien de ces qualifications se justifie à la lumière des deux présomptions de contrainte qui se dessinent s’agissant des victimes mineures d’infractions sexuelles.
Ne faudrait-il pas plus radicalement envisager l’abrogation de ces deux qualifications ? L’interrogation porte plus globalement sur la raison d’être des infractions d’atteintes sexuelles sur mineur. Si l’autorité de fait ou de droit et l’abus d’autorité que confèrent les fonctions permettent d’établir la contrainte (conformément aux prévisions de l’article 222-22-1 du Code pénal) et si l’abus de l’ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes permet d’établir la contrainte morale et/ou la surprise (comme le propose le projet de loi en discussion), que reste-t-il aux atteintes sexuelles ? Par ailleurs, comment expliquer les circonstances aggravantes de l’article 227-25 prévues à l’article 227-26 du Code pénal ? Comment justifier l’infraction de l’article 227-27 exigeant une qualité particulière des auteurs ? Ne devrait-on pas rebasculer vers les qualifications d’agressions sexuelles voire de viol ?
Les travaux parlementaires à venir risquent d’être intenses. Souhaitons que la cohérence d’ensemble de notre droit pénal, de ses principes et de ses qualifications, ne soit pas sacrifiée sur l’autel d’une efficacité qui pourrait être aussi redoutable que dangereuse.
Cathy POMART
Cass. crim., 18 oct. 2017, n° 16-86570. Le juge est la bouche de la loi30. Cependant, juger ce n’est pas seulement dire la loi. « Il n’y a guère que quelques hommes politiques pour penser ou espérer que le juge ne soit que la bouche de la loi »31. En effet, la tâche qui incombe au juge est plus ardue, ce dernier doit avant toute chose rechercher la vérité en vue d’établir la culpabilité ou l’innocence d’un individu.
En droit pénal, la vérité judiciaire se rapporte par une succession de preuves. Pour cette raison, la recherche probatoire a une importance toute particulière en procédure pénale, importance qu’elle ne revêt dans aucune autre matière du droit32. Selon Bentham, « l’art de la procédure n’est essentiellement que l’art d’administrer les preuves »33. Les questions relatives à la preuve sont donc essentielles en procédure pénale et la Cour de cassation y est souvent confrontée.
Dans un arrêt de la chambre criminelle en date du 18 octobre 2017, un individu était poursuivi pour agressions sexuelles aggravées sur sa petite-fille âgée de 8 ans au moment de la dénonciation des faits. De surcroît, la petite-fille était âgée de 5 ans au moment des premiers faits. Elle avait spontanément raconté les agissements de son grand-père à ses parents. Le père s’était alors constitué partie civile en tant que son représentant légal.
Le prévenu avait formé un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d’appel de Douai. Il soutenait que l’expertise psychologique de la petite-fille n’avait pas fourni de précision quant aux incohérences relevées dans le discours de cette dernière. Par ailleurs, la cour d’appel avait ordonné après la condamnation, une expertise psychologique de la petite-fille afin d’évaluer son préjudice. Cependant, le prévenu estimait que cette expertise, relevant de la manifestation de la vérité laissait entrevoir qu’un doute subsistait quant à sa culpabilité. Quelle est l’étendue de la recherche probatoire dans la manifestation de la vérité ? Autrement dit, se pose la question de savoir si la manifestation de la vérité ne concerne que la preuve de l’infraction pénale. La Cour de cassation rejetait le pourvoi au motif que la cour d’appel n’avait fait qu’ordonner une expertise permettant d’évaluer la réalité du préjudice causé à la victime mineure.
En ce sens, la chambre criminelle marque une nette différence entre la preuve de l’infraction pénale d’une part (I), et la preuve du préjudice causé à l’enfant mineur d’autre part (II).
I. La preuve de l’infraction pénale
La preuve de l’infraction pénale peut être rapportée par tout moyen et ce en vertu du principe de liberté de la preuve34. Ce principe « consiste dans l’admissibilité de tout mode de preuve »35. La recherche probatoire est fondamentale en raison de l’impératif de manifestation de la vérité en procédure pénale36. Cette dernière permet d’attribuer aux faits leur exacte qualification pénale.
La qualification pénale retenue à l’encontre du prévenu est celle d’agressions sexuelles aggravées, en vertu des articles 222-22, 222-29, 222-31-1 du Code pénal. Tout d’abord l’agression sexuelle se caractérise par une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise37 et c’est par le défaut de consentement que l’infraction se consomme. En l’espèce, l’atteinte sexuelle se caractérise par le fait que le prévenu déambulait nu la nuit sous son peignoir et que la mineure n’avait pas subi qu’un seul contact accidentel avec le sexe de ce dernier.
Un faisceau d’indices permet également de prouver la contrainte. En effet, il y avait une grande différence d’âge entre la victime mineure et l’auteur de l’infraction. De plus, le grand-père avait nécessairement une relation d’autorité sur sa petite-fille. Le jeune âge d’une victime est considéré comme un facteur de contrainte38 et de surprise par la jurisprudence39. Par ailleurs, il a été prouvé que les faits de déroulaient pendant la nuit lorsque l’enfant était couché dans son lit. Cette situation permet encore plus de caractériser la surprise. Cependant, ces faits ont été racontés par l’enfant, et c’est justement la crédibilité de ces dires que le prévenu remet en cause.
Afin d’éclairer sur la réalité infractionnelle, le juge pénal peut avoir recours à une expertise de crédibilité pour évaluer la véracité des propos tenus par un témoin, un suspect ou une victime. Cette évaluation de crédibilité est réalisée par des experts psychologues, ici il s’agissait de déceler si la parole de la victime était fiable. Elle peut néanmoins rapidement montrer ses limites en raison de la subjectivité des experts40 et c’est cela qui est soulevé par le prévenu. En effet, ce dernier, estime que la psychologue n’avait pas fourni de précision quant aux incohérences qu’elle avait relevées dans le discours de la mineure lors de son examen, ni même sur le caractère inadéquat des réponses que la mineure avait pu lui donner, à la suite de ses demandes d’explications complémentaires. Pour le prévenu, ces incohérences portaient atteinte à la crédibilité des accusations portées contre lui. Seulement, c’est la personnalité de la victime qui est prise en compte. Elle était âgée de 5 à 8 ans au moment des faits et son discours enfantin dans la narration de ces derniers ne trahit en rien leur réalité.
Les preuves rapportées sont librement appréciées par le juge pénal d’après son intime conviction et après avoir été contradictoirement débattues. La chambre criminelle estime que la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir d’appréciation et que les éléments de preuve ont été contradictoirement débattus, ce qui justifie qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner un supplément d’information.
Par ailleurs, en ce qui concerne la caractérisation de la circonstance aggravante, la particulière vulnérabilité de la victime est établie en raison de son jeune âge41. De plus, en vertu de l’article 222-31-1 du Code pénal, les viols et agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un mineur notamment par un ascendant. En l’espèce, le prévenu est le grand-père de la victime donc il répond bel et bien à cette condition. En ce sens, tous les éléments constitutifs de la qualification d’agressions sexuelles aggravées étant rapportés, la preuve de l’infraction est effective. Cependant qu’en est-il de la preuve du préjudice sur le mineur ?
II. La preuve du préjudice sur le mineur
L’accès à la partie civile est réservé à ceux qui se prétendent victime d’une infraction ou à ceux qui représentent la victime. Afin d’obtenir réparation d’un préjudice, il faut apporter la preuve d’un préjudice éventuel, que la victime a subi personnellement et qui a été causé directement par l’infraction. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rappeler qu’« il suffit, pour qu’une constitution de partie civile soit recevable lors de l’instruction préalable, que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale »42. En l’espèce, l’existence d’un potentiel préjudice n’était pas contestable en raison de la nature et de la gravité des faits commis sur la victime. De plus, c’est le père de la victime qui s’était constitué partie civile, ce qui était recevable car il était son représentant légal43.
Cependant, le prévenu remettait en cause l’obligation alléguée par la cour d’appel d’entreprendre après la décision de condamnation, une expertise psychologique de la mineure afin d’évaluer le préjudice subi. En effet, ce dernier considérait que l’évaluation du préjudice participait à la manifestation de la vérité et donc laissait penser qu’un doute subsistait quant à sa culpabilité. Cela dit, cet argument n’est pas valable car la preuve de l’infraction pénale et la preuve du préjudice sont deux choses différentes. En effet, l’expertise médico-psychologique destinée à établir un préjudice n’est pas une expertise ayant pour finalité d’établir la réalité des faits44. Bien que l’expertise médico-psychologique participe à la manifestation de la vérité du préjudice, elle ne participe pas pour autant à la preuve de la consommation de l’infraction pénale par le prévenu.
Par ailleurs, en droit pénal, il existe une protection accrue des victimes mineures d’infractions sexuelles, « les agressions et atteintes sexuelles commises sur mineurs sont au centre d’une préoccupation constante »45. La question des agressions sexuelles sur mineurs est d’autant plus d’actualité car « en 2017, il y a eu 8 788 plaintes ou signalements pour viol concernant des victimes mineures et 14 673 pour agression sexuelle »46.
La protection du mineur passe par une expertise médico-psychologique destinée à établir le préjudice moral et/ou physique subi par ce dernier. Il s’agit d’une véritable mesure de protection du mineur qui prend deux formes. En premier lieu, la protection passe par des soins consécutifs aux sévices subis ce qui permettra d’évaluer les répercussions psychologiques sur la victime. Les soins sont très importants lorsque l’agression sexuelle s’est déroulée dans le cadre familial. Dans un second temps, la protection du mineur prend la forme de dommages et intérêts, à raison de dommages irréparables qu’il a subis. Dans l’affaire ici étudiée, l’expertise médico-psychologique ordonnée par la cour d’appel n’a pour but que de garantir la protection de la victime à la suite des agressions sexuelles exercées par un ascendant. La Cour de cassation rappelle que cette mesure n’intervient pas pour statuer sur la culpabilité ou l’innocence du prévenu mais uniquement pour apprécier la réalité et l’importance des troubles causés par l’infraction.
En procédure pénale, la manifestation de la vérité a donc différents aspects, à savoir la preuve de l’infraction pénale dans le but de préserver l’ordre public mais aussi la preuve du préjudice pour préserver l’intérêt de la victime, de surcroît mineure.
Marion MAJORCZYK
C – L’intégrité psychique de l’enfant
1 – L’intégrité psychique altérée : l’admission de l’enfant en établissement de santé mentale
Rapport thématique « Droits fondamentaux des mineurs en établissement de santé mentale » du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) (2017, Dalloz). La question de la situation des mineurs hospitalisés dans des établissements de soins psychiatriques vient de faire l’objet d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) publié en novembre 2017, intitulé Les droits fondamentaux des mineurs en établissement de santé mentale, qui aborde les multiples aspects de ce sujet, en portant une attention toute particulière et bienvenue aux questions liées à l’autorité parentale.
Ce nouveau rapport reprend, en les systématisant et en les approfondissant, un ensemble de remarques résultant des visites régulièrement effectuées dans les établissements d’hospitalisation psychiatriques, qui avaient pour certaines déjà été formulées dans les rapports annuels du CGLPL et fait l’objet de l’attention de certains spécialistes de l’enfance47.
Une bonne partie des recommandations du CGLPL porte sur les aspects organisationnels de l’hospitalisation psychiatrique des enfants : créer des structures où les adolescents ne soient mélangés ni avec des enfants beaucoup plus jeunes, ni avec des adultes beaucoup plus âgés, assurer la continuité de la prise en charge même pendant les week-ends (!), prévoir une « chambre d’apaisement » et disposer d’une « chambre d’isolement » spécifiquement destinée aux enfants, afin de ne pas recourir à celle qui est destinée aux adultes, etc. Le CGLPL pointe aussi quelques exigences liées aux besoins spécifiques des enfant comme la possibilité de suivre une scolarité et une attention qui doit être portée aux questions relatives à la sexualité des adolescents. Ces recommandations, qui ne peuvent qu’être approuvées, se heurtent, en pratique, à des obstacles essentiellement organisationnels et budgétaires.
D’autres remarques portent sur les incompréhensions possibles entre les personnes ou autorités en charge d’un enfant, qui peuvent estimer que son caractère excessivement perturbateur relève d’un traitement psychiatrique, alors que les médecins de l’établissement psychiatrique refusent de le prendre en charge, jugeant que son état ne relève pas de leur compétence. L’enfant sera alors renvoyé par eux dans le foyer ou le centre éducatif fermé (CEF) où il a été jugé indésirable. Sans que son état s’améliore, évidemment.
Mais le rapport contient aussi d’autres recommandations qui posent des questions d’ordre proprement juridique et qui pourraient être ainsi résumées : comment le droit applicable aux hospitalisations psychiatriques, notamment en ce qu’il garantit un certain nombre de recours, peut-il se concilier avec la minorité juridique du patient ? Cette question, très importante, a pourtant jusqu’à présent été plutôt négligée : ainsi est-elle absente dans la recommandation du Conseil de l’Europe relative à la protection des droits de l’Homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux48 comme dans les observations du comité ONU des droits de l’enfant49 dont les paragraphes 63 et 64 se bornent à déplorer l’insuffisance des moyens au service de la psychiatrie infantile. Pourtant, elle suscite nombre de questionnements chez les professionnels de santé mentale50.
C’est donc sur cette question moins connue et fort complexe des relations entre minorité, autorité parentale et hospitalisation psychiatrique que nous concentrerons nos commentaires.
Pour les adultes, on distingue deux régimes juridiques de l’hospitalisation psychiatrique bien différents selon qu’elle s’est faite avec l’accord du patient – hospitalisation dite « libre » – ou sans son consentement, à la demande d’un tiers ou du préfet. Dans le second cas, la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge prévoit un ensemble de garanties procédurales destinées à éviter les internements abusifs. S’agissant des mineurs, l’hospitalisation dite « libre », comme l’hospitalisation sans consentement, présentent d’indéniables carences au regard de la protection de la volonté et de la liberté de l’enfant.
I. L’hospitalisation « libre » d’un mineur repose sur le consentement… de ses parents. Faute de capacité juridique, le mineur n’a pas à y consentir et ce sont les détenteurs de l’autorité parentale qui ont ce pouvoir, en principe. Cet absolutisme parental interpelle les soignants, attentifs à l’autonomie de l’enfant51.
A. S’agissant des droits des parents, le rapport du CGLPL critique à juste titre des pratiques insuffisamment respectueuses de la coparentalité. S’agissant d’un acte grave, l’accord formel des deux parents est indispensable. Le rapport cite une décision du Conseil d’État qui annule une décision ordinale refusant de sanctionner un médecin qui avait prescrit un antidépresseur à une jeune fille sur le seul accord de sa mère, et sans prévenir son père52. Or selon les observations du CGLPL, l’accord d’un parent est considéré en pratique comme suffisant et, d’ailleurs, les établissements hospitaliers ne s’intéressent guère à la situation juridique des enfants qui leur sont confiés. Ils ne vérifient pas les conditions d’exercice de l’autorité parentale et reçoivent le couple de parents qui se présente devant eux sans se demander si la mère est avec le père ou avec un beau-père. Il n’est pas besoin d’insister sur l’absence de garantie que représente pour un enfant une hospitalisation psychiatrique décidée dans de telles conditions. La crainte d’une éventuelle mise en cause de leur responsabilité, si le parent non consulté venait à se plaindre, devrait pourtant inciter les établissements psychiatriques à une plus grande vigilance.
Lorsque l’enfant a été confié à l’ASE au titre de l’assistance éducative, ou lorsqu’il a été placé dans un établissement d’éducation à la suite d’une décision de nature pénale, notamment dans un centre éducatif renforcé53, l’article R. 1112-34, alinéa 2, du Code de la santé publique donne au chef de l’établissement ou au gardien de l’enfant la responsabilité de demander son hospitalisation psychiatrique. Il en va de même lorsque l’enfant a fait l’objet d’un placement « volontaire » de la part de ses parents si ceux-ci sont injoignables lorsque l’hospitalisation apparaît nécessaire. Cette faculté est critiquée dans le rapport du CGLPL qui met en avant l’article 375-7 du Code civil, lequel maintient aux parents toutes les prérogatives d’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec la mesure d’assistance éducative décidée par le juge.
Nous avouons ne pas partager cette critique, ni en droit, ni en opportunité. Au regard des règles de droit, on peut parfaitement estimer que l’article R. 1112-34 du Code de la santé publique vient donner une précision sur la délicate question de la répartition de l’autorité parentale entre les parents et l’ASE et ne vient donc pas contredire le Code civil, mais en indiquer les modalités d’application. Quant à l’opportunité de ce texte, on sait bien que les réticences et refus parentaux gangrènent l’action éducative de l’ASE, au point que la loi du 5 mars 2007 a dû prévoir que le juge des enfants puisse autoriser les services qui ont la responsabilité de l’enfant à effectuer les actes d’autorité parentale que les parents refusent. Demander l’accord des parents pour l’hospitalisation psychiatrique de leur enfant placé à l’ASE aboutirait à judiciariser quasiment toutes les admissions.
D’ailleurs, le rapport pointe les difficultés suscitées par l’hospitalisation d’un enfant bénéficiant d’une action éducative en milieu ouvert (AEMO) décidée par le juge des enfants : si les parents sont, en ce cas, théoriquement décisionnaires, le juge peut les contraindre en fait à donner leur consentement, ce qui engendre beaucoup de mauvaise volonté et un véritable travail de sape de la thérapeutique54.
Il est donc beaucoup plus clair que les autorités judiciaires et/ou administratives prennent la décision d’hospitalisation, quitte à ce que les parents la contestent s’ils l’estiment injustifiée. Encore faudrait-il qu’ils soient parfaitement informés de la situation de leur enfant et l’on ne peut qu’adhérer à la recommandation en ce sens du rapport, qui détaille avec précision tous les items souhaitables de cette information, actuellement insuffisante selon les observations du CGLPL55.
B. Quant aux droits propres du mineur, son accord personnel n’est donc nullement sollicité. Le rapport n’évoque même pas une éventuelle possibilité pour le mineur de demander lui-même son hospitalisation psychiatrique, pourtant souhaitée par les médecins56, mais bien évidemment non prévue par les textes et donc impossible.
Le rapport détaille de manière précise les différents textes qui imposent ou suggèrent d’associer le mineur aux décisions, notamment médicales, qui le concernent57. Reste qu’il n’y a aucune disposition législative ou réglementaire concernant spécifiquement la psychiatrie. Loin de l’autonomie reconnue aux adolescents en matière de contraception, loin de la garantie de confidentialité des soins à l’égard des parents prévue par l’article L. 1111-5 du Code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique repose, au moins en théorie, sur une vision absolutiste de l’autorité parentale qui est particulièrement malvenue en l’occurrence. Un changement ne semble pas à espérer, la réponse du gouvernement à une question écrite parlementaire révélant une absence totale de perspective de réforme58.
Sans doute, en pratique, la prise en charge psychiatrique dans le secteur « libre » repose-t-elle sur une compliance du patient et le personnel médical prend soin de créer avec l’enfant une « alliance thérapeutique » qui repose sur une certaine forme de consentement59. Il n’en demeure pas moins que sur le plan des principes, l’accord explicite de l’enfant devrait être exigé à partir d’un certain âge60. C’est en tous cas ce que pensent les médecins61.
Si, au contraire, l’enfant conteste vigoureusement la pertinence de son hospitalisation psychiatrique, se pose la question des recours qui lui seraient ouverts. Le CGLPL estime que les enfants devraient pouvoir saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) et que les établissements hospitaliers auraient l’obligation de les informer de cette possibilité. Cette suggestion se heurte néanmoins à un certain nombre de difficultés juridiques et pratiques.
Juridiquement, le recours proposé n’existe pas actuellement dans les textes, ce qui est logique s’agissant d’une hospitalisation « libre ». S’y ajoute le fait que l’enfant est mineur et n’a pas, sauf dérogation législative, la capacité de saisir une juridiction. Le rapport propose donc que le mineur qui conteste son internement « libre » puisse saisir la commission départementale des soins psychiatriques et/ou le JLD. Cette faculté est d’ailleurs imposée par la Cour de Strasbourg, pour laquelle l’article 5 de la Convention EDH exige que ce type de privation de liberté puisse être contesté devant un tribunal ou un organisme similaire. Or la Cour EDH, statuant en matière de majeurs incapables, a jugé que ce droit était de première importance lorsque la détention ne résulte pas d’une décision judiciaire, mais de l’intervention d’un autre acteur tel qu’un tuteur62 : nous pensons qu’il en va de même lorsque l’internement résulte d’une demande des parents63.
Il serait donc utile que la loi française se mette en conformité avec les exigences du droit européen et permette explicitement la saisine du JLD par le mineur en ce cas.
Si la suggestion est convaincante, elle risque cependant de ne pas être très effective en pratique. Comment un mineur, de surcroît interné en établissement psychiatrique et ne pouvant en sortir64, pourrait-il, concrètement, saisir un juge ou une commission administrative ? Le détour par la nomination d’un administrateur ad hoc paraît nécessaire. On sait que la condition de nomination de ce dernier est l’existence d’une « opposition d’intérêts » avec les parents65. Le fait que l’enfant conteste l’internement psychiatrique décidé par ses parents peut-il être considéré comme attestant ce conflit d’intérêts ? À tout le moins peut-on estimer que la protection de l’enfant n’est « pas complètement assurée » par les parents, selon les termes de l’article 706-50 du Code de procédure pénale ?
En réalité, l’idée même d’ouvrir un recours propre à l’enfant implique la suspicion d’un conflit d’intérêts avec les parents, ou à tout le moins de la nécessité d’un contrôle extérieur sur la décision parentale (ou de l’ASE) : la seule solution juridiquement correcte est alors la nomination systématique d’un administrateur ad hoc. Il faudrait donc que toute hospitalisation « libre » d’un enfant à la demande de ses parents ou de l’ASE fasse l’objet d’une communication au JLD qui désignerait cet administrateur ad hoc. Il reviendrait alors à ce dernier, en fonction des circonstances, d’apprécier si l’intérêt de l’enfant est bien de rester hospitalisé contre sa volonté, ou si sa demande de sortie doit être portée devant la juridiction du JLD, avec le soutien d’un avocat.
On mesure la lourdeur de cette procédure et la méfiance que les parents en ressentiraient, alors qu’ils sont déjà meurtris par la nécessité de faire interner leur enfant en service de psychiatrie. D’où la recherche d’une autre manière d’ouvrir un recours effectif à l’enfant hospitalisé à la demande des parents.
Cet autre recours pourrait être porté devant le juge des enfants. Il ne fait pas de doute que ce dernier soit compétent pour lever les hospitalisations décidées par l’ASE. On pourrait aussi considérer qu’un enfant hospitalisé en établissement psychiatrique par décision parentale peut s’estimer « en danger », et donc saisir le juge des enfants, quel que soit son âge. L’hospitalisation de l’enfant n’obéissant pas, en l’occurrence, au droit spécial des hospitalisations psychiatriques mais provenant d’une décision d’autorité parentale, ou d’une décision des services de l’ASE, le juge des enfants serait parfaitement apte à prendre toute mesure – AEMO, placement ou autre – qui l’annulerait. Il faudrait alors que la faculté de saisir le juge des enfants fasse l’objet d’une information aux enfants concernés, et que cette saisine soit concrètement facilitée (par ex., par l’indication d’un numéro de téléphone).
Paradoxalement, les recours sont plus facilement accessibles au mineur en cas d’hospitalisation forcée66.
II. Les hospitalisations contraintes
Pour les mineurs, il existe trois types de procédure pouvant conduire à une hospitalisation psychiatrique forcée : l’hospitalisation sans consentement « de droit commun », prévue par le Code de la santé publique, dont le régime a été complètement révisé par la loi du 5 juillet 2011, l’hospitalisation psychiatrique décidée par le juge des enfants dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative67 et enfin, l’hospitalisation psychiatrique décidée par une juridiction pénale, pendant l’instruction ou dans le jugement, en application de l’ordonnance du 2 février 194568.
Ces trois types d’internement obéissent à des régimes juridiques spécifiques, et les recours sont bien évidemment différents. Le rapport du CGLPL recommande d’ailleurs une certaine uniformisation des règles juridiques : ainsi estime-t-il que tous les enfants devraient figurer dans le registre des hospitalisations sans consentement69 et que les règles très strictes encadrant l’hospitalisation au titre de l’assistance éducative (avis médical d’un médecin extérieur à l’établissement, révisions mensuelles de l’opportunité du maintien de l’hospitalisation, etc.) devraient également s’appliquer aux hospitalisations ordonnées au pénal.
A. Concernant l’hospitalisation sans consentement « de droit commun », la question principale est bien évidemment de savoir dans quelle mesure les mineurs peuvent exercer les droits reconnus à la personne hospitalisée sans son consentement. Le plus important est la possibilité de saisir le JLD, mais l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique reconnaît de nombreux autres droits, dont la plupart sont destinés à rendre ce recours effectif : notification de la décision d’internement, droit de consulter le règlement intérieur, de consulter un avocat, un médecin, etc.
Mais un mineur a-t-il ou non la capacité de saisir le JLD ?
L’article L. 3211-12 du Code de la santé publique dispose que « la saisine peut être formée par : 1°/ La personne faisant l’objet des soins ; 2°/ Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure (…) », ce qui semble bien exclure une saisine par le mineur lui-même70.
Cette question n’est pas vraiment évoquée par le rapport du CGLPL qui semble admettre comme évident que les mineurs puissent, à l’égal des majeurs, saisir le JLD. Cette opinion est également soutenue par Jean-Luc Rongé qui lui donne comme fondement la Convention EDH reconnaissant à toute personne privée de liberté, quel que soit son âge ou son état, le droit de saisir une juridiction71.
Cette difficulté ne semble cependant pas avoir suscité de jurisprudence, pour plusieurs raisons. La première est que le Code de la santé publique organise une comparution systématique de toute personne hospitalisée sans son consentement devant le JLD72 avec l’assistance d’un avocat73. Cette saisine automatique du JLD rend moins cruciale la question de savoir si le mineur peut lui-même le saisir.
La seconde raison est que les parents exerçant l’autorité parentale sont, eux aussi, titulaires du droit de saisir le JLD aux fins de mainlevée du placement de leur enfant en hôpital psychiatrique. Or, contrairement à l’hypothèse de l’hospitalisation « libre » à l’initiative des parents, l’opposition d’intérêts entre les parents et l’enfant n’est ici pas certaine et l’on peut penser que les parents réagiront si l’internement de leur enfant est décidé contre leur gré74.
Il n’empêche qu’il serait opportun que le Code de la santé publique précise plus explicitement le droit qu’a le mineur de saisir le JLD et impose en ce cas la nomination d’un administrateur ad hoc qui puisse représenter le mineur dans l’instance.
La protection de l’enfant pourrait et même devrait encore être améliorée par plusieurs mesures que le rapport du CGLPL propose : d’abord notifier à l’enfant la décision de placement si l’enfant a la maturité suffisante et en tout état de cause s’il a plus de treize ans, lui expliquer quels sont ses droits et ses recours ; vérifier que les parents sont, eux aussi, destinataires de la notification de l’hospitalisation de l’enfant et de toutes les convocations et informations qui leur sont dues, et qu’ils ont été correctement avertis de leurs droits et recours.
Si le moindre doute subsiste sur la capacité des parents à protéger leur enfant, le JLD devrait nommer un administrateur ad hoc. Il conviendrait de le prévoir explicitement dans les textes du Code de la santé publique, afin que le JLD soit amené systématiquement à s’interroger sur l’opportunité d’une telle désignation. On pourrait d’ailleurs proposer que cette nomination soit obligatoire toutes les fois où les parents ne sont pas présents lors de la comparution du mineur devant le JLD et dès lors que l’enfant le demande.
B. Le placement en hôpital psychiatrique d’un mineur à l’initiative du juge des enfants statuant en assistance éducative pose moins de problème au regard des droits du mineur, puisque celui-ci est considéré comme partie au procès en matière d’assistance éducative. L’enfant comme ses parents sont donc destinataires de toutes les pièces de procédure et peuvent exercer les voies de recours de l’assistance éducative75. Si l’hospitalisation a dû être effectuée sans audience devant le juge des enfants, le rapport du CGLPL préconise que l’enfant soit dûment averti par l’établissement hospitalier de l’existence des recours qui lui sont ouverts… ce qui suppose que son personnel en ait une connaissance précise.
La question qui se pose dans ce genre d’hypothèses est surtout celle du rôle des parents : toujours titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, sauf en ce qui concerne « les attributs de l’autorité parentale inconciliables avec la mesure », leur place est particulièrement difficile à définir. L’hôpital risque d’être confronté à des parents qui souhaitent faire à l’enfant des visites non souhaitables et non autorisées par le juge, qui peuvent être perturbatrices. De manière générale, les médecins auront du mal à déterminer comment inclure, ou au contraire, exclure du protocole thérapeutique, des parents dont le mode d’exercice de leurs prérogatives a mis l’enfant « en danger » au point d’avoir besoin d’une assistance éducative. Au demeurant, il ne s’agit ici que d’une variante particulière de la difficulté des relations entre le gardien de l’enfant et ses parents, mais avec cette différence que l’hôpital psychiatrique, contrairement à l’ASE et aux établissements qui reçoivent habituellement les enfants placés, n’a pas l’habitude de ce genre de difficultés.
On notera au passage qu’il peut arriver qu’un enfant suivi en assistance éducative fasse l’objet d’un placement en hôpital psychiatrique « de droit commun ». L’imbroglio qui résulte du cumul des règles des placements administratifs et de l’assistance éducative risque de rendre l’exercice des droits du mineur et de ses parents encore plus complexe. À supposer, évidemment, que les services hospitaliers et le JLD en soient avertis ! En effet, il n’existe aucune procédure permettant d’avertir tant l’hôpital que le JLD de ce que le mineur pris en charge au titre d’une hospitalisation sans consentement « de droit commun » est déjà sous mandat du juge des enfants, et le rapport du CGLPL fait état de cas où cette information n’avait manifestement pas eu lieu76. D’où une recommandation de ce rapport prescrivant que le JLD soit informé de l’existence d’une procédure d’assistance éducative et préconisant la communication, au moins partielle, du dossier d’assistance éducative ainsi qu’un avis du juge des enfants à destination du JLD. On ne peut qu’approuver ces recommandations, tout en se demandant comment les mettre en pratique, ni le JLD ni le juge des enfants n’ayant les moyens concrets d’être avertis de cette concomitance des procédures.
L’enfant lui-même et ses parents pourraient certes la signaler aux autorités judiciaires, mais on peut malheureusement douter qu’ils perçoivent à quel point ce peut être important pour une bonne prise en charge77. Seule la nomination systématique d’un administrateur ad hoc pourrait améliorer la fluidité de la circulation des informations, dans le souci permanent et unique de l’intérêt de l’enfant.
C. La procédure pénale est la troisième voie d’entrée dans l’hospitalisation sans consentement d’un mineur, ce dernier pouvant faire l’objet d’une hospitalisation psychiatrique pendant le cours de l’instruction, à l’initiative du juge des enfants ou du juge d’instruction, ou encore par l’effet du jugement, si son discernement était aboli au sens de l’article 122-1 du Code pénal.
Les enquêtes du CGLPL ne rapportent que de très rares utilisations de cette procédure. Néanmoins, son rapport, comme d’ailleurs la doctrine, regrettent l’absence d’encadrement procédural strict de ce type d’internement par l’ordonnance de 194578 et notamment l’absence d’exigence d’un certificat médical avant l’hospitalisation ordonnée pendant l’instruction et l’absence de vérification périodique de la nécessité de maintenir l’internement psychiatrique. Néanmoins, il faut signaler que l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique permet au JLD de donner mainlevée d’une hospitalisation psychiatrique décidée au titre de l’article 706-135 du Code de procédure pénale et que, de manière générale, ce dernier texte déclare applicable aux hospitalisations psychiatriques pénales les règles protectrices de l’article L. 3313-1 du Code de la santé publique, ce que confirme d’ailleurs ce dernier texte. On peut raisonnablement en déduire une compétence du JLD en matière d’hospitalisation psychiatrique de mineurs sur décision d’un juge pénal. Il faut enfin relever que les garanties de la procédure pénale s’appliquent en l’occurrence : ainsi est-il certain que l’enfant bénéficie de l’assistance d’un avocat et que ses parents sont dûment informés tant de leurs droits que des différentes étapes de la procédure.
En conclusion, l’internement des malades psychiquement atteints est un sujet particulièrement délicat et douloureux. Le fait qu’un mineur soit concerné rend la situation encore plus critique. La lecture du rapport du CGLPL atteste de difficultés certaines. Elle montre aussi que les carences dans la protection du mineur proviennent pour une bonne partie de dysfonctionnements de l’autorité parentale. Lorsque la décision d’internement litigieuse résulte de la décision parentale, lorsque les parents n’accompagnent pas leur enfant qui a fait l’objet d’une hospitalisation contrainte dans ses démarches et recours, le défaut de protection de l’enfant et le mépris de ses droits sont difficilement évitables. Le rapport du CGLPL exige une amélioration de l’information et de l’accompagnement tant des parents que de l’enfant. Mais il semble que le recours à une protection extérieure à la famille s’impose dans de nombreuses occurrences : seule la nomination d’un administrateur ad hoc permettrait de pallier les difficultés personnelles, sociales et juridiques des parents, qui privent l’enfant de ses droits et de la protection qui lui est due.
Françoise DEKEUWER-DÉFOSSEZ
2 – L’intégrité psychique en formation ou la question du discernement
a – L’irresponsabilité pénale de l’enfant
b – La parole de l’enfant manipulée
c – L’endoctrinement terroriste de l’enfant
III – La liberté de l’enfant
A – La détention, facteur de vulnérabilité du mineur
1 – La responsabilité de l’État à raison du suicide d’un détenu mineur
2 – La responsabilité de l’État en raison des violences commises par un détenu mineur
B – La privation de liberté des mineurs en question
(À suivre)
Notes de bas de pages
-
1.
V. Dalloz Actualités, 17 oct. 2017, obs. Januel P.
-
2.
Les précédentes tentatives de clarification législative n’ont pas toujours été concluantes – V. par ex. la L. n° 2010-121, 8 févr. 2010.
-
3.
CE, ass. gén., section de l’intérieur, 15 mars 2018, n° 394437, avis sur un projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes commises contre les mineurs et les majeurs.
-
4.
V. proposition présidentielle faite en novembre 2017 : présomption de non-consentement en deçà de 15 ans.
-
5.
V. Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, Avis pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et des agressions sexuelles, 5 oct. 2016.
-
6.
V. Avis préc. supra note 3, point 16 : « Les deux dispositions envisagées ont pour objet de réprimer de manière spécifique l’agression sexuelle ou le viol, lorsque ces actes sont commis par un majeur sur un mineur de 15 ans. Cette spécificité ne tient pas au quantum de la peine, mais aux éléments constitutifs de l’infraction elle-même : alors que les agressions sexuelles et, parmi elles, le viol, supposent que l’acte soit commis “avec violence, contrainte, menace ou surprise”, la définition des deux infractions nouvelles s’affranchit de ces conditions ».
-
7.
V. not. la réaction d’associations de défense des victimes.
-
8.
Les présomptions de culpabilité ont été validées avec réserves par le Conseil constitutionnel et la Cour EDH : Cons. const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC. Le Conseil constitutionnel a d’abord clairement indiqué qu’« en principe, le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ; que toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu’elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu’est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité » ; la Cour admet également ces présomptions mais explique que l’article 6, § 2 « commande aux États de les enserrer dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense » ; Cour EDH, 7 oct. 1988, Salabiaku c/ France : RSC 1989, p. 167 ; Cour EDH, 30 mars 2004, n° 00053964/00, Radio France c/ France.
-
9.
V. not. le « Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le viol », Assemblée nationale, 22 févr. 2018, n° 721 ; Auconie S. et Rixain M.-P. : Recommandation 24 – Insérer dans le Code pénal le principe de non-consentement et établir deux limites d’âge – 13 et 15 ans : tout acte sexuel d’un majeur sur un mineur de 13 ans serait une agression sexuelle aggravée et, en cas de pénétration, un viol. Entre 13 et 15 ans, tout acte sexuel avec pénétration par un majeur serait réputé non consenti.
-
10.
V. par ex. Rassat M.-L., Droit pénal spécial. Infractions des et contre les particuliers, 6e éd., 2006, Dalloz, Précis, p. 456, n° 485.
-
11.
V. Koering-Joulin R., « Brèves remarques sur le défaut de consentement du mineur de quinze ans victime de viols ou d’agressions sexuelles », in Mélanges Pradel. Le droit pénal à l’aube du troisième millénaire, 2006, Cujas, p. 389-394 ; Guéry C., « L’inceste : étude de droit comparé », D. 1998, Chron., p. 47 ; Rép. pén. Dalloz, v° « Viol », 2017, n° 32, Darsonville A.
-
12.
V. avis préc. supra note 3, points 18 et s.
-
13.
V. Cass. crim., 1er mars 1995, n° 94-85393 : Bull. crim., n° 92 ; Dr. pénal 1995, comm. 171, note Veron M.
-
14.
V. Cass. crim., 21 oct. 1998 : Dr. pénal 1999, p. 5, note Veron M.
-
15.
V. Cass. crim., 7 déc. 2005, n° 05-81316 : Bull. crim., n° 326 ; Dr. pénal 2006, p. 31, obs. Veron M. ; RSC 2006, p. 319, obs. Mayaud Y. : pour la Cour de cassation, le « très jeune âge des enfants (enfants entre 18 mois et 5 ans) les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés ».
-
16.
V. Cass. crim., 5 déc. 2007, n° 07-80068 : D. 2008, Pan., p. 1861, obs. Bonfils P. : « La contrainte résulte de l’incapacité de la fillette, en raison de son tout jeune âge, 6 ans lors des premiers faits, à résister à l’emprise de son père et à donner un consentement valable à ses sollicitations ».
-
17.
V. Cass. crim., 1er mars 1995, n° 94-85393, supra note 12.
-
18.
V. Cass. crim., 21 oct. 1998, n° 98-83843 : Bull. crim., n° 274 ; D. 1999, p. 75, note Mayaud Y. – Cass. crim., 22 sept. 1999, n° 98-86324 : Bull. crim., n° 195 – Cass. crim., 10 mai 2001, n° 00-87659 : Bull. crim., n° 116.
-
19.
V. Guéry C., « Définir ou bégayer : la contrainte morale après la loi sur l’inceste », AJ pénal 2010, p. 126.
-
20.
V. Rép. pén. Dalloz, v° « Viol », 2017, n° 26, Darsonville A.
-
21.
V. Ibid, n° 36.
-
22.
V. Rapport d’information de Mme Mercier M., fait au nom de la commission des lois, Protéger les mineurs victimes d’infractions sexuelles, n° 289 (2017-2018), 7 févr. 2018, p. 36.
-
23.
V. circ., 9 févr. 2010, spéc. n° 1.1 : « la loi procède à une « clarification » de la notion de contrainte et ne fait que consacrer les jurisprudences les plus récentes ».
-
24.
Rapp. préc., supra note 22, p. 36.
-
25.
V. pour une position différente : Rép. pén. Dalloz, v° « Viol », 2017, nos 27 et s. puis n° 36, Darsonville A : « La loi instaure deux critères pour la contrainte morale, critères cumulatifs comme le souligne l’emploi de la conjonction de coordination “et”. Il faut donc une différence d’âge et l’exercice d’une autorité ». Et l’auteure de préciser que « l’emploi du verbe “peut” souligne que les critères légaux peuvent être utilisés par le juge pour caractériser la contrainte morale, mais que ce dernier peut tout aussi bien décider de se fonder sur d’autres éléments ».
-
26.
Rapp. préc., supra note 22 ; Dalloz Actualité, 23 févr. 2018, obs. Januel P. : à une éventuelle présomption de consentement, le rapport avait indiqué préférer une présomption simple de contrainte fondée sur l’incapacité de discernement du mineur ou la différence d’âge entre le mineur et le majeur.
-
27.
V. Avis préc., supra note 3.
-
28.
C. pén., art. 227-25.
-
29.
C. pén., art. 227-27 ; v. Rép. pén. Dalloz, v° « Infractions sexuelles », 2017, nos 59 et s., Malabat V.
-
30.
Montesquieu D., De l’esprit des lois, livre II, chap. VI, 1748, Barillot & fils.
-
31.
Bellon L. et Guery C., « Juges et psy : la confusion des langues », RSC 1999, p. 783.
-
32.
Cesaro J.-F., « La preuve », in Rapport annuel de la Cour de cassation, 2012, p. 84.
-
33.
Bentham J., Traité des preuves judiciaires, 2e éd., t. I, 1830, Bossange, p. 3.
-
34.
CPP, art. 427 : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats contradictoirement discutées devant lui ».
-
35.
Darsonville A., « La liberté dans la production de la preuve », Dalloz actualité, 7 janv. 2009.
-
36.
CPP, art. 81, al. 1 : « Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge ».
-
37.
CPP, art. 222-22, al. 1.
-
38.
Mayaud Y., « Le jeune âge de la victime, facteur de contrainte ou de surprise constitutive d’agression sexuelle », RSC 2006, p. 319.
-
39.
Saas C., « Agression sexuelle sur mineur : l’état de contrainte ou surprise résulte du très jeune âge des enfants », AJ pénal 2006, p. 81.
-
40.
Byk C., « Les neurosciences : une contribution à l’identité individuelle ou au contrôle social ? », RDSS 2012, p. 800.
-
41.
CPP, art. 222-29.
-
42.
Cass. crim., 6 oct. 1964, n° 64.90560 : Bull. crim., n° 256 ; RSC 1965, p. 434, obs. Robert J. – Cass. crim., 4 juin 1996, n° 95-82256 : Bull. crim., n° 230 – Cass. crim., 11 déc. 2002, n° 01-85176 ; Cass. crim., 5 févr. 2003, n° 02-82255.
-
43.
Picot M., « La participation de l’enfant victime au procès pénal », AJ fam. 2003, p. 373.
-
44.
Rolland R., « La protection du mineur, victime d’infraction sexuelle », RDSS 1998, p. 892.
-
45.
Mayaud Y., « L’agression sexuelle sur mineur d’une loi à l’autre… », RSC 2016, p. 268.
-
46.
Januel P., « Violences sexuelles sur mineur : le Sénat développe ses propres propositions », Dalloz actualité, 21 févr. 2018.
-
47.
V. Rongé J.-L., « L’hospitalisation sous contrainte des enfants : des droits en mode mineur », Journal du droit des jeunes, 2016, n 354-355, p. 26.
-
48.
Recommandation n° (2004)10 aux États membres relatifs à la protection des droits de l’Homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux.
-
49.
Obs. finales concernant le cinquième rapport périodique de la France adoptées par le Comité à sa 71e session (11-29 janv. 2016, n° CRC/C/FRA/CO/5), reproduites dans le JDJ avr.-mai 2016, p. 88 et s.
-
50.
V. Panfili J.-M., « L’autonomie réduite de l’adolescent en soins psychiatriques », Revue Droit & Santé 2015, n° 63, p. 29-46.
-
51.
Ibid.
-
52.
CE, 7 mai 2014, n° 359076.
-
53.
Le texte de l’article L. 1112-34 du Code de la santé publique vise explicitement les demandes de placement émanant de directeurs d’établissements auxquels l’enfant a été confié en application des textes relatifs à l’enfance délinquante, ce qui inclut les CEF. L’opinion émise par Jean-Luc Rongé, estimant que l’autorisation des parents est nécessaire pour hospitaliser un enfant placé en CEF, in art. préc. supra note 246, p. 34, semble donc mal fondée.
-
54.
Rapp. p. 24.
-
55.
Recommandations, p. 56.
-
56.
En ce sens, Panfili J.-M., « L’autonomie réduite de l’adolescent en soins psychiatriques », Revue Droit & Santé 2015, n° 63, p. 29-46.
-
57.
Rapp., p. 16-17.
-
58.
QE au gouvernement n° 36681 : JO, 3 sept. 2013, p. 9161, réponse publiée au JO, 17 déc. 2013, p. 13169.
-
59.
Le rapport note, page 21, qu’il n’est pas rare que des adolescents affirment s’opposer à leur hospitalisation, tout en montrant par leur comportement qu’ils n’y sont pas totalement opposés et en reconnaissant leurs bienfaits.
-
60.
C’est ce que suggère le rapport, à la page 18, mais il remarque ensuite, à la page 21, que la démarche consistant pour l’enfant à reconnaître son trouble mental est difficile et c’est pourquoi il ne reprend pas cette proposition dans les recommandations finales. On peut se demander si cette reconnaissance de la maladie est plus facile pour un adulte.
-
61.
V. Panfili J.-M., « L’autonomie réduite de l’adolescent en soins psychiatriques », Revue Droit & Santé 2015, n° 63, p. 29-46.
-
62.
CEDH, 16 janv. 2013, n° 45026/07, Kedzior c/ Pologne ; v. Bartlett P., « Capacité juridique, limitation de la liberté d’aller et venir et droits de l’Homme », RDSS 2015, p. 995.
-
63.
La Cour de Strasbourg a amorcé un raisonnement en ce sens dans son arrêt CEDH, 28 nov. 1988, n° 10229/84, Nielsen c/ Danemark, mais elle a estimé que l’internement litigieux était conforme à l’intérêt de l’enfant, et n’a donc pas condamné l’état en cause.
-
64.
Car hospitalisation « libre » ne veut pas dire portes ouvertes, comme l’explique très bien le rapport du CGLPL.
-
65.
C. civ., art. 388-2.
-
66.
Ce paradoxe est aussi relevé par Panfili J.-M., « L’autonomie réduite de l’adolescent en soins psychiatriques », Revue Droit & Santé 2015, n° 63, p. 29-46.
-
67.
C. civ., art. 375-9.
-
68.
L’ordonnance du 2 février 1945 ne vise pas spécifiquement les hôpitaux psychiatriques mais permet le placement dans un établissement médical, qui peut être psychiatrique : v. dans cette ord., art. 10, al. 5, 4° ; art. 8, al. 9, 6° ; art. 15, 3° ; art. 16, 3°.
-
69.
CSP, art. L. 3212-11.
-
70.
En ce sens, Panfili J.-M., « L’autonomie réduite de l’adolescent en soins psychiatriques », Revue Droit & Santé 2015, n° 63, p. 29-46.
-
71.
Panfili J.-M., « L’autonomie réduite de l’adolescent en soins psychiatriques », Revue Droit & Santé 2015, n° 63, p. 36. V. aussi Bartlett P., « Capacité juridique, limitation de la liberté d’aller et venir et droits de l’Homme », RDSS 2015, p. 995 et CEDH, 16 janv. 2013 n° 45026/07, Kedzior c/ Pologne.
-
72.
CSP, art. L. 3211-12-1.
-
73.
CSP, art. L. 3211-12-2.
-
74.
Pour un ex., v. CE, 13 mars 2013, n° 342704. Cet arrêt concerne le droit antérieur à 2011, mais il montre que les recours des parents contre l’internement de l’enfant ne sont pas exceptionnels.
-
75.
Pour un exemple de recours de la mère, couronné de succès, v. CA Riom, 11 mai 2004, n° 04/00023.
-
76.
Rapp., p. 34.
-
77.
Comme le montre le cas relaté par le rapport du CGLPL, p. 34.
-
78.
Rapp. du CGLPL, p. 32 ; Rongé J.-L., « L’hospitalisation sous contrainte des enfants : des droits en mode mineur », Journal du droit des jeunes, 2016, n 354-355, p. 33.