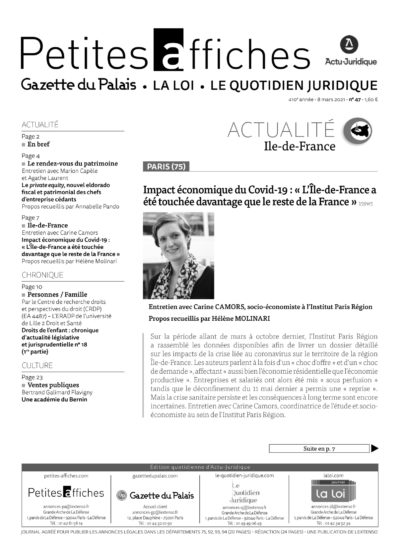Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 18 (1re partie)
Pour commémorer le 30e anniversaire de la ratification française de la convention internationale des droits de l’enfant (7 août 1990), quoi de mieux que de vérifier, dans l’actualité récente, l’effectivité de la fameuse « considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant » de l’article 3-1 de ladite convention dans l’exercice des fonctions gouvernementale, réglementaire et législative confondues. Qu’elle soit affichée ou tue, cette considération est tantôt secondaire, tantôt prioritaire, selon une ligne de fracture dont on peut induire une nouvelle distinction, selon que l’enfant est un « paria » ou une « victime ».
Prolégomènes : La considération de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’exercice des fonctions gouvernementale, administrative et législative : « parias » et « victimes »
L’an 1 avant Covid-19 (cette lointaine année 2019…) aura été marqué par le 30e anniversaire de l’adoption de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) par l’Assemblée générale de l’ONU signée le 20 novembre 1989 à New York. Un anniversaire au goût amer pour la France (et quelques autres pays1) en raison de la plainte déposée par Greta Thunberg et 15 autres jeunes devant le Comité des droits de l’enfant de l’ONU2 pour dénoncer l’hypocrisie des États dans le domaine de la lutte contre le changement climatique (facteur de pandémie ?). Certes, la CIDE ne garantit aux enfants aucun droit environnemental, mais l’idée est que l’effectivité des droits de l’enfant (droits à la santé, à la vie, à la culture, etc.) est conditionnée par la reconnaissance aux enfants, premières victimes du changement climatique de par leur vulnérabilité, d’un droit à un climat vivable et durable.
Le surgissement de la figure de l’« enfant-lanceur d’alerte » peut faire sourire, mais c’est un fait – certes habilement médiatisé/instrumentalisé – dont les enjeux sont réels, à la fois juridique (quelle valeur juridique les juridictions françaises reconnaîtront-elles aux recommandations du Comité ?) et politique : comment les jeunes générations peuvent-elles peser sur la formation de la volonté politique, qui conditionne leur avenir – autrement qu’en faisant participer des classes de CM2 au « Parlement des enfants » sur des thèmes imposés. Le sujet de l’abaissement de la majorité électorale n’est pas nouveau (déjà opéré en 1974), mais il prend une couleur particulière dans le contexte actuel d’éco-anxiété. Certes, la CIDE ne consacre pas plus le droit des enfants de voter ; mais des libertés d’expression, de pensée, et d’association (CIDE, art. 13, 14, 15) au droit de vote, il n’y a pas si loin. À quand donc la reconnaissance des enfants comme minorité politique, opprimée par une majorité adulte, de plus en plus vieillissante et aux préoccupations court-termistes ?
Pour commémorer ce 30e anniversaire, et par la même occasion celui plus récent de la ratification française de la CIDE (7 août 1990), par laquelle la France s’est engagée à respecter et garantir sans distinction les droits énoncés dans le texte (CIDE, art. 2), quoi de mieux que de vérifier, dans l’actualité récente, l’effectivité de la fameuse « considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant » de l’article 3-1 de ladite convention dans l’exercice des fonctions gouvernementale, réglementaire et législative confondues. Qu’elle soit affichée ou tue, cette considération est tantôt secondaire, tantôt prioritaire, selon une ligne de fracture dont on peut induire une nouvelle distinction, selon que l’enfant est un « paria » ou une « victime ».
1°/ On reconnaît l’enfant « paria » au fait que son intérêt dit « supérieur » est une considération secondaire. Celle-ci est paradoxalement assumée par le gouvernement français dans un cas extrême : celui de l’enfant de parents djihadistes français dont le « confinement » en Syrie l’expose aux plus graves dangers, au mépris de ses droits les plus fondamentaux (droits à la vie, à la sécurité, à la santé, à l’éducation, etc.). La politique du « cas par cas » défendue par les autorités françaises, au nom d’une Raison d’État qui ne dit pas son nom (rapatrier les seuls enfants isolés ou orphelins pour éviter la question dérangeante du rapatriement des parents ?), a justement été épinglée par le CNCDH3, exhortant les autorités à rapatrier d’urgence tous les enfants français, ainsi que leurs parents, au nom de leur intérêt supérieur (avis de la CNCDH sur les enfants retenus dans les camps syriens du 24 septembre 20194). Dans un tel contexte, le ministère de la Culture a beau jeu d’assortir le visa d’exploitation accordé à un documentaire consacré aux exactions atroces des salafistes d’une interdiction de représentation publique aux mineurs de 18 ans, et ce au nom de la protection de l’enfance et de la jeunesse. L’argument n’a de toute façon pas suffi à convaincre le Conseil d’État qui a fait prévaloir la « liberté d’information, y compris à l’égard des mineurs de 18 ans », compte tenu de l’objectif d’information et de dénonciation poursuivi par l’œuvre5.
À en juger par les orientations du futur Code de la justice pénale des mineurs (CJPM) issu de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, l’enfant délinquant fait aussi partie des « parias ». On remarquera d’emblée que le législateur n’a pas osé hisser la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant délinquant au rang des principes généraux rassemblés au sein du titre préliminaire du nouveau code. Pour autant, il faut a priori saluer sa volonté de mettre le droit français en conformité avec l’article 40 de la CIDE, qui invite les États à fixer « un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale » (v. l’exposé des motifs). Ainsi, le futur article L. 11-1 du CJPM6 retient-il l’âge de 13 ans comme seuil de la responsabilité pénale, là où il n’en existe aucun en droit positif, sauf en matière de capacité pénale du mineur délinquant (C. pén., art. 122-8). Toutefois, le législateur n’a-t-il pas biaisé ? Il n’a en effet pas renoncé au critère du discernement, qu’il combine avec celui de l’âge, ce qui l’amène à poser des présomptions simples d’irresponsabilité/responsabilité pénale, le discernement ne se décrétant pas ! Autre louvoiement, non moins évident à l’analyse : malgré la réaffirmation du principe éducatif parmi les principes généraux de la justice pénale des mineurs (CJPM, art. L11-3), la réorganisation de la procédure pénale et des mesures éducatives judiciaires sous forme de « modules »7 ne modifie en rien l’orientation répressive des réformes antérieures de l’ordonnance de 1945. À moyens constants, les gains annoncés en termes de célérité et d’efficacité de la réponse pénale satisferont davantage les impératifs sécuritaire et indemnitaire, chers au législateur contemporain, que l’impératif éducatif, malgré leur équivalence affichée dans le titre préliminaire (CJPM, art. L11-3). Qu’on se le dise : l’enfant délinquant n’est pas une victime !
2°/ L’intérêt supérieur de l’enfant victime, le vrai, fait quant à lui l’objet dans la législation récente d’une attention particulière à la faveur de différentes prises de conscience médiatico-politiques : l’ambiguïté intrinsèque du consentement de l’enfant à l’acte sexuel8, l’impossible finalité éducative de la violence, l’exposition de l’enfant aux violences conjugales, etc. Ou plutôt ce sont ces prises de conscience qui ont fait accéder l’enfant au statut de victime – là où il était (respectivement) consentant, indiscipliné ou simple témoin. On comprendra aisément que l’intérêt supérieur de cet enfant promu au grade symbolique de victime soit une considération primordiale dans les textes concernés.
Cette considération primordiale s’est traduite par l’interdiction des « violences éducatives ordinaires » par la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 : selon le nouvel alinéa 3 de l’article 371-1 du Code civil, « L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ». Cette interdiction prolongera forcément ses effets en droit pénal : fini le contrôle de proportionnalité entre les moyens employés et le but éducatif recherché pour valider (ou pas) la correction infligée. Le « droit de correction » parental a vocation à disparaître comme fait justificatif des violences commises puisqu’il ne peut plus être rattaché à la mission éducative des parents – tout comme le droit de correction des enseignants, traditionnellement admis à l’exercer par une sorte de délégation parentale9. Certains juges répressifs ont d’ailleurs anticipé l’adoption de la réforme, par exemple en relaxant du chef de violences aggravées une institutrice qui avait symboliquement ligoté sur sa chaise une élève turbulente, et ce sans invoquer le fameux droit de correction ! Mais pour parvenir à la relaxe, la cour d’appel de Rouen a dû prendre quelques libertés avec les fondamentaux du droit pénal, notamment la distinction classique des mobiles et de l’intention10…
À vrai dire, ce texte a avant tout une vertu pédagogique à destination des parents qu’il faut éduquer à éduquer leurs enfants sans le moindre esprit de violence. Il s’adresse aux familles « ordinaires », sans histoires : le législateur pédagogue incite les parents à réfléchir à leurs méthodes éducatives – parce que les parents « ordinaires » possèdent cette capacité de réflexion. Aux familles « dangereuses » (violentes, délaissantes ou incompétentes), le droit réserve d’autres dispositifs autrement plus opérationnels, qui visent à protéger l’enfant en danger : son intérêt supérieur est par essence même la considération primordiale qui inspire ces dispositifs (assistance éducative, retrait d’autorité parentale, délégation de l’autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental). L’effort du législateur contemporain est de renforcer la modularité de ces mesures pour qu’elles puissent répondre de la manière la plus adaptée possible à la situation particulière de chaque enfant. Ainsi, la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a-t-elle réformé l’ancienne déclaration judiciaire d’abandon en prévoyant que la nouvelle déclaration judiciaire de délaissement parental pourrait n’être prononcée qu’à l’égard du seul parent délaissant (C. civ., art. 381-2, al. 4), pour ne pas priver l’enfant de son autre parent, dans son intérêt évident. Mais comment concilier cette déclaration, qui produit des effets propres (admission en qualité de pupille de l’État, adoptabilité de l’enfant, délégation forcée d’autorité parentale), et les droits du parent non délaissant ? La Cour de cassation a justement rendu deux avis sur la question11 : la conciliation qu’elle préconise aboutit à une délégation forcée de l’autorité parentale avec partage des droits parentaux entre le tiers délégataire et le parent non délaissant – en somme, à la création d’un nouveau cas de délégation forcée-partage, non prévu par les articles 377 et suivants du Code civil ! La loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille12 poursuit le même cap en approfondissant la modularité, d’une part, du retrait d’autorité parentale, qui peut désormais porter sur le seul exercice et non plus nécessairement sur la titularité de l’autorité parentale (C. civ., art. 379-1), et, d’autre part, de la délégation d’autorité parentale, par la création d’un nouveau cas de délégation forcée à l’encontre du parent poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci (C. civ., art. 377, al. 2). Enfin, une nouvelle mesure a vu le jour : la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou d’hébergement du parent violent, poursuivi ou condamné pour crime commis sur l’autre parent (C. civ., art. 378-2). Ces réformes peuvent cependant laisser perplexe par la complexité qu’elles introduisent dans notre droit, qui perd en lisibilité : la délégation-partage et l’exercice unilatéral de l’autorité parentale, de la compétence exclusive du JAF, peuvent être prononcés par le tribunal judiciaire, parfois en dehors des conditions légales. Au lieu de déjudiciariser à outrance le contentieux familial, le législateur serait bien inspiré de remédier à l’éclatement du contentieux familial entre plusieurs juges en créant une véritable juridiction familiale.
Quoi qu’il en soit, c’est au juge de définir la meilleure modalité possible de la mesure. Cependant, un tiers est parfois mieux placé que lui pour faire le choix le plus adapté à l’intérêt de l’enfant. Dès lors, le juge peut-il lui déléguer son pouvoir de décision ? La question se pose en matière de fixation des modalités du droit de visite des parents d’un enfant placé, au titre de l’assistance éducative, auprès d’un service ou d’un établissement dédié. Le choix d’un droit de visite simple ou médiatisé appartient au seul juge des enfants, sous réserve pour lui de motiver spécialement sa décision lorsqu’il impose la présence d’un tiers lors de la visite du parent (C. civ., art. 375-7, al. 4). Mais quid des modalités d’exercice de ce droit, qu’il soit simple ou médiatisé ? Dans le premier cas, aucune délégation de pouvoir au profit du service « gardien » n’est envisageable. Dans le second cas, le juge peut, « sous [son] contrôle », déléguer au service son pouvoir d’organisation des visites, mais sous réserve d’un accord entre ce dernier et les parents. Ces solutions résultent d’une interprétation à la lettre par la Cour de cassation de l’article 1199-3 du Code de procédure civile issu du décret n° 2017-1572 du 15 novembre 201713. Remarquons au passage que l’accord des intéressés (parents et service) n’écarte pas pour autant le contrôle de l’intérêt de l’enfant par le juge – ce qui en soi ne relève plus de l’évidence depuis la déjudiciarisation du divorce de droit commun, dans le cadre duquel il revient à l’enfant de solliciter le contrôle judiciaire ! Mais le traitement des familles « dangereuses » n’est évidemment pas le même que celui des familles « ordinaires »…
Notons également que le contexte des violences conjugales continue de mobiliser le législateur soucieux de protéger l’enfant – en témoigne la dernière loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019. Le huis clos sanitaire imposé par les autorités, également aux familles violentes, pour contenir l’épidémie du Covid-19 sera l’occasion de tester l’efficacité de ces nouvelles mesures, voire de prendre conscience des limites de la méthode législative jusque-là utilisée : n’est-il pas temps de prévoir un dispositif pénal et civil rapide et efficace pour protéger l’enfant lui-même, à l’image de ce qui existe pour le conjoint victime ? Dans cette perspective, constitue une intéressante source de réflexion cet arrêt de la Cour EDH du 12 novembre 201914 condamnant la Russie à propos de violences policières aux répercussions psychologiques dévastatrices pour l’enfant témoin du passage à tabac de son père : la Cour a reconnu à l’enfant le bénéfice de la protection des articles 2 et 3 de la convention EDH. À quand l’extension de cette jurisprudence à l’hypothèse des violences conjugales contre lesquelles les autorités n’auraient pas su protéger l’enfant ? À tout le moins, la crise du Covid-19 contribuera sans doute à l’amélioration du dispositif existant.
Pour finir, l’année 2020 verra peut-être l’adoption définitive de la proposition de loi « visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plates-formes en ligne »15, et donc la consécration légale d’une nouvelle figure de l’enfant victime : l’enfant « YouTubeur » ou « influenceur » – proie facile de certaines marques en quête d’influence chez les jeunes. En attendant, rappelons les fondamentaux en matière d’exploitation commerciale de l’image de l’enfant : l’utilisation de photographies le représentant dans des conditions excédant l’autorisation contractuellement consentie est constitutive d’une atteinte au droit à l’image de l’enfant, sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Peu importe qu’il s’agisse d’un usage par ailleurs conforme à l’autorisation : le seul non-respect de la durée de validité de celle-ci suffit à constituer l’atteinte au droit à l’image16.
Christine DESNOYER

I – L’intérêt supérieur de l’« enfant paria » : une considération secondaire
A – L’intérêt supérieur de l’enfant retenu en Syrie : primauté de la raison d’État
CNCDH, Avis sur les enfants français retenus dans les camps syriens, 24 septembre 2019. Les multiples offensives turques à l’ouest de la Syrie ont conduit à des déplacements massifs de populations vers le nord du pays, territoire contrôlé par l’armée kurde, au prix de conflits intensifs contre les soldats djihadistes de l’organisation terroriste État islamique (Daesh). Les flux migratoires et la capture de djihadistes ont révélé l’existence de personnes, de fratries, de familles de nationalités étrangères, majoritairement européennes, qui ont migré vers la Syrie pour participer à l’avènement (heureusement manqué) d’un nouvel « État islamique en Irak et au Levant ». Des milliers de femmes et d’enfants de soldats djihadistes morts ou capturés sont rassemblés dans des camps de réfugiés contrôlés par l’armée kurde.
Les ressortissants français ayant combattu au sein des troupes de Daesh ont souvent été arrêtés et condamnés sur place et leur retour est lié aux règles du droit international en ce qui concerne les transfèrements de détenus. La situation des femmes et des enfants est différente, même si les premières ont pu jouer un rôle actif ou en soutien à l’organisation terroriste. À la demande de la Syrie, de l’autorité kurde, de représentants de l’ONU et de nombreuses autorités internationales, la France, comme d’autres États, se trouvent face à l’épineux problème du rapatriement de ses ressortissants présents dans les camps situés au Nord Est de la Syrie.
Si cette question du rapatriement est classique en ce qu’elle est un principe du droit international, elle devient particulièrement complexe lorsque le rapatriement est involontaire et concerne des personnes impliquées de manière plus ou moins grande dans des activités terroristes.
Ce bref rappel des faits permet de mettre en balance deux types de considérations : la première concerne le respect des droits fondamentaux des ressortissants français, en particulier mineurs, qui subissent des conditions de vie ingrates et insalubres dans les camps syriens caractérisant un danger pour leur santé et leur vie, et la seconde qui intéresse la préservation de la sûreté de l’État français, déjà endeuillé par les attentats terroristes de 2015. Finalement, cela illustre la sempiternelle équation basée sur une réduction ou le sacrifice volontaire des droits et libertés fondamentales de quelques-uns au profit d’une sécurité renforcée des personnes et des biens sur le territoire national.
Le rapatriement des enfants de djihadistes continue de susciter de nombreux débats publics entre les tenants d’une politique faisant primer une protection obligatoire des enfants, peu important leurs statuts, et une partie de l’opinion ne souhaitant pas voir les ressortissants et leurs enfants revenir en France. Les autorités publiques viennent nourrir ce débat en recourant à des arguments juridiques qui tentent de faire primer des principes au détriment d’autres. Par exemple, le Conseil d’État a rejeté dans plusieurs ordonnances rendues le 23 avril 2019 les demandes de rapatriement formées, par le biais de leurs avocats, par des ressortissantes retenues en Syrie avec leurs enfants. A contrario, l’Assemblée plénière de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) a adopté le 24 septembre 2019 un avis dans lequel elle exhorte le gouvernement d’organiser en urgence le rapatriement de l’ensemble des enfants français. La CNCDH, comme d’autres organisations d’ailleurs, avait déjà exprimé sa préoccupation en envoyant des lettres au Premier ministre qui rejeta les demandes formulées.
La problématique du rapatriement de ces personnes est éminemment politique et renvoie inévitablement aux agressions terroristes dont la France a été victime. Mais elle est également juridique puisque le juge est amené à statuer sur des contentieux donnant lieu à une confrontation entre des principes matriciels du droit.
La première partie de cet article permet de revenir sur le sens de la protection des personnes vulnérables tel que défini par le droit international et les limites de son contenu (1). L’arbitrage du juge administratif est essentiel pour décider du rapatriement des enfants français détenus dans les camps syriens, qui se montre très prudent et n’hésite pas à recourir à la théorie des actes du gouvernement pour rejeter les requêtes formées devant lui (2).
1 – La protection des droits fondamentaux des mineurs : une évidence… limitée
Si la protection des droits fondamentaux est une œuvre juridique exceptionnelle, alimentée par diverses conventions internationales, elle devient impérative dans le contexte des conflits armés dans lequel l’action humanitaire présente néanmoins des limites (a). Mais, sauver des ressortissants français appelle à la mise en œuvre du droit dont les critères, parfois nébuleux, sont définis par les textes (b).
a) Le rappel de l’urgence humanitaire
Les enfants sont souvent les premières victimes des conflits ce qui les place dans une situation caractérisée par une grande vulnérabilité, illustrée par une mortalité élevée. En cela, l’article 38 alinéa 4 de la CIDE dispose que « conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d’une protection et de soins ». Dans la lignée de la CIDE, ce droit pour l’enfant d’être protégé de la guerre, qu’il en soit une victime ou un instrument, est défendu par de nombreuses résolutions adoptées par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations unies depuis les années 1990.
Malgré le foisonnement de textes réaffirmant la nécessaire protection des enfants en contexte de guerre, le droit international humanitaire a créé un dispositif juridique de protection faillible et le problème du rapatriement des enfants vivant dans les camps syriens en est une illustration. Qu’ils s’agissent d’enfants témoins de la guerre ou d’enfants soldats, les États doivent leur apporter « une protection spéciale ».
Les opérations d’évacuation des enfants se sont réalisées « au cas par cas », entre mars et juin 2019, par les autorités françaises et la CNCDH réclame la généralisation de ces actions de protection pour tous les enfants français ou nés de parents français, accompagnés ou non par leurs parents. Cette sollicitation se justifie en raison des conditions de vie dans les camps qui sont attentatoires aux droits de l’enfant les plus élémentaires.
Si la question humanitaire ne fait aucun doute, celle relative à la sécurité fait ici aussi son apparition. En effet, l’organisation de l’État islamique subsiste, malgré ses défaites, et celui-ci peut être tenté de récupérer des mineurs en organisant leur évasion depuis les camps pour les enrôler et les ériger en espoir de leur projet sanglant d’expansion du califat. D’autres arguments avancés reposent sur la menace, à moyen terme, que représenteraient des enfants devenus adultes ou jeunes majeurs et qui s’impliqueraient, hors de tout contrôle, dans des projets d’attentats terroristes qui viseraient le territoire ou des intérêts français. En plus du risque de dispersion des personnes, la menace terroriste préméditée est relevée par un certain nombre de professionnels du droit français qui ont signé diverses tribunes dans la presse quotidienne.
La stratégie du « cas par cas » employée par le gouvernement français semble introduire une logique de degrés ou une distinction dans l’échelle des vulnérabilités, ce qui est contraire aux obligations internationales. De plus, le gouvernement n’écarte pas des retours d’enfants sous réserve d’une rupture de lien avec les parents17. À ce jour, il a néanmoins rapatrié une dizaine d’enfants.
b) L’application des conventions internationales aux ressortissants français
« L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Cette célèbre formule, tirée de l’article 3-1 de la CIDE, ratifiée par la France le 7 août 1990, est destinée à concerner toute personne âgée de moins de 18 ans, au sens de l’article 1er de ladite convention.
La primauté de cette notion est reconnue par le Conseil constitutionnel qui identifie « une exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant », dans une décision rendue le 21 mars 201918. Il rejoint alors la Cour de cassation19 et le Conseil d’État20, mais également les juges supranationaux (Cour européenne des droits de l’Homme et CJUE) dans la construction d’une œuvre juridique à vocation universelle, même si l’invocabilité de l’article 3-1 de la CIDE a provoqué, à l’époque, interrogations et controverses.
La justiciabilité des ressortissants français et de leurs enfants au regard de la convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) ne semble pas laisser de place au doute. En effet, son article 1er dispose que : « les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ». La référence au terme juridiction permet d’englober des situations juridiques plus vastes que l’emploi du terme « territoire » qui n’est pas une condition d’application de la convention21. Mais le mot « juridiction » comporte une grande complexité.
Le texte s’appuie donc sur des critères non territoriaux pour bénéficier aux « personnes relevant de leur juridiction » sans condition de résidence22 ou de nationalité. Cette règle s’impose sans que le principe de réciprocité puisse être retenu pour recevoir le bénéfice de la convention en dehors du territoire du Conseil de l’Europe.
Pourtant, la Cour européenne ne souhaite pas une extension universelle dans l’application de la convention et se limite, par conséquent, « à une perception essentiellement territoriale et non personnelle des compétences exercées par l’État souverain23 ».
Mais il existe des circonstances exceptionnelles dont la question du rapatriement des ressortissants français en Syrie relève.
La Cour européenne a d’ailleurs développé une jurisprudence sur les critères rigoureux d’extra-territorialité de la CEDH24.
Le gouvernement a répondu aux demandes formulées par la CNCDH que les ressortissants français présents dans les camps syriens ne relèvent pas de la juridiction française. Pourtant, le terme de juridiction fait référence à des compétences qui trouvent à s’appliquer dans le cas où l’État exerce un contrôle effectif du fait d’une intervention militaire sur une partie du territoire d’un autre État25.
La CNCDH s’appuie, dans son avis, sur un faisceau d’indices laissant apparaître l’existence d’un véritable contrôle de la France sur certaines personnes, permis grâce à ses relations (diplomatiques, militaires et financières) entretenues avec les forces militaires syriennes constituées par différents groupes religieux et ethniques (FDS). D’ailleurs, plus prosaïquement, la France fait partie des États de la coalition internationale.
En ce qui concerne la CIDE, la technicité du texte est moindre car elle constitue un traité imparfait dont les dispositions présentent un caractère obligatoire plus que relatif (les vicissitudes autour de l’effectivité de certaines dispositions de la CIDE demeurent puisqu’elles n’ont pas toutes fait l’objet d’une réception par le droit et le juge national26). Mais, bien que l’intégration de toutes les dispositions de la CIDE dans le droit français ne soit pas complète, la préservation des droits de l’enfant peut naturellement trouver un relai en s’appuyant principalement sur la CEDH qui présente une force contraignante importante, contrairement à la CIDE.
2 – Les actes de gouvernement à l’épreuve d’une conception universelle des droits
Le rapatriement des femmes et enfants de soldats terroristes de Daesh est une question complexe et très sensible car elle implique, de manière étroite, des risques de radicalisation de ces personnes27. Le juge administratif se trouve face à un véritable défi auquel il répond par son incompétence issue de l’application de la théorie des actes de gouvernement, conduisant in fine à un refus de retour des requérants sur le territoire national (a). Cette position place les personnes dans une situation très fragile en termes de recours effectif à l’office du juge (b).
a) Le rapatriement humanitaire : un acte de gouvernement radical
Dans de longues recommandations générales prises au titre de l’article 25 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, le Défenseur des droits postule le retour des enfants français de Syrie et dresse un état de la paralysie juridique dans laquelle se trouvent des femmes et leurs enfants détenus dans les camps.
La France ne propose plus de protection consulaire pleine et entière depuis la fermeture de son ambassade à Damas. Mais le Défenseur des droits rappelle le rapatriement de 17 jeunes enfants orphelins nés d’une mère française ou isolés au cours du printemps 2019 ce qui souligne la faisabilité de l’opération. D’ailleurs, la recommandation fait état que « le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères par le biais du centre de crise, avec le soutien du ministère de la Défense, dispose de la capacité opérationnelle de mettre fin aux atteintes prévues aux articles 3 et 5 de la CEDH28 ». Mais la priorité semble être les orphelins et non les familles.
En réponse à la recommandation, le Premier ministre indique le 14 juin 2019 qu’il ne partage pas l’avis du Défenseur des droits sur les obligations internationales et considère que l’État n’exerce pas « un contrôle effectif sur le territoire concerné »29.
Le gouvernement s’aligne sur la conviction du juge des référés du Conseil d’État. Il a, en effet, rendu quatre ordonnances identiques en date du 23 avril 201930 dans lesquelles il rejette, de manière catégorique et succincte, les référés formés en avançant son incompétence. Le Conseil d’État était saisi en appel car les demandes avaient déjà fait l’objet d’un rejet de la part du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
La courte argumentation du juge administratif peut surprendre au regard de la liste dense des demandes formulées par les requérants, à savoir notamment la saisine de la Cour européenne des droits de l’Homme pour avis sur la conformité de la théorie des actes de gouvernement à la CEDH et de l’invitation qui était faite au Conseil d’État à poser une question préjudicielle à la CJUE sur la conformité de ladite théorie aux dispositions de la charte des droits fondamentaux. Il est à noter que le juge administratif ne répond à aucune de ces demandes.
Le Conseil d’État, dans ses quatre ordonnances, répète fidèlement la formule suivante : « Les mesures ainsi demandées en vue d’un rapatriement, qui ne peut être rendu possible par la seule délivrance d’un titre leur permettant de franchir les frontières françaises, ainsi que cela a été demandé à l’audience, nécessiteraient l’engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger. Elles ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France. En conséquence, une juridiction n’est pas compétente pour en connaître ».
Autrement dit, le rapatriement n’est pas détachable « de la conduite des relations internationales » et échappe au contrôle juridictionnel. Cette absence de recours s’explique par une tradition selon laquelle l’activité diplomatique et les relations extérieures ne sont pas susceptibles de recours.
Les actes de gouvernement en matière de relations internationales sont divers31, mais ils s’inscrivent dans une tendance à la réduction de leur nombre, à l’instar des mesures d’ordre intérieur32. Toutefois, on retiendra ici aussi le caractère complexe attaché à la notion de « détachabilité »33. Ces ordonnances s’inscrivent, sans surprise, dans la jurisprudence classique du Conseil d’État en matière d’identification pragmatique de l’acte de gouvernement34.
Comme vu supra, la juridiction est le critère d’application de la CEDH. En se déclarant incompétent pour connaître de la demande de rapatriement, le Conseil d’État parvient habilement à défendre implicitement que la CEDH n’est pas invocable par les requérants, même si nous avons démontré que la question est plus difficile qu’elle n’y paraît35.
b) Le droit à un recours effectif très restreint
On admet aisément, au regard du contexte particulier lié au conflit armé syrien, que l’immunité attribuée par le juge administratif aux actes de gouvernement se justifie par la raison d’État qui présente un écho politique incontestable, mais s’explique également par les fonctions assurées par les auteurs de ces actes, qui ne sont pas de nature administrative mais plutôt de nature politique36.
Au-delà de la recherche d’une justification au recours à la théorie des actes de gouvernement en ce qui concerne les demandes de rapatriement des ressortissants français, les décisions du juge administratif conduisent à réduire considérablement les chances de succès pour les requérants et leurs enfants. Il est alors légitime de s’interroger sur la contrariété existant entre les actes de gouvernement appliqués aux rapatriements et la violation de l’article 13 de la CEDH consacré au droit à un recours effectif. Mais, nous avons souligné que le critère de la juridiction comme condition d’application de la CEDH a rapidement été avancé par le gouvernement pour réfuter toute responsabilité sur un territoire situé hors de son contrôle.
Par ailleurs, est remarquée l’absence d’argument du Conseil d’État en ce qui concerne les droits fondamentaux et les droits de l’enfant en particulier. Cet angle est très présent dans les moyens avancés à l’appui des requêtes par les demandeurs mais il ne parvient pas à contrebalancer la théorie des actes du gouvernement qui n’apporte ici aucune protection aux droits fondamentaux.
Les requérants ont, depuis le rejet de leurs référés, saisi la Cour européenne des droits de l’Homme qui pourra peut-être impulser une dynamique vers une plus grande adaptation ou une souplesse aux actes de gouvernement quand ceux-ci produisent des effets sur des droits aussi élémentaires que le droit à la vie.
Enfin, nous rejoindrons la proposition de Serge Slama sur un engagement de la responsabilité sans faute de l’État sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques pour indemniser le préjudice né de conventions internationales.
Nadia BEDDIAR
Documentaire sur le salafisme, visa d’exploitation et priorité à la liberté d’information sur la protection de l’enfance (CE, 5 avr. 2019, n° 417343, SARL Margo Cinéma)
La police du cinéma confiée au ministre chargé de la Culture et le contrôle juridictionnel opéré sur les mesures de police prises sont régulièrement critiqués en tant qu’ils témoignent, sous couvert de la protection de l’enfance et de la jeunesse, d’une censure de la liberté artistique et d’une résurgence des considérations de moralité37. L’arrêt SARL Margo Cinéma38, le premier rendu par le Conseil d’État à propos d’un film documentaire, semble au contraire dessiner un nouvel équilibre entre d’une part la protection de l’enfance et de la jeunesse et d’autre part la liberté d’information, en précisant de manière inédite l’application du pouvoir de police spéciale aux œuvres documentaires.
Était en cause en l’espèce l’interdiction à tout mineur de la représentation du film documentaire Salafistes, réalisé par François Margolin et Lemine Ould M. Salem, et qui vise, au moyen de scènes d’une violence parfois insoutenable, à informer sur la réalité du terrorisme islamiste et à dénoncer les exactions commises. Cette interdiction de représentation, au nom de la protection de l’enfance et de la jeunesse, posait deux difficultés : l’objectif d’information et de dénonciation manquait son but à l’égard des mineurs les plus âgés, dont on sait pourtant combien ils sont les premières cibles de la propagande djihadiste ; il était en partie mis en échec à l’égard des adultes, compte tenu des difficultés d’exploitation en salles engendrées par une telle mesure de police.
L’appréciation par l’autorité de police, sous le contrôle du juge, des scènes de violence contenues dans le documentaire faisait pourtant incontestablement débat39. Dans l’arrêt SARL Margo Cinéma, le Conseil d’État confirme la méthode d’appréciation du caractère violent des scènes filmées qui doit se faire au regard de l’objectif de protection de l’enfance et de la jeunesse. Il la module toutefois en matière de films documentaires en précisant que l’appréciation doit tenir compte de la nécessité de garantir le respect de la liberté d’information. Le Conseil d’État affirme ainsi que le pouvoir de police spéciale du ministre de la Culture doit prendre en considération, outre la protection de la sensibilité des mineurs, leur droit à l’information, se faisant ainsi plus largement le garant de leurs intérêts.
1°) La police spéciale du cinéma fondée sur les nécessités de la protection de l’enfance et de la jeunesse
La police du cinéma, définie à l’article L. 211-1 du Code du cinéma et de l’image animée40, est une police résolument axée sur la protection de l’enfance et de la jeunesse, laquelle en constitue à la fois le fondement et la limite. L’absence de référence globale aux mineurs et la préférence pour la distinction, au sein de la minorité, entre l’enfance d’une part et la jeunesse d’autre part traduisent une logique de gradation dans la protection en fonction de l’âge des mineurs. Il s’agit bien de protéger les enfants et les jeunes compte tenu de leur sensibilité aux images, de leur vulnérabilité et de leur insuffisante maturation psychologique qui ne leur donne pas la même capacité d’analyse, de compréhension et de mise à distance. La stricte adaptation de la mesure de police spéciale aux exigences de protection de l’enfance et de la jeunesse répond à cet égard à la traditionnelle exigence de proportionnalité des mesures de police.
L’ensemble des restrictions, prévues à l’article R. 211-12 du Code du cinéma et de l’image animée, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dont peut être assortie la délivrance d’un visa d’exploitation d’une œuvre ou d’un document cinématographique s’articule autour d’un critère : celui de la présence de scènes de sexe non simulées ou de très grande violence. Si l’œuvre ou le document comportent de telles scènes, il doit faire l’objet d’une interdiction aux mineurs de 18 ans, soit sous la forme d’une interdiction avec classement X, soit sous la forme d’une interdiction simple. Le Conseil d’État précise ici la distinction entre ces deux interdictions au regard du critère des scènes de très grande violence : la première s’impose lorsque le film, « pris dans son ensemble, revêt un caractère d’incitation à la violence », la seconde suffit lorsque le film ne présente pas un tel caractère compte tenu de la manière dont il est filmé et de la nature du thème traité. En revanche, en l’absence de scènes de très grande violence, le visa d’exploitation peut être assorti, en fonction de l’existence de scènes de violence, de leur nombre, de leur nature, ou encore de leur impact, tantôt d’une interdiction aux moins de 16 ans, tantôt d’une interdiction aux moins de 12 ans ou tantôt encore d’une autorisation de la représentation pour tous publics.
Le Conseil d’État reprend dans l’espèce commentée la grille de lecture, qu’il avait lui-même dégagée dans l’arrêt Association Promouvoir en date du 1er juin 201541 pour pallier le silence du code sur les critères d’appréciation des scènes de violence. Il rappelle ainsi que si l’œuvre ou le document comporte des scènes violentes, le ministre chargé de la Culture, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, doit, pour déterminer s’il s’agit ou non de scènes « de très grande violence », prendre en considération trois critères : d’abord la manière dont les scènes sont filmées, ensuite les effets qu’elles sont destinées à produire sur les spectateurs, notamment de nature à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser, et enfin toute caractéristique permettant d’apprécier la mise à distance de la violence et d’en relativiser l’impact sur la jeunesse. C’est par application de ces critères que le Conseil d’État avait confirmé l’interdiction aux mineurs de 18 ans des films Saw 3D Chapitre final42 et Quand l’embryon part braconner43, qui comportaient l’un et l’autre de nombreuses scènes de torture et de barbarie, d’une grande violence physique et psychologique, filmées avec réalisme et complaisance. La représentation de la violence étant de nature à heurter la sensibilité des mineurs, les scènes avaient été qualifiées de très grande violence justifiant les mesures de police ministérielles.
Lorsque l’œuvre cinématographique est un documentaire, l’appréciation ne peut toutefois reposer sur ce seul objectif de protection de l’enfance et de la jeunesse mais doit au contraire être modérée par le nécessaire respect de la liberté d’information.
2°) La police spéciale du cinéma garante du respect de la liberté d’information
Les films documentaires se distinguent fondamentalement des œuvres de fiction par leur objet. Ils visent à décrire et témoigner de la réalité des situations et, partant, à l’établissement et à la diffusion de connaissances. Ils « participent [dès lors] moins de la “simple” liberté artistique que de l’exercice d’une liberté encore plus fondamentale, la liberté d’information »44. Protégée notamment par les articles 11 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et 10 de la convention européenne des droits de l’Homme, celle-ci doit donc être prise en compte, dans l’appréciation de la violence des scènes contenues dans une œuvre documentaire et intégrée au contrôle de proportionnalité opéré par le juge sur les mesures de police. C’est la première fois que le Conseil d’État fait référence en matière de police du cinéma à la liberté d’information, qu’il extrait de la liberté d’expression pour la faire bénéficier d’une protection particulière45. Sont reconnus la liberté d’informer les mineurs comme le droit des mineurs de recevoir des informations.
Le Conseil d’État modère ainsi son appréciation de la violence des scènes contenues dans le film Salafistes. Certes, ce documentaire comporte des scènes réelles montrant des assassinats, tortures et amputations, d’ailleurs pour partie issues de films de propagande des organisations Daesh et AQMI46, et reproduit des propos de djihadistes légitimant leurs actions sans aucun commentaire critique. Mais le Conseil d’État, faisant application de la grille de lecture qu’il a rappelée, relève que les scènes s’insèrent de manière cohérente dans le documentaire, « dont l’objet est d’informer le public sur la réalité de la violence salafiste en confrontant les discours tenus par des personnes promouvant cette idéologie aux actes de violence commis par des personnes et groupes s’en réclamant ». Il s’attache également à l’avertissement en début de film et à la dédicace finale aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, de nature tous deux à éclairer les spectateurs mineurs de l’objectif d’information et de dénonciation poursuivi par les auteurs du documentaire. La violence n’apparaît dans ces conditions ni présentée sous un jour favorable, ni banalisée. « Compte tenu de l’objet du film documentaire et du traitement de la violence qu’il retient, et eu égard à la nécessité de garantir le respect de la liberté d’information », le Conseil d’État en conclut que le film ne comporte pas de scènes de très grande violence de nature à justifier une interdiction aux mineurs de 18 ans, et laisse entrevoir par là même la possibilité d’en autoriser la représentation pour les mineurs les plus âgés, en capacité de comprendre la double lecture entre ce qui est dit ou montré dans le documentaire et ce qu’on veut lui faire dire, comme en mesure de prendre de la distance par rapport aux images et propos contenus dans le film47.
La distinction entre œuvres documentaires et œuvres de fiction peut pourtant en pratique ne pas être toujours évidente48. En effet, les premières peuvent recourir pour les besoins du propos à des acteurs et à des scènes de reconstitution ; les secondes peuvent, sous couvert de fiction, recourir aux images réelles et poursuivre un objectif d’information et de dénonciation. Le choix du mode narratif – documentaire ou fiction – relève de la liberté du réalisateur et réserver la garantie du respect de la liberté d’information aux seuls documentaires, au détriment des fictions qui contribuent pourtant à l’établissement et à la diffusion des connaissances ne semble pas convaincant. En réalité, s’agissant des œuvres de fiction, l’objectif d’information et de dénonciation n’est pas totalement absent de l’appréciation qui doit être portée par le ministre, sous le contrôle du juge, sur les scènes de violence : l’intention des auteurs peut contribuer à justifier la présence des scènes violentes et à en diminuer l’impact. Ainsi dans un arrêt récent Juristes pour l’enfance49, le Conseil d’État a-t-il admis que le film Sausage Party n’était pas de nature à heurter la sensibilité d’un public âgé de plus de 12 ans, après avoir relevé notamment que les scènes montrant des aliments consommant de l’alcool et de la drogue et se livrant à des pratiques sexuelles s’inséraient « de manière cohérente dans la trame narrative du film dont le propos est de dénoncer, dans un esprit subversif, la société de consommation et de promouvoir l’hédonisme ».
L’arrêt SARL Margo Cinéma contribue ainsi à un subtil équilibre entre d’une part l’objectif de protection de l’enfance et de la jeunesse et d’autre part la liberté d’information des mineurs. L’intérêt du mineur ne peut se réduire à une simple protection contre la violence mais implique au contraire d’être tenu informé, dans le respect de ses capacités et de sa sensibilité, de la violence qui l’entoure pour être en mesure de s’en prémunir et d’y résister50. Le mineur est en effet une personne « en construction, qu’il convient de protéger autant que possible, sans entraver le processus d’accès à l’âge adulte »51.
Anne JENNEQUIN
(À suivre)
B – L’intérêt supérieur de l’enfant délinquant : primauté des impératifs sécuritaires et indemnitaires
II – L’intérêt supérieur de l’enfant victime : une considération primordiale
A – L’interdiction des violences éducatives ordinaires : une anticipation ambiguë de l’adoption de la réforme par le juge pénal
B – La modularité renforcée des mesures judiciaires de protection de l’enfant
C – L’enfant témoin de violences contre l’un de ses parents : un mauvais traitement au sens de l’article 3 de la convention EDH
D – L’usage non contractuel de l’image de l’enfant, victime d’une atteinte à son droit à l’image
Notes de bas de pages
-
1.
Allemagne, Argentine, Brésil et Turquie.
-
2.
Saisine directe rendu possible par le 3e protocole additionnel à la CIDE, ratifié par la France le 7 janvier 2016.
-
3.
Commission nationale consultative des droits de l’Homme.
-
4.
Commentaire par Beddiar N.
-
5.
CE, 5 avr. 2019, n° 417343, commentaire par Jennequin A.
-
6.
Commentaire par Pomart C.
-
7.
Commentaire par Beddiar N.
-
8.
L. n° 2018-703, 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dites « loi Schiappa » – thème déjà abordé dans les précédentes chroniques (LPA 29 juill. 2019, n° 146u7, p. 8, p. 16 ; LPA 27 sept. 2018, n° 139f0, p. 3).
-
9.
Puech M., Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, 1976, Cujas, n° 80.
-
10.
Cass. crim., 15 janv. 2019, n° 17-87342, commentaire par Lucidarme A.
-
11.
Cass. 1re civ., avis, 19 juin 2019, nos 19-70007 et 19-70008, commentaire par Autem D.
-
12.
Commentaire par Niemiec A.
-
13.
Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, nos 18-25313 et 18-25894, commentaire par Niemiec A.
-
14.
CEDH, 12 nov. 2019, n° 37735/09, A. c/ Russie, commentaire par Le Doujet-Thomas F.
-
15.
Texte n° 403, « Petite loi ».
-
16.
CA Paris, 19 mars 2019, n° 17/15450, commentaire par Dupuis M.
-
17.
CNCDH, avis commenté, p. 7.
-
18.
Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice.
-
19.
Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n° 02-20613.
-
20.
CE, 22 sept. 1997, n° 161364.
-
21.
Tavernier J., « Compétence ratione loci : extraterritorialité et recevabilité », in Dourneau-Josette P. (dir.), Quel filtrage des requêtes par la Cour européenne des droits de l’Homme ?, 2011, Conseil de l’Europe, p. 105.
-
22.
Lagrange E., « L’application de la Convention à des actes accomplis par les États membres en dehors du territoire national », RGDIP 2008, p. 524.
-
23.
Dupuy P.-M. et Kerbrat Y., Droit international public, 2018, Dalloz, p. 265, § 216-1.
-
24.
CEDH,16 nov. 2004, n° 31821/96, Issa et a. c/ Turquie ; CEDH, 8 juill. 2004, n° 48787/99, Ilascu et a. c/ Moldavie et Russie.
-
25.
CEDH, 7 juill. 2011, n° 27021/08, Al-Jedda c/ Royaume-Uni. Au sujet de la détention en Irak d’un citoyen irlandais ayant également la nationalité irakienne, par des soldats britanniques.
-
26.
Pichard M., « L’effectivité de la Convention internationale des droits de l’enfant : question(s) de méthode(s) », LPA 7 oct. 2010, p. 7.
-
27.
Mayaud Y., V° « Terrorisme et prévention », Rép. pén. Dalloz, févr. 2020, § 651.
-
28.
Défenseur des droits, déc. n° 2019-129, 22 mai 2019, relative à la rétention d’enfants français et de leurs mères dans les camps sous le contrôle des forces démocratiques syriennes au nord de la Syrie, § 79.
-
29.
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php ?lvl=notice_display&id=28974.
-
30.
CE, ord., 23 avr. 2019, nos 429668, 429669, 429674 et 429701.
-
31.
V. par ex. : CE, 29 sept. 1995, n° 171277, Assoc. Greenpeace ; CE, 30 déc. 2003, n° 255904 ; CE, 23 sept. 2002, nos 120437 et 120737.
-
32.
Nguyen Van T., « Le contrôle juridictionnel des mesures d’ordre intérieur », LPA 9 juin 1995, p. 16.
-
33.
Kdhir M., « La théorie de l’acte de gouvernement dans la jurisprudence du Conseil d’État relative aux relations internationales de la France à l’épreuve du droit international », JDI 2003 ; Guérard S., La notion de détachabilité en droit administratif français, thèse de doctorat en droit public, 1997, université Paris II.
-
34.
Saunier C., « La théorie des actes de gouvernement face aux droits fondamentaux », in Droit administratif, 2019, LexisNexis, p. 37-40.
-
35.
Slama S., « L’acte de gouvernement à l’épreuve du droit européen », AJDA 2019, p. 1644.
-
36.
Chapus R., « L’acte de gouvernement, monstre ou victime ? », D. 1958, p. 8.
-
37.
V. par ex. : Canedo M., « Le Conseil d’État, gardien de la moralité publique ? », RFDA 2000, p. 1282 ; Saulnier-Cassia E., « La protection de la jeunesse : limite à la liberté d’expression », RDP 2006, p. 401 ; Le Roy M., « Annulation du visa d’exploitation du film “SAW 3D” » : l’arrêt du Conseil d’État est-il plus effrayant que le film ? », AJDA 2015, p. 1599 ; Bugnon C., « La classification des œuvres cinématographiques : l’art de faire du juge un spectateur averti ? », RRJ 2006-2, p. 719 ; Bossis G. et Rom R., Droit du cinéma, 2004, LGDJ, Systèmes Droit, qui évoquent « la régulation morale de la liberté d’expression » (p. 153).
-
38.
CE, 5 avr. 2019, n° 417343, SARL Margo Cinéma : AJDA 2019, p. 1761, note Le Roy M. ; DA 2019, note Eveillard G. ; JCP A 2019, 2250, spéc. n° 36, note Otero C. ; JCP G 2019, 1070, spéc. n°42, chron. Eveillard G.
-
39.
La commission de classification des œuvres cinématographiques et à sa suite le ministre de la Culture et de la Communication avaient retenu la qualification de « scènes de très grande violence » au sens de l’article R. 211-12 du Code du cinéma et de l’image animée, justifiant la délivrance du visa d’exploitation assorti d’une interdiction de représentation aux mineurs de 18 ans. Saisi par la société de production SARL Margo Cinéma d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision du ministre, le tribunal administratif de Paris avait quant à lui conclu à l’absence de telles scènes et donc à l’illégalité d’une telle interdiction (TA Paris, 12 juill. 2016, n° 1601819/5-1, SARL Margo Cinéma). Mais le jugement allait être annulé par la cour administrative d’appel de Paris qui confirme la qualification ministérielle (CAA Paris, 14 nov. 2017, n° 16PA02615, ministre de la Culture et de la Communication c/ SARL Margo Cinéma).
-
40.
« La représentation cinématographique est subordonnée à l’obtention d’un visa d’exploitation délivré par le ministre chargé de la Culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine ».
-
41.
CE, sect., 1er juin 2015, n° 372057, Assoc. Promouvoir : Lebon p. 178 ; AJDA 2015, p. 1599, note Le Roy M. ; DA 2015 comm 65, obs. Quiriny B.
-
42.
CE, sect., 1er juin 2015, n° 372057, Assoc. Promouvoir : Lebon p. 178 ; AJDA 2015, p. 1599, note Le Roy M. ; DA 2015 comm 65, obs. Quiriny B.
-
43.
CE, 6 oct. 2018, n° 311017, Sté Cinéditions : AJDA 2009, p. 544, note Le Roy M.
-
44.
Eveillard G., « Chronique de droit administratif », JCP G 2019, 1070, spéc. n° 42.
-
45.
Le Roy M., « Visa d’exploitation : quand l’objectif d’information des mineurs et de dénonciation atténue la violence », AJDA 2019, p. 1761 ; Eveillard G., « L’application de la police du cinéma aux films documentaires », DA 2019, n° 7.
-
46.
Cet élément, relevé par le tribunal administratif comme participant à la dénonciation des exactions commises, relevé par la cour administrative d’appel comme établissant que le documentaire pouvait servir la propagande djihadiste, cristallisait les divergences d’appréciation des juges du fond. Il est pourtant passé sous silence par le Conseil d’État.
-
47.
Entre temps, le film documentaire Salafiste a obtenu par décision du ministre de la Culture et de la communication un visa d’exploitation assorti d’une interdiction aux moins de 16 ans.
-
48.
Eveillard G., « L’application de la police du cinéma aux films documentaires », DA 2019, n° 7.
-
49.
CE, 4 mars 2019, n° 417346, Juristes pour l’enfance : JCP A 2020, 2013, spéc. n° 3, chron. de la Morena F.
-
50.
Otero C., « Interdiction d’un film documentaire aux mineurs : la diffusion de connaissances l’emporte sur celle de violences », JCP A 2019, 2250, spéc. n° 36 : « S’opère, eu égard au contrôle de proportionnalité, un bilan coûts/avantages entre d’un côté la restriction qui est l’interdiction à un certain public avec pour visée la protection de la jeunesse et de l’autre la liberté d’information, le juge cherchant le point d’équilibre qui permet au mieux de les concilier. Ce point d’équilibre apparait ardu à trouver entre deux protections, celle de la jeunesse et celle de son information, c’est-à-dire entre la violence qui prohibe presque par nécessité l’accessibilité et la connaissance qui s’impose quasiment par exigence ».
-
51.
Cantie C., « Le visa d’exploitation de La Vie d’Adèle », Concl. sur CAA Paris, 8 déc. 2015, n° 14PA04253, Assoc. Promouvoir et sa. : RFDA 2016, p. 138.