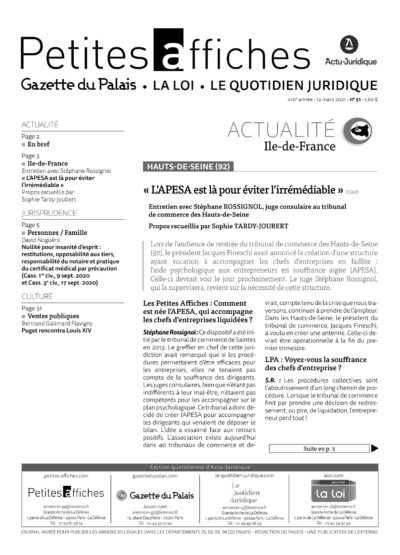Nullité pour insanité d’esprit : restitutions, opposabilité aux tiers, responsabilité du notaire et pratique du certificat médical par précaution
L’insanité d’esprit est une protection occasionnelle qui sanctionne par la nullité de droit de l’acte juridique l’absence de consentement. La charge de la preuve qui incombe au demandeur peut être rapportée par tous moyens, dont la présomption judiciaire. Le défendeur doit alors établir l’intervalle lucide. La nullité est néanmoins inopposable au tiers acquéreur de bonne foi. Si sa mauvaise foi n’est pas démontrée, le cocontractant doit restituer les fruits à compter de l’assignation en nullité de la vente. La responsabilité du notaire est susceptible d’être encourue lorsqu’il est confronté à la vulnérabilité d’un client. La sécurité juridique se discute avec la pratique du certificat médical contemporain de l’acte juridique.
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, no 18-26525
Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, no 19-15046
Alors que le 116e congrès des notaires de France sur les protections1 a voté à 74 %, le 8 octobre 2020, une proposition sur la « zone grise » dans laquelle le consentement peut prêter à discussion, deux affaires invitent à s’interroger sur la nullité pour insanité – d’esprit, est-il habituellement ajouté – ou, si l’on préfère, trouble mental ou absence/défaut de consentement – à distinguer de son intégrité – les vices du consentement étant ici non envisagés. Classiquement, l’insanité « s’entend de toutes les sortes d’affections physiques et mentales altérant le jugement et la faculté de discernement » de l’auteur de l’acte2. Il s’agit de troubles mentaux quelle que soit leur origine3. Il faut évidemment une certaine gravité du trouble4. Par ces deux arrêts inédits, mais tout particulièrement topiques et riches, l’insanité demeure dans l’actualité ! En 2020, on se trouve, en effet, dans un certain contexte pouvant, à l’occasion, traduire une forme de cantonnement de la sanction. Par exemple, la Cour de cassation a renvoyé aux règles de compétence dans un cas international pour ne pas se prononcer sur la nullité d’une procuration5. Elle a aussi refusé d’annuler une procédure pour adoption au motif de l’insanité6. Traduction d’une forme de vulnérabilité, l’insanité d’esprit retient l’attention depuis longtemps7.
Successivement, seront présentés les deux arrêts8. Dans le premier9, un vendeur (initial) a agi tant en son nom personnel qu’en qualité de mandataire de ses père, frère et sœur. Par acte notarié du 29 janvier 2008, il a vendu à une société civile immobilière (ci-après SCI), représentée par son gérant, un ensemble immobilier moyennant le prix de 460 000 €. Par acte sous seing privé du même jour, le gérant de la SCI, ès qualités, s’est engagé à revendre ce bien au mandataire/vendeur, à compter du 29 janvier 2013, pour un prix de 850 000 €. En contrepartie, le mandataire/vendeur s’engageait à verser une somme annuelle de 51 000 €, payable par mensualités, et déductible du prix de rachat convenu. Toujours à la même date, le gérant de la SCI, ès qualités, et le vendeur initial, agissant là en qualité de représentant d’une société, ont conclu un prêt à usage à titre gratuit, pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction. Puis, par acte sous seing privé du 2 mai 2008, ces mêmes parties ont conclu un acte par lequel le vendeur initial s’est engagé à rembourser la somme de 257 000 € mise à sa disposition par la SCI. Par la suite, la SCI a considéré que ses cocontractants avaient manqué à leurs obligations. Par acte authentique du 20 juin 2009, elle a décidé de vendre à une autre personne le château constituant l’ensemble immobilier moyennant un prix de 540 000 € (revente).
Le père du vendeur initial et son épouse ont indiqué avoir été victimes d’abus de faiblesse de la part d’un tiers. Ils ont soutenu avoir contracté sous l’empire d’un trouble mental ayant altéré leur consentement. Avec leurs enfants, ils ont assigné la SCI, la personne tiers acquéreur et le notaire. Ils ont sollicité l’annulation de la vente et des conventions passées les 29 janvier et 2 mai 2008, l’opposabilité de ces nullités au tiers acquéreur et la responsabilité du notaire pour indemnisation. La nullité recherchée des différents actes a été prononcée par arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Agen du 24 octobre 2018. L’inopposabilité de cette sanction au tiers acquéreur, qui était discutée, a été décidée comme la mise à l’écart de la responsabilité du notaire.
Dans le second arrêt10, par acte notarié du 29 septembre 2008, le propriétaire d’une maison d’habitation l’a vendue en viager à la personne acquéreur. 6 mois après, le 29 mars 2009, le vendeur a été placé sous sauvegarde de justice, puis sous tutelle par jugement du 30 juin 2009. Il est décédé en laissant un héritier. Celui-ci a assigné la nouvelle propriétaire en nullité de la vente en invoquant l’insanité d’esprit sur le fondement de l’article 414-1 du Code civil. La cour d’appel de Reims a déclaré la vente nulle par arrêt du 18 décembre 2018. Il était reproché aux juges d’avoir inversé la charge de la preuve en retenant la période pour caractériser le trouble mental et en écartant l’existence d’un intervalle lucide. Un moyen a été relevé d’office relatif à la restitution des fruits tirés de la mise en location de l’immeuble.
Dans un premier temps, nous examinerons la démonstration de l’insanité d’esprit au moment de l’acte litigieux (I). Consécutivement, dans un deuxième mouvement, il s’agira d’appréhender les suites du prononcé de la nullité pour trouble mental (II). Enfin, la troisième étape invitera à se prononcer sur la responsabilité du notaire (III), et, par extension, nous aborderons une des propositions du congrès de 2020.
I – La démonstration de l’insanité d’esprit au moment de l’acte litigieux
On distinguera la charge de la preuve de l’insanité et la liberté des moyens (A) du trompe-l’œil de l’intervalle lucide (B).
A – La charge de la preuve de l’insanité et la liberté des moyens
Le premier arrêt ne s’étend pas outre mesure sur la démonstration de l’absence de consentement au moment précis de l’acte11, instant décisif à bien identifier selon le type d’acte12, qui est l’exigence à respecter pour obtenir le jeu de la sanction pour défaut d’un élément essentiel de l’acte juridique13. Il est simplement évoqué la nullité prononcée en raison de l’insanité d’esprit du vendeur, sur le fondement de l’ancien article 489 du Code civil, c’est-à-dire dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. La solution est identique à la suite de cette réforme, en se reportant alors à l’article 414-1 du même code.
Un point n’est pas discuté devant les juges, concernant la pluralité de parties du côté de ceux sollicitant la nullité pour insanité. On mettra de côté l’allusion à l’abus de faiblesse, infraction de l’article 223-15-2 du Code pénal, qui peut, à certaines conditions, avoir des répercussions sur la validité d’un acte juridique14. Nous avons eu le loisir de traiter de l’hypothèse de plusieurs personnes, parties à un acte, dont l’une est atteinte d’insanité, spécialement pour le trouble mental d’un des deux emprunteurs, exception purement personnelle d’un codébiteur solidaire15. Dans le présent cadre, nous y renvoyons. Relevons que dans l’arrêt commenté, nul ne s’est attardé sur cette question. En fonction des données à disposition, il est difficile de savoir exactement quel était le rôle de chacun. Dont acte.
Le second arrêt est davantage explicite, qui débat ouvertement de la preuve. Il rappelle des règles bien acquises en la matière depuis fort longtemps16. Le moyen rejeté défendait que les juges ne pouvaient retenir « qu’entre juin et novembre 2008, [le vendeur] était frappé d’insanité, pour en déduire qu’il appartenait à [l’acquéreur] de démontrer qu’au jour de la vente litigieuse du 29 septembre 2008, [le vendeur] était lucide ».
L’arrêt indique que l’assignation était sur le fondement de l’article 414-1 du Code civil. Et le pourvoi de l’acheteuse s’appuyait, lui aussi, sur les articles 414-1 et 414-2. Eu égard à la date de l’acte, le 29 septembre 2008, antérieur au 1er janvier 2009, étaient plutôt applicables les anciens articles 489 et 489-1. Leur substance est néanmoins identique sur les points jugés. Le fondement juridique choisi était le bon – sous la réserve exprimée17 –, même si la numérotation des textes a évolué et n’était pas strictement applicable à l’espèce18.
Il s’agit de l’action propre de l’héritier19 sur le fondement de l’insanité20 après le décès de son auteur n’ayant pas, lui, amorcé auparavant la critique en justice (son action qui aurait débuté du vivant de l’auteur de l’acte n’est donc pas transmise et reprise)21. En une telle hypothèse, pour un acte à titre onéreux comme la vente – non pour les libéralités22 –, il est nécessaire de se trouver dans un des cas légaux alternatifs d’ouverture de l’action23, dont la fameuse preuve intrinsèque24. Telle était bien la situation, avec l’action et même l’ouverture effective de la tutelle avant la mort, peu important qu’elle ait été précédée par la sauvegarde de justice. La succession de régimes n’a pas d’incidence dès lors qu’une tutelle25 était bien ouverte avant le décès26.
On ignore la date exacte du décès, caviardée pour l’anonymat. Elle faisait courir la prescription quinquennale pour agir en nullité pour insanité27. Pour la période suspecte28, la tutelle ayant été prononcée, la règle de l’ancien article 503 du Code civil, applicable, pouvait avoir vocation à jouer, si ses conditions étaient réunies, comme le pourrait, après le 1er janvier 2009, celle aménagée de l’article 464 du même code – s’appliquant sans contexte à tout acte juridique, même unilatéral29, comme un testament30, dans la continuité du droit applicable avant la réforme de 2007. Il ne s’agit pas d’une mesure de protection qui rétroagit mais d’une autre façon de démontrer un défaut de consentement. En termes de procédure, le plaideur a clairement intérêt à invoquer les deux fondements, si jamais celui présenté principalement ne convainc pas le juge, non tenu de soulever l’autre d’office, et réciproquement31. Le fondement de l’action doit être explicite32. La voie de la période suspecte n’a visiblement pas été empruntée33. Observons simplement que le jeu de la présomption qui retient une période pour fixer le moment de l’insanité, rapproche, en fait, de l’époque expressément visée pour la période suspecte. Il faut donc relativiser la difficulté ou la facilité de preuve, selon le texte envisagé. Si les occurrences d’application peuvent concerner le majeur vivant, elles sont aussi vérifiables une fois l’auteur de l’acte décédé, car si le demandeur entre dans les cas d’ouverture limitatifs, il doit encore apporter la preuve de l’insanité au moment de l’acte34.
La décision souligne justement que la charge de la preuve incombe à celui qui attaque l’acte pour insanité, comme la loi l’indiquait hier et aujourd’hui encore. Elle le fait dans la réponse à la question sur le mode de preuve retenu. La troisième chambre civile de la Cour de cassation évoque également le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond – solution aussi classique35. Ceux-ci apprécient librement les preuves fournies et en déduisent ou non le trouble mental de l’instant de la manifestation du consentement afin de déterminer si son existence est bien réelle. Il ne faut pas une intelligence, une raison, une conscience, une lucidité, supérieures, mais, a minima, une ampoule basse consommation, allumée36. En effet, si on ne recherche pas forcément un soleil incandescent, une lumière tamisée doit néanmoins faire l’éclairage du vouloir, qui ne saurait être un faux reflet de lueur disparue, comme une étoile désormais éteinte malgré son apparence traînante dans les cieux.
S’agissant d’établir un fait juridique37, les moyens de preuve sont libres, comme des témoignages, par exemple. La preuve par tous moyens est accueillie du vivant de l’auteur de l’acte et après son décès, alors une fois les cas d’ouverture respectés38. Chacun devine que pour démontrer rétroactivement un état de santé à un moment donné, preuve difficile, les éléments médicaux auront un rôle important, lorsqu’on en dispose39. L’existence d’une mesure de protection juridique antérieure et/ou postérieure à l’acte litigieux n’est pas en elle-même décisive40. Elle reste un indice précieux qui permet de retenir, à l’occasion, l’insanité41. Toutefois, il n’y a aucun automatisme, d’autant plus que la jurisprudence le rappelle, comme elle souligne que la cause de l’altération des facultés personnelles, qui peut justifier, avec d’autres données, l’ouverture d’une mesure de protection juridique, est à distinguer de l’insanité42. C’est peut-être ce que tentait, indirectement, de suggérer le pourvoi, en vain, en analysant un des certificats médicaux sur lesquels s’est appuyé le juge pour retenir la présomption43.
Les présomptions du fait de l’homme ou judiciaires sont accueillies44. Traitant de la protection occasionnelle ou inorganisée, Carbonnier indiquait que, rigoureusement, il ne pouvait suffire d’invoquer « un état habituel de démence », tout en faisant état d’une « pratique accommodante » introduite en ce sens45, à appliquer avec mesure46. Il ne s’agit aucunement d’un renversement du fardeau de la preuve mais du déplacement de son objet. Si celui qui supporte la charge de la preuve ne satisfait pas à cette démonstration, certes allégée, il succombe assurément. Il est parfois évoqué la preuve de l’insanité d’esprit habituelle ou l’état habituel d’insanité47.
Sans le ciseler, la Cour reprend à ce propos un attendu de principe classique, dont elle s’inspire pour l’application faite à l’espèce, en approuvant « la cour d’appel [qui a] déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que l’état d’insanité d’esprit existant à la fois dans la période immédiatement antérieure et48 dans la période immédiatement postérieure à l’acte en cause, il revenait à la défenderesse à l’action en nullité d’établir l’existence d’un intervalle de lucidité de son auteur au moment précis où l’acte a été passé ». On comprend que, sans pouvoir être totalement écartée, la présomption admise49 peut perdre de sa force, dans tel ou tel cas, lorsque le constat du fait objectif se situe seulement avant ou après l’acte critiqué. Il faudra alors des circonstances particulières afin de retenir la nullité. En toute hypothèse, lorsque les juges du fond sont saisis de conclusions dans le sens de la présomption, ils doivent motiver leur réponse50.
Le pourvoi tentait pourtant de neutraliser la présomption de différentes manières. Le débat judiciaire exprime les arguments que chacun met en avant au soutien de la lucidité présente ou de sa disparition. L’acheteuse cherchait à rompre la chaîne temporelle en affirmant que les juges avaient constaté que le vendeur était lucide lorsqu’il avait conclu une cession avec des époux le 8 septembre 2008, soit juste après l’acte attaqué et avant le certificat négatif sur l’aptitude51.
Il est intéressant de relever les éléments à partir desquels les juges du fait forgent leur conviction. En l’occurrence, il est relevé que la « cour d’appel a souverainement retenu que deux certificats médicaux, établis, pour le premier, 3 mois avant la vente litigieuse et, pour le second, 2 mois après, montraient que [le vendeur] était déjà atteint, pendant toute la période de juin à novembre 2018, de troubles prédémentiels ou démentiels de nature à altérer sa faculté de gérer ses biens ». Il y a une relative fraîcheur des certificats entourant la vente litigieuse, qui est exprimée en mois. Les constatations peuvent varier. L’objectif reste de caractériser l’inaptitude de fait à comprendre ce que l’on fait et la portée de ce que l’on décide. La référence à la gestion des biens pourrait laisser croire qu’il y aurait une confusion avec la cause de l’ouverture d’une mesure judiciaire. En réalité, il ne nous semble pas que tel est le cas. De façon certes elliptique, mais certaine, la Cour retient l’absence de consentement malgré son expression qui fut manifestée, véritable coquille vide, en droit. L’apparence de consentement valable est détruite. La Cour montre le prolongement de l’état commencé antérieurement à l’acte, jugé suffisamment grave lors de l’acte attaqué. Si elle n’y revient pas explicitement, la Cour aurait pu ajouter que cet état a ensuite conduit, dans le semestre, à la mise en place de mesures, dont la sauvegarde de justice, suivie elle-même dans le trimestre d’une tutelle, autre indice complémentaire.
La Cour laisse entendre que le défendeur à l’action en nullité peut encore repousser celle-ci, non en montrant que l’acte était utile à l’insane et exempt de lésion ou qu’il lui a profité52, mais par l’intervalle lucide.
B – Le trompe-l’œil de l’intervalle lucide
Après une étude du contentieux sur plusieurs années, qui ne nous paraît pas démentie depuis53, nous avons pu considérer que l’exception de l’intervalle lucide n’était que de façade54. Il s’agit d’une affirmation mécanique, souvent reprise par les auteurs, sans portée pratique.
En réalité, il faut bien comprendre la situation. Une fois majeur, partant capable en droit, le sujet de droit est « présumé » émettre un consentement valable. Il n’a pas à démontrer, pour chaque acte, que son consentement existait bien. Mais, la présomption étudiée permet de contredire cette situation ordinaire. Le juge s’est laissé convaincre par les preuves fournies que le consentement n’existe pas parce qu’il a été exprimé dans une période de temps où l’on se trouve dans un continuum de l’altération des facultés cognitives. Il y a pu avoir des hauts et des bas. Mais, la preuve judiciaire est vraisemblance, non une vérité scientifique – à supposer celle-ci dégagée de tout relativisme. Pour l’heure, la technologie n’enregistre pas fidèlement, en permanence, les variations de nos esprits pour en conserver trace authentique, partant preuve – le moyen disponible ne devrait pas forcément faire la permission légale. Habitué à devoir appréhender des faits psychologiques55, le juge fait comme si l’absence de consentement était permanente. Pour cela, il prend des éléments objectifs, connus, dont il tire une conséquence, elle, inconnue : l’état de la conscience et de la volonté au moment du consentement déclic, conception française qui ne retient pas une construction par étapes.
Aussi, lorsque le juge est persuadé de sa déduction, ce n’est que pour la forme, et par une répétition quasi pavlovienne d’une formule prétorienne, qu’il rappelle la possibilité, qui devient toute théorique, de démontrer, en fait, l’intervalle lucide. Si jamais il admettait qu’un tel intervalle puisse exister dans le cas examiné, cela ébranlerait en amont la présomption sur laquelle il s’appuie pour retenir l’insanité56. La tentative de convaincre le juge aura échoué57. C’est pourquoi lorsque le juge rappelle la charge de la preuve58, ou le moment précis (sa date) de l’acte pour établir l’insanité59, voire aussi le pouvoir souverain d’appréciation en complément60, il écarte, en général61, la nullité pour trouble mental, tandis que lorsqu’il évoque la démonstration incombant au défendeur de l’intervalle lucide, il accueille systématiquement cette sanction sur ce fondement.
L’affaire en est une illustration parlante. Le pourvoi avançait, justement dans le principe, « que l’intervalle de lucidité peut être prouvé par tous moyens »62. Il cherchait ensuite à satisfaire la démonstration exigée en se prévalant de l’intervention de l’officier public et ministériel qui, dans cette optique, était un élément fort pour dénier l’insanité. Est reproché un manque de base légale à l’arrêt d’appel qui a statué « en énonçant que, par principe, la présence du notaire n’était pas une garantie suffisante pour établir la lucidité du vendeur, sans rechercher si, dans l’hypothèse où [le vendeur] avait contracté sous l’empire du syndrome prédémentiel relevé par le docteur S. dans le certificat médical du 10 juin 2008, le notaire ne l’aurait pas remarqué ». C’était sous-entendre qu’un notaire constatant des troubles n’aurait pas manqué de refuser d’instrumenter. A contrario, sa mission accomplie serait le signe d’une situation normale quant au consentement des clients. C’est un peu simpliste. On verra que les troubles peuvent exister, justifiant la nullité, sans nécessairement engager la responsabilité du notaire et, surtout, qu’en cette matière, celui-ci doit être classé, juridiquement, comme un témoin lambda. La confiance à accorder est susceptible de varier. Il demeure que la Cour décide que la cour d’appel « n’était pas tenue de procéder à une recherche sur le rôle du notaire que ses constatations rendaient inopérante ». Implicitement, on peut considérer que la Cour laisse au notaire sa place de simple témoin, non de certificateur officiel de l’état des facultés mentales d’une partie à un acte authentique.
Par parenthèse, le pourvoi critiquait encore la motivation d’appel relative au fait qu’un notaire d’un département voisin avait instrumenté à la différence de ce qui était advenu pour l’acte passé avec des époux dans cette même période63. L’idée était d’attiser la défiance à partir de cette circonstance pouvant trahir le fait que le notaire habituel n’aurait peut-être pas agi comme celui sollicité, qui a peut-être été moins regardant, ou moins au courant de la situation exacte. Mais la Cour de cassation décide qu’il est possible de retenir l’insanité « abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs au lieu d’établissement de l’acte de vente ». Dans les décisions, notons néanmoins que le changement de notaire habituel, ou le choix d’un autre officier plus accueillant après qu’un premier a pourtant refusé d’instrumenter pour le même acte, est susceptible d’éveiller l’attention des juges.
Ayant rappelé le principe de la charge de la preuve de l’intervalle lucide, la Cour répond au moyen, en confortant la nullité de la vente en viager : l’acheteuse « ne rapportait pas la preuve que, le 28 septembre 2008, date de signature de l’acte de vente de sa maison en viager, [le vendeur] était lucide et n’était la proie d’aucun trouble affectant la pleine conscience de ses intérêts ».

II – Les suites du prononcé de la nullité pour trouble mental
Les deux décisions sous analyse apportent un éclairage, l’une sur l’opposabilité au tiers acquéreur de la nullité et le jeu de l’apparence (A), l’autre sur la restitution après nullité (B).
A – L’opposabilité au tiers acquéreur de la nullité et le jeu de l’apparence
Pour l’insanité, la nullité de protection, qui a son titulaire64, est relative65. Pour celui qui subit la nullité de l’acte, et qui voudrait la paralyser, il serait vain d’invoquer qu’il a cru à l’apparence d’aptitude ou à la capacité de fait de celui avec qui il traitait, serait-il par ailleurs capable en droit. Il ne saurait mettre en avant sa bonne foi, sa croyance en un consentement valable de celui qui s’est avéré insane lors de l’acte. À l’inverse de la période suspecte qui exige la condition de notoriété de l’inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération des facultés personnelles, l’action pour insanité s’en dispense, comme de la connaissance personnelle du partenaire. Pas davantage, pour sauver l’acte, il ne pourrait être argué de son équilibre, par exemple. Il n’y a pas à prouver un préjudice pour solliciter la sanction. La nullité est de droit au sens où ses conditions étant réunies, le juge saisi est tenu de la prononcer, sans pouvoir d’appréciation comme c’est le cas dans une nullité facultative où une telle marge existe.
Différente est la situation du tiers acquéreur, c’est-à-dire de la personne qui tient ses droits de celui, acquéreur originaire, qui a, lui, traité directement avec la personne insane. Il s’agit d’un acquéreur ayant contracté avec une personne – ayant ou non des droits sur une chose – qui se trouve en conflit avec le titulaire de droits antérieurs sur cette chose, comme le vendeur ayant obtenu la nullité de la vente, rétabli dans sa situation grâce à la rétroactivité. En l’espèce, il s’agissait d’envisager la situation de la cocontractante de la SCI, ayant fait l’acquisition du château, immeuble initialement vendu sous l’empire d’un trouble mental des membres du couple de parents parmi les vendeurs de la famille. Les juges agenais ont retenu que l’acheteuse en second temps était un tiers de bonne foi à l’acte du 29 janvier 2008, « ayant agi sous l’empire d’une erreur commune ». Par conséquent, ils lui ont déclaré inopposable la nullité de cet acte. A été confirmée la validité de l’acte notarié du 20 juin 2009, par lequel elle avait réalisé son acquisition.
Le premier moyen du pourvoi des consorts vendeurs initiaux a cherché, sans succès, à étendre les effets de la nullité aux rapports de la SCI avec le tiers acquéreur. En ce sens, il a été défendu « que ni l’erreur commune ni l’apparence ne peuvent faire obstacle aux conséquences, vis-à-vis des tiers sous-acquéreurs, même de bonne foi, de la nullité édictée par l’article 489 du Code civil », soit celle pour trouble mental. La violation de ce texte était défendue, avec celle de l’article 544 du même code, sur le droit de propriété, critique vouée à l’échec face à la théorie invoquée66. Le raisonnement heurtait de front la théorie de l’apparence privilégiée par la cour d’appel, dans son arrêt confirmatif sur ce point. Cette dernière a préféré la protection du tiers.
Les tiers peuvent invoquer l’inopposabilité d’un acte ou d’une situation juridique. Distincte de la nullité, l’inopposabilité, au sens strict, aboutit, pour certaines raisons, à une inefficience de l’acte inopposable – possiblement valable et efficace entre les parties – au profit de certaines personnes qui sont fondées à l’ignorer ou à en faire écarter les effets. Ici, plus qu’une indifférence à l’acte litigieux, c’est la sanction de cet acte qui pourra être occultée au bénéfice du tiers acquéreur sur le fondement de l’apparence.
La Cour de cassation se prononce sur le jeu de l’apparence dans ces circonstances rappelées. Elle prend clairement position par un attendu de principe explicite, qui a vocation à être transposé aux nouveaux textes sur la sanction de l’insanité après la réforme de 2007 : « en application de la théorie de l’apparence, la nullité d’un acte de vente est sans influence sur la validité de l’aliénation consentie à un tiers sous-acquéreur de bonne foi, qui a agi sous l’empire d’une erreur commune, y compris lorsque cette nullité a été prononcée en raison de l’insanité du vendeur, sur le fondement de l’article 489 du Code civil » (anc.). On peut regretter la diffusion discrète, par un arrêt inédit, de cette règle importante énoncée si fermement.
Error communis facit juris. L’erreur commune fait le droit. Une croyance commune provoque des conséquences juridiques pourtant contraires au droit. Les tiers de bonne foi qui agissent sous l’empire de l’erreur commune ne tiennent leur droit ni du propriétaire apparent ni du propriétaire véritable mais en sont investis par l’effet de la loi. Le vice affectant le titre du propriétaire apparent est sans influence sur la validité du titre du tiers, dès lors que le vice est demeuré ignoré de tous67. Dans notre hypothèse, l’acquisition est jugée valable même si celui se présentant comme propriétaire tient son titre d’un acte juridique entaché de nullité pour cause d’insanité de son vendeur. Le tiers acquéreur tient en effet sa situation d’une personne qui a les apparences d’un propriétaire, dont il a cru légitimement qu’il l’était. Le véritable propriétaire n’a alors plus la possibilité de revendiquer son bien entre les mains d’un tiers.
Le résultat est d’empêcher la remise en cause des actes successifs portant sur le même bien, en raison de la nullité affectant la première aliénation de la chaîne. Certains y verront un progrès indéniable pour la sécurité juridique, celle des tiers. On pourrait y voir le sacrifice de la personne vulnérable. La solution dégagée ici pour les héritiers de l’insane ne saurait être cantonnée à cette hypothèse, qui peut déjà choquer, car ces personnes continuent la personne du défunt68 qui a passé un acte invalide. La généralité de l’attendu dégagé montre, si besoin, la large portée de la règle adoptée, qui concerne au premier chef l’auteur vivant de l’acte qui serait insane. Le tiers acquéreur de son cocontractant pourrait lui opposer l’erreur commune.
La nullité est neutralisée s’agissant d’une restitution en nature du bien objet de la vente. Il faut distinguer cette situation des rapports de l’insane ou de ses héritiers d’avec le cocontractant initial, le vendeur au tiers acquéreur. En effet, la nullité reste opposable au cocontractant direct qui s’est ensuite séparé du bien. Celui qui a pu être perçu comme un propriétaire apparent par des tiers ne l’est pas en réalité. Aussi, il doit restituer au véritable propriétaire la valeur du bien. En cas de mauvaise foi, il devra également les fruits. Encore faut-il qu’il soit solvable, en fait, pour effectuer un tel paiement. La revendication du bien elle-même apporte de ce point de vue davantage de sécurité si elle est accueillie. En outre, parfois, il ne faut pas négliger les liens affectifs de l’insane avec la chose, qui ne peuvent être retrouvés que par la récupération en nature.
Certes, la condition posée est la bonne foi du tiers acquéreur. Présumée69, elle sera fréquemment acquise lorsque celui-ci n’a aucun lien avec l’insane, ou avec quelqu’un de son entourage, lui permettant de soupçonner la cause de nullité de l’acte qu’est le trouble mental, lors de l’acte dont il tire sa situation. Aussi, au moment de l’acquisition, il pourra croire tenir la chose du véritable propriétaire, partant être de bonne foi.
La théorie mobilisée ne saurait s’étendre à un acte à titre gratuit70, ce qui offre une protection aux personnes vulnérables, liée à la catégorie des actes. Le tiers acquéreur, qui n’a rien déboursé, ne perd rien dans un tel cas de figure – sinon une espérance –, et le réel propriétaire mérite protection, serait-ce à travers ses héritiers. Seuls les actes à titre onéreux sont concernés. Il faudra néanmoins faire attention aux sommes déclarées comme étant officiellement payées, mais, en fait détournées de la poche de leur créancier vulnérable par un moyen discret ou un autre. La quittance délivrée par le créancier n’empêche pas, à l’abri des regards, le retour, au profit du débiteur, de l’argent apparemment versé par lui. La vente entre sans conteste dans la catégorie concernée par la théorie de l’apparence.
La solution consacrée par l’arrêt pourrait-elle susciter des comportements visant à contourner, au moins en fait, les effets de la nullité ? Quelqu’un au fait de la faiblesse d’autrui, pourrait le circonvenir habilement, afin d’arracher un acte juridique et, dans la foulée, s’empresser de liquider le produit de son action auprès d’un tiers, devenu inatteignable grâce à la théorie de l’apparence. Il faudrait supposer un montage avec ces manœuvres, dans un esprit de fraude. Le tiers acquéreur serait complice – voire commanditaire – de l’acheteur initial (ou de paille) – rémunéré de façon occulte pour ce « service » – qui, lui-même, devrait s’arranger pour organiser son insolvabilité en cas de recours de l’insane ou de ses héritiers. Il faut espérer qu’un tel risque reste marginal. Les faits peuvent néanmoins démontrer qu’il ne s’agit pas toujours d’une hypothèse d’école, surtout quand le jeu en vaut la chandelle…
En cas de soupçon, ou par simple précaution sage, une parade pour empêcher la mise en œuvre de la théorie de l’apparence est de rendre les tiers acquéreurs potentiels de mauvaise foi, en leur signifiant que l’acte dont leur cocontractant tient ses droits est menacé de nullité pour insanité. L’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception suppose cependant de s’apercevoir de l’insanité et de réagir pour entreprendre la critique de l’acte litigieux. Il exige encore une information sur les opérations envisagées par le cocontractant de l’insane, qui sera souvent inaccessible. De plus, cette voie impose une réaction rapide qui sera rarement possible pour la population vulnérable concernée.
Qu’en serait-il d’une procuration délivrée à une personne par l’insane, qui permettrait ultérieurement la vente de ses biens ? Lorsqu’un mandat est annulé pour insanité du mandant, la nullité entraîne, en cascade, la remise en cause des actes passés par le mandataire en vertu de cet acte effacé, son pouvoir étant juridiquement inexistant. Les tiers seraient-ils fondés à se prévaloir de l’apparence de pouvoir ? Il ne s’agit pas d’un doute sur l’étendue des pouvoirs du représentant conventionnel, à l’occasion d’un acte projeté, ce qui peut conduire à interroger le représenté, hypothèse traitée par l’article 1158 du Code civil, depuis la réforme de 2016, qui a introduit une théorie générale de la représentation71. L’existence même du pouvoir de représenter est en cause. Un rapprochement peut nous inspirer. L’article 1156 du Code civil précise que l’acte accompli par un représentant sans pouvoir (au sens, a priori, du défaut total d’investiture) est inopposable au représenté, « sauf si le tiers cocontractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté »72. Ces dernières illustrations, qui envisagent un représenté capable et apte à défendre ses intérêts, ne sont pas pertinentes dans notre situation, ni, plus largement, pour les majeurs protégés73, peut-on penser. Elles montrent surtout qu’il faut dépasser le seul stade d’une faute du représenté pour retenir éventuellement la théorie de l’apparence appliquée aux pouvoirs confiés. Celui qui traite avec le représentant du représenté insane pourrait être tenté d’invoquer la théorie de l’apparence à son profit. On voit que la brèche de protection est possible, selon telles ou telles modalités de recueil d’une procuration, parfois arrachée à une personne vulnérable, plus que consentie régulièrement74. Il resterait la responsabilité tant du mandataire – à le supposer conscient d’un pouvoir fragile, néanmoins exercé – que, éventuellement, celle du notaire selon la nature de la procuration (notariée) ou/et les circonstances de son utilisation.
La solution de l’arrêt est originale en comparaison de celle adoptée par la jurisprudence jusqu’à présent, avant le droit issu de la réforme de 2016, mais en connaissance de celui-ci. Pour les actes nécessitant l’autorisation du juge, la Cour de cassation a écarté le jeu de la théorie de l’apparence, invoqué afin de maintenir un acte de disposition fait par l’administrateur légal du mineur sans autorisation du juge, partant sans pouvoir réel75. Dans cette logique, le mandat apparent ne pouvait faire échec aux règles de capacité juridique, capacité de droit. Admettre le contraire, ce serait anéantir les règles protectrices des mineurs représentés, parfois avec autorisation préalable du représentant. Pour un majeur protégé, il devrait en aller de même. En outre, même à raisonner sur le terrain de la théorie de l’apparence, il faudrait reprocher au tiers de n’avoir pas opéré la vérification de l’existence et de l’étendue des pouvoirs, grâce à la fonction de la publicité des mesures, qui tend essentiellement à leur opposabilité erga omnes, non à leur information individualisée76. Sur cet aspect, il y a déjà un argument que l’on ne retrouve pas dans l’incapacité de fait.
En argument subsidiaire, le moyen soutenait que « pour se prévaloir d’une erreur commune sur la qualité de propriétaire apparent, la cause de la nullité doit être demeurée ignorée de tous » – condition de la théorie de l’apparence. Sous cet angle, le pourvoi cherche aussi à remettre en cause la bonne foi du tiers acquéreur à partir des éléments factuels de l’affaire, qui relèvent de l’appréciation souveraine, même si l’on peut légitimement attendre des juges du fond une motivation soignée à ce sujet, soumise au contrôle disciplinaire de la Cour de cassation.
S’appuyant sur la presse nationale, le pourvoi avançait que les juges auraient dû vérifier l’état d’esprit du tiers au regard d’articles ayant rendu public le détournement systématique du patrimoine, en relatant notamment que « les hypothèses varient entre une dérive sectaire, un secret de famille, l’influence d’un escroc »77. Sur le terrain du grief de manque de base légale, on arrivait à l’appréciation des preuves pour caractériser l’erreur commune.
Afin de repousser la critique, la première chambre civile se réfugie derrière les constatations faites, reprises : « l’arrêt énonce, d’abord, qu’aucun des articles de presse publiés antérieurement à la vente du 20 juin 2009 ne faisait référence à une difficulté relative à la propriété du château de (…), de nature à remettre en cause la qualité de propriétaire de la SCI, et que les commentaires, interprétations ou points de vue qu’ils contenaient pouvaient être considérés par [le tiers acquéreur] comme n’engageant que leurs auteurs. Il ajoute, ensuite, par motifs propres et adoptés, que la SCI disposait en apparence, sur le bien immobilier en cause, d’un droit réel découlant de l’acte authentique du 29 janvier 2008, lequel avait fait l’objet d’une publication, et qu’au jour de la conclusion de la seconde vente, aucune assignation en annulation n’avait été publiée au service de la publicité foncière. Il relève enfin que la prétendue vileté du prix n’est pas établie, la SCI ayant acquis le château de (…) en 2008, moyennant un prix de 460 000 €, et l’ayant revendu le 20 juin 2009 pour la somme de 540 000 €, après avoir réalisé des travaux dont elle justifie ». Rien ne permettait donc d’éveiller le soupçon.
La bonne foi consiste à croire que l’on a bien traité avec le vrai propriétaire. Elle s’apprécie au jour de l’acquisition du bien78. Le tiers acquéreur doit également avoir commis une erreur commune et invincible, même si la Cour ne s’étend pas sur ce dernier aspect, mis en avant par la deuxième branche du moyen. C’est dire que l’erreur en question devait pouvoir être commise par tout un chacun placé dans les mêmes circonstances. Chacun aurait pu se tromper, en étant normalement attentif et diligent79.
Les juges ont pris soin de caractériser des éléments objectifs pour qualifier la croyance du tiers. Le rôle de la presse relativisé, même celle qui n’est pas dite à scandale, les juges ont donné différentes pistes. Le prix de la vente peut être un élément d’attention, même si, en soi, il peut ne pas être toujours significatif, en fonction des évolutions du marché de l’immobilier. Ici, le prix est justifié avec la mention de l’amélioration du bien par la réalisation de travaux justifiés. Le domaine immobilier connaît la publicité. Sur ce point, la régularité formelle de la vente de laquelle la SCI tirait ses droits est relevée. L’acte authentique a été publié. Inversement, un défaut de publication aurait peut-être pu conduire à faire certaines vérifications. Surtout, il est insisté sur l’assignation pour nullité, postérieure à la seconde vente, donc ignorée lors de celle-ci. L’assignation, en elle-même, suffirait-elle si elle était publiée au service de la publicité foncière (objectif), ou devrait-elle être connue personnellement du tiers acquéreur (subjectif) ? Il nous semble que la formule employée invite plutôt à se contenter d’une connaissance présupposée, objective, par le moyen de la publicité. Il s’agit d’une opposabilité faisant admettre qu’il fallait connaître. On retrouve l’erreur commune et invincible pouvant être commise par tous.
La Cour désamorce la critique du moyen en insistant sur la motivation fournie par la cour d’appel « qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ». Par suite, elle « a pu en déduire » que le tiers acquéreur « de bonne foi, avait agi sous l’empire d’une erreur commune, de sorte que la nullité de l’acte de vente du 29 janvier 2008 ne lui était pas opposable ».
Il ne faut pas être dupe. Les personnes déçues ne manqueront pas de se retourner, en désespoir de cause, contre le professionnel qui a mission d’assurer les différentes parties au sujet des actes juridiques. Fréquemment, le mécontentement va s’orienter à l’encontre du notaire.
B – La restitution après nullité
Dans la vente viagère annulée post-décès, un moyen a été relevé d’office qui entraîne la cassation partielle. Aussi, il convient de l’évoquer sommairement sans s’appesantir. Il est toutefois utile car il montre une conséquence de l’annulation d’un acte portant sur un immeuble qui a pu continuer à être exploité pendant le temps du déclenchement de l’action. La rétroactivité de la nullité80 ne peut gommer toutes les réalités. Il faut parfois voir l’étendue des restitutions à opérer81. La jurisprudence a déjà eu l’occasion de se prononcer sur les restitutions par suite de l’annulation pour insanité d’une vente en viager82.
Depuis 2016, dans un chapitre dédié aux restitutions, l’article 1352-3, alinéa 1er, du Code civil dispose que « la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée »83. L’article 1352-7 du même code énonce que « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande »84.
Ici, la Cour fait application des règles sur la possession des articles 549 et 550 du Code civil85, visés, dont elle reproduit le contenu. Ces dispositions ont vocation à jouer lorsqu’après l’annulation d’une vente, l’acquéreur devient possesseur de la chose d’autrui et que se pose la question de la restitution des fruits. Il s’agit de l’hypothèse de la restitution de fruits et de la date à retenir, ainsi que de la façon dont est appréciée la bonne foi (présumée), qui devient mauvaise foi lorsque le vice de l’acte translatif de propriété est connu. Il est jugé qu’il « résulte de la combinaison de ces textes que la bonne foi du possesseur cesse à compter de la demande en revendication du bien ou en nullité de l’acte translatif de propriété »86.
Cette précision a son intérêt concret dans notre hypothèse. En raison de l’annulation de la vente pour insanité du vendeur, la cour d’appel a décidé que l’acheteuse, « qui a donné l’immeuble en location », devait restituer au fils héritier « les fruits qu’elle en a tirés depuis qu’elle l’a acquis », soit le jour de l’acte de vente.
Implicitement, on comprend que la connaissance par le cocontractant de l’insanité n’est pas une condition de recevabilité ou du bien-fondé de l’action en nullité qui serait à établir87, partant que sa bonne ou mauvaise foi est indifférente sur ce terrain. En revanche, elle a une incidence patente sur la restitution. Dès lors, la Cour exerce sa censure pour violation de la loi car les juges d’appel n’ont pas de preuve de la mauvaise foi apportée par le demandeur en nullité. En effet, la cour d’appel a « constaté qu’il n’était pas démontré que [l’acheteuse] connaissait la maladie de son cocontractant, de sorte qu’elle ne pouvait être tenue de restituer les fruits de la chose qu’à compter de l’assignation en nullité de la vente ».
En l’espèce, l’héritier a assigné l’acheteuse « en nullité de la vente par acte d’huissier en date du 5 juillet 2013, l’assignation délivrée le 16 juillet 2010 ayant été annulée et n’ayant pas pu produire d’effet » – cette irrégularité décale donc le point de départ. Par suite, l’acheteuse « doit restituer les fruits produits par l’immeuble vendu à compter de cette date ». C’est pourquoi intervient la cassation partielle sans renvoi, étant donné que l’arrêt d’appel avait condamné l’acheteuse à restituer au fils héritier « les fruits qu’elle a tirés du bien immobilier depuis qu’elle l’a acquis ».
C’est un autre moyen de cantonner les effets de la nullité pour insanité. Cette nullité peut avoir d’autres conséquences.
III – La responsabilité du notaire
Il faut examiner la mission et la faute possible du notaire (A)88 et, par extension, la pratique du certificat médical accompagnant l’acte (B).
A – La mission et la faute possible du notaire
Face à la vulnérabilité, le notaire remplit sa tâche, qui peut s’avérer délicate, pour détecter une situation susceptible de se répercuter sur le sort des actes passés89. Cet officier public est tenu d’assurer la validité et l’efficacité des actes qu’il établit à l’égard des deux parties90. On peut estimer que sa présence est un gage de sécurité juridique91. En pratique, ce sera souvent le cas. En fait, la position du notaire aura une influence évidente sur l’appréciation de la preuve de l’insanité. Toutefois, en droit, il importe de s’interroger sur la valeur des énonciations de l’acte authentique relatives à l’état mental du client. Fréquemment, les actes peuvent contenir une clause sur le fait que l’auteur est sain d’esprit et de corps. Ou, autre illustration, le notaire « atteste » de la lucidité ou de la validité du consentement de la personne. Il reste que l’opinion du notaire sur l’état de santé de l’auteur de l’acte est, en droit, un simple témoignage92.
De jurisprudence immémoriale constante, il n’entre pas dans la mission du notaire de constater la santé d’esprit93. Aussi, la preuve contraire à ses affirmations peut être apportée, sans transiter par l’inscription de faux, procédure réputée difficile94. Le notaire n’étant qu’un témoin, même coiffé d’une certaine autorité, le juge demeure libre d’accorder crédit ou pas à son attestation95. Les espèces révèlent des solutions dans les deux sens96. La certitude est que le notaire n’est pas une autorité de certification de la santé d’esprit97. S’il en dispose régulièrement, il reste libre d’exploiter l’information médicale pour instrumenter, en estimant que le client conserve l’aptitude nécessaire, mais il ne saurait pour autant échapper à sa responsabilité si jamais ses conditions sont réunies.
Pèse cependant sur l’officier public une espèce de devoir d’abstention, qui n’est pas contradictoire avec le fait qu’il n’entre pas dans la mission du notaire de se prononcer sur l’état mental des clients98. Lorsqu’il établit les actes, le notaire vérifie, par l’accès à la publicité des mesures de protection juridique, que le majeur n’est pas placé sous un régime protecteur organisé99. Ce devoir s’étend à l’incapacité de fait100, à l’inaptitude, dans certaines circonstances. Ainsi, « il appartient au notaire, tenu de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes reçus par lui, de vérifier la capacité de son client lorsque des circonstances particulières lui permettent de mettre en doute ses facultés mentales »101. Par exemple, à propos de la tentative avortée de justification d’avoir instrumenté malgré tout, peut être écartée la grandiloquence d’un pourvoi rejeté : « en retenant la responsabilité du notaire, motif pris de ce que cet officier public ne s’était pas opposé à l’exercice par un citoyen d’un droit fondamental, la cour d’appel aurait violé l’article 1382 du Code civil et l’article 3 de la loi du 25 ventôse an XI »102.
La jurisprudence rappelle le principe et donne des illustrations instructives, dans le sens de la responsabilité103 ou de sa mise à l’écart104. Il convient d’en tirer les enseignements, même a contrario. L’insanité est un motif parfaitement recevable pour décliner l’intervention en tant que notaire. En l’absence de circonstances assez caractérisées, rien ne peut toutefois être reproché au notaire qui prête son concours.
Toutefois, la présence d’un tiers habitué à observer l’état mental ne dispense pas le notaire de sa tâche de vérification. Ainsi, est écarté un des arguments du pourvoi du notaire jugé responsable de ne pas voir averti les parties d’un risque d’annulation ultérieure : « le notaire ne commet aucune faute lorsqu’il instrumente un acte de vente en présence d’une personne ayant toute compétence pour évaluer les facultés mentales de l’acquéreur », en l’occurrence un membre d’une association tutélaire105. La « cour d’appel, après avoir relevé que le notaire ne pouvait refuser d’instrumenter, a constaté qu’il existait différents indices, et notamment la présence de membres de l’Adapei, qui auraient dû alerter le notaire sur l’existence d’un risque d’annulation de la vente ; qu’elle a pu en déduire qu’il avait commis une faute en n’avertissant pas la venderesse de ce risque et légalement justifié sa décision ».
Pareillement, l’intervention d’un autre professionnel ne dispense pas le notaire de son devoir de vigilance. Dans une affaire, l’épouse, en vertu d’une procuration donnée à une personne (auteur avec son conjoint de mauvais traitements et d’abus de faiblesse à son égard), a vendu, avec le consentement de son époux, représenté par un clerc de l’étude où l’acte authentique était passé, à une autre personne, un bien propre immobilier ayant constitué le domicile conjugal. Par la suite, la vendeuse et son tuteur ont assigné l’acheteuse et son époux devenu aussi propriétaire, en annulation des ventes et restitution du bien immobilier. Ont été appelés en garantie, notamment, l’agent immobilier et le notaire. Le notaire condamné in solidum a formé un pourvoi. Il est rejeté, avec une certaine sévérité sur l’appréciation du contexte : la vendeuse insane « était représentée à l’acte litigieux par [la personne], chez laquelle elle résidait, tandis que ni son activité professionnelle déclarée ni l’éloignement de son domicile ne justifiaient le recours à une procuration, signée en présence d’une secrétaire de l’étude devant laquelle elle s’était présentée à l’improviste, circonstances qui étaient de nature à permettre au notaire de douter des facultés mentales de la mandante qu’il n’avait pu rencontrer ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a exactement déduit que le notaire avait fait preuve de légèreté et de négligences fautives en omettant de s’assurer personnellement de la capacité à disposer de sa cliente, obligation dont il ne pouvait être dispensé par l’intervention d’un autre professionnel de l’immobilier lors de la signature de la promesse de vente »106. Retenons le principe, celui d’un devoir personnel maintenu de l’officier public. Le comportement fautif de différents intervenants est relevé. Le mari qui « connaissait la perte d’autonomie », « ne pouvait que douter du consentement de son épouse à la vente et de sa capacité à disposer de son bien ». Aussi, « en omettant d’informer le notaire de cette situation, il a participé à la conclusion de l’acte litigieux ».
En cas de procuration107, par exemple, le notaire doit opérer, par précaution, la vérification des facultés personnelles du mandant108. En ce sens, il est jugé que « le notaire a l’obligation de vérifier la capacité juridique des contractants dont dépend la validité de l’acte qu’il reçoit et authentifie, spécialement lorsqu’une partie est représentée par un mandataire, et qu’en cas de doute, il doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de conférer pleine efficacité audit acte »109. Dans cette affaire, la responsabilité du notaire est écartée, parce qu’il a opéré les bonnes démarches, notamment en désignant un mandataire ad hoc lors de la réitération authentique.
Le notaire est confronté à une multitude de situations variées car la population concernée demeure hétérogène. Parmi les personnes vulnérables, face au double phénomène du vieillissement et de la concentration du patrimoine et des ressources, l’officier public aura fréquemment en face de lui des personnes âgées. Néanmoins, elles ne sont pas toutes affectées par un affaiblissement conséquent, et lorsque celui-ci existe, il peut être davantage progressif, avec des étapes, qu’instantané, voire fluctuant.
Il faut douter sérieusement du maintien des facultés personnelles face à certains signes. Il ne s’agit pas de poser un diagnostic médical exact. Il faut des éléments significatifs qui éveillent l’attention d’une personne normalement diligente et attentive. Malgré la capacité juridique intacte, il s’agit de signes qui font naître sérieusement le soupçon. Seule l’altération manifeste, perceptible par le profane en matière médicale110, doit éveiller l’attention du notaire. C’est dire que l’on n’attend aucunement une compétence médicale de ce dernier. Le doute légitime n’a pas besoin de confirmation par un médecin111. S’il existe, il guide la démarche certaine. Dans le doute, si le notaire ne refuse pas d’instrumenter112, il peut être appelé en garantie, engager sa responsabilité civile, extracontractuelle, sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil, devenu l’article 1240113. Cette conséquence peut aiguillonner la vigilance114.
Par comparaison, même si les missions confiées et les rôles diffèrent, on peut relever une possible extension du contrôle et de l’éventuelle abstention à d’autres professionnels que le notaire. Il s’agit de personnes dont on peut attendre une certaine attention auprès de leurs clients avec la limite de l’immixtion dans leurs affaires. On songe, par exemple, à des opérateurs institutionnels, les banques et les compagnies d’assurances. Un devoir de vigilance peut peser sur certains tiers professionnels au profit de la clientèle fragile. Si le contentieux n’est pas (encore ?) nourri115, la réflexion mérite d’être menée, ne serait-ce que pour adapter les relations aux personnes vulnérables.
En l’espèce, l’arrêt infirmatif d’appel a jugé que le notaire n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité. Les consorts ayant échoué à défendre l’opposabilité de la nullité (consort « insanité ») ont utilisé le biais de la violation de l’article 16 du Code de procédure civile afin de remettre en cause une telle appréciation. C’est l’objet du second moyen, première branche, accueilli, conduisant donc à la cassation partielle avec renvoi devant la cour d’appel de Toulouse.
Le notaire soutenait que le moyen était partiellement irrecevable, une des personnes étant dépourvue d’intérêt à agir contre le chef de dispositif visé. Succinctement, la Cour retient la recevabilité car les demandes de dommages et intérêts contre le notaire ont bien été écartées, ce qui concerne la personne en question.
Le bien-fondé du moyen est dès lors examiné. En bref, les consorts « insanité » reprochaient au notaire d’avoir instrumenté pour authentifier la vente de leur bien, quelques jours après avoir pourtant refusé de le faire pour un acte de prêt au profit des mêmes personnes, sur réception discutée d’une lettre anonyme. Pour les juges d’appel, l’existence d’une telle lettre ne pouvait être établie par les seules déclarations de certains ou des parties civiles au cours de l’instruction judiciaire auxquels le notaire « n’a pas été confrontés, puisqu’il n’a même jamais été entendu lors de l’enquête ». Les consorts « insanité » ont défendu « qu’aucune règle n’impose au juge, pour apprécier la valeur probante de déclarations effectuées dans le cadre d’une procédure pénale, versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties, que les auteurs de ces déclarations aient été confrontés à la partie à qui l’on oppose ces dernières ».
Au visa de l’article 16 du Code de procédure civile violé, la Cour de cassation indique qu’il « résulte de ce texte que le juge peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties dès lors que celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ». Or ici, « les pièces contenant [les] déclarations [décrites] avaient été régulièrement produites et soumises à la libre discussion des parties, de sorte qu’elle devait examiner leur contenu et apprécier leur valeur probante ». Constatons que la cassation ne livre pas le sort exact du notaire quant à sa responsabilité lors du renvoi, puisqu’elle se borne à décrire les éléments de preuve à ne pas écarter a priori. Le rejet de la demande de dommages et intérêts par les juges d’appel est contredit dans le principe116.
Toutefois, le solde de la motivation invite à faire certaines vérifications pour se prononcer à ce propos : « Pour écarter toute faute du notaire, après avoir relevé que les consorts E. soutenaient que celui-ci avait eu connaissance d’indices de nature à le faire douter de leur capacité à s’engager, soit par la presse locale, soit parce qu’il avait reçu, le 21 janvier 2008, une lettre anonyme accompagnée d’un article de journal, l’arrêt énonce que cette lettre n’a pas été retrouvée lors de l’enquête pénale et que son existence ne peut être établie par les seules déclarations faites, au cours de l’instruction, par les nommés D., Q., ou les parties civiles, auxquels le notaire n’a pas été confrontés, n’ayant pas même été entendu lors de cette enquête ».
Si jamais le notaire pouvait avoir des doutes, il lui appartenait de s’abstenir, et de ne pas ignorer la situation de vulnérabilité, susceptible d’avoir une incidence sur le sort de l’acte. En cas de faute, l’inopposabilité au tiers acquéreur pourrait être amenuisée par le montant de la réparation accordée, au titre du préjudice en lien de cause à effet avec le manquement du professionnel. Un comportement délibéré de prise de risque pourrait même, le cas échéant, relever de la faute intentionnelle ou dolosive de l’article L. 113-1 du Code des assurances, exclusion légale de garantie du contrat d’assurance de responsabilité professionnelle. Affaire à suivre.
B – La pratique du certificat médical accompagnant l’acte
Dans leur quotidien, les notaires peuvent être confrontés à la « zone grise », à l’instar des banquiers et assureurs. La personne majeure dispose de sa capacité juridique, mais elle peut présenter des signes qui entraînent le doute sur son aptitude réelle. Il ne faut pas confondre l’inaptitude à exprimer une vraie volonté, au sens du droit, et une simple difficulté à manifester un consentement valable pouvant cependant être pris en considération par le système juridique. Nombre de personnes peuvent ne pas souffrir d’une perte totale et définitive de leur autonomie. Néanmoins, celle-ci ne saurait être consacrée sans distinction pour tous car la perte d’autonomie est une réalité tangible117 qui a un impact certain sur la validité de l’acte juridique.
Le congrès des notaires appelle, de façon louable, à la vigilance pour cette « zone grise » définie comme celle où l’officier public a un doute sur l’intégrité des facultés mentales du client118. S’il n’est pas significatif de façon universelle, le franchissement d’un seuil d’âge119 peut être perçu comme une alerte, conduisant à scruter plus attentivement la situation. Nous ne traiterons pas de ceux, dont nous ne partageons pas l’opinion, qui souhaitent la mise en place d’un statut de la séniorité, une fois une limite d’âge atteinte120. Qu’est-ce donc sinon une incapacité informelle, aux petits pieds, qui ne veut pas dire son nom ? Déclencher une protection par le seul effet de l’âge, n’est-il pas contraire à l’égalité tant clamée par ailleurs ? L’âge (grand ou vieil) n’est pas le seul paramètre. Un client peut parfois se faire répéter la même chose, sans avoir l’air de saisir le sens du discours – et avec une audition correcte. Il y a des signes et des propositions de méthodes afin d’appréhender la faiblesse ou pour détecter la vulnérabilité de l’individu121. Il s’agit d’identifier certaines situations ou indicateurs de la faiblesse.
S’il faut individualiser la relation avec la personne qui exprime, même difficilement, mais assurément, un réel consentement, il faut toujours avoir en tête la limite de l’expression d’une volonté purement mécanique et vide de toute signification au regard du droit. La parole ou la signature deviennent alors pure fiction de consentement. La bienveillance est une chose ; l’aveuglement ou la témérité, une autre. Si une protection juridique apparaît nécessaire, il faut même savoir opérer un signalement au procureur de la République122 ou au juge. C’est même un devoir social123, car le principe directeur de subsidiarité ne dispense pas de telles mesures. Il permet seulement de ne pas y recourir si une protection suffisante peut être fournie autrement. Encore faut-il qu’une telle protection alternative existe. Il faut savoir se résigner à mettre en place la protection juridique adaptée lorsque le cas le dicte. Alors, il faut certes patienter pour passer un acte. Mais, en suivant la procédure idoine prévue par la protection continue (représentation ou assistance ou/et autorisation), on retrouve la sécurité juridique recherchée. La célérité n’est pas tout. Il demeure que le travail judiciaire pourrait être amélioré en termes de réactivité afin de ne pas ralentir à l’excès l’activité juridique des personnes vulnérables. Là est la politique publique à encourager !
Aussi, il nous paraît quelque peu opportuniste, pour le moins, de se réfugier derrière la garantie des droits et libertés de l’individu, dans l’esprit onusien de la convention internationale des personnes handicapées (CIDPH), ici invoquée124, pour passer outre les « contraintes » et se dispenser surtout du cadre de mesures protectrices qui ne sauraient être vues comme des formalités encombrantes au profit d’une alternative sous la maîtrise de l’officier public cherchant à justifier son intervention, malgré tout, par la caution médicale. La communication professionnelle existe néanmoins à ce sujet, probablement dans le but d’une prospective souhaitée : « Retirer, ou même restreindre la faculté pour les notaires en proie aux doutes de s’appuyer sur l’avis autorisé d’un médecin, c’est prendre le risque évident de favoriser le développement d’une pratique, qui consisterait pour eux à refuser systématiquement d’instrumenter125 en présence d’une situation de “zone grise”, ce qui tendrait à consacrer une incapacité de fait généralisée inacceptable et stigmatisante pour certains de nos concitoyens, déjà malmenés par la vie et/ou ayant atteint un certain âge »126. Elle ne doit pas masquer la responsabilité à assumer, en droit positif, à l’instar du rôle irréductible du notaire dans le contrôle du mandat de protection future127 malgré la présence d’un autre contrôleur128. Pareillement, la déjudiciarisation peut conduire à confier des tâches129, mais la responsabilité va alors avec la mission. Si le doute existe légitimement sur l’aptitude, l’honneur du notaire, comme sa responsabilité, n’est pas de passer outre pour faire comme si le client était toujours à considérer comme apte à émettre un consentement valide. Le certificat médical obtenu ne le dispensera aucunement, le cas échéant, de rendre des comptes.
Une pratique est à signaler, celle qui consiste à annexer un certificat médical à l’acte juridique, notarié ou pas d’ailleurs, pour attester du bon état de santé d’une personne délivrant son consentement à un acte juridique130. Sans forcément l’annexer, le certificat peut être conservé en vue d’un litige futur131. Toujours il accompagne l’acte. À notre connaissance, une telle pratique n’est pas unanimement reçue par tous les notaires132. L’enthousiasme des uns133, parfois un peu débridé134, coexiste avec la prudence ou la méfiance des autres, à côté du rappel neutre de la pratique. L’idée est de le faire établir, à une date proche de celle de l’acte projeté, afin qu’il traduise du mieux possible une réalité contemporaine, du moins que sa crédibilité sorte renforcée. Il s’agit d’un certificat de contrôle de l’aptitude malgré la capacité de droit la supposant. Rien ne dit qu’il empêchera le contentieux par la guerre des preuves, notamment celle par production de divers certificats médicaux, autour de l’acte litigieux135.
Sur la méthode, qui peut sérieusement prêter au débat, observons d’emblée que lorsque l’auteur de l’acte est vivant, une expertise psychiatrique peut être diligentée. Le pouvoir judiciaire n’efface en rien la charge de la preuve, et l’éventuelle carence dans son administration136. Devant exercer sa mission, le juge n’est qu’éclairé par celle-ci, qui ne saurait conduire à dire le droit137, bien sûr, ni à lier la juridiction saisie sur l’état des facultés personnelles138. Pourtant, l’examen peut être réalisé dans la suite, plus ou moins proche, de l’acte critiqué avec de nombreux éléments pour retracer une évolution morbide. A fortiori en va-t-il ainsi pour une expertise sur pièces en raison du décès de la personne dont les facultés sont en discussion139. L’appréciation rétrospective est aussi le mécanisme en œuvre lorsque le demandeur produit le certificat du médecin élaboré après l’acte litigieux afin de soutenir sa prétention dans un sens ou dans l’autre. Le juge n’est pas davantage tenu de suivre l’appréciation médicale. Lorsque l’auteur de l’acte est décédé, l’investigation est forcément rétroactive. Lorsque le tribunal décide de donner une autorisation au tutélaire pour confectionner son testament en tutelle – acte strictement personnel, interdisant assistance ou représentation, quelle que soit sa source140 –, il examine la situation actuelle pour apprécier seulement la lucidité présente ou non, maintenant et dans un horizon proche. Il sera aidé par les données médicales transmises ou récupérées. Toutefois, même si l’autorisation est délivrée, la nullité de l’acte pour insanité est clairement ouverte (autre chose est sa chance de succès, qui dépend des preuves apportées). Comment, à l’heure actuelle, sans texte, bien qu’officier public et ministériel, le notaire pourrait-il avoir une crédibilité supérieure à celle du juge étatique permettant de mettre l’acte conclu avec certificat médical contemporain à l’abri de la critique ? De lege ferenda, une intervention en ce sens nous paraît inadaptée et inopportune.
On mettra de côté le certificat de complaisance141, même s’il ne faut pas le négliger. Tenons pour acquis, dans le raisonnement, que le certificat médical produit exprime un constat sérieux et objectif. On admettra aussi la disponibilité du praticien de santé, point frileux pour satisfaire à la démarche, qui délivre dans un délai raisonnable l’attestation espérée, avec une savante description des observations faites. Il faut que le certificat soit, temporellement, aussi près que possible de l’acte. Il faut leur contemporanéité sinon leur simultanéité parfaite. Le secret professionnel médical est fait pour protéger le patient142. Si celui-ci sollicite son médecin traitant pour obtenir une attestation, en la fournissant à un tiers, il peut renoncer, expressément ou tacitement, mais sans équivoque, à ce secret. Il reste encore à sélectionner les catégories de clients à qui cette « formalité » complémentaire sera fortement suggérée. Il en va ainsi sauf à imaginer que les notaires sollicitent tous les clients sans distinction. On reviendrait alors à une tentative de prouver l’aptitude au cas par cas, pour tel acte, malgré la « présomption » de validité du consentement émis résultant de la capacité juridique intacte. Est-ce souhaitable ? Réalisable ?
Par parenthèse, signalons que la jurisprudence a pu s’intéresser au sort de l’acte, anéanti, sans invoquer l’insanité, proprement dite, mais la seule vulnérabilité143. L’affaire est pour l’heure isolée, avec une telle motivation, mais pourrait montrer une voie protectrice face à certaines attitudes qui pourraient se développer. Dans un but protecteur, l’insanité pourrait aussi être accueillie avec davantage de bienveillance par les juges – effet pervers de la précaution jugée avec défiance. Par ailleurs, en présence d’une personne faible, un état de santé insuffisant pour retenir l’insanité, pourrait permettre, à l’occasion, une appréciation accueillante des éléments constitutifs d’un vice du consentement144.
En outre, à propos d’une fameuse milliardaire ayant eu recours à un mandat de protection future notarié, en parallèle d’une procédure en vue d’une mesure judiciaire145, il a pu être reproché, au pénal, à l’« ancien avocat puis mandataire de la victime, d’avoir participé à la signature d’un mandat de protection future »146 – mis en œuvre alors que l’encre de sa formation était encore humide (par un certificat médical de moins de 2 mois)147. Par différents actes, avec d’autres, il a agi « pendant une période où celle-ci était susceptible d’être en état de faiblesse, ce qui pouvait rendre toute opération financière la concernant comme suspecte et aurait dû l’amener en tant que professionnel du droit à s’entourer de toutes les précautions et garanties possibles ». L’avertissement mérite d’être entendu.
Du point de vue psychologique148, il faut faire admettre à un client âgé ou apparemment vulnérable pour une autre cause, le besoin de recourir à un tel certificat attestant du bon état de ses facultés, alors que, par ailleurs, il n’est pas soumis à un quelconque régime de protection juridique, et qu’il est donc pleinement capable en droit. Tous ne réagiront pas de la même manière ! D’aucuns pourraient défendre la discrimination à raison de leur âge149 ou de leur handicap, à tort ou à raison. Il ne faut jamais occulter la susceptibilité et la haute appréciation, même déformée, que chacun peut percevoir ou conserver de lui-même. En face, il faut tenir compte du cocontractant ou du légataire, confronté à un notaire qui instrumente en sollicitant le certificat… Là aussi, les réactions peuvent être variables, jusqu’à la fuite en raison du risque imaginé ou craint. L’idée, à défaut de conseil, qui, lui, suppose de s’adapter finement à la situation personnelle du client connu, est peut-être de présenter la précaution, moins comme un doute exprimé sur l’état réel des facultés du client, que comme une mesure de sécurité juridique pour viser à limiter les éventuelles contestations des uns et des autres, notamment des héritiers insatisfaits.
En soi, ce qui est présenté comme une démarche prudente n’a rien d’absolument décisif150. Il faut toujours se livrer à une appréciation face à l’affirmation de santé d’esprit151. Parfois, la précaution conforte l’analyse du juge sur l’absence d’insanité152. Si un officier public digne de confiance a pris la peine de joindre un tel certificat, c’est que la vérification a bien été menée de l’aptitude réelle, comme peuvent encore en témoigner d’autres éléments. À l’opposé, la démarche éveille la suspicion et n’empêche pas de retenir l’insanité153. Pourquoi recourir à un tel constat médical si la personne est vraiment capable en droit, puisqu’elle est alors censée émettre un consentement ? N’est-ce pas curieux154 ? Y aurait-il un doute et une recherche de se préconstituer une preuve pour éviter des contestations justifiées, ou d’échapper au risque de responsabilité en se réfugiant derrière l’autorité médicale ? L’absence d’un réel contentieux significatif, à ce jour, ne doit pas empêcher de s’interroger.
Aussi, celui qui affirmerait qu’une production d’un certificat médical contemporain de l’acte juridique passé – serait-ce le même jour – purge ce dernier de toute critique efficace contre le consentement, serait, en droit, dans l’erreur, voire commettrait, le cas échéant, une faute professionnelle. Il n’y a qu’à rappeler, par comparaison, une jurisprudence bien connue et assise selon laquelle l’autorisation préalable du juge ou/et l’assistance de l’organe protecteur, ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit155. Autre chose est la fréquence, en fait, de l’efficience du dispositif, qui peut toujours être contredit selon les circonstances de tel ou tel cas. Quant à celui qui garantirait que l’acte est assurément à l’abri d’une remise en cause pour insanité, il serait, a fortiori, exposé à l’ire de celui qui vérifierait le contraire à son détriment.
L’objectif du congrès des notaires est d’aller plus loin, semble-t-il, par un message au législateur, mais déjà aux juges : « De lege ferenda, on peut espérer qu’elle dissuade les magistrats, en présence d’un certificat médical complet, précis et clair, de la tentation de réécrire l’histoire en remettant en cause rétrospectivement le diagnostic alors posé sur la foi d’expertises réalisées plusieurs années après. En présence d’un certificat circonstancié, contemporain à l’acte, a fortiori s’il est conforté par le témoignage corroborant du notaire instrumentaire, une présomption de sanité d’esprit doit s’imposer au juge, susceptible de n’être renversée qu’en présence d’une preuve irréfutable d’un trouble survenu soudainement, de manière imprévisible et irrésistible, ayant finalement altéré la capacité de la personne à effectuer l’acte litigieux »156. Ce serait ainsi un intervalle lucide officialisé, voulu (quasiment) incontestable.
Le 116e congrès des notaires, en 2020, a fait une proposition157. Elle est amenée par la nécessité qu’il y aurait de traiter la « zone grise »158. La responsabilité de l’officier est souvent présentée comme « accessoire » à l’impératif de garantir des actes valides et efficaces159. Il nous semble qu’elle demeure, malgré tout, au cœur de la démarche. Il n’y a qu’à se reporter à la rubrique du risque de responsabilité évincé. « À nos yeux, les effets attachés au recours au certificat médical ne sauraient souffrir de la moindre ambiguïté : confronté à un doute sérieux sur la faculté de discernement de son client, le notaire ayant fait preuve de toute la prudence que requiert son ministère en faisant appel à l’expertise d’un professionnel de santé, sa responsabilité doit être exclue. Ce souhait, exprimé sous la forme d’une affirmation péremptoire et nécessairement subjective, est conforté, ce qui est réconfortant, par l’examen du droit positif »160. Cette dernière affirmation relève davantage de la tentative de persuasion, à notre avis.
Or, affirmons-le, en l’état du droit applicable, rien ne pourrait effacer automatiquement une responsabilité au prétexte que l’on a pris soin de solliciter un professionnel de santé qui aurait attesté d’une aptitude suffisante du client. Il en irait de même avec des témoins161 qui n’empêchent ni la recevabilité, ni le bien-fondé de l’action en nullité pour insanité. Autre chose serait une intervention législative validant un tel procédé pour passer un acte juridique, devenu juridiquement inattaquable, voire créant une immunité, au moins de fait, sinon de droit, pour celui recevant ledit acte. Serait-ce vraiment opportun et dans l’intérêt réel des personnes vulnérables ?
La proposition suppose d’avoir l’assentiment du client, faudrait-il le convaincre de l’utilité du procédé, en insistant avec psychologie162. L’encadrement du secret professionnel médical163 auquel la renonciation serait ainsi demandée l’impose. En effet, en l’état du droit positif, un tel certificat ne figure aucunement dans la liste de ceux obligatoires164 auxquels, de surcroît, le notaire pourrait avoir accès. Nous ne partageons pas l’optimisme consistant à défendre la possibilité pour le médecin, de façon proportionnée, de délivrer certaines données, parce que « le certificat médical qui est destiné au notaire n’est ni plus ni moins qu’un certificat d’aptitude à passer un acte déterminé, lequel ne nécessite pas de dévoiler l’intimité de la personne concernée »165. Rappelons que s’il est besoin d’un certificat d’aptitude, c’est qu’un doute existe bien, au départ, sur celle-ci.
Le client conserverait à sa charge les frais, avec son libre choix du médecin, qui pourrait être le médecin traitant ou celui de la structure d’accueil ou un spécialiste166. Il n’y a qu’à connaître les relations des médecins traitants avec les assureurs pour savoir leur réticence à fournir à des tiers des données médicales sensibles, parfois même malgré la demande de leur patient167. Le notaire n’a pas davantage un quelconque droit direct à une communication de l’information médicale, serait-il officier public et ministériel. Il demeure que le secret protégeant le patient, celui-ci est libre d’y renoncer (s’il est apte à le faire !). Toutefois, la préférence irait au médecin de la liste du procureur de la République168 qui établit habituellement les certificats médicaux circonstanciés169. On ne s’attardera pas sur le coût (montant et fardeau). On passera sur la critique du contenu de ces certificats qui, en pratique, pour nombre d’entre eux, ne donneraient pas satisfaction pour organiser une protection juridique170. Le praticien ne pourra se prononcer que sur une aptitude à un moment donné. Il ne saurait attester de l’existence d’une telle aptitude au moment précis de l’acte projeté. Sera-t-il couvert par son assurance de responsabilité si sa responsabilité était recherchée, conjointement avec celle du notaire ? Face à la vulnérabilité, il faut parfois savoir se résoudre à une protection continue nécessaire.
Notes de bas de pages
-
1.
Intitulé Protéger. Les vulnérabilités – Les proches – Le logement – Les droits.
-
2.
Cass. 2e civ., 5 juill. 2006, n° 05-13885. Les décisions s’attardent exceptionnellement sur la définition bien assise de l’insanité (Cass. civ., 4 févr. 1941 : DA 1941, p. 113 ; Gaz. Pal. Rec. 1941, 1, p. 347). L’insanité comprend toutes les variétés d’affections mentales (et autres, pourrait-on ajouter), par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Cass. com., 2 juin 1981, n° 79-13931 : Bull. civ. IV, n° 259 – Cass. 1re civ., 4 juill. 1995, n° 93-11372 ; Cass. soc., 5 janv. 1999, n° 96-45542 ; CA Rennes, 6 mai 2008, n° 06/04853 ; CA Nancy, 16 mai 2013, n° 12/01862 : D. 2013, Pan., p. 2196, obs. Plazy J.-M. Dans les moyens annexés, Cass. 1re civ., 17 févr. 2010, n° 08-20950 ; Cass. 1re civ., 12 févr. 2014, n° 13-10224 ; Cass. 2e civ., 7 sept. 2017, n° 16-19219.
-
3.
Cass. 1re civ., 12 nov. 1975, n° 74-12097 : Bull. civ. I, n° 319.
-
4.
Cass. 1re civ., 1er déc. 1999, n° 98-11976 ; Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 06-11355.
-
5.
Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-10448 : Bull. civ. I ; D. 2020, p. 2164, note Minois M. ; LEFP juill. 2020, n° 112z4, p. 7, obs. Lemouland J.-J. ; Defrénois flash 1er juill. 2020, n° 156u2, p. 9 ; D. 2020, Pan., p. 1485, spéc. p. 1486, obs. Lemouland J.-J. ; JCP G 2020, 754, obs. Béraudau J.-P. ; Dalloz actualité, 12 juin 2020, obs. Mélin F. ; Dr. famille 2020, comm. 130, note Farge M. ; AJ contrat 2020, p. 381, obs. Pailler L. ; Defrénois 3 sept. 2020, n° 162r6, p. 36, obs. Nourrissat C. ; Defrénois 24 sept. 2020, n° 163h2, p. 30, note Combret J. ; Gaz. Pal. 6 oct. 2020, n° 388h9, p. 83, obs. Robbe C. et Schlemmer C.
-
6.
Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-13419 : Bull. civ. I ; D. 2020, AJ, p. 1174 ; Defrénois 18 juin 2020, n° 161b2, p. 9 ; LEFP juill. 2020, n° 112y3, p. 1, obs. Lemouland J.-J. ; D. 2020, Pan., p. 1485, spéc. p. 1486, obs. Lemouland J.-J. ; Defrénois 24 sept. 2020, n° 163h3, p. 31, obs. Noguéro D. ; Defrénois 22 oct. 2020, n° 163g6, p. 25, note Noguéro D. ; JCP N 2020, 1195, note Peterka N.
-
7.
Noguéro D., « Vulnérabilité et aptitude en France », in La vulnérabilité. Journées québécoises, Travaux de l’association Henri Capitant, t. LXVIII/2018, 1re éd., 2020, Bruylant et LB2V, p. 174, spéc. p. 186. V. les références citées, non reprises ici dans le détail. Adde Noguéro D., L’incidence de la maladie sur l’acte juridique, thèse, Durry G. (dir.), vol. 1, 2000, Paris II.
-
8.
V. les moyens annexés pour les riches détails.
-
9.
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 18-26525.
-
10.
Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-15046.
-
11.
Exemples, Cass. 3e civ., 5 févr. 2013, n° 11-25090 ; CA Reims, 5 févr. 2019, n° 18/013891 : Defrénois 10 oct. 2019, n° 152e1, p. 42, note Noguéro D. ; Dr. famille 2019, comm. 116, obs. Maria I.
-
12.
Exemple, promesse synallagmatique de vente immobilière, Cass. 3e civ., 30 nov. 2017, n° 16-15597 : Defrénois 29 mars 2018, n° 134u8, p. 30, note Noguéro D. ; D. 2018, Pan., p. 1458, spéc. p. 1459, obs. Lemouland J.-J.
-
13.
C. civ., art. 1108 anc. ; C. civ., art. 1128 ; C. civ., art. 1129. Not. Lemouland J.-J., « Consentement et capacité. L’influence discrète de l’utilitarisme », in Larribau-Terneyre V. et Pellé S. (dir.), Quel renouveau pour le droit des contrats ? Une réforme entre tradition et modernité, 2016, PUPPA, p. 87 ; Maria I., « L’existence du consentement, insaisissable condition de validité du contrat », in Mélanges offerts à Geneviève Pignarre, Le droit en perpétuel mouvement, 2018, LGDJ, p. 561.
-
14.
Cass. 1re civ., 13 déc. 2017, n° 16-15463 : Defrénois 29 mars 2018, n° 134v1, p. 34, note Noguéro D. ; Dr. famille 2018, comm. 70, obs. Nicod M. ; D. 2018, Pan., p. 1458, spéc. p. 1459, obs. Lemouland J.-J. – Cass. crim., 18 sept. 2019, n° 18-85038 : RGDA oct. 2019, n° 116v9, p. 25, note Mayaux L. ; BJDA.fr 2019, n° 65, obs. Zalewski-Sicard V. ; Procédures 2019, comm. 335, obs. Chavent-Leclère A.-S. ; D. 2019, p. 2335, note Dejean de la Bâtie A. ; RDC déc. 2019, n° 116j9, p. 76, note Malabat V. ; JCP N 2020, 1045, note Soreau P.-A. ; Defrénois 5 mars 2020, n° 157y3, p. 47, obs. Combret J. ; D. 2020, Pan., p. 1485, spéc. p. 1486, obs. Lemouland J.-J. ; LEDA nov. 2019, n° 112f9, p. 6, obs. Béguin-Faynel C. ; JCP E 2020, 1413, n° 22, obs. Leroy M. : notaire pour le moins indélicat – dernièrement, Cass. crim., 22 avr. 2020, n° 19-80889 : LEFP juill. 2020, n° 112y4, p. 6, obs. Cerf-Hollender A. ; BJDA.fr 2020, n° 70, obs. Roumelian O. ; Gaz. Pal. 6 oct. 2020, n° 388q5, p. 90, obs. Bouveau P. ; adde Noguéro D., « La gestion dynamique de l’assurance-vie pour les majeurs protégés », in Droit prospectif Revue de la Recherche Juridique, 2018-1, t. XLIII-171, PUAM, p. 133 (nombreuses références).
-
15.
Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 18-10756 : Defrénois 21 févr. 2019, n° 145t0, p. 32, note Noguéro D. ; D. 2019, Pan., p. 1412, spéc. p. 1413, obs. Lemouland J.-J.
-
16.
Son troisième moyen, les deux premiers étant non admis.
-
17.
Pour le renversement de la charge de la preuve, était bien invoqué l’ancien article 1315 du Code civil, devenu article 1353.
-
18.
CPC, art. 12.
-
19.
Successeur universel, légal ou testamentaire, et pas le légataire particulier. Cass. 2e civ., 17 févr. 2010, n° 08-21927 : D. 2010, Pan., p. 2122, obs. Plazy J.-M. – Cass. 1re civ., 4 nov. 2010, n° 09-68276 : Bull. civ. I, n° 229 ; D. 2010, AJ, p. 2703 ; Dr. famille 2011, comm. 10, note Beignier B. – Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n° 13-15578 : D. 2014, Pan., p. 2259, obs. Noguéro D. (QPC non transmise) – Cass. 1re civ., 5 nov. 2014, n° 13-15578 et 13-25455 ; Cass. 1re civ., 8 juill. 2015, n° 14-17768 : Bull. civ. I, n° 58 ; AJ fam. 2015, p. 501, obs. Levillain N. ; Dr. famille 2015, comm. 191, note Maria I. ; D. 2016, Pan., p. 1523, spéc. p. 1527, obs. Plazy J.-M. ; JCP N 2015, 1203, note Moisdon-Chataignier S. - Comp. l’héritier, légataire à titre universel, pour la clause bénéficiaire en assurance-vie, Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-11187.
-
20.
Distincte de celle des vices du consentement. Tentative de confusion repoussée, Cass. 3e civ., 20 oct. 2004, n° 03-10989 : Bull. civ. III, n° 177 ; D. 2005, p. 257, note Noguéro D. ; D. 2006, Pan., p. 1570, obs. Plazy J.-M. ; RTD civ. 2005, p. 102, obs. Hauser J. – adde bien distinguer le fondement pour agir, Cass. 1re civ., 11 avr. 2019, n° 17-31785 : Bull. civ. I ; D. 2019, Pan., p. 1412, spéc. p. 1413, obs. Lemouland J.-J.
-
21.
Sur ces aspects et le point de départ de la prescription, CA Reims, 12 févr. 2019, n° 18/011271 : Defrénois 24 oct. 2019, n° 151a9, p. 19, note Noguéro D. – comp. hypothèse d’action reprise, Cass. 1re civ., 14 juin 1977, n° 75-14584 : Bull. civ. I, n° 272.
-
22.
Tous les actes à titre gratuit ne sont pas forcément concernés. Ex. commodat, Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 19-10170 : Defrénois 5 mars 2020, n° 157y5, p. 47, note Noguéro D.
-
23.
Limitation admise après la question prioritaire de constitutionnalité non accueillie, Cons. const., 17 janv. 2013, n° 2012-288 QPC : D. 2013, Pan., p. 2196, spéc. p. 2197, obs. Plazy J.-M. ; Dr. famille 2013, comm. 46, note Maria I. ; RTD civ. 2013, p. 348, obs. Hauser J. – comp. non-renvoi de la QPC discutant la limitation du jeu de l’article 901 du Code civil aux successeurs universels, légaux et testamentaires, à l’exclusion des légataires particuliers et des tiers intéressés, Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n° 13-15578 : D. 2014, Pan., p. 2259, obs. Noguéro D.
-
24.
Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 16-24323 : Defrénois 29 mars 2018, n° 134v0, p. 32, note Noguéro D. ; D. 2018, Pan., p. 1458, spéc. p. 1459, obs. Lemouland J.-J. : promesse de vente immobilière.
-
25.
Sur cet aspect, la nouvelle rédaction de la loi va au-delà de la tutelle et de la curatelle, visées sous la loi de 1968, ajoutant désormais l’habilitation familiale et la prise d’effet du mandat de protection future.
-
26.
Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-20428 : Bull. civ. I ; JCP N 2018, 626, obs. Maria I. ; JCP G 2018, act. 890, obs. Maria I. ; D. 2018, p. 1732, note Lemouland J.-J. ; Dr. famille 2018, comm. 222, note Maria I. ; Defrénois 8 nov. 2018, n° 141m9, p. 34, note Noguéro D. ; JCP N 2018, 1333, note Peterka N. ; RTD civ. 2018, p. 627, obs. Mazeaud D. ; D. 2019, Pan., p. 1412, spéc. p. 1413, obs. Lemouland J.-J. : « il se déduit de la combinaison des articles 414-2, 3°, et 466 du Code civil que, dès lors qu’une action a été introduite aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle au profit du contractant, les héritiers peuvent agir en nullité pour insanité d’esprit, que cette action ait ou non été menée à son terme » (curatelle) – implicitement Cass. 1re civ., 16 janv. 2019, n° 17-31528 : Defrénois 21 févr. 2019, n° 145t1, p. 34, obs. Noguéro D. ; Dr. famille 2019, comm. 117, obs. Maria I. ; D. 2019, Pan., p. 1412, spéc. p. 1413, obs. Lemouland J.-J. ; JCP N 2019, 1227, note Tani A. (curatelle) – implicitement Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-26683 : Bull. civ. I ; D. 2020, AJ, p. 79 ; JCP N 2020, 163 ; JCP G 2020, 90 ; Dr. famille 2020, comm. 51, note Maria I. ; Defrénois 5 mars 2020, n° 157y4, p. 46, note Combret J. ; LPA 11 mars 2020, n° 151x6, p. 13, note Corpart I. ; AJ fam. 2020, p. 191, obs. Houssier J. ; D. 2020, p. 805, note Raoul-Cormeil G. ; BJDA.fr 2020, n° 68, obs. Robineau M. ; Gaz. Pal. 7 avr. 2020, n° 376x5, p. 79, obs. Robbe C. et Schlemmer C. ; D. 2020, Pan., p. 1205, spéc. p. 1212, obs. Noguéro D. ; Gaz. Pal. 16 juin 2020, n° 380c2, p. 80, note Leducq X. ; Defrénois 2 juill. 2020, n° 161g9, p. 39, obs. Chamoulaud-Trapiers A. ; D. 2020, Pan., p. 1485, obs. Lemouland J.-J. ; RTD civ. 2020, p. 348, obs. Leroyer A.-M. ; RTD civ. 2020, p. 372, obs. Barbier H. ; JCP N 2020, 1199, note Peterka N. ; RD bancaire et fin. 2020, comm. 36, obs. Leblond N. ; LEDA mars 2020, n° 112p5, p. 7, obs. Leroy M. ; JCP E 2020, 1413, n° 21, obs. Leroy M. (curatelle).
-
27.
Comp. exception de nullité, CA Orléans, 19 déc. 2019, n° 17/031381 : LPA 26 mai 2020, n° 151w7, p. 15, note Noguéro D. (jurisprudence citée).
-
28.
L’action doit, pour cette action, être introduite dans les 5 ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.
-
29.
Arg., C. civ., art. 1100-1 ; C. assur., art. L. 132-4-1, al. 4. Il ne faut pas prêter trop à la lettre maladroite de la loi qui vise le cocontractant par un copier/coller irréfléchi d’une formule jurisprudentielle établie dans un cas de figure. La jurisprudence a bien une vision plus large à maintenir.
-
30.
Noguéro D. « Les sanctions des actes juridiques irréguliers des majeurs protégés, Première partie, les sanctions hors mesures de protection organisée », LPA 23 déc. 2009, p. 6, spéc. p. 15 ; Murat P., « Retour sur quelques difficultés d’interprétation de l’article 464 du Code civil », Defrénois 30 août 2017, n° 126y3, p. 879.
-
31.
Solution ayant évolué. V. Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 05-12005 : Dr. famille 2006, comm. 198, obs. Brusorio M. ; Defrénois 15 févr. 2007, n° 38529, p. 211, note Noguéro D. – Cass. 1re civ., 8 avr. 2009, n° 08-12073.
-
32.
Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 18-11061 : Defrénois 21 févr. 2019, n° 145t2, p. 34, obs. Noguéro D. ; D. 2019, Pan., p. 1412, spéc. p. 1414, obs. Noguéro D.
-
33.
Dernièrement, avec la responsabilité du notaire, Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-17097 : Defrénois 24 sept. 2020, n° 163h9, p. 32, note Combret J. ; JCP N 2020, 1202, note Peterka N.
-
34.
Exemple, Cass. 1re civ., 16 janv. 2019, n° 17-31528 : Defrénois 21 févr. 2019, n° 145t1, p. 34, note Noguéro D. ; Dr. famille 2019, comm. 117, obs. Maria I. ; D. 2019, Pan., p. 1412, spéc. p. 1413, obs. Lemouland J.-J. ; JCP N 2019, 1227, note Tani A.
-
35.
Exemples, Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-16064, 14-24850 et 14-25189 (nullité) ; Cass. 1re civ., 8 mars 2017, n° 16-13128 : D. 2017, Pan., p. 1490, spéc. p. 1492, obs. Lemouland J.-J. ; Defrénois 12 oct. 2017, n° 129s5, p. 31, note Noguéro D.
-
36.
Exemple, CA Aix-en-Provence, 20 mars 2017, n° 15/17351 (maladie d’Alzheimer ; validité du compromis de vente) ; CA Paris, 30 nov. 2018, n° 17/01578 (maladie de Parkinson, mais pas d’insanité) ; Cass. crim., 27 nov. 2019, n° 18-87082 (maladie d’Alzheimer).
-
37.
C. civ., art. 1358.
-
38.
Exemple, Cass. 1re civ., 27 janv. 1987, n° 84-15371 : Bull. civ. I, n° 31 ; JCP G 1988, II 20981, 2e esp., note Fossier T. ; JCP G 1987, IV 111 ; Journ. not. 1987, art. 58580, p. 560, n° 5, obs. de La Marnierre E.-S. ; Journ. not. 1987, art. 59131, n° 18, p. 1047, obs. Raison A. ; Gaz. Pal. Rec. 1987, 2, p. 428, note J. M. ; Defrénois 1987, art. 33978, p. 776, n° 41, obs. Massip J. – Cass. 1re civ., 6 juin 2012, n° 10-23352 : RTD civ. 2012, p. 507, obs. Hauser J. ; Dr. famille 2012, comm. 154, obs. Maria I. ; D. 2012, Pan., p. 2699, obs. Plazy J.-M. ; RGDA 2012, p. 1090, 1re esp., note Mayaux L. ; Resp. civ. et assur. 2012, comm. 284.
-
39.
Autorisation légale de décharge du secret, en présence d’un intérêt légitime. V. Cass. 1re civ., 22 mai 2002, n° 00-16305 : Bull. civ. I, n° 144 – Cass. 1re civ., 2 mars 2004, n° 01-00333 : Bull. civ. I, n° 69 ; RTD civ. 2004, p. 485, obs. Hauser J. – Cass. 1re civ., 8 mars 2005, n° 03-12044.
-
40.
Cass. 1re civ., 24 févr. 2016, n° 15-14328 : D. 2016, Pan., p. 1523, spéc. p. 1528, obs. Plazy J.-M. : « la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits » (avant la tutelle ici prononcée) et « c’est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte » (nullité écartée) – encore, Cass. 1re civ., 25 mai 2004, n° 01-03629 ; CA Paris, 8 mars 2017, n° 15/24862 : Dr. famille 2017, comm. 144, obs. Maria I. – Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-13091 : D. 2018, Pan., p. 1458, spéc. p. 1459, obs. Lemouland J.-J. ; Defrénois 8 nov. 2018, n° 141m8, p. 33, note Noguéro D. : acte à titre onéreux notarié suivi de curatelle renforcée – Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-15406 : Defrénois 8 nov. 2018, n° 141m7, p. 32, note Noguéro D. ; JCP N 2018, 342, obs. Tani A. ; Dr. famille 2018, comm. 137, note Maria I. ; D. 2018, Pan., p. 1458, spéc. p. 1459, obs. Lemouland J.-J. ; AJ fam. 2018, p. 307, obs. Levillain N. ; RTD civ. 2018, p. 368, obs. Mazeaud D. ; JCP N 2018, 1223, note Peterka N.
-
41.
Cass. 2e civ., 23 oct. 1985, n° 83-11125 : Bull. civ. II, n° 158 – Cass. 1re civ., 7 mars 2000, n° 97-22125 : RTD civ. 2000, p. 542, obs. Hauser J. – Cass. 1re civ., 6 janv. 2010, n° 08-14002 : Dr. famille 2010, comm. 107, 1re esp., note Maria I. ; RGDA 2010, p. 391, 1re esp., note Mayaux L. (maladie d’Alzheimer déclenchée puis sauvegarde de justice et tutelle) – Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 12-11699 (maladie d’Alzheimer évolutive puis tutelle) ; Cass. 1re civ., 19 déc. 2012, n° 11-26619 (succession de tous les régimes judiciaires et vulnérabilité exploitée).
-
42.
Exemples, Cass. 1re civ., 28 janv. 2003, n° 00-17712 : RTD civ. 2003, p. 478, obs. Hauser J. – Cass. 1re civ., 30 sept. 2003, n° 01-15316 ; Cass. 1re civ., 25 mai 2004, n° 01-03629 ; CA Limoges, 15 nov. 2012, n° 11/00713.
-
43.
Troisième branche du troisième moyen : le certificat « énonçait que l’état de santé de M. X “altér[ait] ses facultés de gestion des biens”, altération qui démontrait précisément que le vendeur n’était pas encore atteint d’insanité d’esprit ».
-
44.
C. civ., art. 1382 ; C. civ., art. 1353 anc.
-
45.
Not. Cass. civ., 4 févr. 1941 : DA 1941, p. 113 ; Gaz. Pal. Rec. 1941, 1, p. 347.
-
46.
Carbonnier J., Droit civil, t. 1, Les personnes. Personnalité, incapacités, personnes morales, 21e et 17e éd. refondues, 2000, PUF, Thémis, p. 304, n° 147, et p. 311, n° 151.
-
47.
Non retenue ici, Cass. 1re civ., 6 mai 2009, n° 08-13286.
-
48.
Nous soulignons la conjonction de coordination employée.
-
49.
Malaurie P., avec Peterka N., Droit des personnes. La protection des mineurs et des majeurs, 11e éd., 2020, LGDJ, p. 354, n° 416.
-
50.
Cass. 1re civ., 28 mai 2015, n° 14-17324 : censure de la cour d’appel se bornant à affirmer le défaut de preuve le jour de l’acte.
-
51.
Première et deuxième branches du troisième moyen ; comp. Cass. 1re civ., 30 nov. 2004, n° 02-18363.
-
52.
C. civ., art. 1151. La règle, qui nous paraît critiquable en opportunité de politique législative, n’est applicable qu’à la protection juridique, hormis le mandat de protection future qui y échappe à suivre l’énumération légale stricte (C. civ., art. 1150). Incontestablement, elle ne concerne pas l’insanité. Adde : Noguéro D., « Les pouvoirs de la personne habilitée sur les biens du majeur protégé et les sanctions applicables », LPA 25 nov. 2016, n° 119y8, p. 7.
-
53.
Cass. 1re civ., 20 oct. 1954 : Bull. civ. I, n° 293 ; D. 1955, p. 66 ; JCP G 1954, IV 159 ; Gaz. Pal. Rec. 1954, 2, p. 402 – Cass. 1re civ., 11 juin 1980, n° 78-15129 : Bull. civ. I, n° 184 ; D. 1981, Somm., p. 91, obs. Martin D. – CA Paris, 11 juin 1999 : RTD civ. 1999, p. 815, obs. Hauser J. ; D. 2000, Somm., p. 104, obs. Delmas Saint-Hilaire P. – Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 97-21544 ; Cass. 1re civ., 20 juin 2006, n° 05-14948 : Dr. famille 2006, comm. 211, note Fossier T. ; D. 2007, Pan., p. 313, spéc. p. 315, obs. Lemouland J.-J. – Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 04-19943 ; Cass. 1re civ., 11 mai 2012, n° 11-13154 ; Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 12-17360 : Bull. civ. I, n° 39 ; AJ fam. 2013, p. 241, obs. Levillain N. ; LPA 24 oct. 2013, p. 12, 1re esp., note Maurin L. – Cass. 1re civ., 15 mai 2013, n° 12-14733 ; Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 14-10360 ; CA Bastia, 14 févr. 2016, n° 14/00497 ; CA Colmar, 21 avr. 2016, n° 14/03540 ; Cass. 1re civ., 8 mars 2017, n° 16-13128 : D. 2017, Pan., p. 1490, spéc. p. 1492, obs. Lemouland J.-J. ; Defrénois 12 oct. 2017, n° 129s5, p. 31, note Noguéro D.
-
54.
Noguéro D., L’incidence de la maladie sur l’acte juridique, thèse p. 122 et s., n° 103 et s., et Noguéro D., « Les sanctions des actes juridiques irréguliers des majeurs protégés (Première partie : les sanctions hors mesures de protection organisée) », LPA 23 déc. 2009, p. 6. De façon absolument exceptionnelle, la règle a pu être rappelée en écartant la nullité.
-
55.
Qu’adviendrait-il, sinon, du droit pénal, par exemple ?
-
56.
Malgré des éléments antérieurs et postérieurs à l’acte. V. Cass. 3e civ., 22 juin 2010, n° 09-14979 ; Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-17475 (et moyen annexé) ; Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n° 12-24394.
-
57.
Cass. 1re civ., 2 déc. 1992, n° 91-11428 : Bull. civ. I, n° 299 ; D. 1993, p. 409, note Boulanger F. ; RTD civ. 1993, p. 328, obs. Hauser J. ; Defrénois 15 juin 1993, n° 35527, p. 725, n° 52, obs. Massip J. – Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n° 03-20734 ; Cass. 1re civ., 8 avr. 2009, n° 08-12073 ; Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-16663 ; Cass. 3e civ., 22 juin 2010, n° 09-14979 ; Cass. 1re civ., 19 déc. 2012, n° 11-26340 (malgré un affaiblissement constaté, point suffisant) ; CA Paris, 18 nov. 2016, n° 15/06134 ; CA Paris, 24 nov. 2016, n° 16/00065 ; CA Paris, 8 nov. 2017, n° 16/15107 : Dr. famille 2018, comm. 47, obs. Maria I.
-
58.
Exemples, Cass. 1re civ., 8 avr. 2009, n° 08-12073 ; CA Limoges, 20 juin 2013, n° 12/00379 ; Cass. 1re civ., 6 nov. 2013, n° 12-21801 ; CA Paris, 9 avr. 2015, n° 13/07796 ; CA Paris, 9 avr. 2015, n° 13/07760 ; Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 16-25313 : D. 2018, Pan., p. 1458, spéc. p. 1459, obs. Lemouland J.-J. ; Defrénois 8 nov. 2018, n° 141m6, p. 31, note Noguéro D.
-
59.
Cass. 1re civ., 9 juill. 2009, n° 08-17039 ; Cass. 1re civ., 6 janv. 2010, n° 08-20646 : RGDA 2010, p. 391, 2e esp., note Mayaux L. – Cass. 1re civ., 20 janv. 2010, n° 08-70469 : RGDA 2010, p. 391, 3e esp., note Mayaux L. – Cass. soc., 14 mars 2012, n° 11-13930 ; Cass. 1re civ., 6 juin 2012, n° 10-23352 ; Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 11-24645 ; Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n° 12-24394 ; Cass. 1re civ., 18 déc. 2013, n° 12-26366 ; Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n° 13-14745 ; Cass. 1re civ., 3 déc. 2014, n° 13-25189 ; Cass. 1re civ., 4 mars 2015, n° 14-13278 ; Cass. 1re civ., 24 juin 2015, n° 14-11084 ; Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-16323 et 15-16471 : D. 2017, Pan., p. 1490, spéc. p. 1491, obs. Lemouland J.-J. – Cass. 1re civ., 13 janv. 2021, nos 19-16703 et 19-16874 (moyen annexé) ; Cass. 1re civ., 13 janv. 2021, n° 19-15450 et 19-18474 (moyen annexé).
-
60.
Cass. 1re civ., 3 déc. 2008, n° 07-19616 ; Cass. 1re civ., 28 nov. 2012, n° 11-23175 ; Cass. 1re civ., 10 févr. 2016, n° 15-13267.
-
61.
En dehors de la présomption affichée, il advient que le juge rappelle l’appréciation souveraine de la preuve de l’insanité au moment de l’acte, pour approuver la nullité prononcée. Exemple, Cass. 1re civ., 13 avr. 2016, n° 15-17587 ; Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-25852.
-
62.
Quatrième branche, troisième moyen.
-
63.
Cinquième branche, troisième moyen, sur la dénaturation.
-
64.
C. civ., art. 414-2 ; C. civ., art. 489, al. 1er anc. ; C. civ., art. 1181.
-
65.
C. civ., art. 1179, al. 2.
-
66.
Rejet d’une question prioritaire de constitutionnalité s’agissant de l’atteinte au droit de propriété par la théorie de l’apparence, v. Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 16-22058 : Bull. civ. III – Cass. 3e civ., 22 nov. 2017, n° 16-22058.
-
67.
Sur cette formule jurisprudentielle, Cass. 1re civ., 22 juill. 1986, n° 84-17004 : Bull. civ. I, n° 214. V. le moyen annexé, la cour d’appel reprenant cette règle. Encore, Cass. 1re civ., 3 avr. 1963 : Bull. civ. I, n° 204.
-
68.
Et, d’une certaine façon, sa protection.
-
69.
C. civ., art. 2274 ; C. civ., art. 2268 anc.
-
70.
Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, n° 14-16946 : Bull. civ. I, n° 274.
-
71.
Pas davantage il ne s’agit d’un détournement de ses pouvoirs par le représenté, offrant au représentant la nullité si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l’ignorer, C. civ., art. 1157.
-
72.
Adde François J., « L’acte accompli par le mandataire en dehors de ses pouvoirs et le mécanisme du contrat de mandat », D. 2018, Chron., p. 1215.
-
73.
Noguéro D., « Les pouvoirs de la personne habilitée sur les biens du majeur protégé et les sanctions applicables », LPA 25 nov. 2016, n° 119y8, p. 7.
-
74.
Et, pourtant, au regard du principe de subsidiarité, il faut privilégier le mandat conventionnel, qui n’a pas de contrôleur autre que le mandant, ici vulnérable. V. C. civ., art. 428, al. 1er ; C. civ., art. 494-2 ; C. civ., art. 483, 4° anc. – adde, sort du mandat et inaptitude du mandant, Noguéro D., « Vulnérabilité et aptitude en France », in La vulnérabilité. Journées québécoises, Travaux de l’association Henri Capitant, t. LXVIII/2018, 1re éd., 2020, Bruylant et LB2V, p. 192, note 81.
-
75.
Cass. 1re civ., 17 mai 2017, n° 15-24840 : Bull. civ. I ; D. 2017, AJ, p. 1190 ; AJ fam. 2017, p. 406, obs. Raoul-Cormeil G. ; Dr. famille 2017, comm. 188, note Maria I. ; RTD civ. 2017, p. 610, obs. Hauser J. ; Combret J., « Mineur et société civile : soyons vigilant ! », Defrénois 30 juin 2017, n° 126y6, p. 757.
-
76.
Noguéro D., « La publicité des mesures de protection des majeurs (ouverture, vie et fin) », in Personnes-famille, Acte juridique et obligations : Mélanges en l’honneur du professeur Jean Hauser, 2012, LexisNexis-Dalloz, p. 467, et « La publicité du mandat de protection future », in Mobilité et protection des personnes vulnérables en Europe : connaissance et reconnaissance des instruments, vol. 23, 2014, Société de Législation Comparé, Colloques, p. 23.
-
77.
V. les détails, deuxième branche, premier moyen, édifiants.
-
78.
Exemple, Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 15-21790 : Bull. civ. III.
-
79.
Cass. 3e civ., 11 mai 2006, n° 05-10261.
-
80.
C. civ., art. 1178, al. 2.
-
81.
C. civ., art. 1178, al. 3, renvoi aux art. 1352 et s.
-
82.
Cass. 3e civ., 4 avr. 2019, n° 17-26783 : Defrénois 10 oct. 2019, n° 152e2, p. 43, note Noguéro D. – sur les restitutions, Cass. 1re civ., 21 juin 2005, n° 02-14172 : Bull. civ. I, n° 272 : visa des articles 549, 550, second alinéa, 815-9 et 1304 du Code civil.
-
83.
Les deux autres alinéas traitent du calcul de la valeur et du mode de restitution.
-
84.
Comp. C. civ., art. 1178 anc., abrogé en 2016 : « S’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement » ; v. aussi, sur la chose reçue et vendue, C. civ., art. 1352-2 ; C. civ., art. 1180 anc.
-
85.
Dans le chapitre I « Du droit d’accession » sur ce qui est produit par la chose.
-
86.
Cass. 3e civ., 9 déc. 1998, n° 97-12303 : Bull. civ. I, n° 242 : « l’article 549 du Code civil dispose que le possesseur de bonne foi fait les fruits siens mais que ce dernier cesse de faire les fruits siens au jour de la demande en justice » – Cass. 3e civ., 27 nov. 2002, n° 01-12444 : Bull. civ. III, n° 244 : « à compter de la demande en justice tendant à la résolution de la vente, le possesseur ne peut invoquer la bonne foi » – Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-20737 : à compter de la demande en justice en résolution ou en annulation de la vente.
-
87.
Pas davantage, pour la période suspecte, ne l’est la connaissance personnelle de celui qui traite avec la personne vulnérable, dès lors qu’il existe par ailleurs une notoriété de l’inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération des facultés personnelles.
-
88.
Second moyen, Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 18-26525. V. le moyen annexé sur la responsabilité du notaire. Le tribunal, retenant la faute, n’est pas suivi par la cour d’appel sur ce point.
-
89.
Pignarre L.-F., « Le notaire confronté à la vulnérabilité », RJPF 2018/5, n° 8, p. 7, spéc. p. 12 et 13 ; David S., « Le notaire confronté à la vulnérabilité de fait », Sol. Not. 18 juin 2020, n° 21, dossier expert, inf. 11 ; 116e congrès des notaires de France, rapp., 2020, Paris, in partie 2, Le traitement de la vulnérabilité, titre II, Le traitement de la vulnérabilité des majeurs, ss-titre II, La protection du majeur reconnu vulnérable en fait, chap. I, La vulnérabilité de fait saisie par la loi, p. 278 et s., et chap. II, Le notaire confronté à la vulnérabilité de fait, p. 303 et s. (président, David S. ; rapporteur, Prado V.).
-
90.
Impartialité et objectivité, sans mettre à profit l’état de faiblesse, Cass. 3e civ., 29 mars 2018, n° 17-13641 et 17-13963 : Defrénois 8 nov. 2018, n° 141m5, p. 29, obs. Combret J.
-
91.
Peterka N., « Sécurité juridique et protection de la personne vulnérable : un équilibre introuvable ? », LPA 30 sept. 2020, n° 156k8, p. 8 : avec les dernières évolutions, constat du recul de la protection et de l’affaiblissement de la sécurité.
-
92.
Cass. 2e civ., 5 juill. 2006, n° 05-13885 : différents éléments, dont un scanner, « ce dernier examen effectué quelques jours après la passation de l’acte de donation devant M. A. notaire, affaiblissant considérablement les déclarations de ce notaire selon lesquelles Philippe X lui avait paru en parfaite santé mentale et physique, témoignage déjà fortement amoindri par celui de M. B., notaire, qui avait refusé au même moment de recevoir d’autres actes à raison de l’état de Philippe X » ; implicitement Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 16-25313 : D. 2018, Pan., p. 1458, spéc. p. 1459, obs. Lemouland J.-J. ; Defrénois 8 nov. 2018, n° 141m6, p. 31, note Noguéro D. – implicitement Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, n° 17-17347 et 17-17364 : Defrénois 8 nov. 2018, n° 141m4, p. 30, obs. Combret J.
-
93.
Noguéro D., L’incidence de la maladie sur l’acte juridique, thèse, p. 41 et s., n° 34 (les références citées).
-
94.
Procédure qui s’applique si est contestée une mention entrant dans la mission du notaire comme le constat de la dictée de l’acte. V. C. civ., art. 972 ; exemple pour un testament, Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 17-18465 : Gaz. Pal. 30 oct. 2018, n° 334b8, p. 74, note Leducq X. : « l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de l’existence matérielle des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions ».
-
95.
Exemple, CA Bastia, 9 mars 2016, n° 14/00503 : « il convient d’analyser si à l’époque et au moment où Mme veuve H. a testé devant le notaire, les facultés intellectuelles de cette dernière étaient altérées, nonobstant l’appréciation faite par le notaire instrumentaire, laquelle ne lie pas le juge ». Ici, le notaire avait produit une lettre sur l’état de santé de sa cliente.
-
96.
Validité, Cass. 1re civ., 8 avr. 2009, n° 08-12073 : un certificat médical « attestait qu’un médecin lui avait fait pratiquer un test tout à fait satisfaisant compte tenu de son âge, et que le notaire, ayant reçu l’acte, indiquait, dans celui-ci, que Louise B. lui avait paru saine d’esprit ».
-
97.
CA Paris, 20 oct. 2017, n° 15/22729 : Defrénois 29 mars 2018, n° 134u9, p. 31, note Noguéro D. : vente immobilière, nullité, « à cet égard, les constatations du notaire sur la validité du consentement à l’acte de Monique A. sont inopérantes, cet officier ministériel n’étant pas habilité à donner un avis médical sur la lucidité de Monique A. ».
-
98.
Barthelet C., « Le notaire confronté dans la pratique à la faiblesse de son client civilement capable. D’une obligation de vigilance à un devoir de conseil renforcé, jusqu’au refus d’instrumenter », JCP N 2012, 1195.
-
99.
Comp. extension de l’attention exigée pendant le cours de la mesure judiciaire (C. civ., art. 499) ou de l’exécution du mandat de protection future (C. civ., art. 491, al. 2).
-
100.
Exemples, CA Bastia, 22 janv. 2014, n° 13/00170.
-
101.
Cass. 1re civ., 24 févr. 1998, n° 95-21473 : Bull. civ. I, n° 73 ; JCP G 1998, II 10118, note Fossier T. ; Defrénois 15 sept. 1998, n° 36860, p. 1037, obs. Massip J. ; LPA 22 févr. 1999, p. 7, note Massip J. : pour la cour d’appel « le prêt souscrit par acte authentique le 22 septembre 1987 ne présentait a priori aucun caractère déraisonnable justifiant une mise en garde du notaire ». Censure au visa de l’article 1382 du Code civil : « M. Jamet, qui jouissait de l’entière confiance de Mme X, laquelle en avait fait son notaire de famille, avait nécessairement été amené à faire le constat d’une dégradation de l’état mental de sa cliente ».
-
102.
Cass. 1re civ., 13 nov. 1997, n° 95-19686 : Bull. civ. I, n° 309 ; Resp. civ. et assur. 1998, comm. 22 ; Defrénois 15 mars 1998, n° 36753, p. 356, n° 29, obs. Aubert J.-L. : « (…) qu’après avoir relevé la notoriété et l’ancienneté de la déficience mentale de MM. Charles et Marcel Y, en considération de témoignages divers et de certificats médicaux, et constaté la faiblesse d’esprit de ces personnes qui ne possédaient pas les facultés nécessaires pour apprécier la portée de leurs engagements, l’arrêt énonce qu’il résulte de l’ensemble des documents examinés que l’altération mentale des deux frères existait avant la signature de l’acte notarié et que ces troubles étaient manifestes, même pour une personne dépourvue de connaissance dans le domaine médical, de sorte que le notaire ne pouvait pas ne pas s’apercevoir de cet état », « ce notaire avait manqué à ses obligations en recueillant les signatures de MM. Marcel et Charles Y en dépit de l’altération évidente de leurs facultés ».
-
103.
Cass. 1re civ., 30 mai 1995, n° 93-13758 : Bull. civ. I, n° 226 ; RTD civ. 1996, p. 386, obs. Mestre J. ; Resp. civ. et assur. 1995, comm. 305 ; JCP G 1995, IV 1810 – Cass. 1re civ., 24 févr. 1998, n° 95-21473 ; Cass. 1re civ., 2 oct. 2013, n° 12-24754, 12-26223, 12-25862 et 12-27874 : Bull. civ. II, n° 196 ; AJ fam. 2013, p. 718, obs. Raoul-Cormeil G. ; JCP N 2013, 1282, spéc. n° 20, obs. Mekki M.
-
104.
Cass. 1re civ., 18 déc. 1984, n° 83-13908 : Bull. civ. I, n° 339 ; D. 1985, IR, p. 170 ; JCP G 1985, IV 78 ; Journ. not. 1985, art. 58070, p. 373, n° 3, obs. de La Marnierre E.-S. ; Gaz. Pal. Rec. 1985, 2, Pan., p. 215, obs. Grimaldi M. ; Gaz. Pal. Rec. 1985, 1, p. 387, note Massip J. ; Defrénois 1985, n° 33535, p. 707, n° 42, obs. Massip J. ; RTD civ. 1986, p. 327, obs. Rubellin-Devichi J. – Cass. 1re civ., 9 févr. 1999, n° 97-10317 : Defrénois 30 juin 1999, n° 37008, p. 758, note Aubert J.-L. : procuration donnée au clerc du notaire instrumentant, annulée pour insanité. Sur la responsabilité : « à l’époque de la procuration l’insanité mentale de A. était acquise mais que demeurait une façade d’automatismes et de courtoisie, l’arrêt énonce qu’il était exclu que le notaire se fût nécessairement aperçu de la dégradation de l’état mental de sa cliente ; qu’ayant, ainsi souverainement constaté que l’existence de circonstances particulières permettant au notaire de mettre en doute les facultés mentales du client n’était pas établie ».
-
105.
Cass. 1re civ., 30 mai 1995, n° 93-13758 : Bull. civ. I, n° 226 ; RTD civ. 1996, p. 386, obs. Mestre J. ; Resp. civ. et assur. 1995, comm. 305 ; JCP G 1995, IV 1810. Un autre argument était aussi peu pertinent : « le notaire ne peut refuser d’instrumenter un acte qu’à la condition que l’une des parties soit incapable et fasse l’objet d’une mesure de protection ». L’inaptitude de fait doit conduire aussi à l’abstention. En outre, le professionnel est démenti lorsqu’il soutient qu’on ne peut reprocher « au notaire de ne pas avoir émis de réserves sur la validité de la vente sans relever que l’altération des facultés mentales de Mlle Z était manifeste ou pouvait être appréhendée par le profane qu’est le notaire ».
-
106.
Cass. 2e civ., 2 oct. 2013, n° 12-24754, 12-26223, 12-25862 et 12-27874 : Bull. civ. II, n° 196 ; AJ fam. 2013, p. 718, obs. Raoul-Cormeil G. ; JCP N 2013, 1282, spéc. n° 20, obs. Mekki M. : en vain, il a été défendu que « le notaire chargé d’authentifier une vente n’est pas tenu de vérifier les capacités intellectuelles d’une partie qui a consenti, hors sa présence, un mandat en vue de la conclusion de l’acte authentique » ; que « le notaire ne peut refuser d’instrumenter un acte ou, en présence d’un mandat, exiger l’intervention personnelle du mandant, qu’en présence d’éléments révélateurs d’une situation anormale » ; que « le notaire n’est pas garant de l’exécution des obligations du professionnel intervenu lors de la conclusion, hors sa présence et avant son intervention, d’un acte sous-seing privé ».
-
107.
D. n° 2020-1422, 20 nov. 2020, instaurant la procuration notariée à distance. Facilité toujours adaptée à la cause ? Interrogation rhétorique.
-
108.
Avertissement spécial sur cet acte, 116e congrès des notaires de France, rapp., 2020, p. 317, n° 1604, et p. 319, n° 1606 : enquête de la fondation Médéric Alzheimer – v. not. Cass. 2e civ., 2 oct. 2013, n° 12-24754.
-
109.
Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 16-12958 : RJPF 2017/4, n° 19, obs. Mauclair S. ; D. 2017, Pan., p. 1490, spéc. p. 1491, obs. Lemouland J.-J. ; Defrénois 12 oct. 2017, n° 129s4, p. 29, obs. Noguéro D. : « lors de la signature de l’acte sous seing privé portant promesse de vente, à laquelle la venderesse était représentée par une de ses filles, aucun élément ne permettait au notaire d’envisager que la santé de celle-là puisse être affectée ni de remettre en cause la validité du mandat de représentation ; qu’il ajoute qu’il n’en était pas de même au moment de la réitération de la vente par acte authentique, en raison d’une altération des facultés de la venderesse, survenue peu avant ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a justement déduit que la promesse était valable et que le notaire aurait commis une faute seulement si, ne tenant pas compte de la situation nouvelle dans laquelle se trouvait la venderesse, il n’avait pas sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc pour parvenir à la signature d’un acte authentique offrant toute garantie de sécurité juridique ». Il faudrait encore s’interroger sur la source du pouvoir (mandataire judiciaire ou conventionnel), car on pourrait questionner sa valeur.
-
110.
Cass. 1re civ., 13 nov. 1997, n° 95-19686 : Bull. civ. I, n° 309 ; Resp. civ. et assur. 1998, comm. 22 ; Defrénois 15 mars 1998, n° 36753, p. 356, n° 29, obs. Aubert J.-L.
-
111.
Comp. 116e congrès des notaires de France, rapp., 2020, p. 308, n° 1593 : « le doute ressenti par le notaire doit être corroboré ou infirmé par un homme de l’art ».
-
112.
Devoir du professionnel, 116e congrès des notaires de France, rapp., 2020, p. 313 et 314, n° 1600. Il est précisé des suites éventuelles au refus d’instrumenter.
-
113.
V. encore sur la responsabilité pénale et disciplinaire, 116e congrès des notaires de France, rapp., 2020, p. 317 et 318, n° 1605.
-
114.
116e congrès des notaires de France, rapp., 2020, p. 315 et 316, n° 1604. La nuance de la jurisprudence est soulignée.
-
115.
Exemple a contrario, pour une banque, s’agissant du manquement à son obligation de vigilance (des retraits d’argent par une personne âgée vulnérable accompagnée), Cass. com., 27 janv. 2015, n° 13-20088 : Resp. civ. et assur. 2015, comm. 121.
-
116.
La SCI n’a pas relevé pourvoi incident contre le notaire, d’où l’absence de cassation par voie de conséquence à son égard (CPC, art. 624).
-
117.
Les réalités s’imposent et sont admises par la loi. C. civ., art. 415, al. 3. La protection juridique, qui « a pour finalité l’intérêt de la personne protégée (…) favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci ».
-
118.
116e congrès des notaires de France, rapp., 2020, p. 302, n° 1583. Malgré la volatilité admise de la clientèle, la figure du notaire de « famille » est évoquée, qui permet de mieux s’apercevoir de l’évolution de la situation d’un client. De même, le client nouveau doit renforcer l’attention.
-
119.
Pas d’insanité, en soi, Cass. 3e civ., 11 mars 2009, n° 08-10119, 08-10337 et 08-11293 ; en revanche, avec des critères associés, Cass. 1re civ., 9 févr. 2012, n° 10-25574.
-
120.
V. à ce propos, le débat et les références, Noguéro D., « Vulnérabilité et aptitude en France », in La vulnérabilité. Journées québécoises, Travaux de l’association Henri Capitant, t. LXVIII/2018, 1re éd., 2020, Bruylant et LB2V, p. 177 ; comp. sur la pente glissante de l’« âgisme » qui serait à éviter (spéc. nos 8 et 25), Beauruel M., « L’appréhension du grand âge dans le contentieux du testament », LPA 2 janv. 2020, n° 149n9, p. 8. Pour une nouvelle « présomption légale » « simple » : « La personne de 85 ans est présumée incapable de tester ». « L’insanité d’esprit serait légalement présumée à partir de 85 ans » (n° 23). La règle de preuve serait protectrice dans cette logique que nous réfutons. L’auteur indique la possibilité du certificat comme solution « sans doute moins radicale ». Comme alternative, est également préconisé, le seuil d’âge atteint, un placement systématique sous sauvegarde de justice, continue, partant rénovée (n° 24). En ce sens (sauvegarde « spéciale vieillesse »), avec des nuances désormais, liées à la sécurité juridique, Beauruel M., « Le notaire confronté à la vulnérabilité de fait », LPA 5 oct. 2020, n° 156m1, p. 5, spéc. n° 22 à 24 ; pas franchi, Rebourg M., « Vers un statut des personnes âgées ? Réflexions à la lumière du droit brésilien », RDSS 2020-1, p. 83.
-
121.
Fondation Médéric Alzheimer, Le notaire face aux citoyens en situation de handicap cognitif. Repères pour la pratique, 2014 ; 116e congrès des notaires de France, rapp., 2020, p. 302 à 308, n° 1584 à 1590, p. 314, n° 1601, et p. 319 à 320, n° 1606 (enquête de la fondation Médéric Alzheimer) : et les influences abusives. Renvoi à la brochure de la fondation. Et son enquête, Notaires, personnes âgées et troubles cognitifs, publiée dans La lettre de l’Observatoire, juin 2017, n° 47. Attention toutefois au « monopole » des propositions en ce domaine.
-
122.
C. civ., art. 430, al. 2.
-
123.
C. civ., art. 415, al. 4 ; comp. les signalements de services sociaux, encore, C. civ., art. 484 ; C. civ., art. 494-10 ; C. civ., art. 499.
-
124.
Comp. David S., « Les évolutions souhaitables du mandat de protection future : le mandant (1re partie) », 1re commission Protéger les personnes vulnérables, Defrénois 17 sept. 2020, n° 162a4, p. 21, hors-série (116e congrès). À côté du mandat par assistance, une mesure restrictive de droits – soit substitutive (comp. le dessaisissement pour les époux, C. civ., art. 217 ; C. civ., art. 219 ; C. civ., art. 1426 et C. civ., art. 1429) –, de représentation, avec la modification approuvée à 69 % des articles 488 et 1159, alinéa 2, du Code civil, et la création de l’article 488-1 pour les sanctions. V. déjà, sur la limitation de capacité juridique du majeur dans le mandat de protection future (et autres propositions), Noguéro D., notes sous Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 15-18669 : D. 2017, Pan., p. 1490, spéc. p. 1503 ; D. 2017, p. 191 – et Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 18-14250 : LPA 18 juin 2019, n° 144z1, p. 7 (I, in fine) – et Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-19079 : LPA 29 oct. 2019, n° 147k4, p. 3, spéc. p. 11 et 12 ; et, Noguéro D., « La publicité du mandat de protection future », in Mobilité et protection des personnes vulnérables en Europe : connaissance et reconnaissance des instruments, vol. 23, 2014, Société de Législation Comparé, Colloques, p. 28-29, 33 ; « Vulnérabilité et aptitude en France », in La vulnérabilité. Journées québécoises, Travaux de l’association Henri Capitant, t. LXVIII/2018, 1re éd., 2020, Bruylant et LB2V, p. 194, note 94.
-
125.
Une menace ? Peut-on entériner des pratiques déviantes ?
-
126.
116e congrès des notaires de France, rapp., 2020, p. 309, n° 1593 : Passage souligné, rédigé en couleur dans le texte du rapport.
-
127.
C. civ., art. 491.
-
128.
C. civ., art. 479, al. 3 ; CPC, art. 1258-2, 2°.
-
129.
Exemple, C. civ., art. 507-1. Acceptation de succession et attestation du notaire.
-
130.
Visiblement encouragée, comme démarche à suivre, 116e congrès des notaires de France, rapp., 2020, p. 302, n° 1584 : « Parce que le notaire est un juriste et non un médecin, il ne lui appartient pas d’évaluer les capacités cognitives de ses clients. Il a donc tout intérêt, quand le besoin s’en fait sentir, de déléguer cette tâche à un homme de l’art, dont c’est la compétence, et à solliciter de sa part la délivrance d’un certificat médical ». Leitmotiv de l’incompétence du notaire et de la nécessité de recourir au certificat, 116e congrès des notaires de France, rapp., 2020, p. 303, n° 1585, p. 308, n° 1591, p. 309, n° 1593, et p. 310 et 311, n° 1596 (et la collaboration médecin/notaire), et p. 318, n° 1606. Précisons que cette « délégation » n’enlève rien à l’entière responsabilité du notaire qui aurait instrumenté à tort.
-
131.
Certificat établi à la demande de l’agent immobilier, CA Paris, 13 janv. 2017, n° 15/04651.
-
132.
Cependant, dernièrement, un message, 116e congrès des notaires de France, rapp., 2020, p. 309, n° 1593 : « Il est souvent opposé qu’un avis médical ne constitue nullement une garantie contre une annulation de l’acte et, bien plus, que le certificat médical peut même être utilisé comme un élément indiquant que le notaire avait des doutes sur la capacité de son client, ce qui, à notre sens, est inaudible ». 116e congrès des notaires de France, rapp., 2020, p. 319, n° 1606 : enquête de la fondation Médéric Alzheimer.
-
133.
Mesuré, Pignarre L.-F., « Le notaire confronté à la vulnérabilité », RJPF 2018/5, n° 8, p. 7, spéc. p. 13 : préféré à la présence de témoins pour préconstituer la preuve, « le certificat médical ne dispense pas le notaire de vérifier, par lui-même, la faculté de discernement de son client ».
-
134.
Beauruel M., « L’appréhension du grand âge dans le contentieux du testament », LPA 2 janv. 2020, n° 149n9, p. 8, spéc. n° 20, et sur la « zone grise » définie, n° 21. Toutefois, l’auteur propose de dresser une présomption d’incapacité et d’inaptitude à partir de 85 ans pour le testament, avec la réserve d’une autre option. « Une seconde possibilité, sans doute moins radicale que la première, pourrait être d’imposer à la personne âgée un examen médical pour être autorisée à rédiger son testament. Cette proposition ne serait d’ailleurs qu’une consécration de la pratique notariale ». « À défaut de présenter un certificat médical, la personne de 85 ans est incapable de tester » (spéc. n° 23). Les réalités budgétaires feraient obstacle à une telle démarche. D’où l’alternative du monopole notarié ou la combinaison avec le certificat : « Si le testateur est âgé de 85 ans, son testament devra prendre la forme authentique ». V. Beauruel M., « Le notaire confronté à la vulnérabilité de fait », LPA 5 oct. 2020, n° 156m1, p. 5, spéc. n° 19.
-
135.
CA Bastia, 14 févr. 2016, n° 14/00497 : testament annulé ; CA Colmar, 21 avr. 2016, n° 14/03540 : compromis de vente annulé. Pour écarter la nullité, il était notamment avancé « que cet acte a été reçu par un notaire, qui ne peut recevoir la signature d’une personne manifestement atteinte de trouble mental ».
-
136.
CPC, art. 146 ; V. Cass. 1re civ., 2 mars 2004, n° 02-15211 : Bull. civ. I, n° 70 (indépendamment du secret).
-
137.
CPC, art. 238.
-
138.
CPC, art. 246.
-
139.
Aspects de procédure (not. contradictoire), Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-22121 : D. 2020, Pan., p. 1485, spéc. p. 1486, obs. Lemouland J.-J.
-
140.
C. civ., art. 476 ; v. Cass. 1re civ., 8 mars 2017, n° 16-10340 : Bull. civ. I ; JCP N 2017, 355 ; AJ fam. 2017, p. 250, obs. Raoul-Cormeil G. ; LPA 27 avr. 2017, n° 126b6, p. 15, note Noguéro D. ; Dr. famille 2017, comm. 109, 1re esp., note Maria I. ; RJPF 2017/5, n° 44, obs. Mauclair S. ; D. 2017, Pan., p. 1490, spéc. p. 1503, obs. Lemouland J.-J. ; RTD civ. 2017, p. 354, obs. Hauser J. ; RTD civ. 2017, p. 465, obs. Grimaldi M. ; Defrénois 12 oct. 2017, n° 129s1, p. 27, obs. Combret J.
-
141.
Détecté, il est susceptible d’être reproché au médecin, en discipline, déontologie et responsabilité. Le complice du praticien ne serait pas à l’abri. Cass. 2e civ., 5 janv. 2017, n° 15-28925 : blâme de l’ordre pour le même médecin délivrant, par complaisance, deux certificats différents aux parties s’affrontant sur l’insanité.
-
142.
Droit propre, Cass. crim., 13 oct. 2020, n° 19-87341 : Bull. crim.
-
143.
Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-23197 : Bull. civ. I, n° 177 ; D. 2014, Pan., p. 2259, spéc. p. 2261, obs. Noguéro D. ; AJ fam. 2013, p. 716, obs. Vernières C. ; Resp. civ. et assur. 2013, comm. 393 ; RGDA janv. 2014, n° 110c8, p. 45, note Mayaux L. : « La cour d’appel a relevé que Mme Y était la rédactrice de l’avenant manuscrit signé par René X 2 mois avant son décès, après une intervention chirurgicale et pendant son hospitalisation dans une unité de soins palliatifs et que sa signature révélait des indices de détérioration morphologique pouvant être mis en relation avec une grande fatigue physique ; qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui a souverainement estimé qu’il n’était pas établi que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document au bas duquel il avait apposé sa signature, ni qu’il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat » – comp. dernières « volontés » pour les funérailles, Cass. 1re civ., 15 juin 2007, n° 07-14895.
-
144.
Exemples, Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n° 15-12454 ; Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, n° 16-24498 – Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n° 19-13202. Adde : Noguéro D., L’incidence de la maladie sur l’acte juridique, thèse, p. 200 et s., nos 175 et s.
-
145.
Cass., avis, 20 juin 2011, n° 11-00004 : Bull. civ. avis, n° 7 (moyen annexé) : conclusion du mandat le 6 décembre 2010, et prise d’effet à compter du 20 janvier 2011.
-
146.
Cass. crim., 30 janv. 2019, n° 13-81257 et 16-85919.
-
147.
C. civ., art. 481 ; CPC, art. 1258, 2° ; CPC, art. 1258-1, 2°.
-
148.
Beauruel M., « Le notaire confronté à la vulnérabilité de fait », LPA 5 oct. 2020, n° 156m1, p. 5, spéc. n° 11.
-
149.
V. 116e congrès des notaires de France, rapp., 2020, p. 307, n° 1587.
-
150.
Noguéro D., note sous CA Paris, 20 oct. 2017, n° 15/22729 : Defrénois 29 mars 2018, n° 134u9, p. 31, spéc. p. 32 – Beauruel M., « Le notaire confronté à la vulnérabilité de fait », LPA 5 oct. 2020, n° 156m1, p. 5, spéc. n° 19 ; et n° 5 pour la définition de la « zone grise » ; n° 20, pour la technique des témoignages.
-
151.
Cass. 1re civ., 12 févr. 2014, n° 12-29376 (moyen annexé) : ici, en outre, pas d’abus de faiblesse subi par le testateur ayant dicté devant témoins. Dans un contexte familial houleux, avant cet acte, il avait fait établir, « à la demande du notaire, un certificat médical ayant confirmé sa lucidité, sa conscience et l’absence d’aliénation mentale ».
-
152.
Cass. 1re civ., 18 déc. 1984, n° 83-13908 : Bull. civ. I, n° 339 ; D. 1985, IR, p. 170 ; JCP G 1985, IV 78 ; Journ. not. 1985, art. 58070, p. 373, n° 3, obs. de La Marnierre E.-S. ; Gaz. Pal. Rec. 1985, 2, pan., p. 215, obs. Grimaldi M. ; Gaz. Pal. Rec. 1985, 1, p. 387, note Massip J. ; Defrénois 1985, n° 33535, p. 707, n° 42, obs. Massip J. ; RTD civ. 1986, p. 327, obs. Rubellin-Devichi J. : « la cour d’appel a estimé que ce notaire ayant été “alerté” par la fille de M. Y » « “le fait d’avoir conseillé, l’avant-veille de l’acte, de faire établir un certificat par le médecin traitant n’était pas suffisant et qu’il aurait dû “proposer l’examen par un médecin certificateur après consultation de Mme X sur le choix de celui-ci” ». Si cette précaution plus haute n’est pas exigée, ici, la production du certificat n’empêche pas de rechercher, le cas échéant, des circonstances particulières, ce qui tempère la portée de la démarche : « en se déterminant ainsi, alors que, compte tenu des réserves émises par la fille de Jean-Baptiste Y, le notaire avait, en faisant demander l’avis du médecin traitant, pris une précaution qui était en principe suffisante, de sorte que la responsabilité de l’officier public ne pouvait être engagée que si des circonstances particulières lui permettaient de mettre en doute, les facultés mentales de son client, la cour d’appel, (…) n’a pas recherché si de telles circonstances étaient réunies en l’espèce » – Cass. 1re civ., 3 déc. 2008, n° 07-19616 : testament authentique de la testatrice décédée sans héritier réservataire, avec « un certificat médical, annexé à cet acte, établi par M. Z, médecin, le 9 janvier 2002 [qui] attestait que la testatrice possédait “toutes ses facultés mentales, intellectuelle et physiques” ». Sur action en nullité de la nièce, la Cour estime que le juge d’appel « a souverainement estimé que les certificats médicaux du docteur B. n’établissaient pas l’insanité d’esprit de la testatrice, un certificat médical contraire du 9 janvier 2002 étant même produit ». Les preuves sont appréciées. Cass. 1re civ., 10 févr. 2016, n° 15-13267 : « le certificat du docteur A., établi à la date la plus proche de celle des testaments et la veille de la signature de l’acte de vente, atteste qu’elle était en pleine possession de ses facultés mentales et intellectuelles ». Là encore, les différentes preuves sont appréciées.
-
153.
Implicitement Cass. 2e civ., 9 oct. 2008, n° 07-18192 : insanité certes repoussée, surtout sur le terrain de la preuve intrinsèque non satisfaite. Le moyen décrit une pratique dans un certain contexte. Le plaideur « insistait sur les données suivantes : “l’acte fut passé, non pas en l’étude du notaire mais à la clinique Vallette par M. E.” ; que ce notaire mandaté par Mme C., conscient de l’état dans lequel était François X, a pris la précaution de solliciter du docteur F., qui traitait M. X, un certificat médical ; que les dates sont ici capitales, ce certificat daté du 18 octobre 1993 indiquait : “je soussigné, Docteur F., déclare que François X est en possession de toutes ses facultés mentales”, cependant que l’acte de vente a été signé le 19 octobre 1993, soit le lendemain de la rédaction du certificat médical ci-dessus invoqué, alors qu’il a été établi que le 19 octobre 1993 M. X était privé de toute conscience et ne pouvait valablement s’engager de façon consciente dans un acte notarié d’une telle importance ».
-
154.
Avertissement sur l’effet contraire de la précaution, révélant le doute sur l’aptitude du client, dès lors arme à double tranchant, Pignarre L.-F., « Le notaire confronté à la vulnérabilité », RJPF 2018/5, n° 8, p. 7, spéc. p. 13 : « En définitive, aucune solution ne paraît décisive ».
-
155.
Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 09-13635 : Bull. civ. I, n° 209 – Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-20428 ; Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-26683 : visa des articles 414-1, 414-2, 3°, et 466 du Code civil.
-
156.
116e congrès des notaires de France, rapp., 2020, p. 315, n° 1602.
-
157.
Tardy-Joubert S., « Des propositions pour améliorer la protection des personnes vulnérables, des proches et du logement », LPA 20 oct. 2020, n° 157f3, p. 6 : relevant la proposition du « mandat de fatigue », et la bonne pratique, dans la « zone grise » du certificat médical ; Peterka N., « Sécurité juridique et protection de la personne vulnérable : un équilibre introuvable ? », LPA 30 sept. 2020, n° 156k8, p. 8 : face à la pratique « à double tranchant » pouvant révéler le doute du notaire, l’auteur estime que la « clarification législative serait donc ici bienvenue » ; Pando A., « Mandat de protection future : les pistes d’amélioration des notaires », LPA 27 nov. 2020, n° 157u1, p. 3, in fine : ajout à l’article 414-1 du Code civil, « En cas de doute sérieux sur la santé d’esprit de l’une des parties à l’acte, en raison notamment de son grand âge, ou d’un état de santé précaire, le rédacteur de l’acte prendra le soin de solliciter la production d’un certificat rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République avant, le cas échéant, de rédiger son acte » ; contra Montourcy V., « Congrès des notaires », AJ fam. 2020, p. 544.
-
158.
V. déjà nos observations ci-dessus à ce sujet.
-
159.
116e congrès des notaires de France, rapp., 2020, not., sur les effets du certificat médical, et le double intérêt, p. 312, n° 1598 : « Le recours à un certificat médical permet au notaire de prendre une décision éclairée par l’expertise d’un professionnel de santé, dans l’intérêt du vulnérable, ainsi protégé contre lui-même et contre autrui. Il va ainsi sécuriser l’acte qu’il reçoit et accessoirement évincer les risques attachés à une responsabilité civile professionnelle, que l’on sait, en la matière, particulièrement renforcée ».
-
160.
116e congrès des notaires de France, rapp., 2020, p. 315, n° 1603.
-
161.
Hypothèse évoquée, 116e congrès des notaires de France, rapp., 2020, p. 313, n° 1599.
-
162.
116e congrès des notaires de France, rapp., 2020, p. 309, n° 1594.
-
163.
CSP, art. L. 1110-4.
-
164.
Situation admise, examinée à propos de l’éventuelle fin de non-recevoir du praticien de la santé, 116e congrès des notaires de France, rapp., 2020, p. 311 et 312, n° 1597.
-
165.
116e congrès des notaires de France, rapp., 2020, p. 312, n° 1597. Il est rappelé que le notaire n’a, pour l’heure, pas droit à communication (vœu d’une autre possibilité ?) ; et qu’il reste la transmission par le client lui-même.
-
166.
116e congrès des notaires de France, rapp., 2020, p. 309, n° 1595.
-
167.
D’où l’organisation de la renonciation régulière au secret, Cass. 1re civ., 25 juin 2020, n° 19-15642 : RGDA sept. 2020, n° 117s1, p. 38, note Kullmann J. ; AJ contrat 2020, p. 445, obs. Néraudau B. et Guillot P. ; Gaz. Pal. 27 oct. 2020, n° 389t7, p. 59, note Waltz-Teracol B.
-
168.
116e congrès des notaires de France, rapp., 2020, p. 310, n° 1595. Différents motifs sont avancés qui en contredisent d’autres comme celui de la bonne connaissance préalable de la personne.
-
169.
C. civ., art. 431.
-
170.
Protection juridique des majeurs vulnérables, rapp. du défenseur des droits, sept. 2016 ; rapp. de mission interministérielle, L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, 21 sept. 2018, dit Rapport du groupe Anne Caron-Déglise ; rapp. d’information n° 2075 du 26 juin 2019, AN, sur les droits fondamentaux des majeurs protégés, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, présenté par Abadie C. et Pradié A.