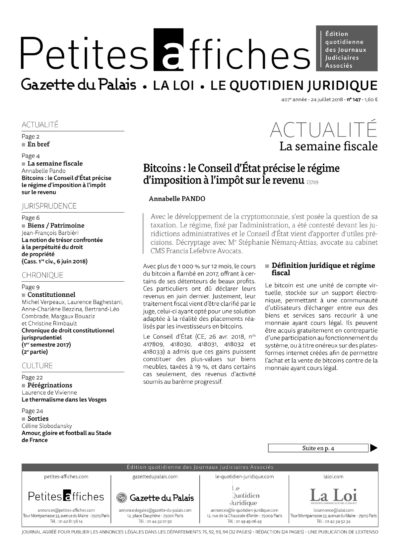Chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel (1er semestre 2017) (2e partie)
La chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel est ouverte à l’ensemble des décisions susceptibles d’intéresser le droit constitutionnel dans sa dimension contentieuse considérée de la manière la plus large. C’est ainsi que le contentieux électoral est intégré dans la présente chronique qui est divisée en quatre parties correspondant aux thèmes principaux du droit constitutionnel contemporain qui intègre aussi bien les questions institutionnelles que les problèmes de hiérarchie des normes et la place des droits et libertés.
La chronique présentée ci-dessous couvre le premier semestre de l’année 2017.
I – Les institutions constitutionnelles
A – Les pouvoirs politiques : le pouvoir exécutif
B – Les pouvoirs politiques : le Parlement et la procédure législative
1 – Les validations législatives (…)
2 – Le contrôle de la procédure législative
3 – La compétence et le domaine de la loi
C – Le pouvoir juridictionnel (…)
D – Le pouvoir financier (…)
E – Les collectivités décentralisées
F – Droits électoraux, contentieux des élections et des référendums
II – Le procès constitutionnel
A – Les acteurs et les actes devant le Conseil constitutionnel
Concernant les actes susceptibles de contrôle, le Conseil constitutionnel s’est, comme à l’accoutumée, montré soucieux du périmètre de la saisine. Il a ainsi limité à un seul mot la question de constitutionnalité qui lui était posée1 et a également entendu contrôler la « version » du texte qui lui était soumise eu égard aux limites que les exigences de la conventionnalité imposent à son examen2.
Dans cette espèce, le Conseil constitutionnel a considéré, tout d’abord, que l’article L. 136-6 du CSS était attaqué dans sa version résultant de la loi du 20 décembre 2006 au vu du fait générateur de l’impôt contesté. Ensuite, il a précisé que l’article 132 de la loi de finances pour 1990 avait déjà été déclaré conforme à la Constitution dans sa version de 1990 (à l’origine de l’actuel article L. 136-6) dans les motifs mais pas dans le dispositif de la décision3, ce qui pouvait permettre un examen en QPC. En revanche, l’article avait été déclaré conforme dans les motifs et le dispositif d’une précédente décision QPC, pour ce qui est du c de son paragraphe 14, ce qui justifiait que cette partie de l’article ne soit pas examinée en l’espèce. Enfin, le juge constitutionnel a été amené à préciser la recevabilité de la question en ce qu’elle portait sur l’interprétation constante de la disposition de la loi telle qu’opérée par le Conseil d’État qui, lui-même, appliquait la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne.
L’interprétation résultait d’ailleurs indirectement de l’application d’un règlement européen. Le Conseil constitutionnel devait-il considérer que contrôler l’interprétation constante du Conseil d’État revenait à contrôler indirectement la régularité du droit de l’Union, ou au contraire, devait-il considérer que l’interprétation du Conseil d’État méritait d’être confrontée au bloc de constitutionnalité au regard de la discrimination qu’elle induit, et cela quelles que soient les motivations qui la fondent (droit de l’Union européenne ou pas) ? Le Conseil constitutionnel a choisi la deuxième option, affaiblissant sa jurisprudence Metro Holding, en laissant la voie ouverte à un contrôle différencié d’une disposition de loi appliquant le droit de l’Union européenne et qui crée une discrimination suivant que cette discrimination résulte du seul droit national ou de l’application directe du droit de l’Union.
B – La procédure devant le Conseil constitutionnel (…)
C – Les techniques contentieuses (…)
D – L’autorité et les effets des décisions du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a estimé, sans surprise, qu’il lui appartenait d’examiner une disposition de loi qu’il n’avait précédemment examinée que dans les motifs de sa précédente décision et non dans son dispositif5 sans avoir à rechercher de changement de circonstances.
Quant au changement de circonstances lui-même, le Conseil constitutionnel a été amené à en préciser le champ d’application lorsque c’est l’une de ses propres jurisprudences qui est susceptible de constituer le changement6. D’après les requérants, le Conseil avait modifié sa jurisprudence, depuis la précédente décision rendue sur l’article litigieux7, concernant la légalité des délits et des peines en estimant que ce principe méritait de s’appliquer également aux sanctions disciplinaires, cela depuis une jurisprudence de 20148. Subtilement, il était ainsi amené à interpréter sa propre interprétation pour déterminer si cette dernière était de nature à avoir modifié le droit applicable. Le Conseil constitutionnel se retrouvant ainsi maître de son pouvoir normatif. En l’espèce, le Conseil a considéré qu’il était erroné d’estimer que la jurisprudence ait étendu la compétence du législateur ou l’ait modifiée dans un sens quelconque, déniant ainsi à cette décision toute valeur de « changement de circonstances ».
Il a enfin précisé « l’objet analogue » qu’ont certaines dispositions de lois entre elles et qui étend à une disposition, non expressément contrôlée par le Conseil, le bénéfice de la chose jugée par lui9. Les requérants invoquaient les réserves d’interprétation formulées par le Conseil constitutionnel dans deux décisions rendues sur la conformité de l’article 232 du CGI, dans sa version initiale et dans sa version modifiée10, qui visaient toutes deux à ce que ne soient pas assujettis à la taxe sur les logements vacants, les logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur. In fine, la requête entendait tabler sur l’analogie entre ces réserves d’interprétation portant sur la taxe sur les logements vacants et l’interprétation constante que retient le Conseil d’État pour les exonérations de la taxe foncière. Ici, la méconnaissance de la chose jugée aurait résulté à la fois de l’interprétation constante du juge administratif et d’une interprétation par analogie, ce qui s’avérait particulièrement audacieux. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief en raison de l’absence d’analogie d’objet entre les textes concernés.
Quant aux abrogations avec effet immédiat dans le cadre du contrôle de QPC, le Conseil constitutionnel a privilégié leur usage en précisant dans les Commentaires que ce type d’abrogation pouvait aboutir, en matière fiscale, à des régimes à deux vitesses suivant que les sociétés avaient choisi des options fiscales avant ou après la législation censurée11. Il a précisé – toujours en matière fiscale – que les dispositions abrogées ne pourraient pas être invoquées dans des affaires déjà jugées à cette date, ni ne pourraient remettre en cause des transactions acquises12 ; les dispositions abrogées ne peuvent pas non plus – assez logiquement – être invoquées à l’encontre d’impositions qui n’ont pas été contestées auparavant13, et cela dans le respect des délais fixés par le LPF14. Il a également pratiqué l’abrogation avec effet immédiat, c’est relativement traditionnel, lorsqu’étaient censurées des infractions pénales, de manière à ce que cette abrogation soit appliquée aux affaires non jugées définitivement à cette date15.
Enfin, il a poursuivi dans la voie des régimes transitoires proposés par réserve interprétative – alors même que cette pratique avait été initiée dans le cadre des abrogations avec effet différé – en précisant dans la décision n° 641 QPC que les délais d’appel applicables après abrogation devaient être les délais de droit commun16.
Le Conseil constitutionnel a également choisi le régime transitoire applicable après une abrogation avec effet différé17. Après avoir censuré les règles de temps d’antenne applicables pour les élections législatives, il a estimé devoir différer l’abrogation au 30 juin 2018 de manière à ne pas priver de toute base légale la régulation électorale du CSA pour les élections à venir. Néanmoins, loin de laisser le CSA libre de fixer les temps d’antenne dans une nouvelle recommandation, le Conseil constitutionnel a précisé que ce temps devait tenir compte du nombre de partis candidats et de la représentativité de ces partis dont il a même donné les critères d’appréciation : cette représentativité devant être appréciée au vu des résultats obtenus lors des dernières élections. Le Conseil constitutionnel joue ici l’office du législateur en donnant des limites à l’appréciation du CSA, relatant même dans les Commentaires aux cahiers, ses sources d’inspiration18. Les mêmes Commentaires précisent que le Conseil n’a fait ici qu’imposer la seule interprétation valable pour augmenter le temps d’antenne accordé au parti En marche !, tout en fixant un « plafond » de temps supplémentaire, directement issu de l’inventivité du Conseil constitutionnel qui n’a décidément plus de limites.
ACB
III – Les normes de références
A – Les sources matérielles (…)
B – Les droits et libertés
Cons. const., 9 juin 2017, n° 2017-635 QPC, M. Émile L. Dans la décision n° 2017-635 QPC du 9 juin 2017, le Conseil constitutionnel avait à connaître des dispositions législatives donnant la compétence de prononcer des interdictions de séjour aux préfets des départements dans lesquels l’état d’urgence a été déclaré.
Le 3° de l’article 5 de loi relative à l’état d’urgence du 3 avril 1955 autorisait le préfet de département à « interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics ». Depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence le 14 novembre 2015, plus de 600 interdictions de séjour ont été prononcées. Ces mesures ont surtout été utilisées pour empêcher des personnes de participer à des manifestations19.
Le justiciable, auteur de la QPC, se trouvait dans cette situation. Le préfet de Paris lui avait interdit le séjour dans les arrondissements où une manifestation avait lieu. Il a alors formé un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté d’interdiction de séjour et, à cette occasion, a posé une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’interdiction de séjour. La question fut transmise au Conseil d’État, puis au Conseil constitutionnel au motif qu’elle présentait un caractère sérieux « notamment en ce qui concerne la liberté d’aller et venir »20.
Devant le Conseil constitutionnel, le requérant et la Ligue des droits de l’Homme, association intervenante, fit valoir que la disposition portait atteinte à la liberté de manifestation, à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de vie privée, au droit de mener une vie familiale normale et à la liberté de travailler. D’une part, ils estimaient que, par sa généralité, la disposition contestée permettait de prononcer une interdiction de séjour pour un autre but que la préservation des atteintes à l’ordre public. D’autre part, ils soulignaient que le prononcé de l’interdiction n’était entouré d’aucune garantie quant à son périmètre et à sa durée. Cela pouvait conduire à ce que le domicile ou le lieu de travail de l’intéressé s’y trouvent inclus pour des durées indéfinies (§ 2).
Le Conseil constitutionnel dut déterminer si le législateur pouvait confier une telle compétence au préfet de département et, dans l’affirmative, si cette compétence pouvait avoir pour seule condition l’intention d’une personne d’entraver l’action des pouvoirs publics.
Le Conseil a considéré que les dispositions en cause portaient une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir et au droit de mener une vie familiale normale. D’une part, la mesure pouvait ne pas être justifiée par la prévention d’une atteinte à l’ordre public (§ 5) et, d’autre part, elle n’était soumise à aucune condition et encadrée par aucune garantie (§ 6). En conséquence, il les a déclarées contraires à la Constitution, mais a différé l’effet de sa déclaration d’inconstitutionnalité au 15 juillet 2017 (§ 9). Le législateur a tiré les conséquences de la censure du Conseil et a adopté, avant l’abrogation de la disposition, un nouveau dispositif censé pallier les problèmes soulevés par le Conseil21. Cette loi n’a pas fait l’objet d’un contrôle a priori par le Conseil constitutionnel. La disposition pourrait donc faire l’objet d’une nouvelle QPC.
Il résulte de la décision qu’un dispositif d’interdiction de séjour ne peut être prévu que pour prévenir les atteintes à l’ordre public (II) et qu’il doit impérativement être encadré pour assurer la garantie de la liberté d’aller et venir et le droit à une vie familiale normale (I).
I. La nécessité d’encadrer le dispositif d’interdiction de séjour pour garantir la liberté d’aller et venir et le droit à une vie familiale normale
La liste des droits et libertés à concilier avec l’ordre public dans le cadre de l’état d’urgence est relativement indéterminée dans le cadre actuel de la jurisprudence constitutionnelle (A). En l’espèce, le Conseil a néanmoins estimé que l’interdiction de séjour n’était pas suffisamment encadrée pour permettre la garantie de ces droits et libertés (B).
A. L’indétermination des droits et libertés à concilier avec l’ordre public, dans le cadre de l’état d’urgence
Dans sa décision du 9 juin 2017, le Conseil a repris le paragraphe de principe qu’il emploie dans toutes les décisions relatives à l’état d’urgence. Il considère que le législateur est compétent pour prévoir un régime d’état d’urgence, mais il doit néanmoins concilier « d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République » (§ 3).
Le Conseil a depuis longtemps admis la constitutionnalité de l’existence d’un régime d’état d’urgence fixé par voie législative. Dans sa décision n° 85-187DC du 25 janvier 1985, Loi relative à l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances, il avait estimé que « si la Constitution, dans son article 36, vise expressément l’état de siège, elle n’a pas pour autant exclu la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence pour concilier (…) les exigences de la liberté et la sauvegarde de l’ordre public »22. Il a eu l’occasion de rappeler ce principe à sept reprises depuis la mise en œuvre de l’état d’urgence de novembre 201523.
Dans sa décision M. Cédric D. [Assignations à résidence dans le cadre de l’état d’urgence], il a précisé la jurisprudence de 1985 en estimant que l’objectif de sauvegarde de l’ordre public devait être concilié avec « le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République »24. Cette formulation, relativement énigmatique, pose un problème théorique. Les droits et libertés reconnus aux personnes résidant sur le territoire ne sont pas limités aux droits et libertés constitutionnellement garantis. La terminologie retenue laisse ainsi penser qu’il pourrait y avoir une conciliation entre des droits n’ayant pas valeur constitutionnelle et un objectif à valeur constitutionnelle, ce qui est théoriquement impossible, car l’objectif à valeur constitutionnelle prime nécessairement sur le droit ou la liberté conférée par voie législative. Il est donc difficile de comprendre pourquoi le Conseil n’a pas simplement fait référence aux droits et libertés constitutionnellement garantis. L’explication semble se trouver dans les méthodes de travail du Conseil constitutionnel plus que dans un raisonnement juridique : le Conseil « répète » ses considérants et les scories qu’ils contiennent.
Sa jurisprudence relative à la conciliation des droits et libertés avec l’objectif de sauvegarde de l’ordre public fut développée dans le cadre du droit des étrangers. En 1989, il avait estimé que le « législateur peut prendre à l’égard des étrangers des dispositions spécifiques à la condition de respecter (…) les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République »25. La référence à la résidence sur le territoire de la République s’expliquait par la volonté d’appliquer le principe d’égalité entre les « étrangers résidant régulièrement en France »26 et les personnes disposant de la nationalité française. En 1993, il rappelait l’exigence de respect des droits et libertés dont disposent les étrangers résidant sur le territoire de la République27 et ajoutait alors que ces droits et libertés « doivent être conciliés avec la sauvegarde de l’ordre public qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle »28. En 1997, toujours en matière de droit des étrangers, il réaffirmait ce principe, mais ne se référait plus qu’aux « libertés et droits fondamentaux reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République », oubliant ainsi la référence à la valeur constitutionnelle de ces droits29. En 2011, il reprenait ce considérant, mais laissait cette fois-ci de côté l’adjectif fondamental et se référait alors aux « droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République »30. En 2015, dans la décision M. Cédric D., le Conseil répétait tel quel ce considérant, qu’il allait alors employer dans toutes les décisions relatives à l’état d’urgence.
L’évolution de cette formulation semble donc être une erreur résultant des méthodes de travail du Conseil, à laquelle il serait peut-être opportun de remédier. Il pourrait se référer plus simplement aux droits et libertés constitutionnellement garantis, en abandonnant la référence à la résidence sur le territoire. Une telle évolution semble d’ailleurs en accord avec la jurisprudence constitutionnelle car le Conseil ne reconnaît sur le fondement de ce principe que des droits et libertés à valeur constitutionnelle : la liberté individuelle, la sûreté, la liberté d’aller et venir, la liberté du mariage, le droit de mener une vie familiale normale31, le droit d’expression collective des idées et des opinions32, le droit au respect de la vie privée et l’inviolabilité du domicile33.
En l’espèce, le Conseil s’est spécialement appuyé pour rendre sa décision sur la liberté d’aller et de venir et le droit de mener une vie familiale normale (§ 3). Il a décidé de ne pas se fonder expressément sur le droit de manifester, consacré sur le fondement du droit d’expression collective des idées et des opinions34, ni sur la « liberté de travailler ». Le commentaire autorisé explique ainsi qu’il a « contrôlé la disposition au regard des droits et libertés principalement atteints par la disposition contestée » (p. 12). Une telle démarche se justifie par la règle de l’économie des moyens d’après laquelle si un moyen suffit à prononcer l’inconstitutionnalité, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les autres. Néanmoins, elle apparaît plus problématique lorsque les décisions du Conseil jouent le rôle de guides de rédaction des dispositions législatives. En ne retenant pas les griefs tirés de l’atteinte au droit d’expression collective des opinions ou à la liberté de travailler, le Conseil n’a pas incité le législateur à prévoir des garanties spécifiques pour assurer le respect de ces droits.
B. Un encadrement insuffisant du prononcé de l’interdiction de séjour
D’après le Conseil, le dispositif prévu par le législateur n’était pas inconstitutionnel dans son principe, mais il devait être assorti de garanties suffisantes.
Comme dans les autres décisions relatives à l’état d’urgence, il relève d’abord que l’usage de la mesure est limité aux périodes durant lesquelles l’état d’urgence a été déclaré et aux territoires sur lesquels il s’applique. Il souligne également les cas limitatifs dans lesquels l’état d’urgence peut être déclaré (§ 4). Pour les assignations à résidence35 et les interdictions de réunion36, il avait estimé qu’une telle limitation spatio-temporelle, assortie d’autres limites et conditions, permettait de déclarer constitutionnelle la compétence conférée à l’autorité administrative pour prendre ces mesures de police administrative. Le conditionnement de cette compétence à la déclaration de l’état d’urgence semble donc être le commencement d’une garantie d’après le Conseil.
Par ailleurs, il a reporté dans le temps les effets de sa décision d’abrogation (§ 9). Il admet ainsi implicitement la constitutionnalité du dispositif dans son principe même s’il estime qu’il fallait l’entourer de conditions et garanties supplémentaires, notamment eu égard à la liberté d’aller et venir et au droit à une vie familiale normale.
Le prononcé de l’interdiction de séjour n’était soumis à aucune autre condition que celle d’une menace d’entrave de l’activité des pouvoirs publics et n’était encadré d’aucune garantie. Le Conseil a estimé que le législateur n’avait « pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit de mener une vie familiale normale » (§ 7).
La disposition permettait au préfet d’interdire à une personne le séjour sur l’ensemble du territoire de son département sans limite de durée. La personne pouvait donc être empêchée d’accéder à son domicile et à son lieu de travail. Elle pouvait ainsi être privée de moyens de subsistance, pour une durée particulièrement longue étant donnés les prolongements successifs de l’état d’urgence.
En outre, rien n’empêchait que plusieurs préfets prennent la même mesure. Virtuellement un individu pouvait être expulsé du territoire français, par le cumul de plusieurs interdictions. Dans le cas de départements isolés, comme les départements d’outre-mer, une personne se voyant interdire l’ensemble du territoire pouvait être contrainte de s’éloigner considérablement de son lieu de résidence et de travail, à ses propres frais. En 1985, une personne résidant en Nouvelle-Calédonie avait ainsi été interdite de séjour sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, ce qui de fait, la contraignait à un important éloignement37.
Enfin, le motif particulièrement vague de menace d’entrave à l’action des pouvoirs publics permettait d’interdire le séjour à presque tout individu. La seule condition posée par la disposition législative était aisément remplie : un nombre infini d’actions peuvent être considérées comme des tentatives d’entrave à l’action des pouvoirs publics. Toute revendication ou désaccord exprimé à l’encontre d’une politique publique semble pouvoir recevoir cette qualification. La précision législative « de quelque manière que ce soit » étendait encore le spectre des compétences du préfet de département. La crainte qu’une personne exprime une opinion dissidente en un lieu donné pouvait par exemple justifier l’interdiction de séjour.
Pour toutes ces raisons, le Conseil a considéré que la disposition portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir et au droit à une vie familiale normale.
L’étendue de la compétence conférée au préfet de département était donc bien trop large par rapport à l’objectif poursuivi de prévention des atteintes à l’ordre public, seul fondement légitime de restriction des droits et libertés.
II. La prévention des atteintes à l’ordre public, fondement légitime de l’interdiction de séjour
Bien que le motif de prévention des entraves à l’action des pouvoirs publics ait été considéré comme un motif illégitime par le Conseil constitutionnel (A), le contrôle qu’il offre ne semble pas apporter des réelles garanties pour les justiciables (B).
A. La prévention des entraves à l’action des pouvoirs publics, motif illégitime de restriction des droits et libertés
La mesure d’interdiction de séjour pouvait être prononcée au seul motif que l’individu cherchait à « entraver l’action des pouvoirs publics ». Le Conseil a estimé que cela était contraire à la Constitution car la mesure d’interdiction pouvait être prononcée « sans que celle-ci soit nécessairement justifiée par la prévention d’une atteinte à l’ordre public » (§ 5).
D’après la jurisprudence du Conseil, il appartient « au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties (…) les atteintes portées à l’exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’objectif de prévention poursuivi »38. Cette triple exigence de nécessité, d’adaptation et de proportionnalité, au sens strict, représente l’expression du principe de proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil. L’exigence de nécessité signifie que seule la prévention des atteintes à l’ordre public peut justifier une limitation des droits et libertés constitutionnellement garantis.
La disposition en cause, par sa généralité, permettait de prendre une mesure d’interdiction de séjour à l’encontre d’une personne dont le comportement ne représentait pas une menace pour l’ordre public. Le préfet pouvait donc prendre une mesure restrictive de liberté sans qu’elle soit justifiée par l’objectif de préserver l’ordre public. Quelques mois auparavant, le Conseil avait déclaré conforme à la Constitution la disposition permettant d’interdire des réunions de « nature à provoquer ou à entretenir le désordre » dans le cadre de l’état d’urgence (loi du 3 avril 1955, art. 8)39. Pourtant, la notion de désordre semble excessivement imprécise et ne fait pas clairement référence à un trouble matériel à l’ordre public. En l’espèce, il a néanmoins estimé que l’étendue des compétences conférées à l’autorité de police administrative n’était pas nécessaire pour réaliser l’objectif de préservation de l’ordre public. L’exigence de nécessité, première condition du principe de proportionnalité, n’était donc pas satisfaite.
En conséquence, la volonté de prévenir les entraves à l’action des pouvoirs publics ne constitue pas un motif légitime de restriction des droits et libertés constitutionnellement garanties.
Le législateur, pour adapter la législation à la jurisprudence constitutionnelle, a repris la condition qui figure à l’article 6, pour décider d’une assignation à résidence. Une interdiction de séjour peut maintenant être prononcée à l’encontre de « toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics »40. Un tel critère avait été déclaré constitutionnel dans la décision M. Cédric D.41. Le Conseil avait alors estimé que les dispositions n’étaient « pas entachées d’incompétence négative » et ne portaient « pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir »42. L’interdiction de séjour constitue a priori une mesure moins restrictive de liberté. Le Conseil considérerait donc certainement que ce critère est satisfaisant en termes de garantie des droits et libertés constitutionnels.
Cette précision législative est bienvenue, mais elle n’apporte peut-être pas une garantie supplémentaire. La juridiction administrative aurait certainement estimé, conformément à la jurisprudence Benjamin43, qu’une telle restriction de liberté ne pouvait intervenir que pour prévenir des atteintes à l’ordre public. Il apparaît légitime de se demander si les modifications opérées par le législateur à la suite de la censure du Conseil assurent une meilleure effectivité des droits et libertés fondamentaux.
B. Une efficacité restreinte du contrôle du Conseil constitutionnel sur les mesures relatives à l’état d’urgence
Le législateur a modifié la loi avant la date d’abrogation fixée par le Conseil assurant ainsi la continuité du dispositif d’interdiction de séjour. Les modifications opérées par le législateur tiennent compte de la censure du Conseil, mais il n’est pas certain que les administrés aient tiré un bénéfice substantiel de ce changement de législation.
Le législateur a répondu aux demandes du Conseil relatives aux limites de temps et de lieu d’une telle mesure et aux garanties nécessaires à son prononcé, notamment en termes de motivation. Concernant la durée, il a précisé qu’elle devait être « limitée dans le temps » ce qui représente une amélioration, mais permet en réalité une prolongation indéfinie tout au long de l’état d’urgence. Concernant le périmètre de la mesure, il a prévu d’exclure expressément le domicile de la personne intéressée. L’exclusion du domicile de la personne représente une réelle avancée, sous réserve que cette exclusion ne conduise pas à prononcer une assignation à résidence déguisée.
Il a également précisé que les mesures devaient tenir « compte de la vie familiale et professionnelle des personnes susceptibles d’être concernées »44. La garantie semble ici plus apparente que réelle. D’une part, ces droits fondamentaux s’imposaient déjà aux autorités administratives sans que la loi ait besoin de venir préciser cette obligation. D’une part, la prise en compte est une notion relativement flexible : le lieu de travail de l’individu peut, par exemple, être concerné par la mesure.
Enfin, la nouvelle disposition prévoit que l’arrêté énonce les « circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent »45. Cette précision semble elle aussi surabondante puisque l’obligation de motivation prévue aux articles L. 211-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’Administration s’imposait déjà au préfet. Cette disposition ne change donc pas l’état du droit, sauf à considérer que le préfet ne pourra pas se prévaloir de l’urgence absolue pour ne pas motiver sa décision.
La censure du Conseil et la nouvelle disposition, qui serait vraisemblablement déclarée conforme à la Constitution, n’auront changé que peu de choses à la situation des personnes faisant l’objet d’une interdiction de séjour. La seule limite nouvelle est l’exclusion du domicile de l’individu du territoire de l’interdiction. Les autres considérations floues et laissées à l’appréciation du préfet, sous le contrôle du juge administratif, n’offrent aucune réelle garantie.
Il semble que les censures du Conseil ne conduisent qu’à une standardisation des dispositions législatives. Le législateur copie les formules ayant reçu un « brevet de constitutionnalité ». Le Conseil lui-même se livre à de telles comparaisons dans son commentaire autorisé (p. 13). Une telle uniformisation n’est pas à déplorer, mais elle n’améliore pas réellement l’effectivité des droits fondamentaux. Les dispositions considérées confèrent de nombreuses compétences aux autorités de police administrative dans le cadre de l’état d’urgence et l’encadrement de ces compétences reste assez flou et laisse une large marge de manœuvre à l’Administration. L’ensemble de ces dispositifs restrictifs de liberté sont acceptés dans leur principe par le Conseil. Ce dernier se contente d’exiger des garanties qui semblent parfois plus apparentes que réelles et renvoie leur contrôle au juge administratif.
Toutes ces mesures ont en commun de n’avoir pas à être ni ordonnées, ni contrôlées par un juge. Il appartient toujours à la personne sujette à une mesure restrictive de liberté, ordonnée hors du cadre protecteur de la procédure pénale, de saisir le juge administratif et d’apporter la preuve d’une illégalité manifeste ou d’un doute sérieux sur sa légalité. Les individus qui en font l’objet doivent, au moins temporairement, se soumettre aux ordres de l’Administration et ne pourront être indemnisés qu’en cas de faute lourde de la part de cette dernière. Les recours qu’ils exercent peuvent parfois s’avérer illusoires : par exemple, si la mesure en cause vise à les empêcher de prendre part à un mouvement social et que l’ordonnance du juge administratif n’est pas rendue avant la manifestation.
En outre, le Conseil ne demande pas que l’usage qui est fait de ces mesures soit limité aux raisons pour lesquelles l’état d’urgence a été ordonné. Comme pour l’assignation à résidence et les autres mesures administratives restrictives de liberté, le Conseil estime qu’il ne ressort pas de sa compétence de contrôler le risque de potentiel d’un détournement de procédure. Un tel contrôle appartient au juge administratif qui est chargé de « s’assurer que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit »46. Or, la jurisprudence du Conseil d’État est extrêmement tolérante à ce sujet. Il avait par exemple admis que des militants écologistes soient assignés à résidence, à l’occasion de la COP 2147. De telles pratiques ne constituent pas, selon le Conseil d’État, un détournement de procédure.
En conséquence, la censure du Conseil n’aura certainement qu’un effet limité sur la situation des personnes faisant l’objet d’une interdiction de séjour.
MB
Cons. const., 7 avr. 2017, n° 2017-625 QPC,M. Amadou S. L’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen constitue le fondement traditionnel de la protection du principe de légalité des délits et des peines et du principe de nécessité des délits et des peines48. Dans la période récente, le durcissement de la législation antiterroriste en vue de répondre à l’augmentation des risques d’attentats a conduit le Conseil constitutionnel à préciser le niveau de protection accordé par cette disposition. Traditionnellement, l’exercice s’avère difficile, en particulier en présence de lois pénales cherchant à anticiper la commission d’attentats en réprimant des comportements précédant le passage à l’acte terroriste.
Dans la décision n° 2017-625 QPC du 7 avril 2017 étaient en cause les articles 421-2-6 et 421-5 du Code pénal qui instituent le délit d’entreprise individuelle de terrorisme. Les dispositions avaient pour objet de réprimer les actes préparatoires à un attentat accomplis par un individu solitaire. Pour établir cette préparation, le texte prévoyait la réunion de deux faits matériels. D’une part, la détention, la recherche, la fabrication ou la volonté de se procurer des objets ou substances pouvant créer un danger pour autrui. D’autre part, la commission de certains faits non répréhensibles en eux-mêmes, comme l’entraînement au maniement des armes ou la consultation habituelle de sites internet terroristes.
En dépit des débats qu’elles ont pu susciter lors de leur élaboration, ces dispositions n’avaient pas fait l’objet d’une saisine parlementaire dans le cadre de l’article 61 de la Constitution. C’est donc par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité que le Conseil a apprécié la conformité à la Constitution de cette nouvelle infraction. Répondant aux moyens soulevés par le requérant, il a considéré que ce nouveau délit ne portait pas atteinte au principe de légalité des délits et des peines(I). En revanche, les dispositions lui sont apparues partiellement contraires au principe de nécessité des délits et des peines (II).
I. L’absence d’atteinte au principe de légalité des délits et des peines
Selon le Conseil constitutionnel, le principe de légalité criminelle impose au législateur de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir en termes suffisamment clairs et précis les éléments constitutifs d’une infraction. Destinée à prévenir l’arbitraire, cette exigence résulte de l’interprétation conjuguée de l’article 34 de la Constitution et de l’article 8 de la Déclaration de 178949. Le Conseil constitutionnel se montre rigoureux dans l’appréciation de son respect. C’est sur ce fondement qu’il avait censuré, par exemple, le délit de harcèlement sexuel50.
En l’espèce, selon le requérant, le délit d’entreprise individuelle de terrorisme méconnaissait le principe de légalité des délits et des peines dans la mesure où ses éléments constitutifs n’étaient pas définis de manière précise et qu’ils incrimineraient de très nombreux comportements (§ 4). Le Conseil a rejeté ce moyen en considérant que les infractions dont la commission doit être préparée pour que le délit soit constitué étaient clairement définies (§ 10). Plus spécialement, concernant la notion d’entreprise individuelle, il s’est borné à renvoyer à sa décision n° 86-213 DC du 3 septembre 1986 dans laquelle il avait déjà estimé qu’elle était définie avec suffisamment de précision (même §)51.
II. L’atteinte partielle au principe de nécessité des délits et des peines
Le principe de nécessité des délits et des peines, qui découle de l’article 8 de la Déclaration de 1789, interdit au législateur d’établir des peines qui ne seraient pas strictement et évidemment nécessaires. Selon le requérant, les dispositions en cause méconnaissaient ce principe dans la mesure où elles sanctionnaient seulement une intention et réprimaient des faits ne conduisant pas nécessairement à la commission d’actes de terrorisme.
La démarche adoptée par le Conseil témoigne de sa vigilance à l’égard de ces dispositions pénales d’un genre nouveau qui, en vue d’anticiper la commission d’actes terroristes, entendent renforcer la prévention des infractions. Après avoir rappelé, en application d’une jurisprudence constante, qu’il ne dispose pas d’un « pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement »52, de façon novatrice il a considéré que « [l]e législateur ne saurait, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, réprimer la seule intention délictueuse ou criminelle » (§ 13). En l’espèce, les dispositions contestées avaient pour spécificité de réprimer les actes préparatoires au délit, et non l’exécution ou le commencement d’exécution du délit lui-même (§ 14). C’est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation en considérant que « la preuve de l’intention de l’auteur des faits de préparer une infraction (…) ne saurait (…) résulter des seuls faits matériels retenus comme actes préparatoires » (§ 16). À cet égard, il est nécessaire que ces faits matériels corroborent une intention, qui doit être établie. En dépit de cette réserve, le Conseil a estimé qu’en retenant comme fait matériel pouvant constituer un acte préparatoire le fait de « rechercher des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui », sans préciser davantage les actes pouvant constituer cette recherche, le législateur avait permis la répression d’actes ne matérialisant pas, à eux seuls, la volonté de préparer une infraction (§ 17). Le Conseil a donc déclaré contraire au principe de nécessité des délits et des peines ce passage de la disposition contestée et a validé le reste du dispositif sous la réserve précédemment énoncée.
BLC
Histoire de l’abrogation du délit de consultation habituelle de sites internet terroristes : de l’art du dernier mot
Cons. const., 10 févr. 2017, n° 2016-611 QPC, M. David P. Le délit de consultation habituelle de sites internet terroristes est aussi intéressant pour ses antécédents qu’il ne l’est pour ses suites.
Ce délit a d’abord été pensé en 2012, puis en 2015 avant d’être finalement mis en place par la loi du 3 juin 2016. Une telle chronologie démontre les tensions entre d’une part, la volonté politique forte ayant à chaque fois mené à reprendre une loi et d’autre part, les données juridiques conflictuelles qui menaient à l’abandonner ou à la limiter. À ce titre, on peut noter que depuis 2012, l’avis du Conseil d’État rendu sur le projet de loi pertinent à l’époque contient presque en substance le débat de la QPC actuelle.
L’idée-force de ce délit consiste à sanctionner sévèrement la consultation sur internet de sites pro-djihadistes. Dans ses éléments constitutifs, le délit est calqué sur celui de consultation de sites pédopornographiques qui est porteur de la même difficulté à saisir un comportement fautif dans la simple consultation, même habituelle, d’un site internet. Cet article réprime de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de consulter habituellement des sites internet terroristes.
En l’espèce, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une QPC posée par M. David P. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 421-2-5-2 du Code pénal.
En substance, la censure de ce délit pose la question plus vaste des exigences constitutionnelles méritant de s’imposer aux infractions pénales de nature préventive qui sont aujourd’hui dans l’air du temps à travers la lutte contre le terrorisme.
La décision est symptomatique d’une inadéquation des outils de contrôle actuels aux mains du Conseil constitutionnel (I) pouvant expliquer que le législateur ait osé actionner le « lit de justice » (II).
I. Un Conseil constitutionnel mis en difficulté
A. Les normes de référence adaptées au phénomène terroriste
Le Conseil constitutionnel utilise les normes de référence suivantes pour contrôler le délit de consultation de sites terroristes : la liberté d’expression, consacrée comme une liberté de consultation sur internet depuis la décision Hadopide rendue en 200953 ainsi que la liberté individuelle. Il renouvelle également pour l’occasion l’OVC de recherche des auteurs des infractions en l’enrichissant d’un objectif de lutte contre le terrorisme qui entre dans les normes de référence du contrôle de constitutionnalité.
Le conflit de cet objectif nouveau avec la liberté individuelle risquait fort d’être problématique.
La décision démontre toute la difficulté à saisir le régime juridique d’une infraction préventive. Traditionnellement associée à la séparation ontologique entre police administrative et police judiciaire, la distinction entre prévention et punition n’est plus aussi nette qu’elle a pu l’être dans le passé. Les crimes terroristes ont conduit le législateur à une pénalisation anticipée de comportements « suspects », « à risque », autant de termes symptomatiques des problèmes de constitutionnalité de ce type d’infractions : absence de clarté dans la définition des éléments constitutifs de ces infractions, méconnaissance de la légalité des délits et des peines, méconnaissance de la liberté individuelle, risques d’inégalité.
En réaffirmant le dogme général de la liberté individuelle et en appliquant à sa garantie le triple test de proportionnalité qu’il a fait sien depuis 2010 (et qui consiste en un examen de nécessité, de proportionnalité et d’adéquation de la mesure)54, le Conseil constitutionnel ne tient pas nécessairement compte de la spécificité de ce délit.
B. Les contours insaisissables d’un délit particulier
La particularité ontologique de ce délit – auquel il est possible de rapprocher le délit d’entreprise individuelle de terrorisme, par exemple – consiste dans le fait qu’il frappe de sanctions particulièrement lourdes des faits qui paraissent relativement anodins. Là encore, comme en matière d’état d’urgence, il convient pour le législateur de saisir les personnes susceptibles de commettre un attentat grâce à des indices qui ne permettent pas d’éviter tout risque de « ratés ». La question de l’adaptation d’un quelconque contrôle juridictionnel avec ce type d’infraction préventive est d’ailleurs en passe de mobiliser l’actualité juridique et juridictionnelle pour l’avenir.
Ce délit trop sévère pour des faits trop imprécis encourait logiquement, comme il est habituel dans la jurisprudence, une censure ; ce fut le cas retentissant du délit de harcèlement sexuel55.
Le législateur, ayant perçu en 2012, puis en 2015 les risques d’inconstitutionnalité que contenait ce délit a, au cours de la discussion parlementaire de 2016, tenté de prendre en compte le caractère fuyant d’un tel délit. Il était en effet prévu que l’internaute « de bonne foi » puisse ne pas se voir appliquer la sanction. Le Conseil constitutionnel a toutefois précisé qu’il s’agissait là d’une limite trop faible pour protéger un particulier innocent ; ce qui a conduit à l’abrogation de la disposition législative.
La question posée est donc celle de savoir comment le législateur – et après lui le Conseil constitutionnel – peuvent-ils saisir la preuve d’une intention maligne ou, a contrario, inoffensive ?
Le juge constitutionnel est plutôt enclin à saisir l’objectif du législateur même s’il est particulier dans la mesure où il n’existe pas vraiment de nuance dans le régime de ce type de délits préventifs. Si le délit de consultation de sites terroristes mérite d’exister, les incertitudes qui l’entourent doivent être considérées, sachant qu’il est impossible de restreindre ses éléments constitutifs sans risquer de le priver de sa nature. Prévoir la « bonne foi » de l’auteur de l’acte aurait pu apparaître suffisant – en cela, la motivation du Conseil nous semble aller dans le bon sens – mais la clarté de cette exemption fait défaut. Le juge constitutionnel a d’ailleurs précisé que le recours aux travaux préparatoires du législateur n’a pas été de nature à mieux renseigner sur la nature de l’exemption.
C. Le recours inédit à l’arsenal législatif existant pour contrôler la constitutionnalité du délit
À délit inédit, examen inédit.
Il est en effet, exceptionnel – c’est le premier contrôle de ce type à notre sens – que le Conseil constitutionnel utilise l’arsenal législatif déjà existant pour contrôler la constitutionnalité d’un texte qu’il est en train de contrôler. C’est là un sérieux enrichissement du contrôle de proportionnalité. Le contrôle de nécessité – partie du triple test – qui vise à évaluer la nécessité de la mesure par rapport à d’autres mesures que le législateur aurait pu prendre (c’est un contrôle qui doit se faire au stade de la potentialité) change ici complètement de nature.
L’audace du juge constitutionnel étonne. Pourquoi rechercher dans les moyens existants à la disposition du législateur, la réponse à la constitutionnalité d’un dispositif législatif contrôlé ? Le Conseil constitutionnel agit comme un législateur en ôtant à ce dernier le droit – dont il nous semble qu’il dispose – de voter des lois inutiles. La « nécessité » d’une mesure ne s’apprécie plus à l’aune de son étude d’impact mais elle devient la mesure de sa constitutionnalité, ouvrant ainsi au Conseil constitutionnel des champs bien plus vastes que le syllogisme du contrôle de compatibilité à la norme fondamentale. Pour atteindre son objectif, le législateur ne peut plus se doter de tous moyens, seuls ceux qui s’avèrent nécessaires aux yeux du Conseil constitutionnel seront conformes à la Constitution.
Peut-être faut-il plutôt voir là une timidité de la haute institution qui va rechercher les raisons de la censure d’un délit – auquel le législateur est particulièrement attaché au point de revenir à la charge durant plus de 5 années – dans l’existence d’outils équivalents dont le législateur dispose déjà. Le Conseil raisonnerait de la sorte : l’abrogation du délit ne serait rendue possible que s’il est avéré que le législateur ne se trouve pas privé d’un moyen d’agir dans le sens de son objectif.
Le Conseil constitutionnel raisonne ainsi d’une manière similaire au Conseil d’État dans son avis rendu sur le projet de loi de 2012 – le délit s’ajoute à un arsenal déjà complet – mais il existe une véritable distinction dans leurs offices respectifs. Le Conseil d’État intervient avant le vote de la loi pour évaluer sa nécessité, le Conseil constitutionnel intervient après le vote de celle-ci pour évaluer sa constitutionnalité. L’existence de mesures parallèles ou bien équivalentes ne nous semble pas de nature à devoir entrer dans les normes de référence du contrôle de constitutionnalité, qui plus est dans le cadre d’un contrôle de QPC prétendument subjectif et concret.
II. Un Conseil constitutionnel mis à l’écart
A. Une décision incomprise
Le Conseil constitutionnel a utilisé la décision pour renouveler son contrôle de proportionnalité. La nécessité a en effet emporté le sens de la décision, ce qui laisse entendre que l’adéquation et la proportionnalité ont été reléguées au second plan. Comme il le fait habituellement pour la censure des délits, le Conseil constitutionnel a choisi d’abroger le délit dans son intégralité. Aurait-il pu envisager une réserve neutralisante ou la censure de la seule exemption de bonne foi – avec effet immédiat ? Habituellement les abrogations avec effet immédiat de certains délits correspondent plutôt à une méconnaissance des droits pénaux protégés de l’article 8 de la Déclaration de 1789, ce qui n’est pas le cas ici où la censure résulte de l’application du triple test.
Le Conseil constitutionnel a-t-il fait œuvre politique en rendant cette décision retentissante ? La question a été longuement discutée au Parlement et ailleurs à la suite de la décision et on objectera que ce débat – sans fin – ne semble pas lié à cette seule décision. Néanmoins le Conseil constitutionnel n’a peut-être pas choisi le bon délit pour appliquer son nouveau triple test fondé sur l’absence de nécessité. Il est en effet difficile d’imaginer que le juge constitutionnel puisse estimer « non nécessaire » un délit que le législateur avait estimé d’une telle importance qu’il avait essayé de le mettre en place à trois reprises dans un délai de 5 ans.
B. Dernier(s) mot(s)
Le législateur n’a pas attendu longtemps pour faire entendre son mécontentement.
Utilisant la commission mixte paritaire réunie pour le vote d’une autre loi – en parfaite méconnaissance de la procédure législative normale et du sens même de la commission mixte paritaire – le législateur a rétabli le délit de consultation habituelle de sites terroristes. Les députés ont néanmoins travaillé en prenant en compte la chose jugée par le Conseil constitutionnel pour tenter de rétablir le délit dans le peu d’espace qu’il leur restait, c’est-à-dire en circonscrivant son application et en permettant son exonération face à un utilisateur de bonne foi. Deux réserves ont ainsi été apportées au projet initial, la consultation doit manifester « l’adhésion à l’idéologie » djihadiste et l’utilisateur interpellé pourra s’exonérer de l’application de la sanction par la démonstration d’un « motif légitime » l’ayant conduit à consulter les sites litigieux (volonté de dénonciation, documentation, journalisme, etc.).
Il reste qu’en quelques jours, la décision du Conseil constitutionnel s’est trouvée critiquée, torturée et surmontée.
Le législateur souverain a rétabli, par un lit de justice, une disposition censurée en prétendant la reformuler sans méconnaître qu’il entendait ainsi faire primer sa volonté sur celle du Conseil constitutionnel. Il semble excessif de voir dans cette pratique une violation de l’état de droit et de la protection des libertés puisque la volonté de respecter la décision semble avoir été réelle : elle a eu toutefois à s’accommoder de la non moins réelle pugnacité du législateur à faire entrer ce délit dans l’ordre juridique. Intoxiqué par l’état d’urgence permanent et imprégné par les arguments tirés de la menace grave qui pèse sur la sécurité de la Nation du fait d’un terrorisme protéiforme et latent, le législateur semble avoir perdu de vue l’impératif de protection des libertés individuelles. Sûrement convaincu par la nécessité de ce délit pour appréhender préventivement les auteurs d’attentats, le législateur a entendu démontrer que la sécurité peut l’emporter sur la constitutionnalité, peut-être parce que cette dernière n’a pas su elle-même s’adapter à une nouvelle législation, à une nouvelle urgence.
Quelques semaines plus tard, le Conseil constitutionnel était de nouveau saisi par la Cour de cassation d’une QPC portant sur le délit de consultation habituelle dans sa nouvelle mouture. Quand cessera la bataille du dernier mot ?
ACB
1 – Les libertés
a – Sécurité et libertés
Au cours de la période récente, le Conseil constitutionnel a apprécié la constitutionnalité de l’atteinte portée par une nouvelle disposition de l’état d’urgence au principe de liberté. En vertu de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, le ministre de l’Intérieur a la faculté d’assigner à résidence une personne quand « il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ». En réponse aux difficultés suscitées par les assignations à résidence de personnes pour une longue durée à la suite des prorogations successives de ce régime d’exception, le législateur a redessiné les contours de ce dispositif dans la loi du 19 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi du 3 avril 1955. Le texte prévoit désormais qu’une même personne ne peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalant à plus de 12 mois. À titre dérogatoire, cependant, le ministre de l’Intérieur peut demander au juge des référés du Conseil d’État un prolongement jusqu’à 3 mois de la mesure d’assignation à condition qu’il invoque des raisons sérieuses permettant de penser que le comportement de la personne continue à constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. En l’absence de saisine dans le cadre de l’article 61 de la Constitution, c’est par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’État que le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de ces dispositifs à la liberté d’aller et venir dans la décision n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017.
Le Conseil constitutionnel considère que la liberté d’aller et venir est une composante de la liberté personnelle, inscrite aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Dans la continuité de sa décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015 (§ 8 à 14), après avoir relevé que les mesures d’assignation à résidence portaient atteinte à la liberté d’aller et venir il a contrôlé la conciliation opérée par le législateur entre l’impératif de prévention des atteintes à l’ordre public et la protection « des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République » (§ 14). Il a conclu à l’absence de méconnaissance de la liberté d’aller et venir en mobilisant quatre arguments. Premièrement, il a relevé que l’assignation à résidence ne pouvait être prononcée ou renouvelée que sous le régime de l’état d’urgence et qu’à l’égard de personnes situées sur le périmètre d’application de ce régime (§ 15). Deuxièmement, d’un point de vue chronologique, il a rappelé que les assignations à résidence prenaient fin en même temps que l’état d’urgence, dont la durée « ne saurait être excessive au regard du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à [s]a déclaration », et qu’en cas de prorogation de ce régime ces mesures devaient être impérativement renouvelées (§ 16). Troisièmement, le Conseil a émis trois réserves d’interprétation. Ces réserves, qui sont dépourvues de fondement juridique exprès, lui permettent de conditionner la constitutionnalité d’un dispositif au respect de l’interprétation qu’il donne de celui-ci. Elles bénéficient de l’autorité de la chose jugée reconnue aux décisions du Conseil constitutionnel par l’article 62 de la Constitution et sont indissociables de la loi. En l’espèce, le Conseil a considéré que le renouvellement d’une assignation à résidence impliquait que le comportement en cause « constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics », que l’Administration produise « des éléments nouveaux ou complémentaires » et qu’elle prenne en compte la durée totale de cette mesure, les conditions de celle-ci et les mesures complémentaires accompagnant cette assignation (§ 17). Quatrièmement, il a souligné que les assignations étaient prononcées sous le contrôle du juge administratif, lequel doit s’assurer de leur adaptation, de leur nécessité et de leur proportionnalité aux objectifs poursuivis (§ 18).
b – Liberté individuelle, respect de la vie privée, principe de responsabilité
Le Conseil constitutionnel considère que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d’asservissement et de dégradation constitue un principe à valeur constitutionnelle protégé par le préambule de la Constitution de 194656. La liberté personnelle, quant à elle, est garantie par l’article 2 de la Déclaration de 1789. Dans la décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, c’est à la lumière des principes de dignité et de liberté que le Conseil a apprécié la constitutionnalité de trois articles de la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Les dispositions en cause fixaient les conditions dans lesquelles le médecin d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté peut arrêter un traitement jugé inutile ou disproportionné en lui substituant une sédation profonde associée à une analgésie. Selon la requérante, ces dispositifs privaient de garanties légales le principe de sauvegarde de la dignité de la personne et la liberté personnelle. Elle estimait, en particulier, que dans la mesure où ces dispositions prévoient que le médecin décide seul de l’arrêt des traitements sans être lié par le sens des avis recueillis lors d’une procédure collégiale dont les contours sont fixés par le pouvoir réglementaire, le respect de la volonté du patient n’était pas assuré. Le Conseil constitutionnel n’a pas accueilli le moyen. D’abord, il a souligné que le médecin devait « préalablement s’enquérir de la volonté présumée du patient », en appréciant le contenu des directives anticipées formulées par celui-ci ou, à défaut, en consultant la personne de confiance désignée par le patient, la famille ou ses proches (§ 10). Ensuite, en application de sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle il « ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement », il a considéré qu’il ne pouvait pas substituer sa volonté à celle du législateur concernant les conditions dans lesquelles le médecin peut décider l’arrêt des traitements (§ 11)57. Enfin, il a rappelé que la décision du médecin était prise à l’issue d’une procédure collégiale destinée à l’éclairer et qu’elle était soumise au contrôle du juge (§ 12 et 13).
Selon une jurisprudence bien établie du Conseil, le droit au respect de la vie privée est protégé par le principe de liberté proclamé à l’article 2 de la Déclaration de 178958. Dans la décision n° 2017-637 QPC du 16 juin 2017, c’est au regard de ce principe qu’il a apprécié la constitutionnalité d’une disposition de la loi du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme, qui permettait aux organisateurs de manifestations sportives de collecter et traiter des données à caractère personnel. Dans cette optique, il a recherché si cette procédure de collecte et de traitement de données poursuivait un objectif d’intérêt général et a apprécié le caractère adéquat et proportionné du dispositif au regard de cet objectif. Le Conseil constitutionnel a d’abord relevé que la collecte d’informations, en ce qu’elle permet aux organisateurs d’identifier des personnes susceptibles de compromettre la sécurité, constituait bien un objectif d’intérêt général (§ 12). Ensuite, il a souligné que le fichier recueillant les informations collectées ne pouvait être établi que par les personnes organisant la manifestation, qu’il ne pouvait recenser que les personnes « qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations » et que sa seule finalité était d’identifier les personnes concernées en vue de leur refuser l’accès à l’enceinte sportive (§ 14). Par suite, le Conseil en a conclu que la disposition en cause était « adéquate et proportionnée à l’objectif d’intérêt général poursuivi » (§ 14).
c – Liberté d’expression/Liberté de conscience
La liberté d’expression est protégée par l’article 11 de la Déclaration de 1789, qui en fait « un des droits les plus précieux de l’Homme ». À ce titre, les limites qui peuvent lui être apportées par le législateur doivent, selon une jurisprudence traditionnelle, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi59. La transmission au Conseil constitutionnel de la loi relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse dans le cadre de l’article 61 de la constitution lui a donné l’occasion de mettre en œuvre son contrôle de proportionnalité60. Selon les députés et sénateurs requérants, le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’opinion, d’expression et de communication61.
Le Conseil a d’abord décelé dans la prévention des atteintes au droit de recourir à une interruption volontaire de grossesse un objectif d’intérêt général, à savoir la garantie de la liberté de la femme qu’il rattache classiquement à l’article 2 de la Déclaration de 178962. Concernant les mesures contestées, il a considéré que la répression des expressions et manifestations perturbant l’accès ou le fonctionnement des établissements pratiquant l’interruption volontaire de grossesse et des pressions morales et psychologiques exercées à l’encontre des femmes, du personnel de ces établissements ou de l’entourage ne portait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression (§ 12). En revanche, il a assorti les mesures réprimant les pressions et intimidations exercées à l’encontre d’une personne cherchant à s’informer sur une interruption volontaire de grossesse de deux réserves d’interprétation. D’une part, la répression ne peut concerner la simple activité de diffusion d’informations en ligne (§ 14). D’autre part, le délit d’entrave ne saurait être constitué qu’à la condition que « soit sollicitée une information, et non une opinion ». En outre, cette information doit porter sur les conditions d’exercice de l’interruption volontaire de grossesse ou les conséquences de celle-ci et être délivrée par une « personne détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière » (§ 15).
d – Liberté d’entreprendre, liberté contractuelle
Selon une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel considère que la liberté d’entreprendre est protégée par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. La décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 lui a donné l’occasion de rappeler la protection qu’il accorde à cette liberté63. Étaient en cause les dispositions de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés-mères et des entreprises donneuses d’ordre imposant à ces organismes une vigilance renforcée sur les activités de leurs filiales, de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs. Selon les sénateurs requérants, une telle exigence portait atteinte à la liberté d’entreprendre dans la mesure où les sociétés concernées se retrouvaient dans l’obligation de divulguer des informations sur leur stratégie industrielle et commerciale (§ 15). Le Conseil n’a pas accueilli ce moyen. Après avoir rappelé son considérant de principe, selon lequel le législateur peut apporter des limites à la liberté d’entreprendre dans la mesure où elles sont liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un intérêt général et à la condition que ces limites ne soient pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi (§ 16), il a nié toute atteinte à cette liberté64. Il a relevé, en particulier, que l’obligation de vigilance n’imposait pas de « rendre publiques des informations relatives à leur stratégie industrielle ou commerciale » (§ 18).
BLC
2 – Le droit de propriété (…)
3 – Le principe d’égalité
a – Principe d’égalité devant la loi
b – Principe d’égalité devant la loi fiscale et les charges publiques – Droits et libertés en matière fiscale
4 – Les droits sociaux (…)
5 – Les principes du droit répressif
6 – Les droits processuels
a – Le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, l’égalité devant la justice et le principe d’impartialité et d’indépendance des juridictions
b – Le principe de sécurité juridique (…)
(À suivre)
Notes de bas de pages
-
1.
Déc. Cons. const., 27 janv. 2017, n° 2016-609 QPC, Sté Comptoir de Bonneterie Rafco [Crédit d’impôt collection].
-
2.
Déc. Cons. const., 9 mars 2017, n° 2016-615 QPC, Épx V.
-
3.
Déc. Cons. const., 28 déc. 1990, n° 90-285 DC, loi de finances pour 1991.
-
4.
Déc. Cons. const., 10 févr. 2017, n° 2016-610 QPC, Épx G.
-
5.
Déc. Cons. const., 24 janv. 2017, n° 2016-606/607 QPC, M. Ahmed M. et a.
-
6.
Déc. Cons. const., 19 mai 2017, n° 2017-630 QPC, M. Olivier D.
-
7.
Déc. Cons. const., 29 sept. 2011, n° 2011-171/178 QPC, M. Michael C. et a.
-
8.
Déc. Cons. const., 28 mars 2014, n° 2014-385 QPC, M. Joël M.
-
9.
Déc. Cons. const., 24 févr. 2017, n° 2016-612 QPC, SCI Hyéroise.
-
10.
Déc. Cons. const., 29 juill. 1998, n° 98-403 DC, loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et Déc. Cons. const., 29 déc. 2012, n° 2012-662 DC, loi de finances pour 2013.
-
11.
Déc. Cons. const., 17 janv. 2017, n° 2016-604 QPC, Sté Alinéa.
-
12.
Déc. Cons. const., 16 mars 2017, n° 2016-618 QPC, Mme Michelle Theresa B.
-
13.
Déc. Cons. const., 30 mars 2017, n° 2016-620 QPC, Sté EDI-TV.
-
14.
Déc. Cons. const., 7 avr. 2017, n° 2017-623 QPC, Conseil national des barreaux.
-
15.
Déc. Cons. const., 24 janv. 2017, n° 2016-608 QPC, Mme Audrey J. ; Déc. Cons. const., 10 févr. 2017, n° 2016-611 QPC, M. David P.
-
16.
Déc. Cons. const., 30 juin 2017, n° 2017-641 QPC, Sté Horizon OI et a.
-
17.
Déc. Cons. const., 31 mai 2017, n° 2017-651 QPC.
-
18.
S’agissant de la notion de représentativité, le Conseil constitutionnel s’est ainsi inspiré de l’article 4 de la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle que le CSA a eu à appliquer lors de la dernière élection présidentielle.
-
19.
V. en ce sens Rapp. Sénat, n° 3978 de M. Pascal Popelin, fait au nom de la commission des lois, déposé le 19 juillet 2016.
-
20.
CE, 29 mars 2017, n° 407230.
-
21.
L. n° 2017-1154, 11 juill. 2017, art. 2, loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
-
22.
Cons. const., 25 janv. 1985, n° 85-187 DC, loi relative à l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances, cons. 4.
-
23.
Cons. const., 22 déc. 2015, n° 2015-527 QPC, M. Cédric D. [Assignations à résidence dans le cadre de l’état d’urgence], cons. 8 ; Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-536 QPC, ligue des droits de l’Homme [Perquisitions et saisies administratives dans le cadre de l’état d’urgence], cons. 5 ; Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-535 QPC, ligue des droits de l’Homme [Police des réunions et des lieux publics dans le cadre de l’état d’urgence], cons. 3 ; Cons. const., 23 sept. 2016, n° 2016-567/568 QPC, M. Georges F. et a. [Perquisitions administratives dans le cadre de l’état d’urgence II], cons. 7 ; Cons. const., 2 déc. 2016, n° 2016-600 QPC, M. Raïme A. [Perquisitions administratives dans le cadre de l’état d’urgence III], cons. 6 ; Cons. const., 16 mars 2017, n° 2017-624 QPC, M. Sofiyan I. [Assignations à résidence dans le cadre de l’état d’urgence II], cons. 13.
-
24.
Cons. const., 22 déc. 2015, n° 2015-527 QPC, préc., cons. 8
-
25.
Nous soulignons. Cons. const., 22 janv. 1990, n° 89-269 DC, loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé – non-conformité partielle, cons. 33.
-
26.
Ibid., cons. 35
-
27.
Nous soulignons. Cons. const., 13 août 1993, n° 93-325 DC, loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France, cons. 3.
-
28.
Nous soulignons. Ibid.
-
29.
Cons. const., 22 avr. 1997, n° 97-389 DC, loi portant diverses dispositions relatives à l’immigration, cons. 10.
-
30.
Cons. const., 9 juin 2011, n° 2011-631 DC, loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, cons. 78
-
31.
Cons. const., 13 août 1993, n° 93-325 DC, préc., cons. 3.
-
32.
Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-535 QPC, préc., cons. 3.
-
33.
Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-536 QPC, préc., cons. 5.
-
34.
Cons. const., 18 janv. 1995, n° 94-352 DC, loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité, cons. 16.
-
35.
Cons. const., 22 déc. 2015, n° 2015-527 QPC, préc., cons. 11.
-
36.
Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-535 QPC, préc., cons. 7.
-
37.
CE, 25 juill. 1985, n° 68151.
-
38.
Nous soulignons. Cons. const., 21 février 2008, n° 2008-562 DC, loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, cons. 13 ; pour une première formulation de ce principe v. Cons. const., 20 janv. 1981, n° 80-127 DC, « Sécurité liberté », cons. 62.
-
39.
Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-535 QPC, préc., cons. 8.
-
40.
L. n° 55-385, 3 avr. 1955, art. 5 nouv.
-
41.
Cons. const., 22 déc. 2015, n° 2015-527 QPC, préc., cons. 11.
-
42.
Ibid., cons. 14.
-
43.
CE, 13 mai 1933.
-
44.
L. n° 55-385, 3 avr. 1955, art. 5-3°.
-
45.
L. n° 55-385, 3 avr. 1955, art. 5-3°.
-
46.
Cons. const., 22 déc. 2015, n° 2015-527 QPC, préc., cons. 12.
-
47.
CE, 11 déc. 2015, n° 395009, M. H. X
-
48.
Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ; Cons. const., 25 févr. 2010, n° 2010-604 DC, loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public.
-
49.
Cons. const., 6 févr. 2015, n° 2014-448 QPC, M. Claude A. (agression sexuelle commise avec une contrainte morale), cons. 5.
-
50.
Cons. const., 4 mai 2012, n° 2012-240 QPC, M. Gérard D. (définition du délit de harcèlement sexuel), cons. 3 à 5.
-
51.
Cons. const., 3 sept. 1986, n° 86-213 DC, loi relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État, cons. 6.
-
52.
Cons. const., 14 oct. 2015, n° 2015-489 QPC, Sté Grands Moulins de Strasbourg SA et a. (Saisine d’office et sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de la concurrence), § 13.
-
53.
Déc. Cons. const., 10 juin 2009, n° 2009-580 DC, loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.
-
54.
Déc. Cons. const., 21 févr. 2008, n° 2008-562 DC, loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
-
55.
Déc. Cons. const., 4 mai 2012, n° 2012-240 QPC, M. Gérard D. [Définition du délit de harcèlement sexuel].
-
56.
Cons. const., 27 juill. 1994, n° 94-343/344 DC, cons. 2.
-
57.
Cons. const., 15 janv. 1975, n° 74-54 DC, cons. 1.
-
58.
Cons. const., 22 mars 2012, n° 2012-652 DC, cons. 8.
-
59.
V. par ex. Cons. const., 8 janv. 2016, n° 2015-512 QPC, M. Vincent R. (Délit de contestation de l’existence de certains crimes contre l’humanité), cons. 5
-
60.
Cons. const., 16 mars 2017, n° 2017-747 DC.
-
61.
V. également III, B, 5), a. Principes de légalité, nécessité et individualisation des délits et des peines.
-
62.
V. par ex. Cons. const., 27 juin 2001, n° 2001-446 DC, loi relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, cons. 5 et 10.
-
63.
V. également III, B, 5), a. Principes de légalité, nécessité et individualisation des délits et des peines.
-
64.
Cons. const., 8 déc. 2016, n° 2016-741 DC, § 102-103.