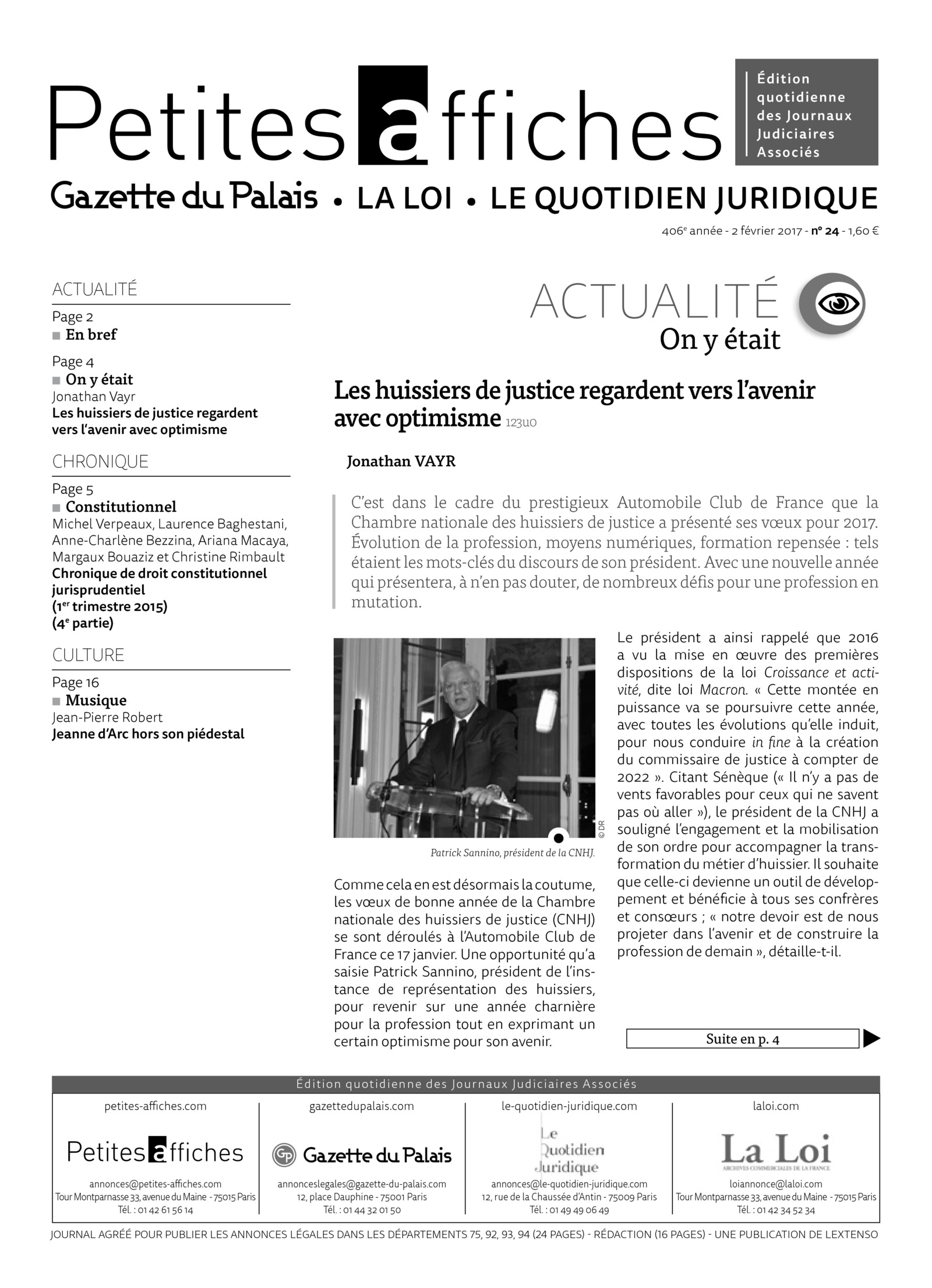Chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel (1er trimestre 2015) (4e partie)
La chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel est ouverte à l’ensemble des décisions susceptibles d’intéresser le droit constitutionnel dans sa dimension contentieuse considérée de la manière la plus large. C’est ainsi que le contentieux électoral est intégré dans la présente chronique qui est divisée en quatre parties correspondant aux thèmes principaux du droit constitutionnel contemporain qui intègre aussi bien les questions institutionnelles que les problèmes de hiérarchie des normes et la place des droits et libertés.
Afin d’être plus réactive, cette chronique est désormais trimestrielle et celle présentée ci-dessous couvre les mois de janvier à mars 2015.
I – Les sources du droit constitutionnel et les normes de référence
A – Les normes de la Constitution
1 – La compétence du législateur (…)
2 – Le contrôle du domaine de la loi et du règlement
3 – La Constitution numérotée (…)
4 – La Déclaration de 1789 (…)
5 – Les droits garantis par le Préambule de 1946
6 – Les PFRLR
7 – La Charte de l’environnement (…)
8 – Les objectifs de valeur constitutionnelle
B – Normes constitutionnelles non invocables dans le cadre de la QPC
C – L’articulation entre le droit interne et les normes internationales et européennes
II – Le procès constitutionnel
A – Les acteurs du contentieux constitutionnel (…)
B – La procédure devant le Conseil constitutionnel
C – Les techniques contentieuses (…)
D – L’autorité et les effets des décisions du Conseil constitutionnel
E – Les actes susceptibles de contrôle
III – Les institutions constitutionnelles
A – Les pouvoirs politiques : le pouvoir exécutif
B – Les pouvoirs politiques : le Parlement et la procédure législative
C – Le pouvoir juridictionnel (…)
D – Le pouvoir financier (…)
E – Les collectivités décentralisées
1 – La délégalisation d’outre-mer
2 – Le contrôle des lois du pays
3 – La libre administration et l’égalité devant le suffrage applicables aux EPCI
4 – La libre administration et les élections locales
F – La régulation des élections et des référendums
1 – Le rejet des requêtes : l’absence de portée suffisante du vice et autres florilèges de moyens infondés
2 – Du constat de manœuvres à la réformation des résultats : un juge électoral renforcé
3 – Le rappel bienveillant des principes constitutionnels du droit électoral
IV – Les droits et libertés
A – Les libertés
1 – Liberté individuelle, respect de la vie privée (…)
2 – Liberté d’entreprendre, liberté contractuelle
Dans la décision n° 2014-444 QPC du 29 janvier 2015, Association pour la recherche sur le diabète, le Conseil constitutionnel a eu à examiner, dans le cadre de la procédure QPC, de la conformité à la Constitution du cinquième alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Parmi les griefs invoqués, figurait la liberté contractuelle. Celle-ci découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, peut connaître, selon une jurisprudence désormais bien fixée, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. La distinction entre les exigences constitutionnelles et l’intérêt général ne manque pas d’interroger de manière récurrente, sur la valeur constitutionnelle ou non de cette notion fourre-tout qu’est l’intérêt général. Le Conseil constitutionnel, qui a soulevé d’office dans cette décision le principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la liberté d’association et solennellement réaffirmé par le Préambule de la Constitution, a considéré, de manière globalisante, que ce principe n’impose pas que toutes les associations déclarées jouissent de la capacité de recevoir des libéralités. Il en tire la conclusion que les griefs tirés de l’atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle des associations déclarées « doivent donc être écartés », faisant de cette sorte une lecture restrictive de la liberté d’association. Par voie de conséquence, il en va de même des griefs tirés de l’atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle des testateurs et donateurs.
L’atteinte à la liberté contractuelle n’a pas davantage été retenue dans la décision du 26 mars 2015, n° 2015-460 QPC, Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et a. L’article 4 de la Déclaration des droits fonde la liberté contractuelle, reconnue dans les mêmes termes que dans la décision n° 444 précitée mais interdit aussi qu’il soit porté atteinte aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant (cons. 18). Cette seconde face de la liberté contractuelle s’apparente alors davantage à la sécurité juridique. Le Conseil constitutionnel a néanmoins considéré que l’atteinte portée aux conventions légalement conclues par les résidents français travaillant en Suisse qui étaient affiliés en France à un régime d’assurance privée est justifiée par le motif d’intérêt général qui s’attache à la mutualisation des risques dans le cadre d’un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale. En effet, les résidents français travaillant en Suisse, qui ont fait le choix de ne pas être affiliés au régime suisse d’assurance maladie antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003, sont affiliés obligatoirement en France au régime général d’assurance maladie. Toutefois, par dérogation, et pendant une période transitoire de douze ans après la date d’entrée en vigueur de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres et la Confédération suisse, ils pouvaient être exemptés de cette obligation d’affiliation au régime général au profit d’une affiliation à un contrat d’assurance maladie privé. La mutualisation l’a en quelque sorte emporté sur le respect des contrats même légalement conclus.
MV
B – Le droit de propriété
Deux décisions (n° 2014-449 QPC et n° 2014-451 QPC) rendues par le Conseil constitutionnel, au cours de ce trimestre, ont abouti à la reconnaissance d’une privation du droit de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.
Selon une jurisprudence établie, le droit de propriété tire sa substance des articles 17 et 2 de la Déclaration des droits. Le premier article reconnaît son caractère inviolable et sacré, son impossibilité à en être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exige et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Le second article impose qu’en l’absence de privation du droit de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration des droits, les atteintes qui y sont portées doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Si dans la décision n° 2014-449 QPC du 6 février 2015, « Société Mutuelle des transports assurances », ce double fondement au droit de propriété est rappelé (cons. 6), ce n’est qu’au regard de l’article 17 de la Déclaration des droits que le Conseil a déclaré l’inconstitutionnalité du transfert d’office du portefeuille de contrats d’assurance d’une personne titulaire d’un agrément. La question des contrats ou de bulletins d’adhésion constitués par une personne dans l’exercice de l’activité d’assurance relève effectivement, par extension de son champ d’application1, de la protection du droit de propriété.
C’est à ce titre que le Conseil s’est prononcé sur cette mesure conservatoire prévue par les dispositions du 8° du paragraphe 1 de l’article L. 612-33 du Code monétaire et financier décidée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dont la constitutionnalité a été mise en cause en raison de l’impossibilité pour la personne visée par cette mesure de pouvoir, pendant une période préalable, procéder elle-même à la cession de tout ou partie de ce portefeuille. La privation de propriété, au sens de l’article 17 de la Déclaration des droits, était, à cet égard, avérée.
C’est aussi sur le seul fondement de l’article 17 de la Déclaration des droits que, dans la décision n° 2014-451 QPC du 13 février 2015, Société Ferme Larrea EARL, le Conseil a émis une réserve d’interprétation quant à la conformité à la Constitution de l’article L. 15-2 du Code de l’expropriation à propos de la prise de possession en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique dont cette disposition ainsi que l’article L. 15-1 du même code en fixent les règles générales.
Dans cette décision, la réserve d’interprétation est circonscrite à l’article L. 15-2 du Code de l’expropriation dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013. Celle-ci fait suite à la déclaration d’inconstitutionnalité, dans la décision n° 2012-226 QPC du 6 avril 2012, des articles L. 15-1 et L. 15-2 issus de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique2.
Les conditions de prise de possession d’un bien qui a fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sont ainsi confrontées, en l’espèce, aux exigences qui résultent de l’article 17 de la Déclaration des droits telles qu’elles sont rappelées, par le Conseil, dans un considérant de principe : « la loi ne peut autoriser l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d’une opération dont l’utilité publique est légalement constatée ; (..) la prise de possession par l’expropriant doit être subordonnée au versement préalable d’une indemnité ; (..) pour être juste, l’indemnisation doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation ; (..) en cas de désaccord sur la fixation du montant de l’indemnité, l’exproprié doit disposer d’une voie de recours appropriée ».
Pour que ces exigences soient remplies, il convient que, dans le cadre d’un appel de jugement fixant l’indemnité d’expropriation qui n’empêche en rien la prise de possession et qui permet alors au juge d’autoriser l’expropriant à consigner tout ou partie du montant de l’indemnité supérieur à ce que celui-ci avait proposé, l’exproprié ne soit pas lésé dans ses droits.
C’est ainsi que la réserve émise quant à la conformité à la Constitution de l’article L. 15-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique permet à l’exproprié d’obtenir la réparation du préjudice qui résulte de l’absence de perception de l’intégralité de l’indemnité d’expropriation lors de la prise de possession, lorsque l’indemnité définitivement fixée excède la fraction de l’indemnité fixée par le juge de première instance qui a été versée à l’exproprié lors de la prise de possession du bien (cons. 8). Cette réserve se justifie par l’obligation à laquelle est assujettie l’indemnisation au titre de l’article 17 de la Déclaration des droits. Celle-ci doit, en tout état de cause, couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation, afin d’être juste.
LB
C – Le principe d’égalité
1 – Principe d’égalité devant la loi
Ce principe est présent dans d’assez nombreuses décisions de ce trimestre, car ce grief est souvent invoqué par les requérants. Il se trouve ainsi dans plusieurs décisions rencontrées dans d’autres parties de cette chronique. C’est le cas de la décision n° 2014-709 DC, Loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral3. Dans la même rubrique consacrée aux collectivités décentralisées, le principe d’égalité est au centre de la décision n° 2015-711 DC du 5 mars 2015, Loi autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire, à propos de la répartition des sièges de conseiller communautaire dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération. Le Conseil constitutionnel a de nouveau mis l’accent sur le nécessaire respect du principe d’égalité devant le suffrage qui s’applique aussi aux EPCI4. Parce que les organes délibérants des EPCI doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques et parce que la répartition des sièges doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité territoriale membre de l’établissement public de coopération, ce n’est que dans une mesure limitée qu’il peut être tenu compte d’autres considérations d’intérêt général. Tout autant que l’égalité devant le suffrage, c’est aussi le respect du principe d’égalité entre les communes au sein des organes des EPCI qui est en cause dans cette décision.
Le principe d’égalité est également présent dans la décision n° 2014-439 QPC, M. Ahmed S5 et dans plusieurs décisions intéressant le droit répressif6.
Quatre autres décisions traitent spécifiquement du principe d’égalité. Le principe d’égalité trouve son fondement sur l’article 6 de la Déclaration des droits, selon lequel la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Par conséquent et dans la décision n° 2014-444 QPC du 29 janvier 2015, Association pour la recherche sur le diabète, et selon un « considérant de principe », le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (cons. 8). La volonté du législateur dans la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, de favoriser les seules associations déclarées « qui ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale », en leur réservant la capacité d’accepter des libéralités par l’affectation de dons et legs, répond à un objectif d’intérêt général spécifique qu’il a reconnu à leur objet et à la nature de leur activité. Ces associations ne se trouvent dès lors pas dans la même situation que les autres associations et cette différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de la loi.
Le principe d’égalité est défini de manière identique, ce qui n’est guère surprenant compte tenu de la concomitance des dates, dans la décision n° 2014-441/443 QPC du 23 janvier 2015, Mme Michèle C. et a., à propos de la récupération des charges locatives relatives aux énergies de réseaux (cons. 5). Les dispositions législatives contestées, à savoir l’article L. 442-3 du Code de la construction et de l’habitation qui fixe le régime des charges récupérables par le bailleur auprès des locataires dans les immeubles appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, distinguent selon les modes de chauffage collectif. Le Conseil a alors jugé que le principe d’égalité n’impose pas que les règles de récupération des charges locatives pour les dépenses liées au chauffage soient identiques quel que soit le mode de chauffage retenu. Cette atteinte apparente au principe d’égalité est justifiée, par un lien direct, à la fois par une différence de situation entre les locataires et par l’objectif d’intérêt général que le législateur s’est assigné, à savoir l’incitation à recourir aux énergies de réseau dans un but de protection de l’environnement, mais dont il faut préciser que le législateur est le seul à le définir. L’atteinte au principe d’égalité doit donc être écartée.
L’article 64 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, relatif aux effets du plan arrêté par le jugement rendu dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, prévoit que les dispositions de ce plan sont opposables à tous à l’exception des cautions solidaires et des coobligés, imposant ainsi les cautions solidaires à demeurer tenues directement au paiement de l’intégralité de la créance. Tout en rappelant l’article 6 de la Déclaration des droits en tant que fondement du principe d’égalité, la décision n° 2014-447 QPC du 6 février 2015, Époux R., le Conseil constitutionnel a jugé que le principe d’égalité devant la loi n’impose pas d’uniformiser les régimes juridiques de la caution simple et de la caution solidaire. C’est en effet le Code civil qui distingue la caution simple de la caution solidaire et qui prévoit que l’engagement de cette dernière est renforcé. Il a donc choisi de maintenir spécifiquement la portée de l’engagement de la caution solidaire dans le cadre d’un plan de redressement judiciaire (cons. 6). La distinction de situation est alors en rapport direct avec l’objet de la loi et les intentions du législateur. En d’autres termes, lorsque la loi introduit une distinction entre deux régimes juridiques, ce que le législateur est habilité à faire selon les termes mêmes de la décision 447 QPC, les conséquences qui en découlent ne sont pas discriminatoires.
C’est parce que les greffiers des tribunaux de commerce titulaires d’un office n’occupent pas des « dignités, places et emplois publics » au sens de l’article 6 de la Déclaration de 1789 que le grief tiré de ce que le droit reconnu aux greffiers des tribunaux de commerce de présenter leurs successeurs à l’agrément du garde des Sceaux méconnaîtrait le principe d’égal accès aux dignités, places et emplois publics est inopérant alors qu’il trouve son fondement dans le même article 67. Une solution identique avait été adoptée pour les notaires dans la décision n° 2014-429 QPC du 21 novembre 2014, M. Pierre T., alors même que les greffiers des tribunaux de commerce et les notaires sont des officiers publics et ministériels8 et qu’ils participent à l’exercice du service public de la justice et ont la qualité d’officier public et ministériel nommé par le garde des Sceaux (cons. 10). A prévalu, dans le refus de leur reconnaître la qualité d’agents publics, le fait qu’ils exercent une profession réglementée dans un cadre libéral au sens du paragraphe I de l’article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives.
MV
2 – Principe d’égalité devant les charges publiques
Les exigences issues du principe d’égalité devant les charges publiques qui découlent des dispositions de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 imposent que l’appréciation des facultés contributives dont il appartient au législateur de déterminer les règles, repose sur des critères objectifs et rationnels afin d’éviter toute rupture caractérisée du principe.
La contribution à l’impôt est soumise à conditions. Tout d’abord et dans tous les cas, l’impôt ne peut revêtir un caractère confiscatoire, pas plus qu’il ne pourrait faire peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives.
Cette dernière exigence est satisfaite, selon la décision n° 2014-456 QPC du 6 mars 2015, Société Nextradio TV, par les dispositions de l’article 235 ter ZAA du Code général des impôts qui instituent une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés (CEIS)9. D’une part, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objectif poursuivi en retenant comme seuil d’assujettissement la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe fiscalement intégré (cons. 8). D’autre part, les règles d’assujettissement de cette catégorie de sociétés, quelle que soit la nature de l’activité de certaines des sociétés du groupe, ne font pas peser sur la société mère une charge excessive au regard de ses facultés contributives et cela, compte tenu de la définition retenue de l’assiette de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés (cons. 9).
Ensuite, les modalités de fixation de l’assiette de l’impôt doivent être en rapport avec l’appréciation des facultés contributives des contribuables assujettis à l’impôt, sous peine de porter atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques. Le défaut de ce lien est à l’origine de l’inconstitutionnalité relevée dans la décision n° 2014-436 QPC du 15 janvier 2015, Mme Roxane S., à l’encontre du troisième alinéa de l’article 760 du Code général des impôts. Cette disposition prévoyait que, lorsqu’une créance à terme a été soumise à l’impôt sur une base estimative, le créancier est tenu de déclarer toute somme supplémentaire recouvrée postérieurement à l’évaluation en sus de celle-ci. Or le rapport exigé entre les modalités de fixation de l’assiette de l’impôt et l’appréciation des facultés contributives qui conditionnent la constitutionnalité du dispositif institué n’est pas établi pour deux raisons : d’une part, parce que l’imposition qui en résulte n’est pas soumise à la condition que la créance avait été sous-évaluée à la date du fait générateur de l’impôt et, d’autre part, du fait que le contribuable n’est pas admis à rapporter la preuve de ce que la capacité du débiteur à payer une somme excédant la valeur à laquelle la créance avait été évaluée résulte de circonstances postérieures au fait générateur de l’impôt.
Le Conseil précise, par ailleurs, dans la décision n° 436 QPC, le régime applicable aux créances à terme. Il admet aussi bien le principe de l’imposition des créances à terme sur leur valeur nominale10 -sans que cette différence avec les créances exigibles dont l’évaluation repose sur leur valeur estimative, n’emporte d’atteinte à l’égalité devant les charges publiques – que la dérogation à ce principe. En effet, par exception, l’assiette d’une créance à terme peut être déterminée d’après une déclaration estimative lorsqu’à la date du fait générateur de l’impôt, le débiteur « se trouve en état de faillite, de procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaires ou de déconfiture »11. L’incidence sur la valeur des créances à terme des difficultés que le débiteur rencontre pour s’acquitter de ses obligations légitime une telle dérogation.
Plus spécifiquement, et sans que le principe d’égalité devant les charges publiques ne soit méconnu, le régime d’imposition sur une base estimative des créances à terme ouvre droit à une différence de traitement entre les créanciers détenteurs de créances à terme selon que leurs débiteurs relèvent ou non de procédures collectives prévues par le Code de commerce. En effet, le Conseil précise que « le principe d’égalité n’impose pas que la loi fiscale soumette les créances à terme sur des débiteurs susceptibles de faire l’objet d’une procédure de surendettement » (situation de déconfiture12) en application du Code de la consommation à des règles identiques à celles applicables lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective en application du Code de commerce.
Parce que les procédures de surendettement n’ont ni le même objet, ni le même effet que les procédures collectives, une telle différence de traitement est admise. Il suffit, pour cela, qu’elle repose sur des critères en rapport direct avec l’objet de la loi. C’est à ce titre que le Conseil valide, dans la décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015, Association française des entreprises privées et a., la différence de traitement instituée par la loi entre les contribuables qui perçoivent des produits de titres de sociétés établies dans un État ou un territoire non coopératif ou qui réalisent des plus-values à l’occasion de la cession de titres de ces dernières et les autres contribuables. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l’objectif de valeur constitutionnelle poursuivi par le législateur, de lutte contre la fraude fiscale des sociétés qui réalisent des investissements ou des opérations financières dans les États et les territoires non coopératifs (cons. 9).
Cependant, le dispositif institué doit permettre au contribuable de pouvoir apporter la preuve de ce que la prise de participation dans une société établie dans un tel État ou territoire correspond à des opérations réelles étrangères à tout objectif de fraude fiscale (cons. 10). Sous cette réserve, le principe d’égalité devant les charges publiques n’est pas méconnu.
C’est aussi à une double réserve d’interprétation que s’est heurtée la question de l’affiliation au régime général d’assurance maladie du fait de la résidence en France, dans la décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015.
Tout d’abord, en ce qui concerne la cotisation due par les personnes affiliées au régime général d’assurance maladie du fait de leur résidence en France, hors le cas particulier des résidents français travaillant en Suisse, la conformité au principe d’égalité devant les charges publiques de l’article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale qui assoit les cotisations d’assurance maladie des personnes affiliées au titre de la couverture maladie universelle sur l’ensemble des revenus de la personne et qui instaure une exonération de cotisation pour le montant des revenus inférieurs à un certain seuil, est établie sous réserve que le pouvoir réglementaire fixe le montant du plafond de ressources ainsi que les modalités de sa révision annuelle. À cette condition, est considérée conforme à la Constitution la différence de traitement entre les personnes affiliées à la branche maladie du régime de sécurité sociale selon qu’elles le sont au titre de leur activité professionnelle ou au titre de leur résidence en France (cons. 14).
Ensuite, en ce qui concerne le cas spécifique des résidents français travaillant en Suisse, régi par l’article L. 380-3-1 du Code de sécurité sociale et la différence qu’il institue entre l’assiette de cotisation au régime général de sécurité sociale des travailleurs frontaliers (qui cotisent sur leur revenu fiscal de référence) et celle des travailleurs salariés en France cotisant au régime général d’assurance maladie (qui cotisent sur leur revenu d’activité), le principe d’égalité devant les charges publiques est respecté tant que le pouvoir réglementaire d’application de la loi n’inclut pas, dans l’assiette de la cotisation, des revenus du foyer fiscal qui ont déjà été soumis à une cotisation au titre de l’affiliation d’une personne à un régime d’assurance maladie obligatoire (cons. 23).
LB
3 – Principe d’égal accès aux emplois publics (…)
D – Les droits sociaux (…)
E – Les principes du droit répressif
1 – Principes de légalité, nécessité et individualisation des délits et des peines
La nécessité des peines donne lieu à une jurisprudence constitutionnelle timide où le Conseil, se limitant à un contrôle de l’erreur manifeste, se montre particulièrement respectueux de l’appréciation des faits tant au regard de la compétence du législateur qu’eu égard à la marge d’interprétation qu’il convient ensuite de laisser aux juges.
La décision n° 2014-448 QPC du 6 février 2015, M. Claude A., le démontre.
Saisi d’une QPC le 19 novembre 2014 qui lui avait été posée par la Cour de cassation13, le Conseil avait à juger de la conformité à la Constitution de l’article L. 2222-22-1 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 2010. La requête entendait pointer une forme d’incohérence dans la législation pénale au sujet des éléments de définition de la « contrainte morale » définie par l’article 222-22-1 du Code pénal.
En effet, l’article 227-25 du Code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende « le fait par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans ». L’article 222-22 du Code pénal, qui donne le régime législatif globalement applicable aux infractions d’agression sexuelle, fait de la contrainte un élément constitutif de l’infraction. Parallèlement, l’article 222-30 du Code pénal dispose que lorsque l’infraction « est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit », une circonstance aggravante de l’infraction sexuelle est avérée. Au vu de ces législations, la question se pose de la reconnaissance d’une contrainte morale sur la victime et de ses éléments d’identification.
La contrainte résulte-t-elle notamment de l’autorité et de l’ascendance exercée sur la victime – ce qui revient à qualifier un inceste – ou cette même autorité constitue-t-elle plutôt une circonstance aggravante de l’infraction ? C’est cette question que la loi du 8 février 2010 a voulu clarifier sans réellement atteindre son objectif. Cette loi a entendu se préoccuper de l’inceste et a inséré dans le Code pénal, l’article 222-22-1 de manière à faire de cet article une forme de guide introductif applicable aux infractions sexuelles. Il dispose que « la contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime »14. Partant, il y aura donc agression sexuelle ou viol dès lors que des circonstances de fragilité et d’emprise psychologiques pourront être démontrées.
Si cette précision législative a certes permis de protéger plus utilement les victimes d’inceste, elle a néanmoins créé une véritable confusion entre l’élément constitutif de l’infraction d’agression sexuelle et l’élément permettant d’établir la circonstance aggravante ; confusion que la requête entendait pointer.
L’article 222-22-1 du Code pénal était l’objet de la QPC en ce qu’il prévoit que l’autorité de droit ou de fait que l’auteur des faits incriminés exerce sur la victime est à la fois un élément constitutif de l’agression sexuelle et une circonstance aggravante de l’infraction d’agression sexuelle en vertu du 2° de l’article 222-30 du Code pénal. La légalité des délits et des peines autant que la proportionnalité de ces dernières étaient mises en cause.
Le grief tiré de la légalité des délits et des peines pouvait être jugé pertinent dès lors qu’il existait bien une forme d’incompétence législative du législateur puisque ce dernier avait failli dans la définition des éléments de l’infraction. Pourtant, le Conseil a soigneusement contourné ce problème en se ralliant à la conception défendue par les travaux parlementaires en 2010 et réitérée par le Gouvernement dans ses observations. Cette interprétation consiste à considérer que la différence d’âge et la situation d’autorité sont simplement des éléments de faits qui doivent permettre au juge, au cas par cas, d’apprécier si la contrainte, qui, quant à elle, est un élément constitutif de l’infraction d’agression sexuelle ou de viol, est constituée. En d’autres termes, le Conseil considère que la situation d’autorité n’est pas directement un élément constitutif de l’infraction ; partant, le grief de méconnaissance de la légalité des délits et des peines ne peut pas utilement être avancé à l’encontre de l’article 222-22-1. En retenant ce raisonnement, le juge constitutionnel évacue aisément la question d’une éventuelle confusion qui naît de l’utilisation de l’autorité sur la victime comme élément constitutif de l’infraction autant que comme circonstance aggravante, dès lors que cet élément n’est pas constitutif de l’infraction (cons. 7). Quant à l’atteinte à la nécessité ou à la proportionnalité des peines, elle est rapidement évacuée par le Conseil constitutionnel qui préserve au législateur et aux juges pénaux la plus grande marge d’appréciation sur la peine à retenir quand une infraction est constituée. Le Conseil a repris son raisonnement développé plus haut en considérant l’autorité sur la victime comme un simple élément d’évaluation offert au juge pénal. Il n’y avait donc plus lieu de considérer que la peine était d’une sévérité disproportionnée, dès lors qu’il ne s’agissait même pas d’une peine (cons. 9).
La jurisprudence relative à la « rigueur non nécessaire dans la recherche des auteurs d’infraction » a fait l’objet d’une application fort intéressante dans la décision n° 2014-452 QPC du 27 février 2015, M. Olivier J. Le Conseil constitutionnel y a examiné l’article 131 du Code de procédure pénale (CPP). L’interrogation constitutionnelle portait sur le mécanisme que celui-ci prévoit et qui permet de décerner un mandat d’arrêt contre une personne résidant à l’étranger sans qu’il soit nécessairement avéré que cette dernière soit en fuite. En l’espèce, le requérant, installé à l’étranger, avait lui-même fait l’objet d’un mandat d’arrêt suivant cette procédure. Les griefs d’égalité devant les procédures et de rigueur non nécessaire à la recherche des auteurs d’infraction étaient invoqués.
Ce dernier grief résulte d’une jurisprudence constructive du juge constitutionnel qui consiste à déduire du rapprochement des articles 7 et 9 de la Déclaration de 1789 ainsi que de l’article 34 de la Constitution, l’exigence qui veut que le législateur fixe lui-même les règles de procédure pénale sans qu’il en résulte une rigueur excessive de ces procédures. Cette règle doit se concilier avec l’objectif de recherche des auteurs d’infraction qu’elle tempère. En l’espèce, alors que l’article 131 du CPP s’applique au mandat d’arrêt, le Conseil constitutionnel a entendu émettre une réserve au sujet du « type » de mandat concerné puisque l’article L. 122 de ce même code en liste en effet cinq types. Le Conseil a précisé qu’afin de s’accorder avec l’objectif de recherche des auteurs d’infraction et la préservation de l’ordre public, l’exercice des libertés ne saurait être préservé si la procédure de l’article 130 était susceptible d’être mise en œuvre dans le cadre d’un mandat d’amener à l’encontre d’une personne n’encourant pas les peines les plus graves. En somme, c’est donc la gravité de l’infraction qui doit justifier la dureté de la procédure.
Quant au grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les règles de procédure, il aurait pu apparaître pertinent. Il y avait bien une différence de traitement en l’espèce, mais le Conseil a relevé que l’ensemble des garanties procédurales de droit commun s’appliquait aux procédures déclenchées sur le fondement de l’article 131 du CPP (cons. 6). Le Conseil a par ailleurs justifié la différence de traitement par la différence réelle de conditions d’exercice des procédures – au regard de la capacité des autorités judiciaires à ordonner des mesures coercitives (cons. 7). Cette différence de situation est en effet non négligeable puisqu’il semble assez net que l’appréhension d’un individu hors du territoire de la France entraîne des procédures plus longues et laborieuses en raison de l’existence même du principe de souveraineté de l’État étranger ; la procédure de l’article 131 du CPP vise précisément à atteindre cet objectif de recherche des personnes résidant hors de France qui justifie la discrimination.
La décision signe donc une application des plus classiques du principe d’égalité devant les procédures et n’ajoute pas à la jurisprudence constitutionnelle en matière pénale.
ACB
2 – Droits de la défense et respect des garanties procédurales (…)
F – Les garanties des droits
1 – Le droit à un recours juridictionnel effectif et les principes d’impartialité et d’indépendance
Le Conseil constitutionnel reconnaît, sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, un droit constitutionnel à un recours juridictionnel effectif15. Ce droit peut donc être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité16. Dans deux décisions, en date du 29 janvier et du 6 mars 2015 (n° 2014-446 QPC et n° 2014-455 QPC), le Conseil constitutionnel a contrôlé la conformité de dispositions législatives, telles qu’interprétées constamment par les juridictions suprêmes, à ce principe (respectivement cons. 3 et cons. 5).
Dans la première décision (n° 2014-446 QPC), était en cause le quatrième alinéa de l’article 194 du Code de procédure pénale, tel qu’interprété par la Cour de cassation. Cette disposition prévoit que la chambre de l’instruction doit se prononcer, lorsqu’il est fait appel d’une décision ordonnant un placement en détention provisoire, au plus tard dans les dix jours de l’appel, dans le cas d’une ordonnance de placement en détention, et dans les quinze jours, dans les autres cas. Toutefois, la Cour de cassation juge constamment qu’un tel délai de quinze jours ne s’impose pas lorsque la chambre de l’instruction se prononce sur renvoi après cassation (cons. 3). Cela résulte d’une jurisprudence ancienne que le Conseil vise dans sa décision (5e visa). Le Conseil n’étant pas une cour suprême, il ne lui appartient pas de juger si la Cour de cassation fait une bonne interprétation de la loi mais si la loi, telle qu’elle est interprétée, peut être considérée comme constitutionnelle.
Le droit au recours n’était pas invoqué par les requérants mais le Conseil choisit de l’associer à l’article 66 de la Constitution. Il estime que « le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus bref délais » (cons. 8). Il reprend ici un considérant formulé à l’occasion de la décision relative à l’hospitalisation sans consentement17. Il considère alors simplement « qu’il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence y compris lorsque la chambre de l’instruction statue sur renvoi de la Cour de cassation » (cons. 8). Il en conclut que « sous cette réserve, l’absence de disposition législative fixant un délai maximum dans lequel la chambre de l’instruction doit statuer » est constitutionnel. Il reprend ainsi la solution énoncée dans la décision n° 2010-71 QPC.
La décision peut surprendre. D’abord, si les deux séries de dispositions sont comparables, elles sont loin d’être identiques. La disposition en cause intervenait en matière de procédure pénale et l’article 34 de la Constitution exige que « la loi fixe les règles concernant (…) la procédure pénale ». Ainsi, le silence du législateur en la matière, que le Conseil reconnaît expressément, aurait dû suffire à censurer le dispositif.
Ensuite, le Conseil semble tirer argument de la possibilité, pour la personne placée en détention provisoire ou son avocat, de demander sa mise en liberté, à tout moment (cons. 7). Or la Cour de cassation a au contraire considéré qu’une telle voie de droit ne permettait pas de contester la légalité du titre de détention. Dans le cas où la validité du placement en détention n’avait été examiné que plusieurs mois après la décision de renvoi, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait jugé que si cela était « regrettable », il n’y avait pas eu violation de l’article 5, § 4 de la Convention EDH car « l’intéressé avait la possibilité de former à tout moment des demandes de mise en liberté et, à cette occasion, faire examiner la validité du titre de détention ». La Cour de cassation a cassé cet arrêt aux motifs que : « la personne mise en examen n’est pas recevable à invoquer l’irrégularité de la décision initiale de placement en détention »18. En l’espèce, sept mois s’étaient écoulés et aucune voie de droit ne permettait à l’intéressé de contester utilement sa détention.
Enfin, le Conseil maintient le caractère complètement aléatoire de la durée d’examen d’une telle demande. La Cour de cassation renvoyait la question aux motifs que « la personne mise en examen se trouve dans l’impossibilité de connaître le délai dans lequel sera examinée la légalité de sa détention et de faire sanctionner le dépassement d’un tel délai »19. Elle avait déjà relevé cette difficulté dans son rapport annuel de 2013 où elle proposait « de compléter les articles 148-2 et 194 du Code de procédure pénale afin de rendre applicables les délais prévus par ces dispositions aux cas dans lesquels doit statuer une juridiction saisie sur renvoi après cassation par la chambre criminelle » (p. 83-84). Le Conseil ne répond pas au problème soulevé en imposant simplement « de statuer dans les plus brefs délais » (cons. 8). La Cour de cassation avait déjà envisagé un tel pansement jurisprudentiel en faisant application de l’article 5, § 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui impose que la juridiction se prononce à bref délai20. Cependant, les intéressés restent tributaires de l’interprétation qui sera faite de ce qui constitue un « bref délai » et n’auront pas de moyen de le faire sanctionner. Pour toutes ces raisons, la Cour de cassation appelait de ses vœux une réforme et la question prioritaire de constitutionnalité lui offrait les moyens de contraindre le législateur à la mettre en œuvre. Le Conseil n’a pas voulu la suivre dans cette voie. Il se contente d’inciter timidement le législateur à légiférer (cons. 12) et déclare la disposition conforme sous réserve.
Le législateur a souhaité fixer un tel délai à l’article 23 de la loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne mais le Conseil constitutionnel a considéré que cet article était un cavalier législatif et l’a censuré dans sa décision n° 2015-719 DC du 13 août 2015. Le véhicule législatif permettant la mise en œuvre de cette réforme semble difficile à trouver.
Dans la deuxième décision, était en cause l’article 911-8 du Code de justice administrative. Il prévoit que lorsque le juge administratif rend son jugement sous astreinte, il peut décider qu’une partie de l’astreinte ne sera pas versée au requérant (alinéa 1er) et que, dans ce cas, elle sera reversée à l’État (alinéa 2). La difficulté intervient lorsque la partie perdante est l’État lui-même. Le Conseil d’État considère alors que, dans ce cas, seul l’alinéa 1er s’applique. La part versée au requérant peut être réduite par le juge à l’occasion de la liquidation de l’astreinte mais l’État n’est pas contraint de se reverser la part restante21. Le Conseil d’État avait pourtant d’abord considéré que « lorsqu’une astreinte est prononcée à l’encontre de l’État, la juridiction ne fait pas usage de cette faculté et attribue l’intégralité de la somme au requérant »22. Cependant, le Conseil constitutionnel, pour apprécier la constitutionnalité du dispositif, se base sur le dernier état de la jurisprudence administrative (cons. 5). Le requérant invoquait la méconnaissance du droit à l’exécution des décisions de justice qui serait une composante du droit à un recours juridictionnel.
Le Conseil constitutionnel va d’abord réaffirmer l’existence d’un tel droit en considérant que le droit à un recours juridictionnel effectif « comprend celui d’obtenir l’exécution des décisions juridictionnelles » (cons. 3). La reconnaissance de la valeur constitutionnelle d’un tel droit n’est pas nouvelle. Le Conseil avait déjà jugé que « toute décision de justice a force exécutoire ; qu’ainsi, tout jugement peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle y est requise, prêter main-forte à cette exécution »23. Cependant, le fondement retenu n’est plus tout à fait le même. Considérant alors qu’il s’agissait d’un « corollaire du principe de la séparation des pouvoirs énoncé à l’article 16 de la Déclaration »24 ; il le rattache à présent au droit au recours.
Ensuite, le Conseil se base sur l’objectif de la mesure d’astreinte, qu’il présente de manière détaillée (cons. 4). Il en donne une définition qui semble directement inspirée de la définition doctrinale citée dans le commentaire de la décision (p. 1) : « l’astreinte est une mesure comminatoire qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter une décision juridictionnelle » (cons. 6). Il met en avant la liberté dont dispose le juge pour en fixer le taux (cons. 7). Puis, il relève que la faculté de réduire le montant de l’astreinte, d’une part, a lieu postérieurement à sa liquidation et, d’autre part, relève du seul pouvoir d’appréciation du juge. Le Conseil semble considérer qu’ainsi le caractère comminatoire du dispositif n’est pas remis en cause. Il en conclut alors que « le respect des exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 est garanti par le pouvoir d’appréciation ainsi reconnu au juge depuis le prononcé de l’astreinte jusqu’à son versement postérieur à la liquidation » (cons. 7).
Enfin, il ajoute que la responsabilité de l’État pourra être engagée (cons. 7). Cet élément semble être ajouté afin de rappeler que l’astreinte n’a pas vocation à constituer des dommages et intérêts mais uniquement à contraindre la partie perdante à l’exécution.
Quelques objections peuvent être formulées à l’encontre du raisonnement suivi. Le Conseil semble ici faire peu de cas du fait que l’astreinte est en soi une décision de justice qui en tant que telle devrait recevoir exécution. De plus, il se place uniquement du point de vue du requérant qui ne touchera pas la totalité du montant mais il omet que réciproquement l’État, contrairement à toute autre partie dans une situation identique, ne sera pas contraint de verser l’intégralité de la somme due. Or l’astreinte vise davantage à contraindre la partie perdante qu’à récompenser le requérant ; l’objectif même de la mesure semble ainsi perdu de vue. Enfin, le fait que le juge dispose d’un important pouvoir pour fixer le taux de l’astreinte devrait, au contraire, justifier l’inutilité d’un autre dispositif de modulation.
Sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration des droits, le Conseil constitutionnel considère également que « les principes d’indépendance et d’impartialité sont indissociables de l’exercice des fonctions juridictionnelles »25.
Dans sa décision n° 2014-438 QPC du 16 janvier 2015, le Conseil constitutionnel était amené à juger de la constitutionnalité du dispositif permettant à la juridiction commerciale « de se saisir d’office pour convertir la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire lorsqu’il apparaît, après l’ouverture de la procédure de sauvegarde, que le débiteur est déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement » (C. com., art. L. 621-12) (cons. 2). Le Conseil considère d’abord que la procédure en cause ne rentre pas dans le cadre de la jurisprudence relative à la saisine d’office. Puis, il contrôle la conformité au principe d’impartialité des pouvoirs que le juge peut exercer d’office.
Le Conseil constitutionnel a, ces quatre dernières années, développé une jurisprudence assez précise relative à la saisine d’office des juridictions fondée sur le principe d’impartialité26. Il a, dans un considérant de principe repris dans la décision en cause (cons. 4), exclut, par principe, la constitutionnalité d’une saisine d’office. À cette occasion il en donne une définition : la saisine d’office est « la faculté d’introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle [la juridiction] prononce une décision revêtue de l’autorité de chose jugée » (cons. 4). Ainsi, la juridiction doit maîtriser l’intégralité de la procédure de son déclenchement au prononcé de la décision. Néanmoins, un tel dispositif peut, lorsqu’il ne permet pas le prononcé d’une sanction, être constitutionnel à deux conditions. D’une part, il doit être fondé sur un motif d’intérêt général. D’autre part, la loi doit instituer des garanties propres à assurer le respect du principe d’impartialité.
Le Conseil a estimé que, lorsque le juge procède à la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, il ne se saisit pas d’une nouvelle instance. Ainsi, la jurisprudence relative à la saisine d’office n’est pas applicable à cette procédure (cons. 9). Il suit le même raisonnement que pour le prononcé d’office de la liquidation judiciaire ou de la cessation partielle de l’activité pendant la période de redressement judiciaire27.
En revanche, à cette occasion, le juge peut exercer certains pouvoirs d’office dans le cadre de cette instance. D’après le commentaire de la décision, cela « fait du juge un acteur du procès au cours de l’instruction dans des conditions qui sont susceptibles de constituer un pré-jugement » (p. 7). Le Conseil a dégagé, en se fondant sur le principe d’impartialité également, un cadre constitutionnel pour l’exercice d’une telle faculté. Celle-ci est soumise à la double condition d’être « justifiée par un motif d’intérêt général et exercée dans le respect du principe du contradictoire »28 (cons. 10). Ce principe, formulé très largement, s’applique à tout pouvoir exercé d’office par le juge.
La condition relative à l’existence d’un motif d’intérêt général semble appréciée de manière assez souple. Ainsi, la volonté « d’éviter l’aggravation irrémédiable de la situation de l’entreprise »29 (cons. 11) constitue un tel motif. De même, le fait que le débiteur soit « entendu ou dûment appelé » avant le prononcé de la conversion constitue une garantie suffisante du respect du principe du contradictoire (cons. 12).
Il conclut donc à la constitutionnalité du dispositif institué par l’article L. 621-12 du Code de commerce. Toutefois, l’article 2 de l’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives a abrogé la phrase prévoyant que le tribunal « peut également se saisir d’office ».
Dans la décision n° 2014-457 QPC, le Conseil constitutionnel avait à connaître de la composition du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens. Lorsque cet ordre prononce des sanctions, il exerce des fonctions juridictionnelles. À ce titre, ses membres, comme la juridiction dans son ensemble, doivent être indépendants et impartiaux (cons. 4). Cela signifie que, d’une part, ils ne doivent pas être soumis à des pressions extérieures, notamment émanant d’autres pouvoirs publics, et, d’autre part, qu’ils ne doivent pas avoir d’a priori sur l’affaire qu’ils auront à juger.
La requérante contestait « la présence de membres siégeant en qualité de représentants de ministres ». Le Conseil va d’abord contrôler le respect du principe d’impartialité. Il relève que, « lorsque la saisine émane d’un ministre ou d’un autre représentant de l’État », les représentants de l’État ne peuvent siéger au Conseil national de l’Ordre réuni en formation disciplinaire. Il estime alors que ces garanties légales permettent « de satisfaire au principe d’impartialité » (cons. 5).
S’agissant du principe d’indépendance, le Conseil relève que les membres désignés par les ministres « ne siègent pas en tant que membres nommés au sein du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire mais en qualité de représentants respectivement du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé de l’Outre-mer ». Ainsi, des représentants des membres du Gouvernement siègent dans une juridiction. Selon le Conseil, cela compromet en soi l’indépendance de la juridiction. La circonstance qu’ils n’aient qu’une voie consultative n’est pas suffisante pour écarter de grief d’inconstitutionnalité (cons. 6). Le Conseil déclare donc inconstitutionnelles les dispositions instituant ces représentants et leur donnant voix consultative.
2 – Le principe de sécurité juridique
Dans la décision n° 2015-710 DC du 12 février 2015, le Conseil a examiné la constitutionnalité de l’article 8 de la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Cet article habilite le Gouvernement « à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier la structure et le contenu du livre III du Code civil, afin de moderniser, de simplifier, d’améliorer la lisibilité, de renforcer l’accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la norme », puis il fixait en treize point les modalités d’une telle réforme.
Les sénateurs auteurs de la saisine soutenaient que la procédure même de l’ordonnance était source d’une trop grande insécurité juridique : l’entrée en vigueur de l’ordonnance puis sa ratification, avec d’éventuelles modifications, créerait, en raison de la succession même de régimes juridiques distincts, une insécurité juridique : « Si votre Conseil validait l’habilitation donnée au Gouvernement sur ce sujet vaste, l’ordonnance entrerait en vigueur immédiatement après sa publication. Elle régirait donc les contrats conclus sous son empire. Puis, dans le meilleur des cas, le Parlement la ratifierait dans des délais inconnus, sans exclure d’en modifier certaines dispositions. Le Parlement créerait alors un nouveau droit des contrats, appelé à régir ceux conclus après qu’il se serait prononcé ». L’argument apparaît particulièrement spécieux. S’il avait été admis, il aurait pu l’être en toute autre matière puisque la difficulté soulevée est inhérente à la procédure des ordonnances.
Le Conseil se borne alors à rappeler que les exigences liées à la sécurité juridique s’imposent au législateur « lorsqu’il modifie, notamment à l’occasion de sa ratification, les dispositions d’une ordonnance entrées en vigueur » (cons. 7). Il rappelle alors les principes encadrant les validations législatives (la poursuite d’un but d’intérêt général suffisant, le respect des décisions de justice ayant force de chose jugée, le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions)30, fondés sur l’article 16 de la Déclaration des droits ; ainsi que ceux prohibant l’atteinte aux contrats légalement conclus, fondés sur les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits31.
MB
Notes de bas de pages
-
1.
V. comme précédents en ce qui concerne l’extension du champ du droit de propriété aux nationalisations d’entreprises, Cons. const., 16 janv. 1982, n° 81-132 DC, loi de nationalisation ; à la propriété industrielle et commerciale, Cons. const., 8 janv. 1991, n° 90-283 DC, loi relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme ; à la propriété culturelle, Cons. const., 27 juill. 2006, n° 2006-540 DC, loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société d’information.
-
2.
Les articles L. 15-1 et L. 15-2 sont désormais codifiés au C. expr., art. L. 231-1 et C. expr., art. L. 331-3 pour cause d’utilité publique issus de l’article 6 de l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
-
3.
V. supra la rubrique III.E/3.Libre administration et les élections locales.
-
4.
V. les décisions fondatrices : Cons. const., 8 août 1985, n° 85-196 DC, loi sur l’évolution de la Nouvelle-Calédonie, cons. 16 ; Cons. const., 23 août 1985, n° 85-197 DC, loi sur l’évolution de la Nouvelle-Calédonie, cons. 35 ; Cons. const., 2 juill. 1986, n° 86-208 DC, loi relative à l’élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, cons. 20 à 24.
-
5.
V. supra I.C.L’articulation entre le droit interne et les normes internationales et européennes.
-
6.
Cons. const., 29 janv. 2015, n° 2014-446 QPC, M. Maxime T. ; Cons. const., 27 févr. 2015, n° 2014-452 QPC, M. Olivier J. et Cons. const., 18 mars 2015, n° 2014-453-454 QPC, M. John L. et a. ; v. infra, IV.E./1.Principes de légalité, nécessité et individualisation des délits et des peines.
-
7.
Cons. const., 26 mars 2015, n° 2015-459 QPC, M. Frédéric P, à propos du droit de présentation des greffiers des tribunaux de commerce.
-
8.
C. com., art. L. 741-1, pour les greffiers et ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.
-
9.
Est prise en compte la rédaction du CGI, art. 235 ter ZAA, dans sa rédaction issue du paragraphe I de l’article 30 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. Il s’agit de la rédaction applicable à la période au cours de laquelle la société requérante (société Nextradio TV) demande la restitution des droits de la CEIS dont elle s’est acquittée au titre des exercices clos de 2011 et 2012.
-
10.
V. CGI, art. 760, paragraphe 1.
-
11.
V. CGI, art. 760, paragraphe 2.
-
12.
Selon l’arrêt de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 19 déc. 1973, n° 72-13236) auquel se réfère le Conseil constitutionnel dans la présente décision, la situation de déconfiture se caractérise « par l’état du débiteur non commerçant dont le passif surpasse l’actif et qui se trouve dans l’impossibilité de satisfaire intégralement tous ses créanciers lorsque ceux-ci ont cessé de lui faire crédit ».
-
13.
Cass. crim., 13 nov 2014, n° 14-81249.
-
14.
C’est nous qui soulignons.
-
15.
Implicitement : Cons. const., 21 janv. 1994, n° 93-335 DC, loi portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction et, explicitement : Cons. const., 9 avr. 1996, n° 96-373 DC, loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
-
16.
Cons. const., 11 juin 2010, n° 2010-2 QPC.
-
17.
Cons. const., 26 nov. 2010, n° 2010-71 QPC.
-
18.
Cass. crim., 12 juin 2013, n° 13-82084.
-
19.
Cass. crim., 12 nov. 2014, n° 14-86016.
-
20.
V. par ex. Cass. crim., 24 mai 2011, n° 11-81118.
-
21.
V. par ex. : CE, 30 mars 2001, n° 185107 ; CE, 24 oct. 2001, n° 204962 ; CE, 14 nov. 2001, n° 183450 ; CE, 13 juill. 2007, n° 270327.
-
22.
Résumé de la décision CE, 28 févr. 2001, nos 205476 et 209474.
-
23.
Cons. const., 29 juill. 1998, n° 98-403 DC, cons. 46.
-
24.
Idem.
-
25.
Cons. const., 26 mars 2006, n° 2010-110 QPC.
-
26.
Cons. const., 7 déc. 2012, n° 2012-286 QPC ; Cons. const., 15 nov. 2013, n° 2013-352 QPC ; Cons. const., 7 mars 2014, n° 2013-372 QPC ; Cons. const., 7 mars 2014, n° 2013-368 QPC ; Cons. const., 6 juin 2014, n° 2014-399 QPC.
-
27.
Cons. const., 6 juin 2014, n° 2014-399 QPC, préc.
-
28.
Idem, cons. 10.
-
29.
Idem, cons. 11.
-
30.
Cons. const., 14 déc. 2006, n° 2006-544 DC.
-
31.
Cons. const., 13 janv. 2003, n° 2002-465 DC.