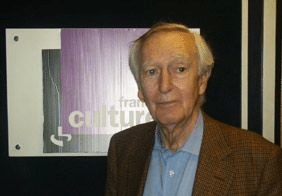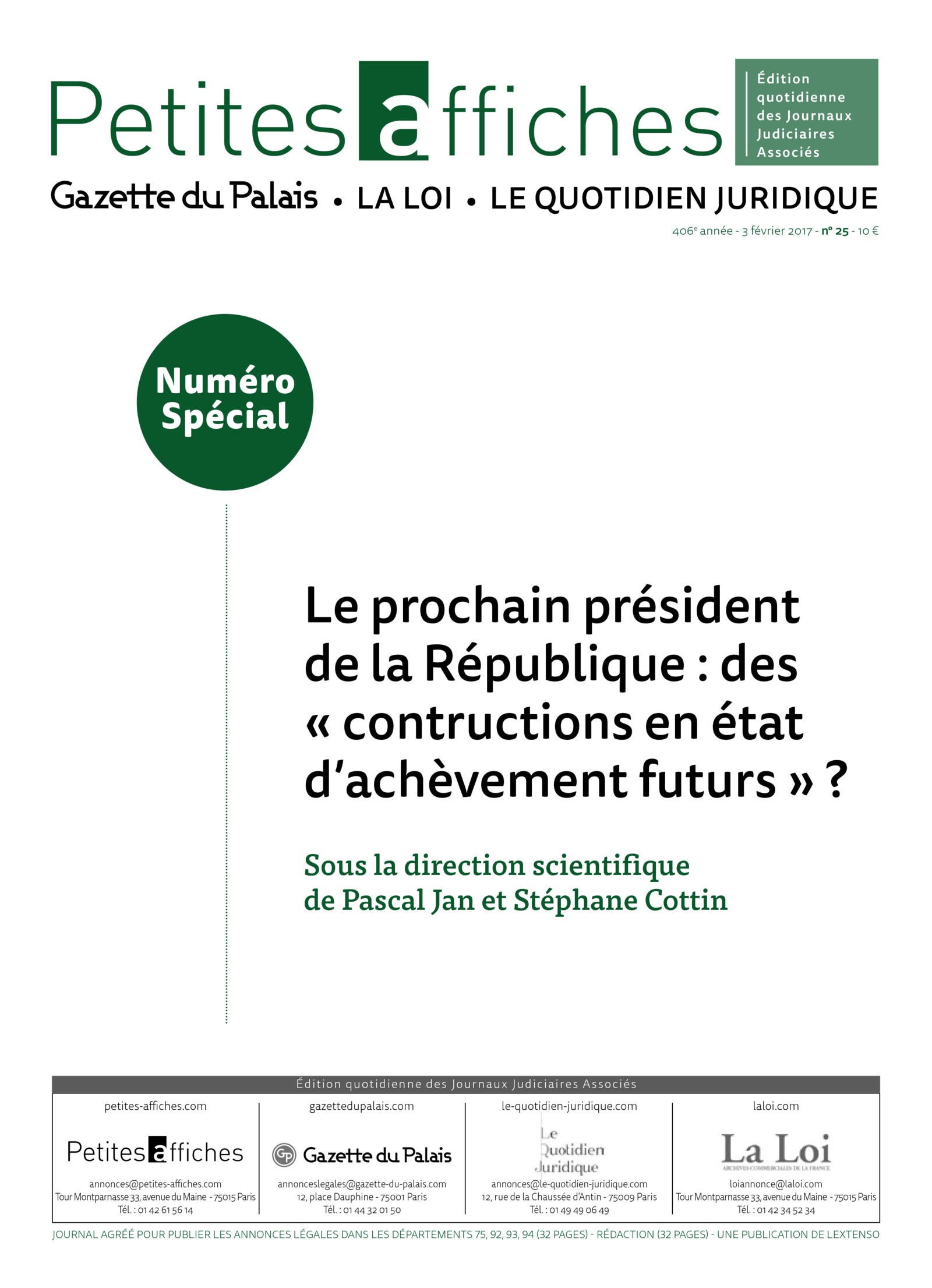Irrecevable, vous avez dit irrecevable ? Sur une étrange décision du Bureau de l’Assemblée nationale
Instaurée par la loi constitutionnelle du 23 février 2007, la procédure de destitution du président de la République par la Haute Cour a attendu pour entrer effectivement en vigueur l’adoption de la loi organique du 24 novembre 2014 portant application de l’article 68 de la Constitution. À ces sept années de tergiversations, le Bureau de l’Assemblée nationale ajoute la perplexité en déclarant non recevable, le 23 novembre 2016, la proposition de résolution qui inaugure la nouvelle procédure.
La procédure visant à réunir la Haute Cour en vue de la destitution du président de la République « en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » (article 68, alinéa 1er, de la Constitution), présente de grandes analogies avec celle de la motion de censure, parce que son objet est de mettre en cause la responsabilité institutionnelle du président de la République. De nature exclusivement politique, sa mise en œuvre relève directement de la représentation nationale elle-même : ainsi, elle doit être signée par au moins un dixième des membres de l’assemblée concernée ; de même, seuls les votes favorables à la destitution sont recensés (mais ils doivent réunir les deux tiers des membres de l’assemblée) ; enfin, elle est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour, mais sous réserve de satisfaire aux conditions de recevabilité.
C’est ici qu’intervient la différence : l’initiative prend la forme d’une proposition de résolution (et non d’une motion) dont le Bureau de l’assemblée saisie vérifie la recevabilité ; elle est ensuite, selon le droit commun, renvoyée à la commission compétente, mais celle-ci se borne à un simple avis qui ne saurait entraver la poursuite de la procédure.
Le seul obstacle à l’inscription à l’ordre du jour résulte donc du contrôle de la recevabilité de la proposition par le Bureau, dont l’article 1er, alinéa 2, de la loi organique du 24 novembre 2014 portant application de l’article 68 de la Constitution détermine les conditions : « La proposition de résolution est motivée. Elle justifie des motifs susceptibles de caractériser un manquement au sens du premier alinéa de l’article 68 de la Constitution. Elle est signée par au moins un dixième des membres de l’assemblée devant laquelle elle est déposée ».
L’article 2 dispose simplement en son premier alinéa : « Le Bureau de l’assemblée devant laquelle la proposition de résolution a été déposée vérifie sa recevabilité au regard des conditions posées à l’article 1er », et l’alinéa suivant précise : « Si le Bureau constate que ces conditions ne sont pas réunies, la proposition de résolution ne peut être mise en discussion ».
Or telle est la décision qu’a prise le Bureau de l’Assemblée nationale le 23 novembre 2016 à l’égard de la proposition de résolution visant à réunir le Parlement en Haute Cour, en vue d’engager la procédure de destitution à l’encontre du président de la République : il « considère que la proposition de résolution ne justifie pas de motifs susceptibles de caractériser un manquement au sens du premier alinéa de l’article 68 de la Constitution ».
La décision d’irrecevabilité, prise par 13 voix contre 8, à main levée (le scrutin secret ayant été refusé), soulève une sérieuse difficulté quant à sa motivation – ou, plutôt, à son absence de motivation – par rapport à l’article 2 de la loi organique du 24 novembre 2014. Selon celui-ci, en effet, le Bureau « vérifie » la recevabilité « au regard des conditions posées à l’article 1er », à savoir le nombre requis de signatures (condition satisfaite : la proposition est signée par 79 députés) et la motivation. Or la proposition est motivée1 : c’est donc l’interprétation de la justification qui est en cause.
Il faut, pour en saisir la portée, se reporter aux travaux préparatoires. C’est le rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée, Philippe Houillon, qui a proposé de confier au Bureau « un simple contrôle de la recevabilité de la proposition de résolution », et de compléter l’article 1er par le membre de phrase litigieux (« elle justifie des motifs susceptibles de caractériser un manquement… »), afin de « déclarer irrecevables les propositions de résolution fantaisistes qui n’entreraient pas dans le champ du dispositif prévu à l’article 68 de la Constitution ». Cette adjonction vise donc seulement à préciser le sens qu’il convient de donner à la motivation, laquelle ne peut invoquer n’importe quel motif : « Cela permettra de s’assurer que la proposition s’inscrit bien dans le champ d’application de l’article 68 de la Constitution »2.
En d’autres termes, la mission du Bureau est d’exercer « un simple contrôle de la recevabilité » en vérifiant seulement l’existence d’une justification qui mette en cause un comportement du président constitutif d’un manquement que les signataires considèrent « incompatible avec l’exercice de son mandat ». L’article 2 de la loi organique n’autorise donc pas le Bureau à apprécier la pertinence des motifs, il suffit qu’ils allèguent un tel manquement dont il appartiendra aux débats en séance de juger la gravité.
La portée exacte de l’article 2, telle qu’on vient de la préciser, ressort d’ailleurs a contrario d’une disposition du projet de la loi organique que la commission, suivie par l’Assemblée, a supprimée pour lui substituer le « simple contrôle » du Bureau. L’article 2 du projet disposait en effet que « la commission de la première assemblée saisie (à laquelle la proposition de résolution est renvoyée) s’assure que la proposition n’est pas dénuée de tout caractère sérieux. À défaut, la proposition ne peut être mise en discussion ».
« Un tel filtrage », observe Philippe Houillon, « était à la fois contestable sur le fond et discutable du point de vue de la constitutionnalité »3. En effet, il aurait permis d’exercer le contrôle du « sérieux » des motifs de la proposition et d’en empêcher ainsi la discussion en séance. Mais n’est-ce pas l’opération à laquelle s’est précisément livré le Bureau le 23 novembre dernier ?
En tout cas, on ne saurait considérer comme précédent un épisode aussi contraire à l’esprit et à la lettre des dispositions constitutionnelles et organiques.
ANNEXE : Proposition de résolution visant à réunir le Parlement en Haute Cour, en vue d’engager la procédure de destitution à l’encontre du président de la République, prévue à l’article 68 de la Constitution et à la loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l’article 68 de la Constitution
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Avec étonnement et consternation, les Français ont pu prendre connaissance du livre récent de MM. Davet et Lhomme intitulé Un président ne devrait pas dire ça. Dans ces pages surprenantes, produit d’une soixantaine d’entretiens couvrant la quasi-totalité de son mandat, le président de la République, chef des armées, s’installant lui-même dans le rôle de commentateur, en temps réel de ses décisions les plus secrètes en matière d’emploi de la force armée, a communiqué par le menu à ces journalistes du Monde le contenu de ses conversations avec les présidents Obama et Poutine, son analyse détaillée de leur psychologie et de ses propres « tourments intérieurs ». Il les a même fait assister en direct, à un échange téléphonique avec le Premier ministre grec !
Le président leur a confié par ailleurs le ciblage des bombardements français sur des objectifs en Syrie et des documents ultraconfidentiels fuités aux journalistes, qui seront par la suite publiés dans leur journal ; il leur a détaillé les conditions de libération des otages par nos forces spéciales ; il leur a précisé que la France paie des preneurs d’otage, directement ou indirectement. Il leur a confié qu’il a lui-même ordonné l’assassinat de terroristes identifiés, les fameuses opérations « Homo » : « J’en ai décidé quatre au moins », a-t-il déclaré. La liste des personnes ciblées sera communiquée aux mêmes journalistes.
« La France est en guerre », avait pourtant dit lui-même le président de la République le 16 novembre 2015 devant le Parlement réuni en Congrès. Nous sommes en état d’urgence, que nous avons prorogé à plusieurs reprises. Nous avons eu 250 morts et 800 blessés l’an dernier. Près de 20 000 soldats français sont engagés, tant sur le sol national que sur plusieurs théâtres d’opération qui, tous, engagent les conséquences graves pour la sécurité de la France. Dans de telles conditions, est-il concevable que le président de la République, dans l’exercice de ses fonctions, viole ainsi ouvertement l’obligation de secret qui pèse sur les décisions les plus sensibles qu’il doit prendre en tant que chef des armées ?
Autant de telles confessions seraient compréhensibles, sinon conformes au droit, dans des Mémoires rédigées dix ou vingt ans après les faits, par un président qui aurait quitté le pouvoir depuis longtemps ; autant de telles révélations sont proprement intolérables et même dangereuses, alors que la France est en guerre et que le président est censé en assumer la conduite. On sait que Mme Clinton est aujourd’hui critiquée et même menacée de poursuites, pour avoir utilisé sa boite mail personnelle alors qu’elle était à la tête du Département d’État.
Pour mesurer la gravité des « confessions » présidentielles ainsi révélées, il n’est pas inutile en effet de garder à l’esprit l’extrême rigueur qu’impose notre droit, en cas de divulgations de secrets concernant la défense nationale pour toute autre personne… qui ne serait pas président de la République.
Si par exemple, un officier de l’une de nos unités de l’armée française, un responsable de nos services de renseignement, voire l’un de nos diplomates, était pris d’une envie aussi soudaine qu’irrépressible de révéler publiquement le quart de la moitié des secrets de défense nationale que le président de la République a lui-même divulgués à deux journalistes du Monde, alors les articles 413-9 et suivants du Code pénal viendraient à s’appliquer dans toute leur rigueur. Soit « sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, d’un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit d’en donner l’accès à une personne non qualifiée ou de le porter à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée ». La loi prévoit qu’en cas d’imprudence ou de négligence, l’infraction est punie « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende » (article 413-10) ; elle prévoit également l’interdiction d’exercer une fonction publique (article 414-5 du même Code).
La question de l’application de l’article 68 de la Constitution doit dès lors être posée.
Il ne s’agit aucunement de proposer ici de « juger » le président de la République pour ses confidences, ni même de prétendre les qualifier sur le plan pénal. Au demeurant, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014 sur la loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution, a clairement rappelé que « la Haute Cour, instituée à la suite de la suppression de la Haute Cour de justice, ne constitue pas une juridiction chargée de juger le président de la République pour des infractions commises par lui en cette qualité, mais une assemblée parlementaire compétente pour prononcer sa destitution en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ».
Or, les confidences du président de la République, tout autant qu’un effondrement de la fonction présidentielle, relèvent d’un manquement caractérisé à ses devoirs, « manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat », tel que prévu aux termes de l’article 68 de la Constitution.
Il n’est pas inutile de rappeler ici l’origine de la révision constitutionnelle du 23 février 2007, qui a conduit à l’adoption de cet article.
Après les tentatives du juge Halphen de mettre directement en cause le président Chirac alors au pouvoir en 2001, la commission Avril instituée l’année suivante avait retenu l’idée de confirmer l’irresponsabilité du chef de l’État pour les actes accomplis en cette qualité, de garantir son immunité judiciaire, civile et pénale, pendant toute la durée de son mandat, mais avec logiquement pour contrepartie, la possibilité d’une destitution lorsque le président « manque à ses devoirs ».
C’est précisément ce que prévoit l’article 68, en disposant que « Le président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ».
L’extrême gravité des faits précédemment rappelés, qui concernent directement l’exercice du mandat du président de la République, chef des armées aux termes de l’article 15 de la Constitution, qualité que François Hollande a fait ostensiblement valoir auprès de ses interlocuteurs du journal Le Monde, constitue un manquement évident aux devoirs du président de la République, ainsi qu’à la crédibilité et la dignité même de sa fonction.
De surcroît, au moment où la nation est confrontée à un péril imminent justifiant que le Parlement ait prorogé l’état d’urgence pour une durée sans précédent dans l’histoire de la République, les violations répétées du secret relevant de la sécurité nationale sont manifestement incompatibles avec l’exercice du mandat présidentiel :
-
le président de la République, chef des armées, est tenu de préserver le secret de nos opérations militaires et de notre stratégie, afin de protéger le succès de nos armes et l’intégrité du territoire national. Or, la divulgation d’opérations aériennes, celle de l’exécution décidée par le chef de l’État lui-même, de chefs djihadistes, mettent en péril cet objectif ;
-
le président de la République est le garant de la protection des Français. Or, en révélant que la France payait pour la libération de ses otages, il prend le risque d’inciter à de nouvelles prises d’otages ;
-
le président de la République est le garant de la parole de la France. Or, en révélant le contenu de ses conversations avec des chefs d’État étrangers, voire en faisant participer des journalistes à ces entretiens, il met en cause la crédibilité de la parole de la France et la confiance de ses partenaires.
La mise en œuvre de l’article 68 paraît donc indispensable. Elle permettra en outre de faire la lumière sur l’étendue des informations secrètes ou confidentielles relevant de la sécurité nationale, qui ont pu être divulguées aux journalistes, ainsi que de signaler solennellement que ce type de débordement ne saurait se reproduire, surtout dans une période dans laquelle nous allons être confrontés à une guerre longue contre le terrorisme.
Pour l’ensemble de ces motifs, nous vous invitons à adopter la présente proposition de résolution visant à réunir le Parlement en Haute Cour, en vue d’engager la procédure de destitution à l’encontre du président de la République, prévue l’article 68 de la Constitution et à la loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l’article 68 de la Constitution.
Article Unique :
En application de l’article 68 de la Constitution et de la loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l’article 68 de la Constitution, le Parlement est réuni en Haute Cour.