L’état d’urgence, étude constitutionnelle, historique et critique
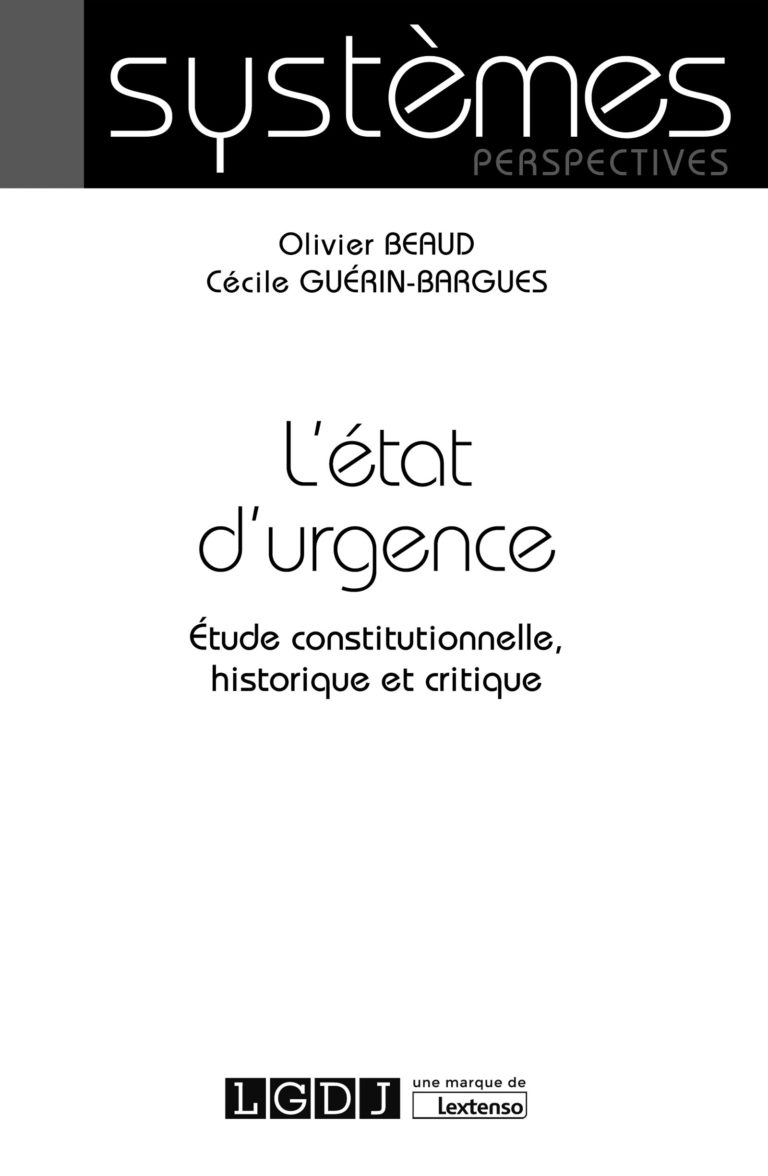
Couverture de l’ouvrage d’Olivier Beaud et Cécile Guérin-Bargues
DR
La loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 a prolongé une nouvelle fois l’état d’urgence, jusqu’au 15 juillet 2017, en précisant que les changements de gouvernement consécutifs aux élections présidentielle et législatives n’y mettront pas fin. Cette dernière précision n’a pas été relevée par les commentateurs, à tout le moins dans la presse généraliste ou au sein de la classe politique1. Pourtant, cet ajout, loin d’être anecdotique, révèle la complexité du régime juridique de l’état d’urgence ainsi que sa plasticité. Or ces caractéristiques sont trop souvent méconnues. C’est donc le grand mérite de l’ouvrage d’Olivier Beaud et Cécile Guérin-Bargues de nous montrer la complexité de l’état d’urgence, à travers la triple approche, constitutionnelle, historique et critique, annoncée dans le titre.
Cette approche peut d’ailleurs surprendre, au moins dans son choix de privilégier un prisme constitutionnel sur un tel sujet. Les auteurs s’en expliquent dans une introduction modeste, car elle admet qu’une tel parti-pris conduit à écarter certains aspects importants de l’état d’urgence, comme par exemple « le choc frontal entre l’état d’urgence et les libertés publiques »2, mais extrêmement éclairante. Ils soulignent en effet que l’état d’urgence intéresse bel et bien le droit constitutionnel, dès lors que l’on admet qu’il n’est pas seulement une simple extension des pouvoirs de police liée à une situation particulière, mais qu’il entre bien dans la catégorie des pouvoirs de crise, qui recouvrent également l’état de siège et le régime de l’article 16 de la Constitution, ce qui est difficilement contestable. Dès lors, la démarche apparaît pleinement pertinente.
Dans ce cadre, les auteurs nous proposent de tout d’abord « décrypter le droit de l’état d’urgence ». Ce détour par le droit positif s’impose indiscutablement, tant il s’avère plus complexe que ce qu’une simple intuition laisserait penser. C’est même à un « véritable fouillis juridique »3 que l’on se trouve confronté.
Cette situation tient en fait à la relative complexité du régime de l’état d’urgence, tel que l’a créé la loi du 3 avril 1955. Cette loi prévoyait en effet une distinction entre d’une part la déclaration de l’état d’urgence, réservée au Parlement, qui délimite à cette occasion une circonscription dans laquelle il pourra être appliqué et d’autre part son application stricto sensu, confiée au gouvernement, qui devra déterminer des zones, plus précises, où il sera effectivement mis en œuvre. Cette distinction emporte d’autant plus d’effets que, comme le souligne Roland Drago, lors de l’application, le gouvernement peut ajouter un certain nombre de mesures de police, comme les perquisitions de jour et de nuit, conduisant à ce qu’il appelle un « état d’urgence aggravé »4. Cette distinction, subtile, est encore rendue plus difficile à saisir depuis que l’ordonnance du 15 avril 1960 a transféré du Parlement au président de la République la compétence de déclarer l’état d’urgence, tout en conférant au Parlement le soin de le prolonger. En outre, quiconque, dans un louable mouvement de référence aux textes, se reporterait à la loi de 1955, se heurterait à une difficulté supplémentaire, liée à la présence, au sein de celle-ci, à la fois de la définition de l’état d’urgence et de la déclaration de celui-ci pour l’ensemble de l’Algérie, alors française. Cette observation est l’occasion pour les auteurs d’un détour fort intéressant par la théorie du droit et plus précisément par la distinction entre « acte-règle » et « acte condition », que regroupe la loi de 1955, ainsi que l’avait déjà observé François Luchaire dans son commentaire sur la décision du Conseil constitutionnel du 25 janvier 19855. Intellectuellement stimulante, cette distinction est en outre la seule véritablement opérante pour expliquer que l’état d’urgence puisse être suspendu par un événement extérieur, une dissolution en 1955, un changement de gouvernement en 1958 ou les deux en 1962, sans que le régime de l’état d’urgence lui-même disparaisse.
Complexe au plan du droit positif, l’état d’urgence est aussi très riche lorsqu’on l’envisage sous l’angle historique. Il a fait l’objet en effet de multiples applications depuis 1955, dans des contextes différents qui, tous, agissent comme autant de révélateurs.
L’adoption de la loi du 3 avril 1955 est évidemment étroitement liée au contexte algérien. Il s’agissait d’élaborer un instrument de nature à permettre de renforcer les prérogatives des autorités engagées dans la lutte contre les rebelles sans en passer par le déclenchement de l’état de siège, dont on craignait le symbole qu’il représentait mais aussi qu’il révélât que la crise était plus profonde qu’on ne voulait bien l’admettre. Et ce contexte algérien marque aussi les débats qui ont eu lieu lors de l’adoption de la loi. En effet, si elle ne fut pas absente, la question de l’atteinte aux libertés passa en second plan, derrière la dénonciation d’une entreprise de renforcement de l’oppression coloniale. C’est encore la situation algérienne qui entraîne la seconde utilisation de l’état d’urgence, à compter du 17 mai 1958, mais cette fois-ci dans la perspective de prévenir une prise de pouvoir par des troupes factieuses et, innovation notoire, sur une zone couvrant l’ensemble du territoire métropolitain. Ce sont à nouveau des événements liés à l’Algérie qui ont entraîné la mise en œuvre de l’état d’urgence à compter du 23 avril 1961. Mais cette fois, elle se fera sous l’empire du régime de l’ordonnance du 15 avril 1960. Surtout, nouveauté permise par le changement de Constitution, l’utilisation de l’état d’urgence sera combinée à celle de l’article 16, permettant ainsi au général de Gaulle de prolonger l’état d’urgence par une ordonnance prise en vertu de cet article 16.
C’est en Nouvelle-Calédonie que sera à nouveau appliqué l’état d’urgence, quasiment un quart de siècle plus tard. Cette occurrence est d’ailleurs bien connue des juristes, parce qu’elle fut l’occasion d’une célèbre décision du Conseil constitutionnel6, amorçant la possibilité d’un contrôle incident de constitutionnalité. C’est d’ailleurs sous cet angle qu’elle fut commentée7.
En 2005, c’est le territoire métropolitain qui connaîtra, pour la première fois depuis 1961, une nouvelle application de l’état d’urgence, dont la particularité se situe davantage dans ce qu’il a révélé du jeu politique au sein de l’exécutif, avec un affaiblissement présidentiel permettant l’affrontement du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur, que dans son régime juridique, tout à fait classique.
Mais c’est bien sûr l’utilisation de l’état d’urgence à compter de novembre 2015 qui est particulièrement riche d’enseignements. On notera ainsi que la loi du 20 novembre 2015 ne se contente pas de prolonger l’état d’urgence. Elle en modifie également les caractéristiques, avec notamment un nouveau mécanisme de contrôle parlementaire mais aussi, par exemple, la création d’une nouvelle mesure dérogatoire en matière de dissolution des associations ou groupements ou encore le réaménagement du régime des perquisitions administratives. Difficile de nier que, comme le pointent les auteurs, ces modifications se sont faites « en succombant trop souvent à une surenchère sécuritaire »8, tout en perpétuant les « travers législatifs »9 de la loi de 1955 : combinaison d’une loi de circonstance avec des dispositions touchant au fond du droit et malfaçons rédactionnelles. Bien sûr, le climat de peur créé par la violence et l’ampleur des attentats ne fut pas pour rien dans ce résultat, suscitant une volonté de légiférer vite, sans grande considération pour la qualité formelle de ce qui était ainsi produit.
En outre, cette application, en 2015, de l’état d’urgence, s’est accompagnée d’un projet de procéder à sa constitutionnalisation. Sur ce point, les auteurs sont sans ambiguïté, pointant « un projet de révision superflu et insuffisant »10. Il est en effet, à leurs yeux, parfaitement inutile, puisque l’état d’urgence trouve déjà un fondement largement suffisant dans l’article 34 de la Constitution, qui dispose que « la loi fixe les règles (…) concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». Le projet de révision est en outre insuffisant pour répondre à l’objectif qu’il affiche de renforcer les garanties et les contrôles en période d’usage de l’état d’urgence, en particulier parce qu’il ne comporte aucune disposition relative à l’encadrement dans le temps de sa mise en œuvre. On sait que ce projet de constitutionnalisation de l’état d’urgence a fini par être abandonné.
Au final, les auteurs voient dans l’échec de ce projet le résultat de la double difficulté auquel il s’est heurté : d’une part le décalage entre la nécessaire brièveté théoriquement inhérente à l’utilisation de l’état d’urgence et la longue durée dans laquelle s’inscrit hélas la menace terroriste, d’autre part la grande difficulté qu’il y a, dans l’absolu, à concevoir un état d’exception constitutionnel, c’est-à-dire un régime où le droit encadre sa propre limitation. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la manière dont a été fait usage de l’état d’urgence en 2015 démontre à l’envi cette double difficulté. C’est là un constat qui, à défaut de beaucoup nourrir le débat politique, ne peut qu’interpeller les juristes.
Notes de bas de pages
-
1.
V. par ex . Le Monde, 14 déc. 2016, L’Assemblée nationale vote la prolongation de l’état d’urgence.
-
2.
P. 13.
-
3.
P. 18.
-
4.
Drago R., « L’état d’urgence et les libertés publiques », RDP 1955, p. 671.
-
5.
D. 1985, p. 363.
-
6.
Décision n° 85-187 DC, 25 janv. 1985, JO 26 janv. 1985, p. 1137.
-
7.
V. par ex. les remarques de Bruno Genevoix à ce sujet dans « La jurisprudence du Conseil constitutionnel en 1985 », Annuaire International de la Justice Constitutionnelle, 1985, spéc. p. 400-402.
-
8.
P. 128.
-
9.
Ibid.
-
10.
P. 160.





