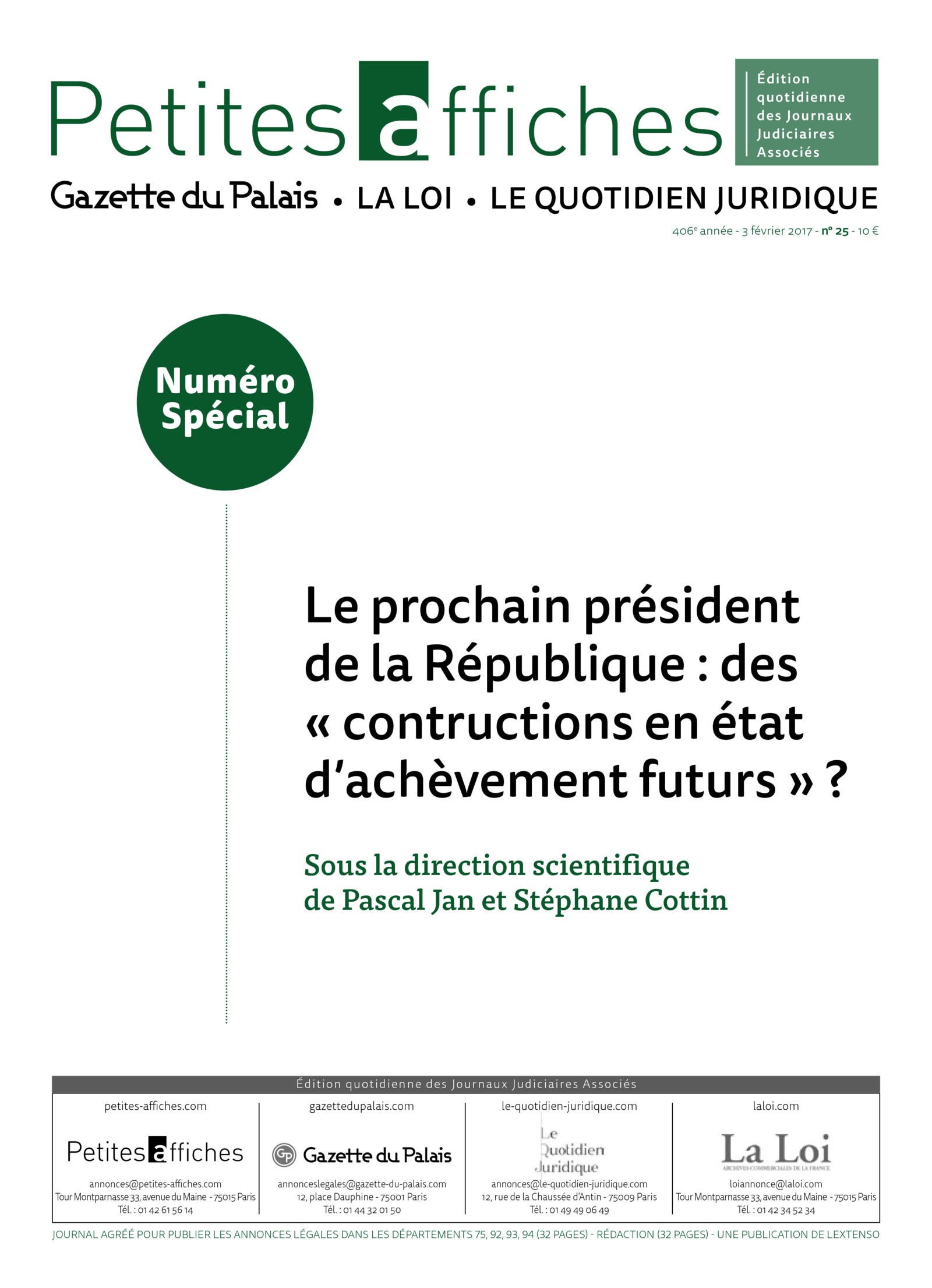Propos offensants à l’égard d’un chef de l’État
Quand l’invective « Casse-toi pov’con », après avoir alimenté les chroniques politico-médiatiques hexagonales, bénéfice d’une destinée européenne devant le prétoire de la Cour de Strasbourg, on se dit que, décidément, la judiciarisation des mœurs est à son comble.
Ce ne fut qu’un seul juge, le juge tchèque qui s’éleva contre l’admissibilité de la requête en soulignant dans son opinion en partie dissidente : « Je pense comme la majorité qu’il y a lieu de manière générale de considérer que la présente espèce est un cas de violation de l’article 10 de la Convention. Toutefois, je ne vois pas que le grief tiré de l’article 10 ait représenté pour le requérant un préjudice important. La peine prononcée, une amende de 30 euros avec sursis, ne saurait selon moi correspondre au “sens ordinaire” que l’on donne aux termes “préjudice important” ». Il est vrai que présenté de telle manière, la critique semble on ne peut plus raisonnable ; dans le même temps, on sait que d’importants « rappels » en matière de droits fondamentaux, peuvent provenir d’affaires presque ridicules : personne n’a oublié le litige concernant une querelle de voisinage relative à du linge suspendu dans une cour d’immeuble à Malte, qui réussit le tour de force de déboucher sur un arrêt de Grande chambre dans l’affaire Micallef1… Qu’en est-il en l’espèce ? La dissidence était-elle véritablement justifiée au regard des principes en jeu ? La cause ne recelait-elle pas, en tout état de cause, un intérêt pour la protection des droits de l’Homme ? Ces interrogations ne sont pas hors de propos quand on rappelle que l’arrêt Micallef – en dépit du fait qu’il fut la manifestation d’une incroyable débauche procédurière dénoncée notamment par le président Costa accompagné des juges Fura, Kovler et Jungwiert – n’en resta pas moins important en ce qu’il orchestra un revirement de jurisprudence remarqué s’agissant des mesures provisoires dans le cadre des procédures d’injonction2. Partant, il est n’est pas inutile de s’immerger rapidement dans l’étude des faits – dont le trame est marquée par la maxime populaire de l’« arroseur arrosé » – afin de pouvoir répondre à ces questions en totale connaissance de cause.
Alors que le requérant avait brandi à Laval, à l’occasion d’une visite de Nicolas Sarkozy, un petit écriteau sur lequel l’expression « Casse-toi pov’con » avait été malicieusement inscrite – en guise de réponse à une réplique mémorable du président de la République au salon de l’agriculture alors qu’un participant avait refusé de lui serrer la main –, il fut poursuivi par le ministère public et condamné pour « délit d’offense au chef de l’État » conformément au très décrié article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. Particulièrement activée sous la présidence du général de Gaulle, cette incrimination était tombée en désuétude depuis 1974 et l’arrivée à la présidence de Valéry Giscard d’Estaing. Son activation a donc « ravivé des souvenirs peu réjouissants »3, tant ce délit pénal semble anachronique surtout quand on rappelle que la peine encourue est de 45 000 euros. Les tribunaux français ne furent toutefois pas sensibles à ces éléments : le tribunal de première instance avait notamment considéré qu’en faisant sienne la réplique en question, Hervé Eon avait clairement eu l’intention d’offenser le chef de l’État. Le jugement avait été ensuite confirmé par la cour d’appel d’Angers tandis que le pourvoi du requérant n’avait pas été admis par la Cour de cassation. Là où les juridictions françaises ont vu, purement et simplement, une offense répréhensible car préméditée au regard de l’engagement politique du requérant, la Cour européenne, quant à elle, a considéré qu’il y avait là une véritable et estimable « critique de nature politique ». Prenant au sérieux l’engagement de M. Eon – militant du Front de gauche, ancien élu, ayant notamment mené une longue lutte « de soutien actif à une famille turque, en situation irrégulière sur le territoire national » (§ 58) –, la Cour plaça la problématique sur le terrain du discours et du débat politiques. Du coup, elle fut en mesure d’appliquer le standard jurisprudentiel selon lequel « les hommes politiques doivent pouvoir endurer des critiques particulièrement acerbes, tant de la part des journalistes que de la part de “la masse des citoyens” » (§ 59). Surtout, elle renversa la perspective en démontrant explicitement les conséquences d’une expression malheureuse et vulgaire prononcée par le chef de l’État en affirmant au § 60 de son arrêt : « La Cour retient, d’autre part, qu’en reprenant à son compte une formule abrupte, utilisée par le président de la République lui-même, largement diffusée par les médias puis reprise et commentée par une vaste audience de façon fréquemment humoristique, le requérant a choisi d’exprimer sa critique sur le mode de l’impertinence satirique ».
L’affaire Eon valait bien ce rappel, qui plus est dans un contexte politique hexagonal très souvent exacerbé par de multiples atteintes à la liberté d’expression. La Cour, en décidant de ne pas faire jouer le couperet du « préjudice important », rappela que le propre des démocraties est de supporter une forte dose de satire. On sait que dans le cadre des régimes autoritaires, les propos ou dessins satiriques sont systématiquement bannis tandis que leurs auteurs sont persécutés et, dans le pire des cas, éliminés. Il n’était pas plus mal que la Cour ait rappelé à un vieux système démocratique, parfois en panne, que « cette forme d’expression artistique et de commentaire social qui, de par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter » (§ 60) devait être préservée, n’en déplaise au premier des Français. Il est vrai que la Cour ne s’attaqua point, in casu, à l’incrimination anachronique du délit d’offense au chef de l’État. Elle écarta expressis verbis l’analyse sous l’angle de la « compatibilité avec la Convention de la qualification pénale retenue » (§ 55) – alors qu’elle fut plus audacieuse pour le délit d’offense au chef d’état étranger 4 –, il n’en reste pas moins que l’arrêt Eon restera dans l’histoire contentieuse de l’article 10 comme un rappel de bon aloi sur le rôle salutaire de la satire politique pour le bon fonctionnement des systèmes politiques. Il ne reste plus qu’aux juridictions françaises d’être moins frileuses à l’avenir si d’aventure l’article 26 de la loi de 1881 était (qui sait ?) à nouveau mobilisé.
ANNEXE : CEDH, 14 mars 2013, n° 26118/10, Eon c/ France
La Cour :
(…)
47. La Cour estime que la condamnation du requérant constitue une « ingérence des autorités publiques » dans son droit à la liberté d’expression et que les arguments du Gouvernement doivent être examinés dans le cadre des restrictions à la liberté d’expression prévue au paragraphe 2 de l’article 10. Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences de cette disposition. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
a) Prévue par la loi
48. La Cour constate que les juridictions compétentes se sont notamment fondées sur les articles 23 et 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. L’ingérence était donc bien « prévue par la loi ».
b) But légitime
49. Selon le Gouvernement, l’ingérence avait pour but de protéger l’ordre. La Cour considère pour sa part, en particulier à la lumière des motivations retenues par les juridictions nationales, que l’ingérence visait « la protection de la réputation (…) d’autrui ».
c) Nécessaire dans une société démocratique
50. Il reste à la Cour à rechercher si cette ingérence était « nécessaire » dans une société démocratique pour atteindre le but légitime poursuivi. Elle renvoie à cet égard aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière5.
51. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation6. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable ; il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos reprochés aux requérants et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus7.
52. En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l’ingérence apparaissent « pertinents et suffisants » et si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis »8. Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents, appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l’article 109.
53. En l’espèce, la Cour relève que l’expression apposée sur un écriteau, « Casse toi pov’con », brandi par le requérant lors d’un cortège présidentiel sur la voie publique, est littéralement offensante à l’égard du président de la République. Cela étant, ce propos doit être analysé à la lumière de l’ensemble de l’affaire, et en particulier au regard de la qualité de son destinataire, de celle du requérant, de sa forme et du contexte de répétition dans lequel il a été proféré.
54. Après l’avoir qualifié de « copie conforme servie à froid d’une réplique célèbre inspirée par un affront immédiat », les juridictions nationales ont principalement retenu que le propos avait été repris uniquement dans l’intention d’offenser. Le tribunal a considéré qu’en faisant « strictement sienne la réplique », le requérant ne pouvait avoir d’autre intention. La cour d’appel a estimé qu’il ne pouvait pas être de bonne foi – le propos n’étant pas tombé dans le domaine public pour devenir d’usage libre – eu égard en particulier à son engagement politique et à la préméditation de son acte.
55. La Cour note en premier lieu que la restriction apportée à la liberté d’expression du requérant est sans relation avec les intérêts de la liberté de la presse puisque les propos litigieux n’ont pas été formulés dans un tel contexte. C’est la raison pour laquelle il ne lui semble pas approprié d’examiner la présente requête à la lumière de l’affaire Colombani précitée. En effet, dans cet arrêt, la Cour avait relevé que, contrairement au droit commun de la diffamation, l’accusation d’offense ne permettait pas aux requérants de faire valoir l’exceptio veritatis, c’est-à-dire de prouver la véracité de leurs allégations, afin de s’exonérer de leur responsabilité pénale. Elle avait alors jugé que cette particularité constituait une mesure excessive pour protéger la réputation et les droits d’une personne, même lorsqu’il s’agit d’un chef d’État ou de Gouvernement. En l’espèce, le requérant, à qui des propos injurieux étaient reprochés, ne soutenait pas avoir été l’objet d’une attitude ou d’un propos blessant de la part du chef de l’État et avait formulé une insulte et non une allégation. Il en résulte qu’il ne pouvait invoquer comme moyen de défense ni l’excuse de provocation, ni l’exception de vérité. En outre, il convient de constater que, comme en droit commun, les juridictions nationales ont examiné la bonne foi du requérant, afin d’envisager une éventuelle justification de son acte, même si elles l’ont exclue compte tenu de son engagement politique et du caractère prémédité des propos employés. Il reste enfin que la poursuite s’est faite, non pas à l’initiative du président de la République, mais du ministère public, ainsi que le veut le droit interne pertinent.
À la lumière de ces éléments, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’apprécier la compatibilité avec la Convention de la qualification pénale retenue, fut-elle considérée comme présentant un caractère exorbitant, dès lors qu’elle n’a produit aucun effet particulier ni conféré de privilège au chef d’État concerné vis-à-vis du droit d’informer et d’exprimer des opinions à son sujet10.
56. La question se pose néanmoins de savoir si la restriction apportée à la liberté d’expression du requérant peut être mise en balance avec les intérêts de la libre discussion de questions d’intérêt général dans le contexte de la présente espèce.
57. À cet égard, la Cour estime que l’on ne peut pas considérer que la reprise du propos présidentiel visait la vie privée ou l’honneur, ou qu’elle constituait une simple attaque personnelle gratuite contre la personne du président de la République.
58. La Cour observe, d’une part, qu’il résulte des éléments retenus par la cour d’appel que le requérant a entendu adresser publiquement au chef de l’État une critique de nature politique. Cette juridiction a en effet indiqué qu’il était un militant, ancien élu, et qu’il venait de mener une longue lutte de soutien actif à une famille turque, en situation irrégulière sur le territoire national. Elle a précisé que ce combat politique s’était soldé, quelques jours avant la venue du chef de l’État à Laval, par un échec pour le comité de soutien car cette famille venait d’être reconduite à la frontière et que le requérant en éprouvait de l’amertume. Elle a enfin établi un lien entre son engagement politique et la nature même des propos employés.
59. Or, la Cour rappelle que l’article 10, § 2 ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours et du débat politique – dans lequel la liberté d’expression revêt la plus haute importance – ou des questions d’intérêt général. Les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance11.
60. La Cour retient, d’autre part, qu’en reprenant à son compte une formule abrupte, utilisée par le président de la République lui-même, largement diffusée par les médias puis reprise et commentée par une vaste audience de façon fréquemment humoristique, le requérant a choisi d’exprimer sa critique sur le mode de l’impertinence satirique. Or, la Cour a souligné à plusieurs reprises que la satire est une forme d’expression artistique et de commentaire social qui, de par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C’est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d’un artiste – ou de toute autre personne – à s’exprimer par ce biais12.
61. La Cour considère que sanctionner pénalement des comportements comme celui qu’a eu le requérant en l’espèce est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur les interventions satiriques concernant des sujets de société qui peuvent elles aussi jouer un rôle très important dans le libre débat des questions d’intérêt général sans lequel il n’est pas de société démocratique13.
62. Eu égard à ce qui précède, et après avoir pesé l’intérêt de la condamnation pénale pour offense au chef de l’État dans les circonstances particulières de l’espèce et l’effet de la condamnation à l’égard du requérant, la Cour juge que le recours à une sanction pénale par les autorités compétentes était disproportionné au but visé et n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique.
(…)
Notes de bas de pages
-
1.
CEDH, gde ch., 15 oct. 2009, Micaleff c/ Malte.
-
2.
Sudre F., JCP G, 18 janv. 2010, p. 62.
-
3.
Hervieu N., « L’équivoque sursis européen concédé au délit d’offense au président de la République », lettre Actualités Droits-Libertés, CREDOF, 20 mars 2013.
-
4.
CEDH, 25 juin 2002, Colombani c/ France : v. les critiques d’Beaud O., « L’offense du président de la République : petite leçon aux juridictions françaises sur la primauté de la liberté d’expression », D. 2013, p. 968 ; et de Hervieu N., préc. cit.
-
5.
V., parmi de nombreux autres, Mamère, préc., et CEDH, gde ch., nos 21279/02 et 36448/02, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c/ France, § 45 et 46.
-
6.
Fressoz et Roire c/ France, préc., § 45.
-
7.
CEDH, n° 31457/96, News Verlags GmbH & Co. KG c/ Autriche, § 52.
-
8.
CEDH, n° 64915/01, Chauvy et a. c/ France, § 70.
-
9.
V., parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Zana c/ Turquie, 25 nov. 1997, § 51, recueil des arrêts et décisions 1997-VII.
-
10.
V., a contrario, CEDH, 26 juin 2007, n° 75510/01, Artun et Güvener c/ Turquie, § 31, et Pakdemirli préc., § 51 et 52 ; v. aussi le rappel de ces références dans l’arrêt CEDH, n° 2034/07, Otegi Mondragon c/ Espagne, § 55.
-
11.
CEDH, 8 juill. 1986, série A, Lingens c/ Autriche, § 42, n° 103 ; CEDH, 27 mai 2004, n° 57829/00, Vides Aizsardzības Klubs c/ Lettonie, § 40 ; CEDH, n° 37698/97, Lopes Gomes da Silva c/ Portugal, § 30.
-
12.
CEDH, 25 janv. 2007, n° 8354/01, Vereinigung Bildender Künstler c/ Autriche, § 33 ; CEDH, 20 oct. 2009, n° 41665/07, Alves da Silva c/ Portugal, § 27 ; et mutatis mutandis, CEDH, 21 févr. 2012, nos 32131/08 et 41617/08, Tuşalp c/ Turquie, § 48.
-
13.
Mutatis mutandis, CEDH, 20 oct. 2009, n° 41665/07, Alves da Silva, préc., § 29.