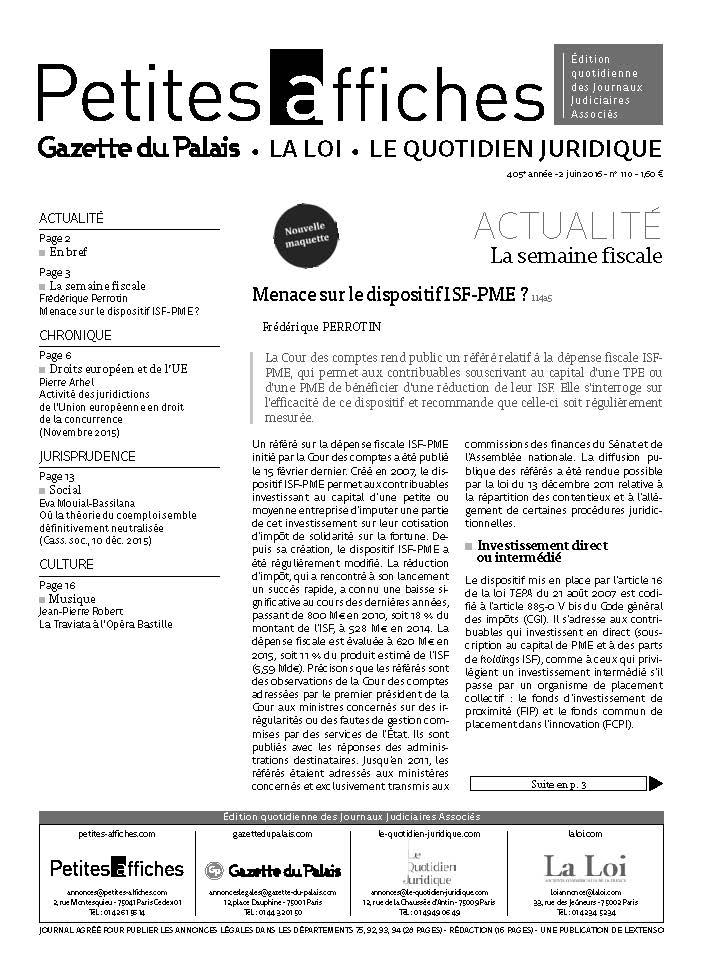La Traviata à l’Opéra Bastille

Maria Agresta en Violetta.
OnP.
Avec cette reprise de La Traviata, l’Opéra de Paris conclut sa trilogie initiée avec Le Trouvère et poursuivie par Rigoletto. Si on devait mesurer la bonne santé vocale de la maison, la présente distribution, de haut niveau, en fournirait un bon étalon. Dans le rôle-titre, la jeune Maria Agresta fait un joli succès : voix bien placée, large, admirablement timbrée, qui n’a pas de difficulté à s’imposer dans les vastes espaces de l’Opéra Bastille. On la sent à l’aise dans les diverses facettes d’une partie exigeante : des colorature de « E strano ! » et de la cabalette qui suit (Ier acte), à « Ah, no giammai ! » (II), pages d’une déchirante vérité parce que tout bascule alors. À ses côtés, l’Alfredo de Bryan Hymel est de classe, présentant bien, pas affecté. Le « Brindisi » au Ier acte est amené naturellement et la suite évite le pathos, tout comme les deux airs du II respirent les effluves d’une jeunesse que rien n’a encore ébranlé. Željko Lučić, un des grands barytons Verdi du moment, prête à Germont une faconde là aussi totalement naturelle, et les deux airs du IIe acte sont un modèle de beau cantabile, sans trop de morgue non plus que de vaine compassion. Le chef Michele Mariotti est extrêmement attentif à ses troupes qu’il guide d’une main sûre. Sa vision de la pièce est intimiste, fuyant tout pathos. On aime la façon dont il retient le mouvement et le fait évoluer par un savant dosage des effets, et le souci de la couleur. Des contrastes également qui habitent le champ musical et le dilatent ou le contractent au gré des événements. Dès lors, ces tonalités semblent tomber sous le sens parce qu’amenées avec un vrai souci de théâtre.
L’a-t-on côté mise en scène ? Le cinéaste Benoît Jacquot a voulu jouer l’économie de moyens. Il dit avoir cherché à ramener chacun des quatre tableaux de l’opéra « à un élément qui serait comme la partie pour le tout » : un vaste lit d’apparat au Ier, un arbre gigantesque au IIe, un escalier monumental au IIIe, et de nouveau le lit au dernier. Il dit également avoir pris pour point de départ le tableau Olympia d’Édouard Manet, qui trône au-dessus du lit et fournit les traits d’Annina, la servante de Violetta, grimée en femme noire comme celle qui, sur la toile, veille sur la beauté nue. Ces éléments disposés épars sur le vaste plateau de Bastille sont enveloppés d’un noir irrémédiable. Le souci d’intimisme est poussé à l’extrême. Au Ier acte, point de réception chez Violetta, mais un souvenir de celle-ci, avec une théorie de bonshommes de noir vêtus, alignés raides, qui s’avancent et reculent. Et au IIIe, des invités qui, mécaniquement, gravissent les degrés de l’escalier majestueux, laissant place fugitivement à une rangée de danseurs pour quelques pas plus banaux qu’affriolants. C’est que tout ce petit monde est contraint à la fête, dit-on. Certes. Mais que cela est triste, compassé, sous-tendu par une direction d’acteurs elle-même réduite à peu de chose. Au point qu’on se demande si le régisseur n’a pas, sans le vouloir, épousé la théorie exposée dans le programme de salle par Karol Beffa : Verdi aurait dans son opéra pratiqué plus l’allusion et l’ellipse qu’une construction rigoureuse et privilégié l’invraisemblance à la vraisemblance. Selon lui, au IIe acte en particulier, « personne n’est jamais nulle part » et celui-ci « est littéralement un acte de fuites et de courants d’air ». Ce qui, renchérit l’auteur, fait que « nous assistons à un ballet des absents, à un carnaval démasqué où plus personne cependant ne se reconnaît ». Cette invraisemblance, qui apparaît clairement in fine lors de l’agonie de La Traviata, « hante tout le reste de l’œuvre ». On ne l’avait en effet pas pensé de la sorte.