Milosz, le poète et le diplomate
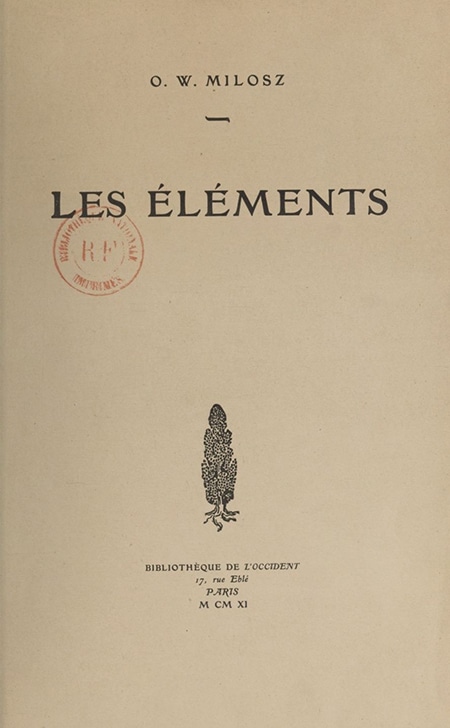
DR
« La poésie, c’est la raison en vacances, une possibilité de survivre dans ce monde voué au matérialisme », Laurent Terzieff
Poète de l’âme. Poète métaphysique. O. V. de L. Milosz avait une voix étrange et un comportement qui dérouta certains. Ses excentricités, ses rires et ses brusques colères composaient un personnage pittoresque. Il y avait en Milosz quelque chose de byronien, quelque chose de non-banal, mais la poésie l’habitait. Il était la poésie. Oscar Wilde déclara un jour en présentant le jeune poète : « Voici Milosz-la-poésie ». Personnalité complexe et ambiguë, Milosz se tenait le plus souvent silencieux, mais quand il intervenait, il le faisait d’une façon impétueuse. Alors, d’une voix gutturale, avec un léger accent slave, il avait un torrent d’expressions brillantes, incisives, parfois caustiques ; et Milosz pouvait s’enflammer, comme révolté, mais c’était un être très indulgent. « Je n’ai jamais connu personne d’aussi gai, d’aussi exalté, d’aussi émotif… éclatant d’un rire inouï quand il voyait ou racontait des choses burlesques. Toujours prêt à s’attendrir, à se passionner » (Francis de Miomandre, Le vrai Milosz, Cahier spécial de Poésie 42).
Milosz fut aussi un de ces êtres capables de s’engager totalement pour une cause. Lorsque, en 1916, il entra comme rédacteur diplomatique au Bureau d’Études de la Maison de la Presse, fondé par Aristide Briand, Milosz découvrit l’existence d’un mouvement lithuanien de libération. Le combat pour la cause de la Lituanie fut alors le sien. En 1919, il fut membre de la délégation lituanienne à la Conférence de la Paix, et, en 1925, il fut nommé Ministre-résident de Lituanie en France. Milosz défendit ainsi officiellement son pays jusqu’en 1933. Commentant un jour les raisons qui le poussèrent à s’engager pour la cause lituanienne, il dit : « C’est parce que la Lituanie est la patrie de mes ancêtres depuis le XIIe siècle, parce que ces ancêtres ont vécu du travail des paysans non pas polonais mais lituaniens, parce que la Lituanie est la plus faible, et, enfin, pour cette raison décisive que seule une Lituanie indépendante et installée à Vilna est capable de donner toute sa mesure dans la défense de ceux-là même de ses intérêts qu’une fatalité historique semble relier aux intérêts de la Pologne ».
Derrière ce personnage qui, à n’en pas douter, déconcertait, se dissimulait un être sensible, allergique au bavardage et aux mornes opinions. Milosz cachait en vérité une vie intérieure, riche et intense, et ses plus proches amis diront qu’il avait un grand cœur. La dimension de sa poésie est celle de l’âme, son entreprise marquée de la fraternité humaine. Nous pouvons penser qu’à l’intérieur de chaque individu se cache une réalité, certains diront une sensibilité spirituelle ; quelques-uns l’ont réveillée plus que d’autres, l’exprimant par l’intermédiaire d’un art ou une entreprise quelconque. Milosz l’exprima à travers la poésie.
La vie de Milosz fut donc, avant tout, une quête spirituelle qui s’exprima à travers son œuvre littéraire, et si l’homme fut mal compris, c’est qu’il avait une intelligence rare et aiguë, et un comportement quelque peu désuet. Désuet, parce que Milosz refusa d’être conforme à la modernité de son temps, mais faut-il se laisser entraîner dans la modernité de son époque ? Et il y a modernité et modernité. Quand la modernité est porteuse de sens, facteur de progrès et d’évolution, on y souscrit sans problème, mais quand la modernité pervertit toute chose, quand elle invite la vulgarité, c’est très différent. Milosz eut cependant réellement conscience, par exemple, du terrible fléau qui allait s’abattre une nouvelle fois sur l’Europe, tout comme André Suarès qui dénonça vertement l’hitlérisme. Il le dit et l’écrivit. Quant à sa vie, elle fut une succession d’errances dans un monde où il ne se sentait pas très bien chez lui. Une poursuite passionnée d’expériences et d’études, à la recherche de la vérité de l’homme. Il fut un peu comme un alchimiste en quête de la pierre philosophale. Milosz avait un sens aigu des réalités éternelles, et dans son œuvre, il recourut constamment aux images et formes d’un monde « aux profonds, sages et chastes archétypes ». Il était d’un autre temps, égaré dans une époque avec ses multiples bouleversements, découvertes et changements politiques, sociaux et culturels. « On l’écoutait parler, et le vent glacé du Nord passait sur nous comme s’il venait du fond des âges. Pris d’effroi, on ne voulait pas entrer dans l’univers étrange, sauvage, qui était le sien, mais le vertige vous prenait et on était bien obligé de le suivre jusqu’aux portes infernales de l’au-delà. Les grands initiés de l’Inde et les grands mystiques chrétiens, et Edgar Poe, et Rimbaud, et Hamlet, et Faust – Faust surtout –, en lui il y avait tout cela ! » (L. Pasteur Valery-Radot, Mémoires d’un non-conformiste, éditions Grasset, Paris 1966).
Romancier, auteur dramatique, traducteur (notamment de Goethe, Novalis, Hölderlin, Shelley et Shakespeare), exégète biblique, ethnographe, diplomate, Milosz sut transformer chaque image pour lui donner une dimension supérieure. Dimension de la vraie poésie. Dimension musicale. Dimension intérieure. Sa poésie est intermédiaire entre le monde instinctif et la souffrance et l’esprit.
Milosz sut aussi avoir avec la nature de sensibles contacts. Il savait, par exemple, causer aux oiseaux, et il s’arrêtait longuement devant une fleur ou un arbre. Les vies de la nature ne semblent pas avoir eu de secret pour lui, et nous pouvons aisément rapprocher sa relation avec celle de saint François qui lui aussi parlait aux oiseaux. « Milosz passait beaucoup de temps dans la forêt de Fontainebleau en compagnie des oiseaux. Je me souviens parfaitement qu’un jour où je lui avais rendu visite, nous allâmes nous promener dans la forêt. Pour attirer les oiseaux, Milosz n’utilisa aucun moyen habituel, comme la nourriture ou les appels. Il siffla une certaine mélodie très courte et, immédiatement, une multitude d’oiseaux surgirent de tous les coins de la forêt, l’entourant, se posant sur ses bras, en réponse à son sifflement. Les oiseaux étaient de plusieurs variétés et de couleurs différentes. J’avais vraiment l’impression qu’ils se parlaient et qu’ils se comprenaient parfaitement. Cela dura un moment, puis Milosz me dit : je vais leur dire de rentrer à la maison. Il siffla de nouveau et la nuée d’oiseaux s’envola et se dispersa dans toutes les directions » (Souvenirs de Petras Klimas, qui fut membre du Conseil d’État de Lituanie).
Bien qu’il fût le contemporain de nombreux mouvements avant-gardistes, il semble que Milosz resta en marge de toute nouveauté. Peut-être même ignora-t-il volontairement les révolutions artistiques qui se manifestèrent entre les deux guerres mondiales. Cependant, Guillaume Apollinaire dit un jour à son sujet, lors d’une conférence qu’il fit en 1908 : « Le siècle n’est pas juste enfin pour O.V. de L. Milosz dont l’âme est ardente. Ce slave n’est pas désenchanté et nous reconnaissons en lui une puissance d’images, un lyrisme si évocateur qu’il ne faut pas hésiter à le placer entre les premiers des nouveaux poètes ». Pourtant, Jean Paulhan l’ignora à la N.R.F. ainsi que Paul Éluard dans son anthologie poétique. Ce fut principalement après la Seconde Guerre mondiale que Milosz sera oublié, comme le furent André Suarès et Joë Bousquet qui n’étaient pas dans le goût des modes littéraires d’alors. Qui lit aujourd’hui Le Voyage du condottière ou Le Meneur de lune ? Seuls Paul Valéry et Jules Supervielle parlèrent un peu de Milosz, mais ce furent principalement Francis de Miomandre, son découvreur, et Edmond Jaloux qui montra l’importance de son roman L’Amoureuse Initiation, qui le firent connaître.
Référence : AJU002r1




