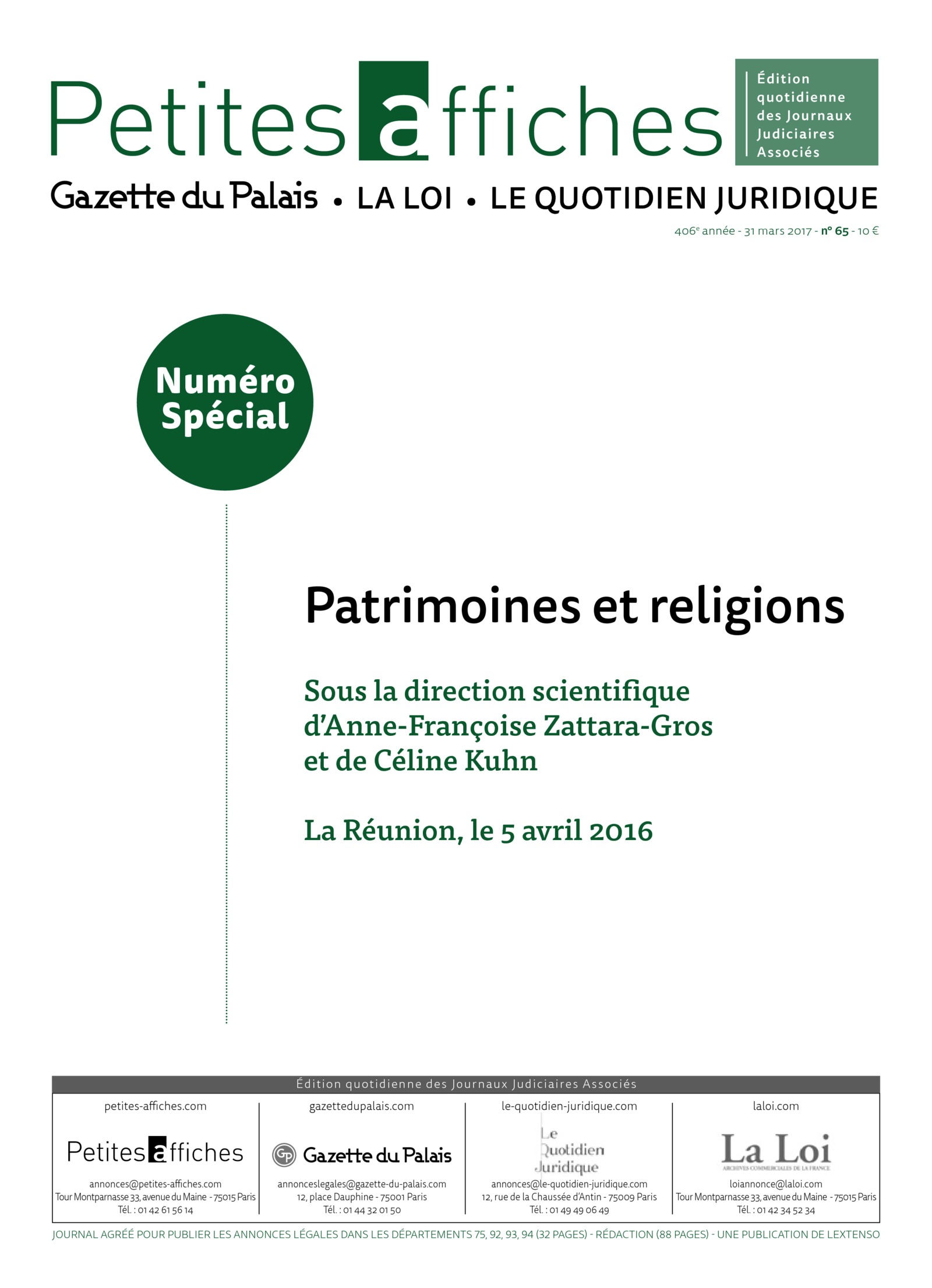La protection juridique de l’immatériel religieux
L’immatériel religieux prend deux visages : les biens et le patrimoine. La protection des premiers requiert une adaptation du droit qui, au prix de concessions réciproques, fournit des solutions équilibrées. L’adaptation devient plus difficile lorsque les biens religieux imprègnent le groupe ou la communauté. Ces biens forment alors un patrimoine immatériel constitutif, dans l’espace, d’un ordre juridique transnational et, dans le temps, d’un fonds commun ayant vocation à se transmettre et se renouveler.
« Laudato si’, mi’ Signore » – « Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait saint François d’Assise dans ce beau cantique récemment repris par le pape François dans son encyclique sur l’écologie ; ce beau cantique où il est justement rappelé que « notre maison commune est comme une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts ». « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe ».
Mais, s’inquiète le pape, « cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter. (…) Nous oublions que nous-mêmes, nous sommes poussière1. Notre propre corps est constitué d’éléments de la planète, son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle nous restaure ».
Cette encyclique nous montre combien notre approche individualiste de la propriété est dépassée, voire dangereuse. Nous ne sommes pas maîtres de la Terre car nous ne sommes qu’une partie intégrante de celle-ci à laquelle nous appartenons et dont nous sommes aujourd’hui responsables face aux générations futures. Cette approche écologique de la propriété révèle aussi que le droit de propriété n’est pas la seule technique juridique de protection des valeurs essentielles à l’homme : « L’environnement est un bien collectif, patrimoine de toute l’humanité, sous la responsabilité de tous », poursuit le pape François. « Celui qui s’approprie quelque chose ne fait qu’administrer le bien de tous et pour tous », ajoute-t-il.
Ce qui vaut pour la Terre ne vaut-il pas a fortiori pour les valeurs véhiculées par l’immatériel religieux ? La religion est immatérielle par essence. Dieu, les textes sacrés – qu’ils aient été dictés par Dieu ou inspirés des prophètes – les pratiques, les rites, les symboles… tout est immatériel, de sorte que la propriété paraît inadaptée à la protection de telles valeurs. Pourquoi ? Parce que l’immatériel religieux est d’abord un fonds commun, un patrimoine commun qui n’appartient à personne parce qu’il a vocation à profiter à tous. En termes juridiques, il constitue une res communis.
Mais par-delà cet immatériel commun, intemporel et transnational, des valeurs immatérielles de sources religieuses sont créées par l’homme et appréhendées par le droit comme de véritables biens – même s’il convient d’en retenir une acception large –, c’est-à-dire des valeurs sur lesquelles une personne peut faire valoir un monopole, une sphère d’exclusivité soustraite à l’usage d’autrui.
Protéger l’immatériel religieux dans notre univers terrestre, donc juridique, emprunte ainsi deux voies sensiblement différentes selon que l’on adopte une démarche individualiste ou collective, que l’on s’intéresse au croyant ou à la communauté des croyants, que l’on retient une approche « micro-religieuse » ou « macro-religieuse ».
Dans le premier cas, il s’agira de protéger les biens immatériels religieux (I). Dans le second, la protection s’intéressera au patrimoine immatériel religieux (II).
I – La protection des biens immatériels religieux
La protection des biens immatériels religieux impose au droit un effort d’adaptation à la spécificité de la chose religieuse. Les biens religieux ne sont pas des biens ordinaires. Tantôt cette adaptation est possible et plus ou moins réussie (A) ; tantôt au contraire, elle paraît difficile, sinon impossible, tant les mécanismes juridiques sollicités cadrent mal avec l’originalité de ces biens (B).
A – Le droit s’adapte
Le droit s’adapte à la protection de certains biens religieux, qu’ils soient de nature extrapatrimoniale ou de nature patrimoniale.
1 – Des biens extrapatrimoniaux
Le droit assure la protection des biens extrapatrimoniaux – c’est-à-dire des biens attachés à la personne, difficilement évaluables en argent mais sur lesquels leur titulaire exerce une emprise exclusive – contre les atteintes susceptibles d’être portées par autrui. Mais cette protection est loin d’être absolue tant elle doit se concilier avec d’autres impératifs tout aussi fondamentaux.
À ce titre, la liberté de conscience, de pensée et de religion, protégée par l’article 9 de la Convention EDH, l’est également contre les discriminations (à l’embauche, au travail, au logement…), les injures ou les diffamations même si le niveau de protection n’atteint sans doute pas celui auquel aspirent certaines communautés de croyants. Il suffit de songer, par exemple, aux Versets sataniques de Salman Rushdie qui ne caractérisent pas, pour le tribunal de grande instance de Paris le 29 juillet 1989, une diffamation commise envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée ; ou encore les caricatures de Mahomet publiées par Charlie Hebdo qui, dénonçant le danger des fanatismes religieux et de l’instrumentalisation de l’islam, ne visent pas la communauté musulmane dans son ensemble et ne constituent donc pas le délit d’injures publiques envers un groupe de personnes à raison de sa religion2. Le droit pénal n’est pas le bras armé d’une religion donnée ; il est au service de la société tout entière.
La vie privée, protégée au titre de l’article 9 du Code civil et de l’article 8 de la Convention EDH, accorde une place aux convictions religieuses en distinguant, ce que certains ne manquent pas de condamner, la simple révélation de l’appartenance religieuse qui ne porte aucune atteinte à la vie privée et la révélation de la pratique religieuse d’une personne qui caractérise une telle atteinte3. Faut-il aller plus loin et intégrer toute révélation concernant la religion dans le champ de protection de la vie privée ? Tout dépend, me semble-t-il, de la relation sociale établie par le croyant à propos de sa religion et des pratiques qu’elle lui dicte. Que la religion soit pratiquée en un lieu privé, en toute intimité, sans manifestation extérieure ou publique, et la protection mérite de lui être accordée ; au contraire, que le croyant se livre à sa pratique religieuse en public ou affiche son appartenance à une religion, par exemple au moyen du port d’un signe, et je ne vois pas en quoi la révélation de cette appartenance devrait constituer la moindre atteinte à sa vie privée. Là encore, gardons-nous de la tentation de l’excès et de la généralisation.
Si la Cour de cassation respecte la liberté de conscience du mari de confession juive qui refuse la délivrance à son ex-épouse, après le prononcé du divorce civil, de la lettre de répudiation unilatérale (le « gueth ») lui permettant de se remarier, en refusant toute condamnation sous astreinte4, elle n’hésite pas à le condamner au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’abus de droit, même en l’absence de preuve de l’intention de nuire5. Le droit ne saurait forcer la liberté de pensée mais l’argent peut la faire plier.
Dans l’évaluation du préjudice, le droit de la responsabilité civile peut, en certaines circonstances et au titre du poste « préjudice exceptionnel » de la nomenclature Dintilhac, tenir compte des pratiques religieuses de la victime à condition toutefois que soit démontré le caractère atypique du préjudice. Ainsi fut rejetée la demande d’une victime musulmane invoquant ne plus pouvoir se prosterner et s’agenouiller pour la prière au motif que la religion musulmane autorise que les gestes de prière soient effectués en position assise par une personne handicapée et, par conséquent, que « la simplification autorisée du rite permet à la victime de continuer à pratiquer sa religion »6.
À l’inverse, le droit s’impose parfois à la spiritualité au nom de valeurs qu’il estime supérieures. Tel est le cas du droit à la vie qui l’emporte sur les convictions religieuses des témoins de Jéhovah. Pour le Conseil d’État, le médecin peut passer outre le refus de soins si l’acte médical est indispensable à la survie de la personne7. La protection de la vie humaine l’emporte ici sur le respect des convictions. Et c’est heureux.
2 – Les biens patrimoniaux
Les biens patrimoniaux religieux sont, quant à eux, considérés comme des objets de propriété ordinaires, qu’ils soient de nature corporelle ou incorporelle.
Je n’insisterai pas sur les premiers tant ils dépassent le cadre de mon intervention. Songeons simplement aux produits dérivés des religions, à ce que l’on nomme parfois les « bondieuseries », ces tasses, mugs, fioles d’eau bénite, croix en bois ou en plastique et autres assiettes à l’effigie d’une sainte ou d’un saint. Ces objets corporels relèvent de l’article 544 du Code civil et du principe de libre disposition contre lequel les convictions religieuses ne peuvent rien. Dans le même ordre d’idées, on se souvient que ces convictions sont impuissantes à légitimer le refus de vente de préservatifs par un pharmacien8.
Mais c’est sans conteste avec les biens patrimoniaux incorporels d’inspiration religieuse que s’épanouit le mieux la liberté du commerce. Une rapide recherche sur le site de l’INPI révèle que plus de 340 marques françaises contiennent le mot « halal ». Les marques relatives à Lourdes sont également nombreuses et variées : « poupée Sainte Bernadette de Lourdes », « La goutte d’eau de Lourdes », « K d’eau de Lourdes », mais aussi « J’ai les jambes Lourdes » sans oublier le logo du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes déposé comme marque.
Le droit d’auteur n’est pas en reste, parfois même au plus haut sommet. Rappelons-nous le double CD du pape Jean-Paul II disant et méditant en français Les vingt mystères du Rosaire, paru en 2002 et toujours en vente en ligne au prix de 16 €. On sait également que la notion de cercle de famille a pu être appliquée à un cercle religieux, pourvu qu’il ne soit pas trop étendu. Mais c’est surtout le droit moral qui attache la plus grande importance aux convictions religieuses au travers du droit au respect de l’œuvre. A été interdite à ce titre l’utilisation à des fins commerciales d’une musique d’inspiration religieuse, la Méditation de Thaïs9. Si l’utilisation d’extraits d’œuvres musicales ne constitue pas en elle-même une violation du droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, elle peut, en raison du contexte dans lequel elle intervient, affecter sa perception par le public et porter atteinte à son esprit. Ainsi fut notamment condamnée la diffusion d’extraits de chants sacrés au cours d’un spectacle théâtral, fût-il de qualité et unanimement salué par la critique, y compris la presse catholique10.
Les dessins et modèles épousent également la tendance religieuse. Ainsi découvre-t-on dans les médias que H&M, Dolce & Gabana, Uniqlo ou encore Marks & Spencers se mettent à la mode islamique. Faut-il pour autant, comme l’appelle de ses vœux Élisabeth Badinter, boycotter ces marques ? Certaines formes de philosophie n’étant pas étrangères à la politique, Manuel Valls renchérit en affirmant que « le voile n’est pas un objet de mode mais un asservissement de la femme ». Quoi que l’on en pense au fond, ces questions sont étrangères au droit, spécialement celui des dessins et modèles, qui garantit avant tout la liberté du commerce et de l’industrie, que les biens commercialisés soient ou non des biens religieux ou à connotation religieuse.
Le « business religieux » est même particulièrement florissant. On peut lire dans la presse récente que le « Quick Halal » de Montpellier a multiplié ses entrées depuis qu’il commercialise du bœuf halal certifié par la Grande mosquée de Lyon et remplacé le porc par de la dinde. Le succès est tel que Burger King annonce l’ouverture d’une quarantaine de « Quick Halal » en France dans les prochaines années. La vague du halal se porte à merveille. On pourrait en dire de même du casher. Encore faut-il s’assurer, au nom du respect des convictions de chacun, que le consommateur soit suffisamment informé du caractère halal ou casher des produits qu’il achète sur le marché.
Grâce à un respect mutuel et au prix de quelques adaptations et concessions réciproques, droit et religion parviennent à vivre en harmonie. Mais le droit éprouve davantage de difficultés à s’adapter aux biens religieux dès lors qu’ils revêtent une dimension collective.
B – Le droit s’adapte mal
Le droit s’adapte mal à la spécificité des biens religieux lorsqu’ils imprègnent le groupe ou la communauté dans son ensemble. L’individualisme du droit subjectif coïncide alors mal avec le caractère collectif de ces biens qui participent des pratiques et des traditions religieuses. Le rapprochement s’impose avec la difficile protection juridique du folklore.
Qu’il soit religieux ou non, le folklore peine à obtenir une protection juridique au moyen de l’une quelconque des propriétés intellectuelles, spécialement de la propriété littéraire et artistique qui paraît pourtant la mieux disposée à la délivrer.
Que cherche-t-on à protéger ? Le folklore, dont certains rites religieux sont une expression, peut se définir comme l’ensemble des manifestations artistiques de la culture d’un peuple ou d’une communauté, transmise de générations en générations. Il s’agit d’un héritage vivant qui fait partie intégrante de la vie des personnes et dont le caractère évolue au fil des générations, lesquelles se réapproprient sans cesse ses bases et les font évoluer. Autrement dit, le folklore est anonyme, traditionnel et fait généralement l’objet d’une transmission orale, autant de caractères qui rendent difficile, sinon impossible, sa protection par le droit d’auteur.
Le premier problème tient à la condition d’originalité. Dans la mesure où le folklore est le résultat constant d’un processus impersonnel d’activité créatrice, exercée par voie d’imitation au sein d’une communauté, qu’il est certes en perpétuelle évolution de génération en génération mais que l’artiste d’une génération donnée est nécessairement lié par le respect de la tradition, sa part d’innovation est réduite. Il lui est donc difficile de donner à la forme de cette tradition l’empreinte de sa personnalité nécessaire à la reconnaissance de la condition d’originalité.
Le deuxième problème tient à la durée. Le plus souvent, l’expression de ce folklore remonte à la nuit des temps, de sorte que la durée de la protection est en général expirée. Sauf à considérer, avec Pierre-Yves Gautier, que la diffusion dans le cercle limité de la communauté ne vaut pas divulgation, de sorte que le délai de prescription ne court pas11. Mais cette réserve me paraît bien difficile à mettre en œuvre.
Le troisième problème intéresse la titularité du droit. Transmise et créée au fil des générations, l’expression d’un folklore ou d’une tradition religieuse ne satisfait pas à l’exigence d’un travail en commun pour être qualifiée d’œuvre de collaboration. Le plus souvent œuvre impersonnelle, ses auteurs peinent de surcroît à être identifiés.
La propriété littéraire et artistique paraît donc inapte à assurer la protection des traditions religieuses. Aux raisons techniques qui viennent d’être rapidement évoquées s’ajoute un motif plus fondamental tenant à la finalité de la protection. Pourquoi faudrait-il assurer à une personne ou à un groupe restreint de personnes un monopole d’exploitation quand les rites et traditions ont vocation à être suivis par tous ? La logique n’est pas celle d’une réservation et de l’exclusion d’autrui, ce qui correspond à la logique civiliste d’appropriation, mais au contraire celle d’une diffusion et d’une préservation de la tradition religieuse dans l’espace et dans le temps. Il n’est alors plus question de protéger des biens religieux mais d’organiser la protection du patrimoine religieux.
II – La protection du patrimoine immatériel religieux
La protection du patrimoine immatériel religieux s’opère à la fois dans l’espace et dans le temps. Dans l’espace, ce patrimoine s’inscrit dans un ordre juridique transnational (A) ; dans le temps, le patrimoine immatériel religieux aspire à être transgénérationnel et s’analyse en un fonds commun mis à la disposition de tous (B).
A – Dans l’espace : l’ordre juridique
Le patrimoine immatériel religieux, du moins celui des grandes religions, apparaît comme la composante d’un ordre juridique transnational destiné à transcender les frontières étatiques nationales pour gouverner les relations internationales privées des personnes, indépendamment ou presque des souverainetés nationales.
Le patrimoine religieux est ainsi porteur d’un ordre juridique transnational caractérisé par :
-
une communauté de personnes suffisamment stable, identifiée et organisée pour asseoir le développement de normes adaptées ;
-
une complétude et une autarcie assurées par l’existence d’un législateur, prenant la forme d’un pouvoir de commandement et d’une charte fondatrice et d’un juge ou, plus largement, d’une instance d’apaisement des conflits, selon les expressions employées par Rémy Libchaber dans son bel ouvrage L’ordre juridique et le discours du droit ;
-
enfin, une relative autonomie par rapport aux ordres nationaux, ce qui renvoie aux règles de « relevance » étudiées notamment par Santi Romano.
Ces dernières relations présentent de loin, chacun le sait, les plus vives difficultés. Il suffit de songer à la redoutable question du foulard islamique pour en mesurer toute l’ampleur. Mais d’autres et innombrables questions d’articulations des ordres terrestres et spirituels ne manquent pas de se poser, au juriste, au politique, au philosophe… Faut-il, par exemple, camoufler de boîtes blanches les statues nues de la ville ou d’un musée lors de la venue d’un président iranien ? Faut-il pratiquer l’autocensure sur notre propre territoire national au nom d’une pratique religieuse transnationale ? Faut-il en France des imams certifiés par un label qui serait délivré par le Conseil national du culte musulman ? On s’interrogera aussi sur la portée d’un possible arbitrage religieux, notamment rabbinique, qui mettrait en œuvre des règles susceptibles d’entrer en conflit avec l’ordre public international français telles que des discriminations successorales ou l’interdiction pour la femme de témoigner.
B – Dans le temps : le fonds commun
Le patrimoine immatériel religieux, dans sa dimension temporelle et transgénérationnelle, constitue un fonds commun ayant vocation à se transmettre de génération en génération et à se perpétuer en se renouvelant.
Mais que contient ce fonds commun et que veut-on véritablement transmettre à chaque saut générationnel ? Si l’objectif est de transmettre une tradition, des rites et des pratiques, autrement dit les manifestations de cette culture et ses savoir-faire, cette transmission tôt ou tard échouera et finira, au mieux, consignée dans des livres et exposée au musée. Il ne peut y avoir de transmission réussie que si la communauté vivante s’empare du passé en se l’appropriant et se le réappropriant sans cesse, en faisant du passé leur présent. Autrement dit, il ne suffit pas d’obtenir l’inscription sur la liste du « patrimoine culturel immatériel » de l’Unesco pour sauvegarder une tradition ou une culture. Encore faut-il que ce patrimoine immatériel continue de vivre au sein de la société. Or ce processus est aujourd’hui en crise.
Notre société contemporaine valorise l’innovation, la création, la nouveauté et tend à négliger tout ce qui vient du passé. C’est un lieu commun d’affirmer que l’accélération du temps vécu par nos sociétés modernes condamne le passé à une obsolescence plus rapide qu’autrefois. Les valeurs actuelles sont tournées vers l’avenir, les nouvelles technologies et l’innovation. Que reste-t-il vraiment de la culture du passé, si ce ne sont des livres poussiéreux rangés dans les rayons des bibliothèques ? Dans notre monde moderne, ou prétendu tel, reste-t-il une place pour une transmission du patrimoine immatériel religieux ?
Il ne sert à rien de pratiquer un rite, respecter une tradition, une prescription ou un interdit sans s’être préalablement interrogé sur les raisons qui les fondent ni sans avoir compris les valeurs et les idéaux qu’ils expriment. De telles attitudes relèvent du panurgisme, de l’homme-mouton qui suit sans s’interroger ni comprendre. La forme occulte le fond. C’est le règne de l’apparence sociale, le signe d’un assèchement de la société et d’une perte de repères.
Il n’est pas étonnant qu’à l’heure d’internet et des nouvelles technologies, les jeunes générations se détournent des traditions qu’ils jugent, non sans raison parfois, surannées. Et si, au lieu d’enseigner la rigidité des règles et leur cortège de prescriptions et d’interdits, la pratique rigoureuse de tel ou tel rite, on s’interrogeait avant tout sur leur signification profonde, les raisons de leur existence et, surtout, la pertinence de leur respect dans une société qui, souvent des siècles après leur édiction, a profondément évolué ? Et si l’on acceptait de poser cette question dérangeante afin d’orienter en priorité la transmission du patrimoine immatériel vers ce qu’il a d’intemporel et de transgénérationnel, à savoir les valeurs et les idéaux qui ont bâti nos civilisations et qui, au contraire des formes, n’ont pas pris une ride ?
On ne protège pas le passé en l’enfermant dans un musée, un coffre-fort ou une tombe. Ce passé-là est voué à l’oubli, tôt ou tard. On protège le passé en lui insufflant la vie au temps présent, ce qui peut nécessiter certaines adaptations. Il convient donc de transmettre, non les pratiques, les rites, les savoir-faire, mais les valeurs qui les guident, les raisons, les passions, l’esprit. Transmettre le « pourquoi » bien plus que le « comment ». Seule cette transmission est universelle et intemporelle, indépendante des nouvelles technologies et des progrès techniques. Il faut mettre l’accent sur les valeurs plus que sur les pratiques, le fond plus que la forme, la ratio legis plus que la règle elle-même.
C’est ce patrimoine vivant, transmis de génération en génération, à chaque fois assimilé, recréé et reformulé au regard du contexte présent, qui crée un lien entre les générations et donne du sens. Il est tout le contraire des approches muséales ou archivistes qui laissent définitivement dans le passé ces connaissances et creusent le fossé des générations.
Donner du sens impose d’expliquer, d’enseigner, de dialoguer, de débattre, de comprendre mais aussi d’accepter les points de vue contraires, de tolérer les différences et, surtout, d’évoluer. Aucune règle n’est immuable, figée pour l’éternité, parce que toute règle ne vaut que par les raisons qui la fondent. Enseigner la raison plus que le dogme, voilà ce qui sauvera le patrimoine immatériel, qu’il soit ou non religieux.
N’est-ce pas exactement ce que nous faisons dans nos facultés de droit ? Par nature le droit est collectif et transgénérationnel. Sa préservation temporelle emprunte les mêmes canaux que la protection de l’immatériel religieux. Ce que nous transmettons à l’université de générations en générations est moins la règle, laquelle évolue au rythme effréné des réformes, que les fondements de la règle, sa valeur, sa portée, ses critiques, autrement dit un raisonnement juridique, une méthode de pensée. Par où l’on voit, comme le suggérait le pape François, que la religion et le droit obéissent aux mêmes canons. C’est en suivant cette démarche que la religion sera pleinement « droit compatible ».
Notes de bas de pages
-
1.
Genèse, 2 :7.
-
2.
CA Paris, 12 mars 2008 ; TGI Paris, 22 mars 2007 : Juris-Data n° 2007-327959
-
3.
V. par ex., Cass. 1re civ., 6 mars 2001, n° 99-10928, à propos de la publication dans la presse réunionnaise, par l’ancien époux d’une femme sur le point de se remarier, d’un communiqué relatif à sa situation au regard de la religion musulmane – selon lui, le mariage religieux qui l’unissait à elle n’était pas dissous – et appelant les invités au remariage à « prendre leurs responsabilités ».
-
4.
Cass. 2e civ., 21 nov. 1990, n° 89-17659.
-
5.
Par ex., Cass. 2e civ., 5 juin 1985, n° 84-11088.
-
6.
CA Paris, 12-6, 7 mars 2013, n° 07/00665.
-
7.
CE, 26 oct. 2001, n° 198546.
-
8.
Cass. crim., 21 oct. 1998, n° 97-80981.
-
9.
TGI Paris, 15 mai 1991 : Juris-Data n° 1991-047112 ; JCP G 1992, II, 21919, note Daverat X.
-
10.
CA Paris, 4e ch., 7 juin 2000, n° 98/21449 : D. 2001, p. 2555, obs. Sirinelli P.
-
11.
C. civ., art. 2232.