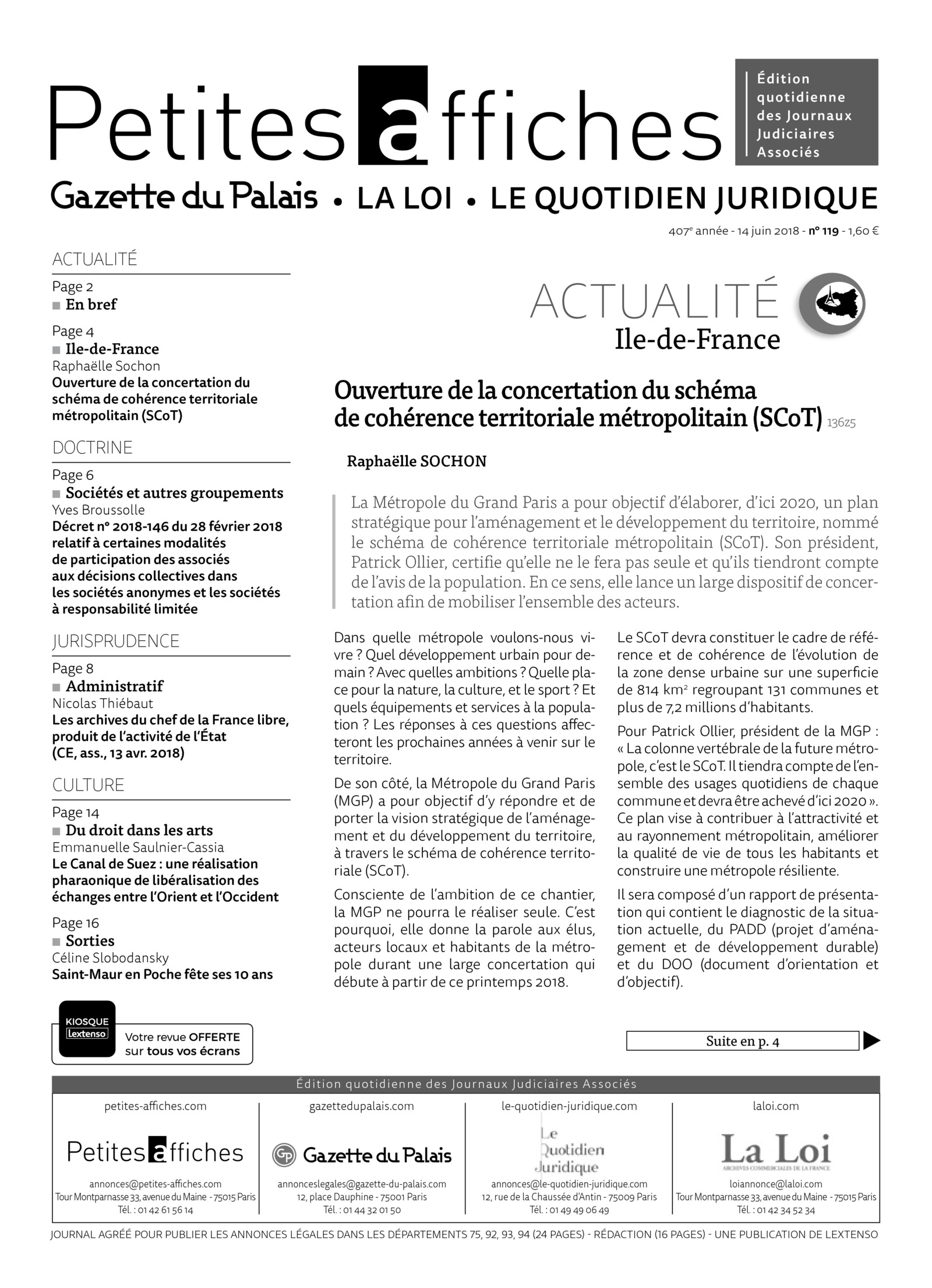Le Canal de Suez : une réalisation pharaonique de libéralisation des échanges entre l’Orient et l’Occident
L’Institut du monde arabe présente une exposition dédiée à « l’épopée » du Canal de Suez, chantier économique, géographique, technique, humain, politique hors du commun, qui de l’époque des Pharaons à nos jours, bouleverse les échanges entre l’Orient et l’Occident, en mobilisant aussi le droit, notamment international.
De son commencement par Sésostris III au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ – qui aurait le premier fait relier le Nil à la mer Rouge – à son doublement partiel en 2015 en passant par la voie navigable principale réalisée sous la conduite de Ferdinand de Lesseps, le Canal de Suez a traversé l’histoire de l’Égypte et de la France, bouleversé les relations économiques entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie, agité les convoitises et tensions politiques au Moyen-Orient.
La voie d’eau de 193 kilomètres percée entre Port Saïd et Suez a mobilisé à partir de 1859 des centaines de milliers d’ouvriers égyptiens – et de paysans astreints à la corvée jusqu’en 1863 – dans des conditions inhumaines, puis grâce à une mécanisation de plus en plus perfectionnée, est devenue l’un des plus grands chantiers de travaux publics du XIXe siècle1, ce qui permit d’achever la construction en une décennie seulement. Le Canal fut inauguré en 1869 dans un faste colossal – où ne manquèrent au rendez-vous historique que Verdi et Bartholdi2 – permettant au Khédive Ismaïl Pacha – successeur de Saïd Pacha qui avait lancé le projet et dont le père Méhémet Ali avait lancé les premières études avec des experts français – d’accueillir à Port Saïd, parmi de nombreux hôtes royaux européens, l’impératrice Eugénie représentant Napoléon III, qui parcourut à bord de l’Aigle, le Canal jusqu’à Suez, après une étape à Ismaïlia.
Aux côtés des enjeux économiques et des stratégies politiques – illustrés par de nombreux documents picturaux et photographiques choisis dans les archives de l’association du souvenir de Ferdinand de Lesseps et du Canal de Suez –, la construction et la gestion du Canal ont nécessité des engagements juridiques. Les juristes du XXIe siècle seront particulièrement intéressés par deux documents, un officiel, le premier acte de concession, et un texte secret, le protocole de Sèvres.
La traduction manuscrite, datée du 19 mai 1855, du premier acte de concession par le vice-roi d’Égypte à Ferdinand de Lesseps établissant une compagnie universelle pour le percement de l’isthme de Suez et l’exploitation d’un Canal entre les deux mers, conservée aux Archives nationales, présente clairement en préambule la dimension internationale du projet : « Monsieur Ferdinand de Lesseps, ayant appelé notre attention sur les avantages qui résulteraient pour l’Égypte de la jonction de la mer Méditerranée et de la mer Rouge, par une voie navigable pour les grands navires, et nous ayant fait connaître la possibilité de constituer, à cet effet, une compagnie formée de capitalistes de toutes les nations, nous avons accueilli les combinaisons qu’il nous a soumises et lui avons donné, par ces présentes, pouvoir exclusif de constituer et de diriger une compagnie universelle pour le percement de Suez et l’exploitation d’un Canal ».
Le corps de l’acte de concession contient à la fois des dispositions d’une très grande souplesse – comme l’article 2 prévoyant que « le directeur de la compagnie sera toujours nommé par le gouvernement égyptien et choisi, autant que possible, parmi les actionnaires les plus intéressés dans l’entreprise » – et d’une plus grande rigidité – comme l’article 3 suivant lequel « la durée de la concession est de 99 ans à partir du jour de l’ouverture du Canal des deux mers » – qui ont les unes et les autres été dépassées – c’est-à-dire enfreintes – par les événements politiques et anticipant de fait l’entrée en vigueur de l’article 10 – « À l’expiration de la concession le gouvernement égyptien sera substitué à la compagnie, jouira sans réserve de tous ses droits et entrera en pleine possession du Canal des deux mers et de tous les établissements qui en dépendront ».
Alors que le gouvernement égyptien détenait, en 1869, 44 % des actions de la compagnie – 21 000 actionnaires français possédant le reste – l’endettement du pays conduisit à la vente 6 ans plus tard de toutes les parts au Royaume-Uni – longtemps opposé au projet concurrençant la route des Indes – qui occupa militairement l’Égypte. La protection du Canal par la convention de Constantinople en octobre 18883 ne freina pas la volonté des Égyptiens de s’émanciper de la présence britannique, qui finit par se concrétiser par l’indépendance en 1936 – actée par le traité de Londres – ce qui ne mit pas fin pour autant à l’emprise du Royaume sur le Canal de Suez, qui va devenir un symbole de revendication des putschistes menés par Gamal Abdel Nasser et évinçant le roi Farouk en 1952.
La nationalisation annoncée par Nasser dans son discours à Alexandrie le 26 juillet 1956 devant un peuple en liesse – diffusé sur grand écran dans la quatrième et dernière section de l’exposition – a entraîné les plus vives tensions et tentations belliqueuses des puissances concernées. En dépit d’une résolution des Nations unies4, la France, le Royaume-Uni et Israël ont négocié entre le 22 et le 24 octobre 1956, soit 3 mois après l’annonce de la nationalisation du Canal, un pacte secret, appelé protocole de Sèvres et reproduit seulement en trois exemplaires. Détruit par le gouvernement britannique et introuvable dans les archives nationales françaises, c’est la copie conservée par Christian Pineau alors ministre des Affaires étrangères qui est présentée à l’IMA. Quelques jours après cette alliance secrète, Israël a envahi l’est du Canal, les Français et Britanniques l’ont bombardé, puis parachuté des troupes à Port Saïd et Port Fouad. L’opposition de l’OTAN5 – mais aussi de la Russie – à l’opération a permis un cessez-le-feu et la création d’une force d’intervention en novembre qui a conduit au départ des troupes franco-britanniques en décembre et finalement la réouverture du Canal à la navigation en avril 1957. 10 ans plus tard, la guerre des Six jours a à nouveau provoqué une fermeture du Canal – qui ne rouvrira qu’en 1975 – et des années d’affrontement entre Israël et l’Égypte.
Sous les régimes les plus divers – celui des Pharaons, des monarchies, de la République socialiste de Nasser à la République autoritaire de Sissi – et en dépit des convoitises qu’il a suscité, la réalisation du Canal de Suez correspond au moins partiellement aux idées saint-simoniennes, défendues dès 1844 par Barthélémy Prosper Enfantin auprès du vice-roi d’Égypte alors réticent aux propositions de modernisation des voies de communication entre les continents, pressentant justement les intérêts des grandes puissances et les dangers pour l’indépendance de son pays.
Un siècle et demi plus tard, le doublement partiel sur 35 kilomètres, ainsi que l’élargissement et l’approfondissement sur plus de 37 autres kilomètres du Canal, réalisés en un an jour pour jour, réduisant le temps de trajet de plusieurs heures – par l’effet de la circulation à double sens et non plus alternée6 – et qui devrait doubler le trafic en quelques années – aujourd’hui de 45 navires par jour – privilégie davantage l’expansion du commerce international que la circulation des idées et la compréhension entre les peuples. Elle n’en reste pas moins une réalisation artificielle qui demeure unique et pharaonique, plus de 4 000 ans après les premières barques posées sur le Nil par Sésostris III…
L’épopée du Canal de Suez. Des pharaons au XXIe siècle
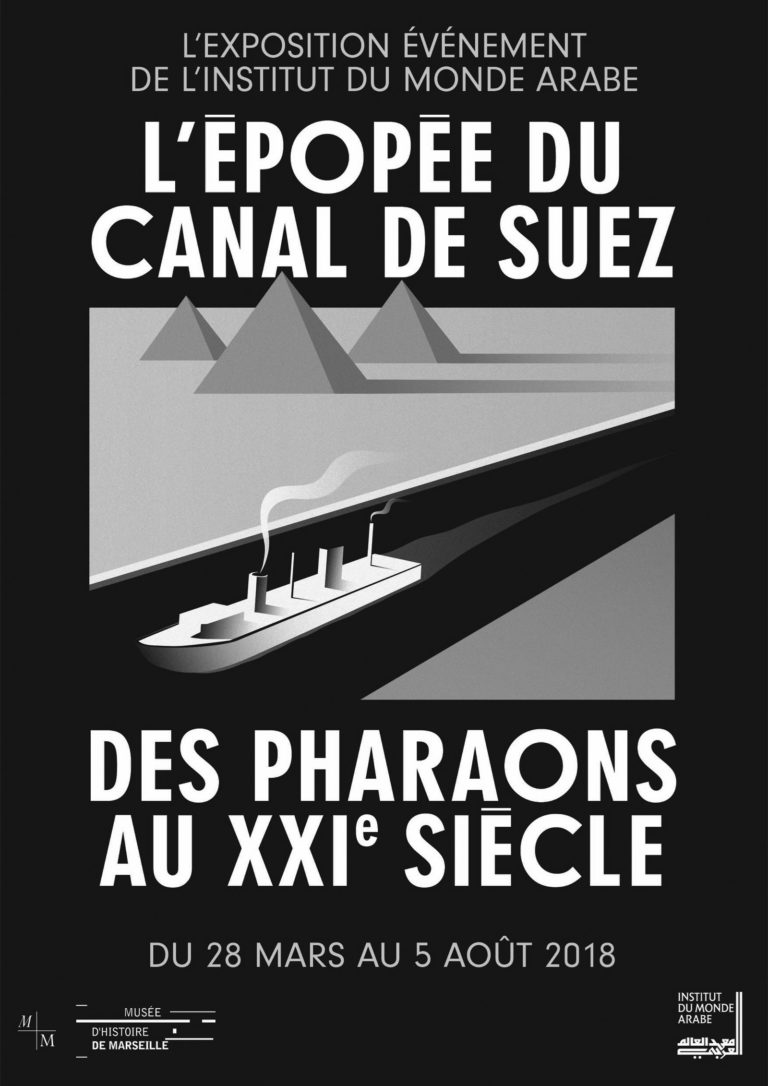
L’épopée du Canal de Suez. Des pharaons au XXIe siècle
DR
Notes de bas de pages
-
1.
Montel N., Le chantier du Canal de Suez (1859-1869), 2018, Presses des ponts.
-
2.
Verdi s’était vu commander par le Khédive, l’opéra Aïda sur une idée de l’égyptologue Auguste-Édouard Mariette, qui ne put être représenté dans le nouvel Opéra du Caire en raison du siège de Paris qui bloquait les décors… Quant à Bartholdi, sa proposition d’ériger à l’entrée du Canal une statue monumentale représentant une paysanne égyptienne fut rejetée par Ismaïl Pacha. Il recycla l’idée quelques années plus tard, qui prit alors la forme de la Statue de la Liberté à New-York…
-
3.
La convention du 29 octobre 1888 déclare « libre et ouvert, en temps de guerre comme en temps de paix, à tout navire de commerce ou de guerre, sans distinction de pavillon » le Canal de Suez.
-
4.
Résolution 118 du 13 octobre 1956 du conseil de sécurité des Nations Unies exigeant notamment le respect de la souveraineté de l’Égypte et le règlement des différends par un tribunal arbitral.
-
5.
Les rapports de force entre les différentes Nations intéressées et l’OTAN sont difficilement compréhensibles dans cette partie de l’exposition, qui peut être utilement complétée par la lecture de KYLE K., « La Grande-Bretagne, la France et la crise de Suez », in Histoire, économie & société 1994, p. 79 et s.
-
6.
https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=87948.