Les aides européennes en faveur de la culture et de la musique
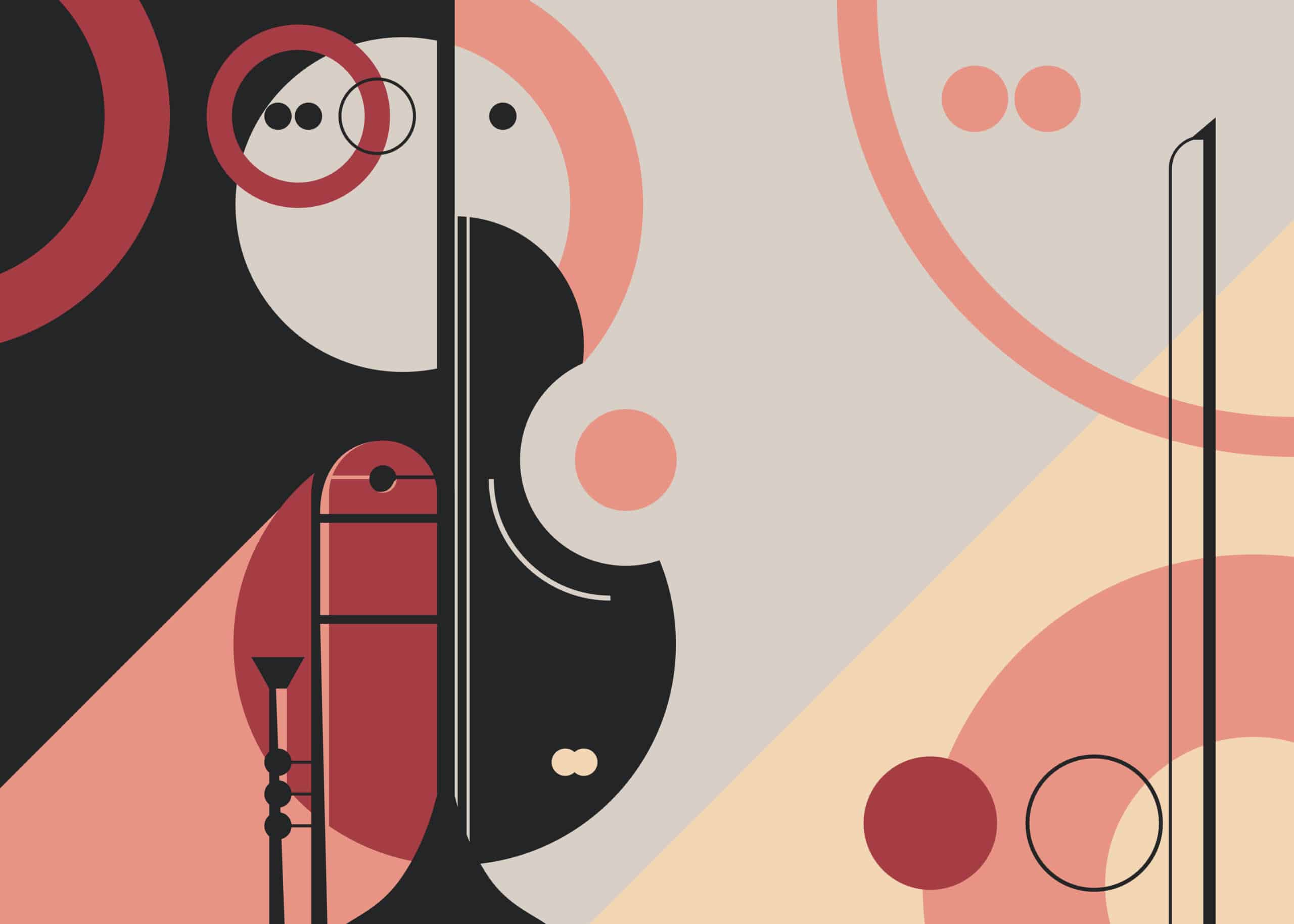
L’Union européenne, encore trop souvent perçue comme une réalité essentiellement économique, voire politique, est pourtant également présente dans le domaine culturel et artistique. Ainsi peut-elle par exemple intervenir pour soutenir la mobilité des artistes et des professionnels de la culture ou pour encourager la recherche et la création musicales.
La culture et la musique, qui ne rentrent pas dans les compétences de l’UE, peuvent pourtant être financées par les fonds européens1 dans le cadre des politiques de « cohésion économique, sociale et territoriale » (TFUE, art. 174 à 178). Tout projet d’investissement, d’organisation d’événement, de développement touristique ou encore de formation, de recherche et d’innovation peut ainsi bénéficier d’un soutien, à partir du moment où il correspond à l’un des objectifs de ces politiques. Ainsi la musique est-elle particulièrement considérée comme créatrice d’emplois et de développement économique, ce qui par exemple autorise le financement européen de festivals à la campagne grâce au programme Leader qui, depuis maintenant plus de trente ans, permet d’établir la « liaison entre les actions de développement de l’économie rurale » et de soutenir des formations aux métiers en lien avec la musique.
Plus récemment, l’UE a pris deux nouvelles initiatives intéressantes dans ce domaine, l’une destinée à soutenir la mobilité des artistes et des professionnels de la culture (I) et l’autre visant à encourager la recherche et la création musicale (II).
I – Les aides visant à soutenir la mobilité des artistes et des professionnels de la culture
Le programme Culture moves Europe (2022-2025), qui vise à soutenir la mobilité des artistes et des professionnels de la culture, tout en favorisant leur développement professionnel et en leur permettant d’initier ou d’approfondir des relations professionnelles internationales, est mis en œuvre par le Goethe-Institut2.
Ce dispositif financé par le programme Europe créative, dédié aux secteurs culturels, créatifs et audiovisuels3, permet d’accorder des bourses de mobilité aux artistes et aux professionnels de la culture âgés de plus de 18 ans et résidant dans l’un des 40 pays d’Europe créative4. Il couvre les secteurs de l’architecture, du patrimoine culturel, du design, du design de mode, de la littérature, de la musique, des arts du spectacle et des arts visuels. Il bénéficie du succès du projet pilote i-Portunus. Mobilité des artistes, ouvert aux compositeurs, musiciens et chanteurs, de préférence dans la musique classique, le jazz et les genres musicaux traditionnels entre 2018 et 2022.
Pour être éligibles, les projets doivent répondre à deux de ces quatre objectifs : comporter un mécanisme d’exploration (recherche artistique et créative, recherche de nouveaux concepts) ; de création (destiné à produire une nouvelle œuvre artistique ou culturelle) ; de connexion (développement et renforcement d’un réseau professionnel ou recherche de nouveaux publics) ; d’apprentissage (renforcement de compétences). Ils ne devront en tout cas pas porter sur une œuvre déjà existante.
L’appel Mobilité individuelle, qui comprend la mobilité d’une personne seule et la mobilité groupée, de deux à cinq personnes, lesquelles doivent avoir le même projet et la même destination, suppose un partenaire international, qui accepte d’accueillir l’artiste (ou le groupe), de le guider dans son environnement de travail et de l’aider à réaliser son projet. Il pourra s’agir d’une organisation, d’un(e) artiste ou d’un lieu d’accueil implanté dans l’un des 40 pays du programme Europe créative, autre que celui de résidence, sachant qu’une seule destination est autorisée.
La mobilité pourra d’ailleurs être virtuelle pour les personnes handicapées5 et pour les artistes résidant dans un pays dans lequel la sécurité est menacée ou qui souhaiteraient se rendre dans un pays dans lequel la sécurité est menacée.
La durée de la mobilité peut être comprise entre sept et quarante jours pour les artistes individuels, ou entre sept et quatorze jours pour les groupes (de deux à cinq personnes).
Dotée d’un budget de 21 millions d’euros, la première phase de ce projet (2022 à 2025)6 offre des bourses de mobilité à près de 7 000 artistes, professionnels de la culture et organisations d’accueil. Des appels relais pour la mobilité individuelle s’adressant à tous les secteurs éligibles sont ainsi lancés chaque année entre l’automne et le printemps.
Ce régime comporte deux lignes d’action : mobilité individuelle (pour les individus et les groupes jusqu’à cinq personnes) et résidence.
Les bourses de mobilité7 comprennent en effet d’abord plusieurs indemnités destinées à prendre partiellement en charge le coût du voyage (transport, logement, etc.), et ce proportionnellement à la distance parcourue et au mode de transport utilisé (critère de la durabilité). Une allocation journalière de 75 euros sera également versée à leurs bénéficiaires. La présence d’enfants de moins de 10 ans, les frais de visa, l’accès à des territoires ultramarins ou à des pays où la sécurité est menacée pourront également être pris en compte.
Des indemnités supplémentaires liées à certaines priorités de ce programme (inclusion et durabilité) ont également été prévues, comme la recharge verte, visant à dissuader les participants de voyager en avion, ou encore la possibilité pour les personnes en situation de handicap de bénéficier d’une couverture pouvant aller jusqu’à 100 % de la bourse de mobilité.
Elles permettent ensuite d’obtenir une aide en matière de résidence, qui s’adresse aux organisations à but non lucratif, aux ONG, aux organismes publics, aux fondations, aux entreprises et aux travailleurs indépendants des 40 pays membres de ce programme. Elle a pour but de faciliter l’accueil d’un à cinq artistes ou professionnels de la culture, venus d’autres États en faisant partie, qui ont prévu d’y rester de 22 à 300 jours.
II – Les aides visant à encourager la recherche et la création musicale
L’université de Strasbourg (Unistra), la Haute école des arts du Rhin (HEAR), le Centre de recherche et d’enseignement sur la musique (Freiburger Forschungs und Lehrzentrum Musik, FZM) de la Hochschule für Musik (HfM) de Freiburg et de l’Albert-Ludwigs-Universität de Freiburg ont créé, le 1er janvier 2021, au sein de l’Université franco-allemande de Sarrebruck8, le Collège doctoral européen d’interprétation et de création musicales (Europäisches Doktorandenkolleg für musikalische Interpretation und künstlerische Forschung – GLAREAN), habilité depuis la rentrée universitaire 2020-2021 à délivrer un doctorat (PhD).
Ce collège binational, unique en Europe, spécialisé dans le domaine de la recherche et de la création musicale, a vocation à former des musiciens de très haut niveau et à leur donner les moyens d’assurer leur mobilité et de faire ainsi découvrir au monde entier leurs aptitudes, aussi bien dans le domaine scientifique qu’artistique. Il s’efforce également de renforcer la réflexion scientifique des doctorants, particulièrement en musicologie et de les ouvrir à d’autres disciplines pas seulement artistiques, comme les sciences humaines et sociales (histoire de l’art, philosophie, psychologie, sociologie, etc.) ou encore scientifiques (mathématiques, informatique, etc.).
Ce doctorat s’adresse à des interprètes, compositeurs ou directeurs d’ensemble, qu’ils soient professionnels ou non, à condition d’être titulaires d’un master, et désireux d’approfondir d’un point de vue critique une question précise en lien direct avec leur pratique professionnelle.
Tous les doctorants inscrits dans cet établissement sont automatiquement rattachés au Collège GLAREAN et bénéficient de l’offre commune de séminaires et de cours de l’ensemble des établissements à l’origine de sa création, ainsi que de l’ensemble de leurs ressources musicales et documentaires. Ils disposent d’une aide à la mobilité proportionnelle à leurs moyens de financement.
Chacun a la possibilité d’avoir deux codirecteurs scientifiques, français ou allemands, deux codirecteurs artistiques, français ou allemands, un codirecteur scientifique français et un codirecteur scientifique allemand, un codirecteur artistique français et un codirecteur artistique allemand.
Les cours se déroulent en français, en allemand et en anglais (chaque intervenant utilisant sa propre langue ou l’une des trois). Les enseignants invités sont autorisés à dispenser leur enseignement en anglais. Les travaux des doctorants doivent être rédigés dans l’une de ces langues, en accord avec l’enseignant, à l’exception de la thèse, qui devra l’être dans la langue imposée par l’établissement, où exerce le directeur scientifique, et qui sera également celle de la soutenance.
Les aides apportées par l’UE aux artistes et plus particulièrement aux musiciens sont donc loin d’être négligeables. Bien qu’elles ne soient toujours suffisamment connues, ne serait-ce que des artistes éligibles, elles montrent bien que la culture a toujours constitué une dimension essentielle de la construction européenne9.
Notes de bas de pages
-
1.
À savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen pour une transition juste (FETJ).
-
2.
Organisation à but non lucratif fondée en 1951, dont la mission principale est de promouvoir l’apprentissage de l’allemand, comme deuxième langue, d’encourager le rayonnement de la culture allemande et de favoriser la coopération culturelle internationale, est présente dans 93 pays. Elle est financée par le gouvernement allemand.
-
3.
Europe créative, qui est le programme-cadre de la Commission européenne visant à soutenir les secteurs de la culture et de l’audiovisuel, dispose d’un budget de 2,44 milliards d’euros pour la période 2021-2027, en hausse sensible par rapport à la période 2014-2020 où il atteignait seulement 1,5 milliard d’euros.
-
4.
Les 27 pays de l’UE, ainsi que leurs régions ultrapériphériques et les pays et territoires d’outre-mer, plus l’Albanie, l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, l’Islande, le Kosovo, le Liechtenstein, le Monténégro, la Macédoine du nord, la Norvège, la Serbie, la Tunisie et l’Ukraine.
-
5.
Sur la situation des personnes en situation de handicap, v. J.-L. Clergerie, A. Gruber, J.-P. Kovar, P. Rambaud, T. Rambaud, Droit institutionnel et matériel de l’Union européenne, 15e éd., 2024, Précis Dalloz, p. 716 à 719.
-
6.
Environ 6 000 subventions sont accordées entre 2022 et 2025. Le troisième appel « relais » pour la mobilité individuelle s’adressant à tous les secteurs éligibles est ouvert du 1er août au 30 novembre 2024.
-
7.
75 % de la bourse de mobilité seront versés à la signature du contrat ; les 25 % restants ainsi que les indemnités supplémentaires le seront à la fin de la période de mobilité (à la remise du rapport).
-
8.
J.-L. Clergerie, A. Gruber, J.-P. Kovar, P. Rambaud, T. Rambaud, Droit institutionnel et matériel de l’Union européenne, 15e éd., 2024, Précis Dalloz, p. 833 à 835.
-
9.
V. à ce propos, J.-L. Clergerie, L’Europe des artistes et des écrivains, 2022, La Sirène aux yeux verts éditions, p. 13 et 14.
Référence : AJU016f2




