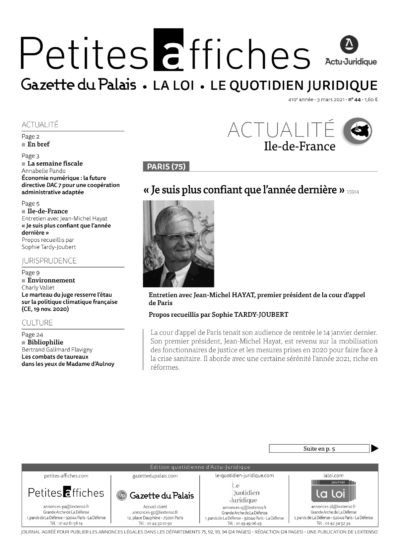Le marteau du juge resserre l’étau sur la politique climatique française
La présente décision, rendue par le Conseil d’État le 19 novembre 2020, a le mérite d’être la première dans le domaine de la justice climatique, spécifiquement sur le sujet des engagements pris par la France en la matière.
Médiatisée, cette décision est importante en ce qu’elle répond à plusieurs questions-clés pour le développement de ce type de contentieux devant le juge administratif. Point de départ, il ne faudrait toutefois pas en surestimer la portée réelle. Cette dernière est actuellement suspendue à l’issue que pourra donner le juge au fond du contentieux.
CE, 19 nov. 2020, no 427301, ECLI:FR:CECHR:2020:427301.20201119
Il est peu courant qu’une décision rendue dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir (REP) fasse écho dans la presse nationale, a fortiori dans le domaine environnemental. La décision du Conseil d’État Commune de Grande-Synthe du 19 novembre 2020 est de celles-ci. À peine rendue, elle a été immédiatement qualifiée d’« historique » par les défenseurs de l’environnement, et même de « tsunami juridique » par une partie de la doctrine1. Il est vrai que cette décision est le premier contentieux « climatique » mettant en cause directement l’action des pouvoirs publics sur lequel le Conseil d’État a eu à se prononcer.
En l’espèce, la commune de Grande-Synthe et son maire, en sa qualité d’élu et de citoyen, avaient adressé en 2019 au chef de l’État et au gouvernement des courriers tendant à ce que la France respecte ses engagements en matière climatique, et qu’elle aille même au-delà en prenant des mesures législatives et réglementaires afin de « rendre obligatoire la priorité climatique », notamment en adoptant des mesures d’adaptation au changement climatique et en interdisant toute nouvelle mesure augmentant les émissions de gaz à effet de serre (GES). Les demandeurs, à la suite des refus nés des silences gardés de l’Administration, ont introduit un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État, afin que les décisions implicites de rejet soient annulées et qu’il soit enjoint au gouvernement de prendre les mesures et dispositions demandées au préalable.
Il ne faut pas s’y tromper. L’objectif de ce recours – fortement médiatisé depuis son introduction2 – était de faire constater la carence (et même l’inaction) de l’État dans le respect de l’objectif de réduction des gaz à effet de serre prévu par plusieurs dispositions conventionnelles, européennes et nationales, en particulier celles de l’accord de Paris.
En substance, le juge administratif va admettre la recevabilité du recours avant de statuer sur la portée normative des objectifs climatiques de la France. Il va néanmoins rejeter au fond les demandes tendant à rendre obligatoire la priorité climatique et surseoir à statuer sur la question principale tendant à l’annulation du refus implicite « de prendre toute mesure utile permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national », car il ne dispose pas d’éléments suffisants lui permettant de rendre sa décision. Il ordonne donc un supplément d’instruction tendant à la production, sous 3 mois, de la preuve que le refus opposé par le gouvernement à la demande des requérants est compatible avec l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de GES qui lient la France.
Le juriste doit ici noter qu’en 2020, les tribunaux français ont su verdir leur jurisprudence de manière éclatante et que cette décision vient s’insérer dans ce contexte d’actualité prétorienne. D’une part, le 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a proclamé que « la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle »3. D’autre part, dans une décision du 10 juillet 2020, les juges du Palais-Royal condamnaient l’État à une astreinte de 10 millions d’euros s’il ne respectait pas ses obligations en matière de pollution de l’air dans les 6 mois4.
Cette décision est singulière. Pas uniquement parce qu’elle est le premier recours climatique contre l’État devant le juge administratif – rappelons tout de même que le Conseil d’État a eu à connaître d’un premier contentieux climatique, certes réduit, en 20075 avec la décision Société Arcelor Atlantique Lorraine6 –, mais surtout parce qu’elle s’inscrit dans une période paradoxale de renforcement des objectifs de réduction de gaz à effet de serre et d’augmentation inéluctable de ces derniers dans les faits.
La France se présente pourtant depuis la COP 21 comme la cheffe de file du multilatéralisme climatique7. Or depuis 2018, deux actions climatiques très médiatisées ont été introduites devant les juridictions administratives afin de reconnaître le caractère contraignant de l’accord de Paris et la carence de l’État dans la mise en œuvre de ces objectifs8. La décision ici commentée est l’une de ces deux affaires. Elle présente à ce titre des qualités jurisprudentielles indéniables qui permettront peut-être à la doctrine de dessiner les contours de la justice administrative du climat à la française.
Face au sentiment montant que les pouvoirs publics ne mettent pas en œuvre assez vite et assez fermement les mesures rendues nécessaires par le changement climatique, le recours au juge apparaît comme une arme opportune pour contraindre les États à respecter les engagements qu’ils ont eux-mêmes adoptés en la matière9. Comme l’évoque en ce sens la professeure Christel Cournil, le recours climatique devient « un outil stratégique juridico-politique pour attirer la lumière sur la nécessité d’agir face à l’attentisme (voire l’impuissance) de l’État français »10. C’est en soi une démarche loin d’être singulière qui s’observe désormais dans tous les pays. Les requérants demandent, en réalité, comme dans n’importe quel autre recours, le respect de l’État de droit par les pouvoirs publics en faisant appel à l’autorité judiciaire.
Tout l’intérêt de cette décision réside, dans un premier temps, au stade de l’admissibilité du recours climatique par le juge administratif (I). C’est une décision importante et prometteuse, mais ses répercussions sur le droit et la cause climatique dépendront largement de l’issue du supplément d’instruction ordonné par le juge administratif (II).
I – L’admission d’un recours climatique fondé sur les obligations qui incombent à l’État
À titre liminaire, il convient de noter que le Conseil d’État évite sans surprise de se prononcer sur les choix du législateur quant à la trajectoire de la politique climatique française11. Les requérants demandaient au gouvernement de soumettre un projet de loi tendant à « rendre obligatoire la priorité climatique » et interdire toute mesure susceptible d’augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Sans surprise, le Conseil d’État, en se fondant implicitement sur la théorie des actes du gouvernement, affirme que l’abstention du pouvoir exécutif de soumettre un projet de loi au Parlement échappe à la compétence de la juridiction administrative. Cette position traditionnelle12 conduit logiquement les juges du Palais-Royal à considérer le refus implicite du gouvernement comme fondé sur ce point.
Deux écueils majeurs pouvaient en revanche conduire à ce que ce recours climatique échoue. Le premier se situait au stade de la recevabilité de la requête sur le terrain de l’intérêt à agir des requérants. Le second était la question cruciale de la normativité des engagements français en matière climatique et de l’appréciation que peut donner le juge quant au respect de la trajectoire adoptée par les pouvoirs publics.
A – Les fondements de l’intérêt à agir en matière climatique
La principale limite avancée par la doctrine en matière de recours climatique est la question de la matérialisation d’un intérêt donnant qualité pour agir contre l’inaction publique, lequel doit être suffisamment spécial, direct et certain13. L’idée traditionnelle est d’éviter que l’usage du REP se transforme en action populaire. Or le Conseil accepte ici le recours de la commune mais rejette celui de son maire.
D’une part, le gouvernement opposait une fin de non-recevoir à la requête déposée par la commune de Grande-Synthe en ce que les « effets du changement climatique sont susceptibles d’affecter les intérêts d’un nombre important de communes ». Le Conseil d’État va dans un premier temps juger l’action de la commune recevable « eu égard à son niveau d’exposition aux risques découlant du phénomène de changement climatique et à leur incidence directe et certaine sur sa situation et les intérêts propres dont elle a la charge, [qui] justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation des décisions implicites attaquées ». Dans un second temps, il juge que la circonstance qu’un grand nombre de communes soit confronté au changement climatique est sans importance sur l’intérêt du requérant. D’autre part, le recours du maire est rejeté car la circonstance que son domicile serait menacé d’ici une vingtaine d’années par la montée des eaux n’est pas suffisant pour matérialiser son intérêt à agir.
Le juge administratif dessine au travers de ces deux cas de recevabilité le critère de l’intérêt à agir en matière climatique. Une collectivité territoriale sera recevable à introduire un « REP climatique » si et seulement si son territoire est spécialement frappé par les conséquences du changement climatique14, peu importe que d’autres communes soient plus durement frappées par celui-ci, peu importe que les dégâts se fassent sentir dans 1 an ou dans 20 ans et peu importe que la mesure attaquée ait une application nationale ou internationale. En l’espèce, c’est bien parce que le changement climatique, s’il n’est pas endigué par des mesures adéquates prises par les pouvoirs publics, va causer « à l’horizon 2030 ou 2040 », la disparition du territoire de la commune de Grande-Synthe sous les eaux, que le Conseil d’État admet la recevabilité du recours15. Or le maire de la commune soutenait exactement la même chose : son domicile allait lui aussi disparaître face au risque de submersion. Pourtant ce dernier a été débouté. C’est en réalité une question de degré dans l’intérêt à agir.
Une collectivité et une personne physique n’ont pas le même rapport à la terre et ne sont donc pas égales devant le changement climatique : l’une se développe sur un territoire, l’autre vit sur une propriété. Rien n’indique qu’une personne physique vivra toujours dans son domicile d’ici 20 ans. Cette dernière peut déménager, céder son bien, être expropriée, etc. Son intérêt ne peut donc être affecté certainement par la montée des eaux sur une échéance aussi lointaine. À l’opposé, une commune ne peut se mouvoir : elle « est indissociable de son territoire »16, lequel, s’il disparaissait, entraînerait invariablement l’extinction juridique de la commune. La question des effets du réchauffement climatique est donc primordiale pour cette dernière. Afin d’étayer ce raisonnement, le juge use de la preuve scientifique, en l’espèce en consultant les données publiques de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC).
Une fois ce principe posé, le Conseil d’État statue sur les demandes d’intervention des communes de Paris et de Grenoble en utilisant le critère d’incidence territoriale qu’il vient de mettre en avant. Il va consulter les données publiques de l’ONERC pour fonder l’existence d’un risque climatique de sécheresse et de crues significatives et importantes sur ces deux territoires, lequel affecterait donc en creux la pérennité de ces deux personnes publiques ou celle des intérêts qu’elles défendent.
Il admet enfin assez logiquement les interventions des quatre associations de protection de l’environnement sur le fondement de l’article L. 142-1 du Code de l’environnement, leur donnant qualité pour agir dans ce domaine.
Ce faisant, le Conseil d’État ouvre son prétoire aux personnes publiques locales suffisamment concernées par le changement climatique, sans pour autant reconnaître une action populaire dans ce domaine. Il reste ainsi dans la droite ligne de sa jurisprudence de 2015 dans laquelle il refuse l’introduction d’un recours sur le seul fondement d’un intérêt pour la cause écologiste, lequel n’a ni « pour objet, ni pour effet d’ouvrir à toute personne un droit au recours contre toute décision ayant une incidence sur l’environnement »17. C’est finalement un compromis prometteur au vu de la multiplicité des manifestations que revêtent les conséquences du changement climatique. Néanmoins, admettre la recevabilité d’un recours ne signifie pas qu’au fond le juge administratif retiendra le caractère contraignant des objectifs climatiques.
B – La normativité des engagements climatiques pris par la France
La question de la normativité est une question récurrente dans les actions climatiques. Les objectifs qu’ont souscrits les États emportent-ils des obligations ou sont-ils du droit mou ? Les conséquences sur le plan contentieux ne sont évidemment pas les mêmes. Seule la première hypothèse permet de fonder un éventuel recours climatique. La doctrine s’interrogeait donc sur la manière dont le juge administratif allait accueillir, manier, voire mettre en œuvre les objectifs climatiques à l’occasion de cette affaire18. Afin de fonder le caractère normatif et obligatoire des objectifs climatiques ainsi que le rôle du pouvoir réglementaire en ce domaine, les juges du Palais-Royal vont tout d’abord rappeler les objectifs climatiques que la France s’est fixés dans le cadre du droit international, puis il va rechercher les mesures contraignantes tendant à atteindre ces objectifs en droit interne.
Dans un premier temps, la France comme l’Union européenne ont apporté leur signature à l’accord Paris adopté le 12 décembre 2015 dans le cadre d’une Conférence des parties (COP), lequel fixe des objectifs ambitieux afin de lutter contre les émissions de GES. Cet accord s’inscrit dans le cadre plus large des stipulations de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) de 1992, dont il est un instrument juridique destiné à atteindre les objectifs prévus par ladite convention. Dans un second temps, il relève que l’Union européenne met en œuvre ces deux textes en adoptant deux « Paquets Énergie Climat ». Le premier est introduit par une décision du 23 avril 200919, le second l’est par le règlement européen du 30 mai 201820. Ce dernier a assigné à la France un objectif de réduction de ses émissions de 37 % d’ici 2030 par rapport à leur niveau de 200521. Enfin, dans un dernier temps, la France a adopté la loi Énergie-Climat en 201922, laquelle a modifié l’article L. 100-4 du Code de l’énergie qui prévoit désormais « l’objectif de réduction des émissions de GES de 40 % entre 1990 et 2030 », en se référant directement aux stipulations de l’accord de Paris et la CCNUCC. Ces nouvelles dispositions ont pour objectif de mettre en œuvre de manière effective les objectifs de ces normes de droit international, relayées par celles de l’Union européenne. Afin d’atteindre ces objectifs, le Code de l’environnement prévoit à l’article L. 222-1 A, lui-même introduit par la loi Énergie-Climat, que le pouvoir réglementaire doit fixer par décret un plafond national des émissions de GES pour la période 2015-2018, puis pour toutes les périodes consécutives de 5 ans. Il est alors indiqué que pour la première période, la seule achevée au jour de la décision, le budget carbone fixé par décret le 18 novembre 2015 prévoyait une valeur limite de 442 Mt de CO2eq par an23.
De ces trois échelons (mondial, européen et national) le juge va déduire un engagement de la France et de l’Union européenne à lutter contre le changement climatique. Toutefois, comme ce sont des stipulations de droit international qui fixent originellement les objectifs de réduction de GES et qu’elles n’ont pas en l’espèce d’effet direct à l’égard des particuliers, le Conseil d’État va faire une application de sa traditionnelle jurisprudence GISTI24. Il recherche parmi les normes en vigueur en droit interne lesquelles sont des normes complémentaires destinées à permettre l’application desdites stipulations. Il va ainsi les trouver dans la législation française, laquelle fonde le caractère contraignant des engagements climatiques pris par la France, car ces dispositions législatives doivent être interprétées à la lumière de l’accord de Paris et de la CCNUCC.
Cette décision n’est guère étonnante. Le Conseil d’État interprète en réalité les dispositions applicables en droit français « en fonction de la volonté du législateur de mettre en œuvre l’accord de Paris »25 et de respecter les normes européennes. Il estime ici en creux que l’article L. 100-4 du Code de l’énergie est tout sauf une loi de programmation, car les objectifs qu’il contient doivent tendre à la mise en œuvre de l’accord de Paris au travers des dispositifs contraignants prévus par le Code de l’environnement, lesquels confient au pouvoir réglementaire le rôle de fixer par voie de décret les outils destinés à atteindre ce but. Le juge est donc fondé à analyser le refus implicite opposé par le gouvernement à la commune de Grande-Synthe.

II – Une décision prometteuse dont les effets sont encore incertains
La décision Commune de Grande-Synthe est assurément prometteuse en ce qu’elle permet au juge d’analyser l’action de l’État en matière de lutte contre le changement climatique (A). Toutefois, face à un manque d’éléments lui permettant d’apprécier le refus implicite opposé par le gouvernement à la demande préalable, il suspend en réalité l’issue de ce contentieux à une décision ultérieure (B).
A – Une décision prometteuse : analyse de l’action de l’État en matière climatique
Le Conseil, après avoir déduit l’obligation du pouvoir réglementaire d’agir pour atteindre les objectifs climatiques, se livre à une appréciation in concreto du respect du premier budget carbone pour la période 2015-2018, et relève que ce budget a été dépassé « substantiellement ». Pour appuyer ce constat, il évoque les conclusions du Haut conseil pour le climat (HCC). Ce dernier, dans ses rapports annuels de 2019 et 2020, souligne « les insuffisances des politiques menées pour atteindre les objectifs fixés ». D’autre part, il met en valeur le fait que le décret du 21 avril 202026 a modifié le budget carbone de la période 2019-2023 en réduisant son ambition, faisant peser la majorité des efforts à fournir pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris et ceux communautaires sur les budgets 2024-2028 et 2029-2033. Si, sur le papier, les objectifs de l’accord de Paris peuvent être tenus avec un strict respect de ce récent décret, l’essentiel des réductions sera reporté après 2023. Le juge administratif constate que le rythme de réduction qui sera imposé entre 2024 et 2030 n’a dès lors jamais pu être atteint jusqu’ici. De plus, la Commission européenne, se fondant sur un récent rapport du Groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) mettant en évidence l’aggravation du réchauffement climatique, envisage d’augmenter grandement les objectifs de réduction des GES de l’Union européenne afin de tenir les engagements de la COP 21. Il y a donc une forme d’incompatibilité entre la posture française et celle de l’Union européenne.
La démarche du juge est intéressante car il se livre à une appréciation des conséquences des actions publiques en matière de réchauffement climatique sur le fondement de plusieurs rapports scientifiques. Comme il l’a fait pour admettre la recevabilité du recours en examinant les données publiques de l’ONERC, le Conseil fait ici appel aux rapports annuels du HCC et à ceux publiés par le GIEC afin d’étayer son raisonnement. Le recours à la preuve scientifique n’est pas nouveau en droit. À ce titre, le droit général de l’environnement est régulièrement présenté comme « la rencontre fertile de la science et du droit »27. En droit comparé, on note systématiquement la correspondance entre la preuve scientifique et la preuve juridique dans les recours climatiques28. Cette décision met en évidence l’importance que peut revêtir le consensus scientifique sur des sujets aussi conflictuels que le réchauffement climatique. La légitimité d’un rapport tel que celui fourni par le cercle d’experts du GIEC, le même qui a inspiré par ses travaux scientifiques l’accord de Paris, est évidemment une ressource précieuse que le juge administratif français ne peut ignorer pour fonder son appréciation de l’action publique française. Il est d’ailleurs important de noter que le rapporteur public dans cette affaire a consacré les premières lignes de ses conclusions à rappeler que le réchauffement climatique, fondé par des preuves scientifiques, n’avait pas été contesté par le gouvernement et qu’il y avait lieu d’agir maintenant pour l’endiguer29.
Le juge administratif, convaincu par la preuve scientifique, affirme que factuellement les objectifs climatiques du premier budget carbone ne sont pas tenus. Il semble de surcroît apprécier le bien-fondé du décret du 21 avril 2020 qui modifie les trois budgets carbones suivants. De cette appréciation, il souligne en creux l’incohérence de la norme française face aux nécessités climatiques. C’est à cause de cette contradiction que le juge va demander un supplément d’instruction.
B – Une décision dont la portée sera fonction d’un supplément d’instruction ordonné par le juge administratif
L’office de la haute assemblée est ici fondé sur la jurisprudence Association des Américains accidentels. Selon cette dernière, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée et refusée, au regard du droit applicable au jour de la décision. Cette appréciation au jour de la décision « réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative, pour l’autorité compétence, de prendre des mesures jugées nécessaires »30. Or, en l’espèce, l’effet utile d’une éventuelle annulation du refus opposé par le gouvernement à la demande de prendre « toute mesure utile permettant d’infléchir la courbe des émissions de GES sur le territoire national » réside bel et bien dans la question de savoir si, au jour de la décision du juge administratif, ce refus est compatible ou non avec la trajectoire de réduction des GES. Il s’agit donc pour le juge d’analyser cette trajectoire au regard, non pas du budget carbone prévu par le décret du 18 novembre 2015, mais de celui du 21 avril 2020, qui l’a remplacé en modifiant les budgets des trois futures périodes.
Le Conseil décide donc de surseoir à statuer car les conclusions de la requête ne permettent pas d’apprécier la trajectoire définie par la France dans le décret de 2020, afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article L. 100-4 du Code de l’énergie et dans le règlement (UE) n° 2018/842 du 30 mai 2018. Le juge relève l’incohérence qu’il y a entre ce décret, qui prévoit un rythme de diminution des GES jamais atteint jusque-là, et les récentes annonces de la Commission européenne. Ne pouvant déduire la légalité du refus implicite des pièces dont il dispose, il ordonne logiquement un supplément d’instruction en laissant 3 mois au gouvernement pour prouver le bien-fondé de son refus implicite31.
C’est justement cette demande de surplus d’instruction qui a fait le plus de bruit médiatiquement, même si, pour la cause climatique, il est intéressant de voir le juge demander au gouvernement de se justifier de ses actions avec toute la solennité que revêt la chose jugée. Il ne faut néanmoins pas oublier que le dossier n’a pas été tranché au fond. À la question « le gouvernement pouvait-il refuser la demande tendant à ce qu’il respecte ses engagements climatiques ? », le juge n’a pas encore répondu. Ce contentieux sera effectivement qualifiable « d’historique », si la décision prise dans 3 mois vient reconnaître la carence de l’action publique en la matière, et que le juge enjoint au gouvernement d’y remédier sous astreinte. En la matière, un précédent juridique amène espoir et crainte.
Crainte, tout d’abord, que le juge administratif choisisse de faire comme dans sa décision du 12 juillet 201732 relative à la pollution de l’air : qu’il constate l’insuffisance de l’action publique et enjoigne d’y remédier dans le délai le plus court possible sans pour autant assortir sa décision de mécanismes juridiques contraignants. Or ce contentieux a nécessité une seconde décision le 10 juillet 202033 pour constater que l’État n’avait pas exécuté la décision de 2017, et donc qu’il y avait lieu de lui enjoindre sous astreinte, dans un délai de 6 mois de l’exécuter. Ici c’est pourtant dans un rapport temporel « d’urgence climatique » qu’il faut agir34. Il est donc a priori inenvisageable que le Conseil d’État choisisse que l’exécution de sa décision dans ce contentieux s’étale sur plusieurs années.
Espoir, ensuite, que le Conseil utilise néanmoins la seconde partie de la décision relative à la pollution de l’air du 10 juillet 2020, dans laquelle il condamne l’État à une lourde astreinte de 10 millions d’euros par semestre, laquelle sera liquidée si, dans un délai de 6 mois, il n’a pas exécuté ses obligations en matière de pollution de l’air. En cas de constat d’une réelle carence de l’État en matière de lutte contre les émissions de GES (ce qui aurait déjà en soi de fortes répercussions médiatiques), le juge administratif pourrait enjoindre au respect de ces obligations dans un délai de quelques mois. À l’issue de ce dernier, si la trajectoire de réduction des émissions n’est toujours pas satisfaisante, il pourrait adjoindre à l’injonction une astreinte, laquelle pourra avoir un montant substantiel. Or il apparaît bien que ce soit une obligation de résultat qui incombe au gouvernement en matière de lutte contre les GES, de par la formulation actuellement retenue par le juge administratif.
Il convient de noter, que cette décision, rendue dans le cadre d’un contentieux de légalité, vient d’influencer le très récent jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 3 février 2021 dans le cadre d’un autre recours climatique, indemnitaire en ce cas35. Ce recours de plein contentieux a été introduit au tout début de l’année 2019 par plusieurs associations de protection de l’environnement. Nommée « l’Affaire du siècle », cette action en justice avait pour objectif de reconnaître la carence fautive de l’État face au changement climatique. Or le juge de première instance a bel et bien reconnu une telle carence, notamment dans le respect des objectifs climatiques que s’était fixé la France, qui a entraîné un préjudice écologique. Au travers de ce jugement, le juge reconnaît que l’État s’est lui-même imposé une obligation générale de lutte contre le changement climatique, admettant de facto l’urgence de la situation et sa capacité à agir contre celle-ci. Or la carence partielle de l’État français à respecter les objectifs qu’il s’est fixé en matière de lutte contre les GES engage sa responsabilité en l’espèce. Si l’État n’a été condamné qu’à verser un euro symbolique à chaque association requérante, le signal reste fort car le préjudice écologique a été reconnu. Toutefois, là encore, une partie de l’affaire reste suspendue à un surplus d’instruction. À n’en pas douter, cette décision, qui, rappelons-le, n’est que de première instance, va influencer celle que devra rendre le Conseil d’État pour trancher définitivement le contentieux de la commune de Grande-Synthe. Les deux affaires semblant suivre la même dynamique jurisprudentielle.
Enfin, le 30 novembre 2020, la Cour européenne des droits de l’Homme a admis la recevabilité directe d’une requête tendant à prouver les manquements de 33 États en matière de lutte contre les émissions de GES, dont la France.
La décision Commune de Grande-Synthe ne doit pas être vue comme la dernière rendue en matière environnementale en 2020, mais bel et bien comme le point de départ d’une dynamique contentieuse plus large qui trouvera son élan, nous l’espérons, en 2021. On en retirera quand même que les engagements d’un État, même formulés sur le sujet d’émissions de gaz, sont loin d’être du vent.
Notes de bas de pages
-
1.
B. Parance et J. Rochfled, « Tsunami juridique au Conseil d’État. Une première décision “climatique” historique », JCP G 2020, 1134.
-
2.
Par ex. : https://lext.so/ZSqj1X.
-
3.
Cons. const., 31 janv. 2020, n° 2019-823 QPC, Union des industries de la protection des plantes : JO n° 0027, 1er févr. 2020 ; D. 2020, n° 20, p. 1159 ; AJDA 2020, p. 1126.
-
4.
CE, 10 juill. 2020, n° 428409, Assoc. Les Amis de la Terre France, Lebon à paraître : AJDA 2020, p. 1776.
-
5.
M. Torre-Schaub, « Les dynamiques du contentieux climatique : anatomie d’un phénomène émergent », in M. Torre-Schaub et a. (dir.), Quel(s) droit(s) pour les changements climatiques ?, 2018, Mare & Martin, p. 117.
-
6.
CE, 8 févr. 2007, n° 287110, Sté Arcelor Atlantique Lorraine : Lebon, p. 56.
-
7.
M. Toussaint, « Du climat dans la Constitution : un outil pour la justice climatique ? », Énergie - Env. - Infrastr. 2018, dossier 47.
-
8.
M. Torre-Schaub et B. Lormeteau, « Aspects juridiques du changement climatique : de la gouvernance du climat à la justice climatique (1re partie) », JCP G 2019, n° 39, 1674.
-
9.
J.-C. Rotouillé, « Le contentieux de la légalité », RFDA 2019, p. 644.
-
10.
C. Cournil, « “L’Affaire du siècle” devant le juge administratif. Les ambitions d’un des premiers futurs recours “climat” français », AJDA 2019, p. 437.
-
11.
B. Parance et J. Rochfled, JCP G 2020, n° 1134.
-
12.
CE, 19 janv. 1934, Cie marseillaise de navigation à vapeur Fraissinet : Lebon, p. 98 – CE, 29 nov. 1968, n° 68938, Tallagrand : Lebon T., p. 607 – CE, 26 nov. 2012, n° 350492, M. Krikorian : Lebon T., p. 528.
-
13.
M. Torre-Schaub et B. Lormeteau, JCP G 2019, n° 39, 1674 ; J.-C. Rotouillé, RFDA 2019, p. 644.
-
14.
En ce sens, v. CE, 19 mars 1993, n° 119147, Cne de Saint-Egrève : Lebon T., p. 1083.
-
15.
V. les conclusions du rapporteur public M. Stéphane Hoynck sur la présente affaire.
-
16.
V. les conclusions du rapporteur public M. Stéphane Hoynck sur la présente affaire, p. 4.
-
17.
CE, 23 oct. 2015, n° 392550 : Énergie - Env. - Infrastr. 2016, comm. 12.
-
18.
M. Torre-Schaub et B. Lormeteau, « Aspects juridiques du changement climatique : de la justice climatique à l'urgence climatique (2de partie) », JCP G 2019, n° 52, 2382.
-
19.
PE et Cons. CE, décision n° 406/2009/CE, 23 avr. 2009, relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 : JOUE L 140/136, 5 juin 2009.
-
20.
PE et Cons. UE, règl. n° 2018/842, 30 mai 2018, relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 : JOUE L 156/26, 19 juin 2018.
-
21.
PE et Cons. UE, règl. n° 2018/842, 30 mai 2018, annexe I, art. 4.
-
22.
L. n° 2019-1147, 8 nov. 2019, relative à l'énergie et au climat : JO n° 0261, 9 nov. 2019.
-
23.
D. n° 2015-1491, 18 nov. 2015, relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone : JO n° 0268, 19 nov. 2015.
-
24.
CE, 23 avr. 1997, n° 163043, GISTI : Lebon, p. 143 – CE, 11 avr. 2012, n° 322326, GISTI et FAPIL : Lebon, p. 142.
-
25.
V. les conclusions du rapporteur public M. Stéphane Hoynck sur la présente affaire, p. 18.
-
26.
D. n° 2020-457, 21 avr. 2020, relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone : JO n° 0099, 23 avr. 2020.
-
27.
É. Naim-Gesbert, Droit général de l’environnement. Introduction au droit de l’environnement, 3e éd., 2019, LexisNexis, p. 17 ; M. Prieur, Droit de l’environnement, 8e éd., 2020, Dalloz, p. 21.
-
28.
C. Cournil, AJDA 2019, p. 437 ; M. Torre-Schaub, « Les dynamiques du contentieux climatique : anatomie d’un phénomène émergent », in M. Torre-Schaub et a. (dir.), Quel(s) droit(s) pour les changements climatiques ?, 2018, Mare & Martin, p. 119.
-
29.
V. les conclusions du rapporteur public M. Stéphane Hoynck sur la présente affaire, p. 1.
-
30.
CE, 19 juill. 2019, n° 424216, Assoc. des Américains accidentels : Lebon, p. 296.
-
31.
V. également en ce sens : C. Collin, « Contentieux climatique de Grande-Synthe : une déclaration plus prometteuse qu’historique » note sous CE, 19 nov. 2020, n° 427301 : Dalloz actualité, 27 nov. 2020.
-
32.
CE, 12 juill. 2017, n° 394254, Assoc. Les Amis de la Terre France : Lebon, p. 229.
-
33.
CE, 10 juill. 2020, n° 428409, Assoc. Les Amis de la Terre France, à paraître au Lebon : AJDA 2020, p. 1776.
-
34.
V. les conclusions du rapporteur public M. Stéphane Hoynck sur la présente affaire, p. 1.
-
35.
TA Paris, 3 févr. 2021, nos 1904967, 1904968, 1904972, 1904976 4-1, Assoc. OXFAM France et a., dite Affaire du siècle.