« Deux hommes dans la ville » : les limites de l’argument d’émotion contre la peine de mort
Alain Delon est décédé le 18 août 2024. Retour sur un de ses grands films, Deux hommes dans la ville, sorti sur les écrans en 1973, dans lequel il donne la réplique à Jean Gabin, à l’époque âgé de 69 ans. C’est un émouvant « passage de témoin » entre deux générations d’acteurs qui auront incarné le cinéma français pendant presque un siècle. Le film est aussi un plaidoyer contre la peine de mort, à l’époque encore en vigueur en France. Quelques mois auparavant, le 28 novembre 1972, Buffet et Bontemps avaient été exécutés.

Un chef-d’œuvre du cinéma « noir »
Alain Delon y interprète le rôle d’un ancien truand condamné autrefois pour le braquage d’une banque. Son éducateur social, incarné par Jean Gabin, se porte garant pour lui, parvenant à faire en sorte qu’il soit libéré avec deux ans d’avance. Des liens amicaux se tissent entre les deux hommes, et la réinsertion de l’ancien détenu, qui à sa sortie a trouvé femme et travail, semble être placée sous les meilleurs auspices. C’est sans compter avec la malchance (ou plutôt l’injustice…), incarnée par un inquiétant inspecteur de police (Michel Bouquet), convaincu que le repris de justice récidivera et qui le harcèle. Un jour, l’ancien truand surprend le policier en train de menacer sa compagne et le tue dans un accès de colère. Condamné à mort, sa grâce présidentielle est refusée et il est guillotiné.
Le film fait constamment référence au Jean Valjean des Misérables de Victor Hugo. Dans les deux cas, un ancien condamné, libéré et décidé à vivre dorénavant de manière honnête, ne parvient pas à se réinsérer car il est accablé par une Justice inhumaine incarnée par un inspecteur de police impitoyable (Javert). Notons que Jean Gabin avait interprété en 1958 le rôle de Jean Valjean dans le film Les Misérables de Jean-Paul Le Chanois, et Michel Bouquet celui de Javert, en 1982, dans la version de Robert Hossein.
Un plaidoyer contre la peine de mort…
Deux hommes dans la ville est non seulement un film sombre et poignant magistralement interprété, mais aussi un plaidoyer contre la guillotine, et à ce titre un acte militant qui se doit d’être jugé comme tel. Dans le scénario – très orienté – tout est conçu pour critiquer la peine de mort et donc à l’époque la Justice, et tout est conçu, aussi, pour sanctifier Alain Delon, jusqu’à rendre compréhensible et presque légitime l’assassinat du policier Michel Bouquet, certes coupable d’agissements moralement et déontologiquement blâmables (et, en réalité, plutôt improbables). Aucune distanciation n’est admise, Jean Gabin se chargeant de faire la leçon tout au long du film, émaillé de phrases que Victor Hugo aurait pu très bien écrire : « Méfiez-vous, à force de chercher un coupable, on le fabrique » ; « c’est aux conditions du crime qu’il faut s’attaquer, beaucoup plus qu’aux criminels » ; « j’ai une opinion personnelle de la Justice : je pense qu’elle doit être juste mais pas féroce ».
… ou bien un plaidoyer pro domo ?
Certes, le film est une œuvre artistique (très réussie, au demeurant), et pas une enquête documentaire. Pour comprendre les ressorts qui l’animent, il est nécessaire de se pencher sur celui qui l’a non seulement réalisé, mais en a aussi écrit le scénario : le romancier et metteur en scène José Giovanni. Né en 1923 de parents corses issus d’un milieu aisé, pendant l’occupation il devient un collaborateur de la Milice et des nazis, puis plonge dans le banditisme le plus sordide se livrant à des vols, extorsions, enlèvements et meurtres accompagnés de tortures au préjudice, principalement, de juifs. Pour ces faits, il est jugé en 1948 par la cour d’assises de Marseille et condamné à la peine capitale. En 1951, il obtient une réduction de peine à vingt ans de travaux forcés. Il est finalement libéré en 1956, après onze ans de détention. `
Quand, en 1993, la presse suisse révèle ses antécédents, José Giovanni ne les nie pas, se bornant à déclarer : « J’ai payé. J’ai droit au pardon et à l’oubli » ; ce qui est vrai, tant au regard du droit que de la morale. La Justice a donc accompli sa mission avec humanité en réduisant à deux reprises, très fortement, sa peine, et en lui permettant de se réinsérer pleinement dans la société afin d’entamer une nouvelle vie dans laquelle il connaîtra, en tant que romancier et cinéaste, un grand succès (meilleur encore que celui du Monsieur Madeleine des Misérables…).
Dans son cas, elle a appliqué le principe annoncé par Jean Gabin dans le film : la Justice se doit d’« être juste mais pas féroce ». Mais José Giovanni n’a pas été reconnaissant pour la clémence dont il a fait l’objet, instruisant dans son film un procès à charge contre l’institution qui ne tient compte ni de son parcours personnel, ni de la vraisemblance.
Victor Hugo : deux manières de combattre l’injustice de la Justice
Victor Hugo a été toute sa vie un adversaire implacable de la peine de mort, combat qui se manifeste davantage dans Le Dernier jour d’un condamné et dans Claude Gueux que dans Les Misérables (qui est plutôt un acte d’accusation contre les bagnes). Le premier texte est, de loin, le plus connu et le mieux réussi car l’écrivain avait perçu le « piège » du sujet : difficile de susciter l’empathie des lecteurs pour son condamné au regard de la victime et de sa souffrance. Dans Le Dernier jour d’un condamné, Hugo avait échappé très habilement au dilemme … en l’escamotant totalement. Son livre ne nous dit absolument rien sur elle (même pas son sexe ou son âge), ni sur son entourage, ni sur les mobiles et les circonstances du meurtre.
Il en va tout autrement s’agissant de Claude Gueux, pour lequel Victor Hugo reprend un fait divers de son époque, parfaitement documenté. Si le protagoniste de ce court roman porte le nom du véritable détenu condamné à mort en 1832 pour un meurtre commis à la maison centrale de Clairvaux, il l’enjolive et le transforme complètement, en modifiant sa vie et son parcours judiciaire pour en faire, finalement, une sorte de « Christ » tout empreint de générosité et d’altruisme, un honnête homme incarcéré pour avoir volé un pain (comme Jean Valjean). Dans la réalité, Claude Gueux était un voleur récidiviste qui n’avait pas commis un larcin pour nourrir les enfants de sa compagne (comme le raconte Hugo), mais avait, la première fois dérobé les économies d’un garçon de ferme et, la deuxième fois, volé une jument. Violent, cynique, il avait surtout tué de manière atroce, avec préméditation, un gardien de prison afin de se venger de la décision prise (par le directeur de l’établissement, pas par le gardien) de le séparer d’un autre détenu, Albin, plus faible et plus jeune, dont il abusait sexuellement et à qui il dérobait systématiquement sa nourriture.
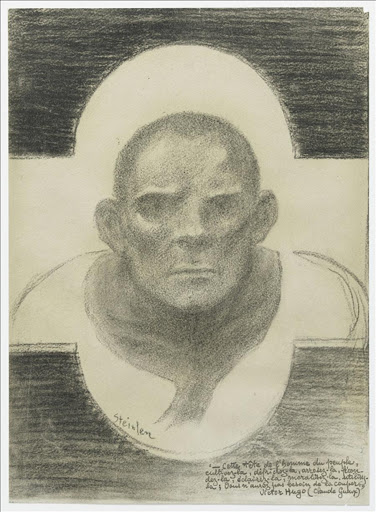
Alain Delon comme Claude Gueux ?
Pour son film, José Giovanni s’inspire bien plus du maladroit Claude Gueux que du fin et sensible Dernier jour d’un condamné : c’est ainsi qu’Alain Delon devient, lui aussi, une émouvante (et improbable) figure christique. En corollaire, sa victime (Michel Bouquet) est décrite comme un monstre démoniaque (plus noir encore que Javert, car ce dernier finit par libérer Jean Valjean) ; et, bien évidemment, la douleur de la famille de l’inspecteur de police est complètement ignorée – à l’exception d’une allusion, rapide et presque moqueuse, à sa présence endeuillée lors du procès, suggérant une manœuvre, voir une mascarade vestimentaire pour manipuler le jury.
Il fallait supprimer la guillotine, mais comment convaincre l’opinion publique qu’il était plus que temps de le faire ? Car l’horreur du crime suscite autant d’émotion que l’horreur de la peine de mort… L’approche rationaliste de l’incontournable Cesare Beccaria mettait en avant des arguments qui étaient déjà imparables à la fin du XVIII siècle. Dans son essai Dei delitti e delle pene (1764), le marquis constatait que non seulement la peine capitale n’avait aucun impact dissuasif sur la criminalité, mais qu’elle mettait en scène, en la glorifiant, une violence légale qui faisait passer un message terrible : le meurtre est admis comme étant un mécanisme « normal » de régulation de la société, et puisque l’État le pratique, il n’y a aucune raison pour que les individus n’y aient pas recours…
Si les arguments des abolitionnistes étaient recevables au plan de la raison, ceux des défenseurs de la peine capitale faisaient brèche grâce à l’émotion suscitée par des crimes atroces : Buffet et Bontemps avaient été condamnés à mort pour avoir égorgé deux otages, une infirmière de 35 ans et un gardien de prison de 27 ans, et le président Pompidou avait refusé de les gracier, leur crime particulièrement atroce ayant bouleversé l’opinion publique. Certes, l’émotion était utilisée aussi par les abolitionnistes, dans des romans (Le Dernier jour d’un condamné et Claude Gueux – ce dernier de manière fort maladroite) et des films (Deux hommes dans la ville – avec une efficacité certaine), mais opposer la souffrance du condamné à la souffrance de la victime ne pouvait qu’aboutir à une impasse : lequel des deux souffrirait le plus ? Lequel des deux devrait susciter en priorité l’empathie de l’opinion publique ?
« J’ai l’honneur de demander l’abolition de la peine de mort en France »[1]
Dans l’impossibilité de déterminer une échelle de la souffrance, depuis environ deux siècles la France ne parvenait pas à tourner la page d’un rituel judiciaire archaïque et, en 1981, la majorité des Français restait donc favorable à la peine de mort. Aux arguments de la rationalité et à ceux de l’émotion, il fallut donc ajouter la détermination de deux hommes politiques convaincus que, même en démocratie, la majorité n’a pas toujours et forcément raison. François Mitterrand et Robert Badinter firent passer « en force » leur décision, et permirent finalement à la France de sortir des ornières archaïques de la loi du talion et d’une approche émotionnelle de la politique pénale se mettant systématiquement à genoux devant le « ressenti » de la souffrance. Une belle leçon qui reste d’actualité dans d’autres dossiers…
[1] Discours de Robert Badinter à l’Assemblée nationale, 17 septembre 1981.
Référence : AJU463168





