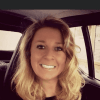Ne touchez pas à l’individualisation de la peine !
Faut-il remettre en cause le « dogme » de l’individualisation des peines, comme le soutient Laurent Lemasson dans les colonnes du Figaro ? Cette idée fait bondir notre chroniqueuse Me Julia Courvoisier, qui propose d’emmener les lecteurs d’Actu-Juridique à une audience pour leur montrer à quoi sert, en pratique, la possibilité pour le juge d’individualiser la peine infligée à un prévenu.

J’ai lu, il y a quelques jours, un article paru dans Le Figaro auquel je tenais à répondre puisque, sans aucune retenue, son auteur, un docteur en droit public, y indique que :
« le retour des peines planchers pourrait être une bonne chose s’il permettait, précisément, de remettre en cause le dogme de l’individualisation des peines. Ce dogme repose sur ce que l’on peut appeler la conception thérapeutique du châtiment : l’idée que la peine doit avant tout servir à réinsérer le délinquant et qu’elle doit donc être adaptée à sa personnalité par le juge.
À l’encontre de cette conception désastreuse, il faut revenir à l’idée que les peines sont avant tout rétributives et légales : leur but premier est de châtier le criminel à la hauteur de son crime et de dissuader ceux qui pourraient être tentés de l’imiter. Elles doivent être adaptées au crime, pas au criminel, et ne doivent pas être laissées à l’arbitraire du juge »
J’avais d’abord envisagé de réagir par un cours simplifié de droit pénal que j’aurais appelé « le droit pénal pour les nuls ». J’ai ensuite pensé écrire un pavé agacé sur l’indépendance nécessaire et évidente des juges dans un État de droit et l’échec passé de la mise en place de peines plancher (https://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1310.asp#P603_89842). J’aurais aussi pu parler de psychologie, mais je n’en ai pas les compétences.
Non, la justice ne « châtie » pas les criminels
Et puis j’ai eu une idée.
Vous inviter à me suivre en audience pour vous montrer que le principe de l’individualisation des peines pénales n’a rien d’un dogme dangereux pour notre justice !
D’abord, partons d’un principe immuable auquel je suis attachée : dans un État de droit démocratique, la justice ne « châtie pas les criminels » contrairement à ce qui est soutenu dans cet article. Laissons ce terme aux talibans et conservons une certaine civilité si vous le voulez bien.
Le Code pénal prévoit, c’est vrai, des peines maximales. Il appartient ensuite à une juridiction, après un débat contradictoire, de fixer la sanction : dix ans de prison, sept ans, neuf ans ? Le maximum ? Comment trancher ? Je ne sais pas, je ne suis pas juge et j’en suis ravie : je serai bien incapable de décider qui mérite deux ans de plus ou trois ans de moins que son voisin.
Mais c’est ce que l’on appelle la « personnalisation de la peine ». Ce principe, à valeur constitutionnelle, possède un intérêt pratique : vous conviendrez que le SDF qui vole pour manger n’est pas le même que celui qui vole car il est cleptomane. Et pourtant, tous les deux risquent la même chose : 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende (article 311-3 du Code pénal).
J’étais donc cet après-midi au tribunal correctionnel : à l’inexpérience d’un article, je souhaite opposer l’humanité et la réalité d’une audience pénale.
« Il n’a pas dû manger ni boire depuis un moment »
Il y a quelques jours, j’ai été contactée un peu en urgence par un jeune homme dont le frère est en détention provisoire depuis la fin du mois de février : son dossier a été renvoyé d’office car il y avait trop d’affaires à juger ce jour-là et donc, il a été incarcéré en attendant la prochaine audience. Et l’audience se tient cet après-midi. Le procureur reproche à mon client d’avoir vendu des psychotropes à la sauvette la semaine précédent la première audience. Une petite enquête des policiers plutôt bien ficelée comme on dit, avec quelques surveillances et puis, le combo classique : interpellation, perquisition, garde à vue et déferrement.
Je sais qu’il va être condamné, vu le contenu du dossier.
Je rencontre d’abord le frère de mon client, évidemment, pour qu’il m’en dise plus avant l’audience. Il vient au bureau et il « sent la rue » : je lui offre un café et des petits gâteaux car je vois tout de suite qu’il n’a pas dû manger ni boire depuis un petit moment. Je lui propose aussi de se laver les mains, évidemment. On parle un peu de la vie, son français n’est pas très bon, mais on se débrouille. Il reste pudique sur sa venue en France, confie simplement avoir fui la pauvreté de l’Algérie.
Je connais ces désirs d’une vie meilleure. J’entends, depuis 13 ans, des récits souvent durs, parfois insupportables. Ponctués de pleurs et de honte. Personne ne peut être indifférent à ces récits de vie. Et pour tout vous dire, il m’arrive d’espérer qu’un jour, certains de nos hommes politiques assistent à ces entretiens bouleversants qui les aideraient sûrement à mettre un peu d’eau dans leur vin lorsqu’ils déversent leurs certitudes sur les plateaux de télévision.
« Une petite cellule froide, qui ne sent pas très bon, aux murs sales »
Je rencontre mon client ce midi au « dépôt » du tribunal. Le « dépôt », c’est l’endroit miteux où l’on « dépose » les prévenus qui vont être jugés et qui viennent des prisons du coin. On y dépose les gens, comme on dépose nos encombrants en bas de nos immeubles. Je déteste ce mot « dépôt » mais je n’ai pas le choix. Mon bureau provisoire : une petite cellule froide, qui ne sent pas très bon, aux murs sales.
Aujourd’hui, les policiers du dépôt et les prévenus déambulent dans une odeur d’urine qui donne la nausée. Parce que oui, on y dépose les prévenus mais on y laisse aussi des policiers des heures entières pour les surveiller. Pour la dignité, on repassera. Nous sommes donc tous là, à essayer de garder un peu le sourire et faire comme si nous ne sentions rien.
Mon client entre dans ce petit box pourri.
Il sent la prison. Il a les dents abîmées alors qu’il n’a que 25 ans. Il est immédiatement mal à l’aise de devoir parler à son avocate dans cet état, dans ce local, dans cette tenue sale. Il est « indigent » pour la prison qui lui a donc fourni quelques vêtements de fortune. Il a honte d’être là parce que son rêve n’était pas de se retrouver ici avec moi. Encore moins à Fleury-Mérogis entassé dans une cellule avec des inconnus.
Il a fui l’Algérie après la révolution du Hirak. Il ne trouvait plus de travail et il venait de perdre son père après avoir déjà perdu sa mère quelques années plus tôt. L’inflation galopante, la covid, les pénuries de produits de première nécessité (lait, huile, semoule notamment) l’ont convaincu de tenter sa chance ailleurs et de rejoindre son unique frère en France.
Qu’aurais-je fait si j’avais été à sa place ? Certainement la même chose. Fuir la pauvreté semble un réflexe de survie humaine, si j’en crois ce qu’il se passe actuellement dans le monde entier.
Alors il est arrivé en France. Vogue la galère : il a vendu des cigarettes sous le manteau, a travaillé au noir en tant que peintre en bâtiment. Il vit dans un squat. Essaie de faire bonne figure en me parlant de ses rêves, qui s’éloignent de plus en plus. Il se fait un ou deux euros en revendant des paquets de cigarettes. Il dit n’avoir pas vendu de médicaments qui eux, se vendent 2 euros le comprimé. Le dossier ne fait pas ressortir de violences de sa part, ni de profil violent.
« Alors Monsieur, vous vivez ici dans une grande précarité : du coup, pourquoi vous n’êtes pas resté en Algérie ? » lui demande la présidente à l’audience lorsqu’il lui explique, brièvement, son évidente quête du mieux. Ou du moins mauvais.
Neuf mois ferme
Mon métier m’a appris beaucoup de belles choses, mais aussi une très moche : il y a plusieurs niveaux de misère. La misère que l’on voit ici est parfois bien moins grave que celle que l’on peut rencontrer dans l’immense majorité des autres pays du monde. En termes de misère, on peut toujours faire pire. Parce que c’est ce qu’il y a de terrible avec la misère : elle n’a pas de limite.
Mais en audience, on parle peu de misère. On parle plutôt de « précarité ». Ça permet peut-être à certains de mieux dormir la nuit, je ne sais pas.
Mon client avait été condamné il y a un an à une amende de 300 euros pour avoir volé de la nourriture (une ordonnance pénale qui est une procédure alternative aux poursuites pénales). Il risquait cinq ans de prison et 375 000 euros d’amende.
La procureure a demandé au tribunal de le condamner aujourd’hui à dix-hui mois de prison et de le maintenir en détention. Il a été condamné à neuf mois et est retourné ce soir à Fleury-Mérogis. Il ne fera pas appel de sa condamnation, évidemment.
Ma question est simple : à quoi l’auriez-vous condamné, vous ?
Référence : AJU359203