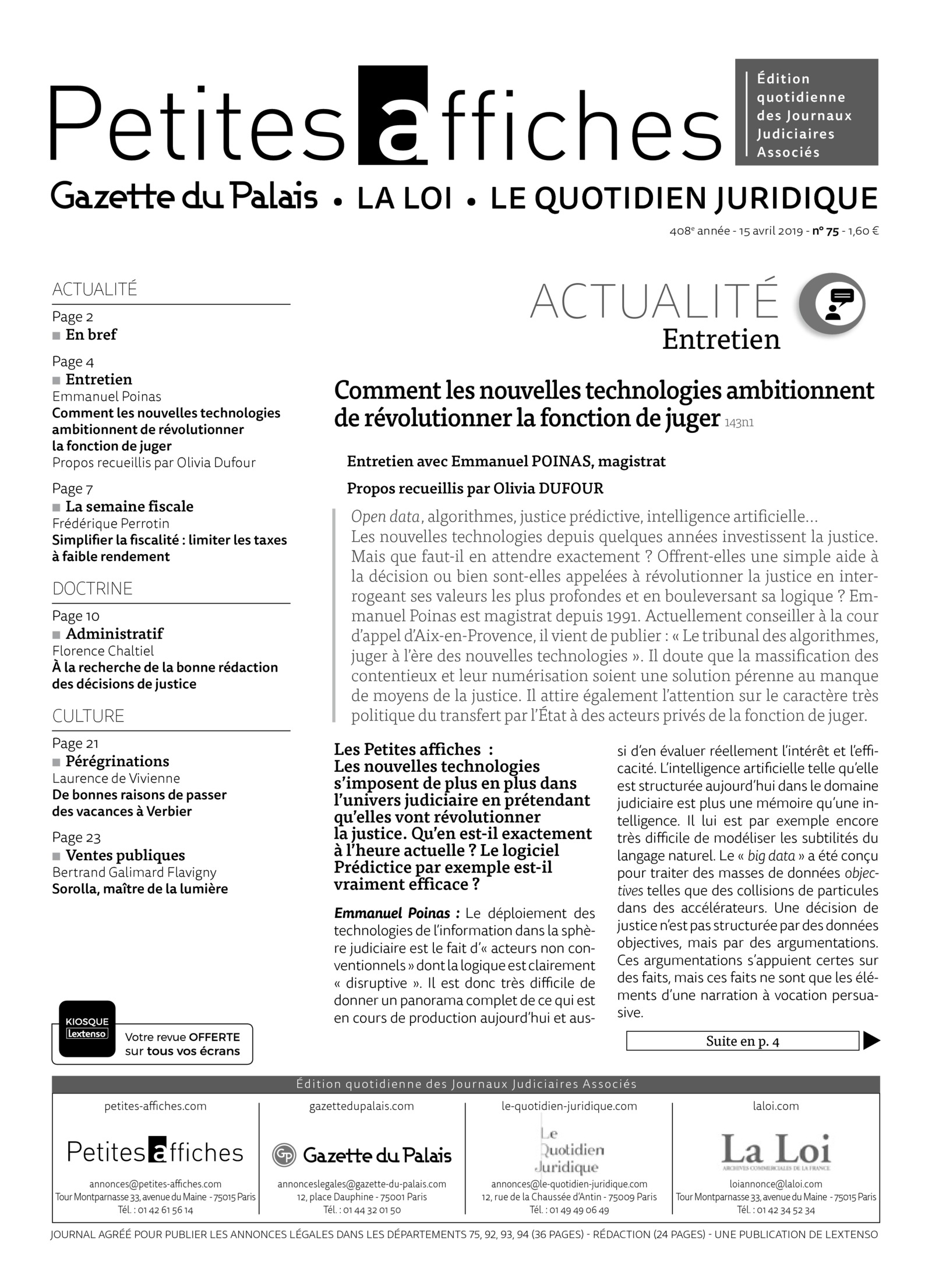Comment les nouvelles technologies ambitionnent de révolutionner la fonction de juger
Open data, algorithmes, justice prédictive, intelligence artificielle… Les nouvelles technologies depuis quelques années investissent la justice. Mais que faut-il en attendre exactement ? Offrent-elles une simple aide à la décision ou bien sont-elles appelées à révolutionner la justice en interrogeant ses valeurs les plus profondes et en bouleversant sa logique ? Emmanuel Poinas est magistrat depuis 1991. Actuellement conseiller à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, il vient de publier : « Le tribunal des algorithmes, juger à l’ère des nouvelles technologies ». Il doute que la massification des contentieux et leur numérisation soient une solution pérenne au manque de moyens de la justice. Il attire également l’attention sur le caractère très politique du transfert par l’État à des acteurs privés de la fonction de juger.
Les Petites affiches
Les nouvelles technologies s’imposent de plus en plus dans l’univers judiciaire en prétendant qu’elles vont révolutionner la justice. Qu’en est-il exactement à l’heure actuelle ? Le logiciel Prédictice par exemple est-il vraiment efficace ?
Emmanuel Poinas
Le déploiement des technologies de l’information dans la sphère judiciaire est le fait d’« acteurs non conventionnels » dont la logique est clairement « disruptive ». Il est donc très difficile de donner un panorama complet de ce qui est en cours de production aujourd’hui et aussi d’en évaluer réellement l’intérêt et l’efficacité. L’intelligence artificielle telle qu’elle est structurée aujourd’hui dans le domaine judiciaire est plus une mémoire qu’une intelligence. Il lui est par exemple encore très difficile de modéliser les subtilités du langage naturel. Le « big data » a été conçu pour traiter des masses de données objectives telles que des collisions de particules dans des accélérateurs. Une décision de justice n’est pas structurée par des données objectives, mais par des argumentations. Ces argumentations s’appuient certes sur des faits, mais ces faits ne sont que les éléments d’une narration à vocation persuasive. Rendre justice est un art du langage. Le déploiement d’algorithmes d’évaluation des décisions de justice en vue de leur reproductibilité apparaît donc pour l’instant hors de portée des systèmes experts tant que ceux-ci ne « parlent » pas réellement comme des humains. Or ce n’est toujours pas le cas. Le logiciel « Prédictice » a notamment fait l’objet d’une expérimentation qui a été jugée non concluante par la cour d’appel de Rennes. Mais comme la plupart des produits innovants, il convient de « faire crédit » des expérimentations en cours aux développeurs. La part de « mise en évidence » des produits est bien entendu indissociable de toute « création de valeur » à notre époque et les technologies judiciaires n’échappent pas à la règle ; certains « opérateurs » excellent même en ce domaine. Si leurs clients sont satisfaits, c’est en un sens le principal…
LPA
La révolution annoncée que vous nommez « disruption » se fonde sur une forte capacité à traiter l’information en affirmant que le juge ne fait pas autre chose que justement que de traiter de l’information. Mais est-ce réellement cela la justice ?
E. P.
Une décision de justice n’est pas rédigée selon la manière dont elle est élaborée. Pour dire les choses simplement la décision est d’abord prise, et elle est mise en forme. Or ce processus n’est pas retranscrit dans la forme ordinaire des jugements. Les décisions de justice, sont donc des actes de volonté (des plaideurs, du juge), mais ne sont pas des « faits » au sens scientifique du terme. C’est d’ailleurs pourquoi pendant longtemps le commentaire des décisions de justice et leur exploitation n’ont été que du ressort de spécialistes à même de proposer une analyse des termes des jugements et de distinguer par exemple « la jurisprudence » au milieu de la masse des décisions qui constituent « le contentieux ». Ramener les motifs des décisions à de l’information « ordinaire » et surtout « objective » présente donc un risque quant à la pertinence de ce qui est traité, et méconnaît aussi le principe de hiérarchie des décisions de justice entre elles. C’est l’un des principaux vices de raisonnement qui affectent la volonté « d’extraire » du droit d’une analyse massifiée des jugements. En revanche, la promesse d’une justice « prédictive » d’un droit « accessible » et d’une législation « simplifiée » est de nature à exercer un attrait véritablement irrésistible auprès des décideurs publics.
LPA
Face au manque de moyens de la justice, on a le sentiment que le numérique est perçu comme la solution, parce qu’il peut permettre des économies mais aussi parce qu’il s’inscrit dans une logique du nombre et de la performance qui rejoint la logique gestionnaire. N’est-ce pas trahir la fonction de juger que de la réduire à cela ?
E. P.
La nécessité de bien gérer les fonds publics doit naturellement s’appliquer à la justice. Mais on ne peut « bien gérer » que ce que l’on est en mesure de comprendre. Il est toujours dangereux de réformer « à l’aveugle ». Or ce qui fait l’objet d’études ce sont surtout des grandes masses, des « flux », auxquels même la loi doit s’adapter. D’expérience, la tendance est assez forte de considérer qu’en matière judiciaire lorsqu’il s’agit de réformer « l’intendance suivra ». Elle suit le plus souvent, mais à quel prix pour le justiciable ? De même que la part du budget des juridictions est assez infime par rapport à la totalité des sommes allouées chaque année à « la justice », de même les processus juridictionnels sont rarement analysés en relation avec le travail réellement fourni. À force « d’ajustements » mal évalués, la qualité des services se dégrade. À partir de là, l’image de la justice en pâtit et la confiance des justiciables diminue. L’indigence des études d’impact, ou leur totale inexistence est une chose assez fréquente en la matière.
Le fait de massifier encore plus le fonctionnement des services et de le « numériser » est-il une solution pérenne ? Personnellement, j’en doute. Il existe actuellement une véritable « pensée magique » en la matière. Le modèle gestionnaire, sous sa forme actuelle montre cruellement ses limites. La numérisation d’une procédure ne diminue en rien le temps nécessaire pour en prendre connaissance et l’apprécier. Ce n’est pas parce que les « piles de dossiers » ne sont plus entreposées dans les couloirs que les conflits qu’ils traduisent s’évanouissent miraculeusement. Ce n’est pas parce qu’on a déployé le logiciel « Cassiopée » qu’il se produit moins de faits criminels dans les ressorts d’un pays dont la population continue à augmenter. Même pour décider de la pertinence d’une « orientation algorithmique » d’une procédure il sera nécessaire de faire intervenir un libre arbitre humain. Mais au lieu d’apprécier la situation concrète, le juge du futur sera peut-être appelé à évaluer la pertinence de l’analyse délivrée par un algorithme. Est-ce cela le progrès qu’il conviendrait de souhaiter ? Chacun appréciera.
LPA
Va-t-on vers une justice à deux vitesses avec des contentieux de masse traités par des automates et quelques contentieux rares restant de la compétence des juges ?
E. P.
Je crains que l’on ne se dirige pas vers une « justice à deux vitesses », mais vers une « justice sans jugements » et des « jugements sans travail ». La tendance à la « barémisation » des contentieux n’est pas liée au déploiement des nouvelles technologies, mais à une volonté politique d’évacuer la conflictualité juridictionnelle des rapports de droit. Cette volonté, validée par le Conseil constitutionnel en France, est aujourd’hui très présente dans le débat public. Elle connaît cependant des oppositions, par exemple en matière de justice prud’homale. La notion de « contentieux rares » est souvent utilisée pour justifier la nécessaire « simplification » des autres contentieux, mais il est difficile de croire que les contentieux ainsi « regroupés » ne finissent pas par être banalisés eux aussi, ou renvoyés à des modes alternatifs de règlement des litiges régulièrement présentés comme moins coûteux, plus efficaces, plus modernes et enfin en réalité plus légitimes. La controverse n’oppose pas en réalité deux formes de justice, mais une justice qui tend mécaniquement à devenir « non-juridictionnelle ». Le fantasme d’un passage du « tribunal » en direction d’une « plate-forme » ou d’un « service transactionnel » est très attractif. Si ces tendances se déploient effectivement l’avenir de la justice sera à rechercher dans le modèle de l’arbitrage. La vraie question qui se posera sera la gestion de l’inégalité des acteurs intervenant à ces relations contractuelles de résolution des conflits. Arbitrer entre Dupont et Google pourra n’être pas compliqué pour Google, mais ne sera peut-être pas simple pour Dupont…
LPA
Ces innovations interrogent sur la place de l’humain. Par exemple, la généralisation de la visioconférence inquiète les avocats. Qu’en pensez-vous ?
E. P.
Cette technique est une atteinte potentielle aux droits des justiciables lorsque tout se passe bien, et une atteinte indéniable lorsque la visioconférence dysfonctionne. Récemment, le Conseil d’État a annulé une ordonnance de référé précédé d’un débat tenu à distance pour lequel les conditions de communication avaient été mauvaises. Une telle rigueur mériterait d’être analysée au regard des standards mis en œuvre dans les juridictions judiciaires. Il est logique que les avocats se plaignent car ce sont les facultés de défense de leurs clients qui sont en cause. Plusieurs ouvrages publiés sur ce sujet, et deux thèses de doctorat d’État, dont une primée par l’École nationale de la magistrature en 2017 a d’ailleurs mis en œuvre une approche très critique de l’éloignement du juge et du justiciable à l’œuvre dans la visioconférence. Je ne peux que souscrire à ces analyses dont la valeur intellectuelle a été reconnue.
LPA
En tant que magistrat, voyez-vous des applications intéressantes pour la justice qui pourrait la servir sans changer sa nature ?
E. P.
Pour n’envisager que deux exemples un service de visioconférence qui fonctionne peut être un outil tout à fait utile, notamment pour tenir des réunions administratives qui « mangent » du temps de transport de magistrats, sans parler des économies potentielles en termes de frais de déplacement. Elle pourrait aussi être déployée massivement pour assurer des formations professionnelles « rares » ou le nombre de participants est limité par la taille des salles de cours où les emplois du temps. Mais c’est le choix du déploiement juridictionnel qui a été fait et qui continue de l’être. De même qui n’apprécierait pas des services d’indexation des pièces d’une procédure qui puisse être susceptible de faciliter l’appréhension d’un dossier et mettre par exemple en évidence des rapprochements entre acteurs d’un procès criminel, ou entre les argumentations d’un procès civil complexe ? Si les « legaltech » étaient orientées vers ces questions très « basiques » et construites à partir du travail juridictionnel et non en concurrence avec lui, les professionnels applaudiraient à leur déploiement des deux mains. Mais à plusieurs reprises il a été constaté que le déploiement de certains outils amenait à « recalibrer » les services judiciaires en fonction des outils au lieu de faire l’inverse, induisant ainsi des charges de travail supplémentaires pour les personnels ! Cette absence de dimension « pratique » du déploiement de certaines technologies contribue d’ailleurs à faire en sorte que les agents ne s’y intéressent pas réellement, si ce n’est pour tenter de les contourner, et que « l’innovation issue du terrain » ne soit finalement pas possible.
LPA
Aux termes de vos recherches pensez-vous qu’il faille craindre ces évolutions techniques ? Sont-elles de nature à modifier la nature de la justice ?
E. P.
La fonction juridictionnelle est toujours étroitement reliée aux structures politiques dans lesquelles elle se déploie. L’administration judiciaire est très centralisée en France, très décentralisée en Suisse. Ce ne sont pas les évolutions techniques qui sont, selon moi, le plus à craindre, que les postulats idéologiques et politiques qui sous-tendent et promeuvent de telles évolutions. Or les structures de représentation en France sont actuellement l’objet de critiques et de préconisations d’évolution très fortes. « La justice » fonction de l’État apparaît ainsi elle aussi marquée par une forme de crise de l’État et notamment une crise de légitimité. Si l’État est au final prêt à « concéder » massivement la fonction juridictionnelle à d’autres acteurs que lui-même, parce que cette forme de souveraineté directe est « trop coûteuse », on ne peut pas reprocher à ces acteurs de tenter d’exploiter une telle philosophie. Ce qui se joue à travers les évolutions technologiques c’est de mon point de vue la mise en lumière d’une crise de la souveraineté politique dans les relations que l’État entretient avec le « peuple français » au nom duquel la justice est rendue et dont la mention figure dans chacune de ses décisions.