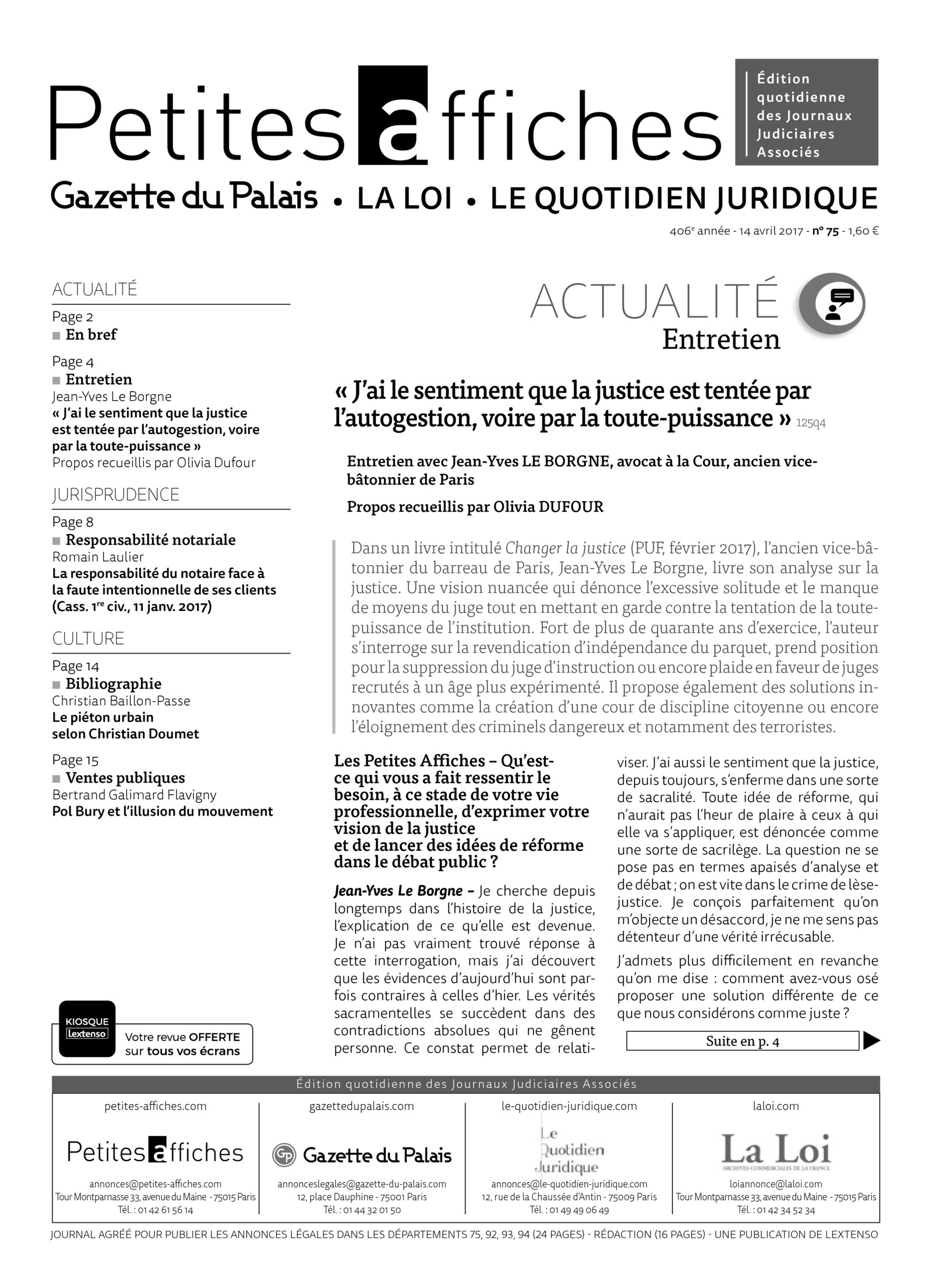« J’ai le sentiment que la justice est tentée par l’autogestion, voire par la toute-puissance »
Dans un livre intitulé Changer la justice (PUF, février 2017), l’ancien vice-bâtonnier du barreau de Paris, Jean-Yves Le Borgne, livre son analyse sur la justice. Une vision nuancée qui dénonce l’excessive solitude et le manque de moyens du juge tout en mettant en garde contre la tentation de la toute-puissance de l’institution. Fort de plus de quarante ans d’exercice, l’auteur s’interroge sur la revendication d’indépendance du parquet, prend position pour la suppression du juge d’instruction ou encore plaide en faveur de juges recrutés à un âge plus expérimenté. Il propose également des solutions innovantes comme la création d’une cour de discipline citoyenne ou encore l’éloignement des criminels dangereux et notamment des terroristes.
Les Petites Affiches – Qu’est-ce qui vous a fait ressentir le besoin, à ce stade de votre vie professionnelle, d’exprimer votre vision de la justice et de lancer des idées de réforme dans le débat public ?
Jean-Yves Le Borgne – Je cherche depuis longtemps dans l’histoire de la justice, l’explication de ce qu’elle est devenue. Je n’ai pas vraiment trouvé réponse à cette interrogation, mais j’ai découvert que les évidences d’aujourd’hui sont parfois contraires à celles d’hier. Les vérités sacramentelles se succèdent dans des contradictions absolues qui ne gênent personne. Ce constat permet de relativiser. J’ai aussi le sentiment que la justice, depuis toujours, s’enferme dans une sorte de sacralité. Toute idée de réforme, qui n’aurait pas l’heur de plaire à ceux à qui elle va s’appliquer, est dénoncée comme une sorte de sacrilège. La question ne se pose pas en termes apaisés d’analyse et de débat ; on est vite dans le crime de lèse-justice. Je conçois parfaitement qu’on m’objecte un désaccord, je ne me sens pas détenteur d’une vérité irrécusable.
J’admets plus difficilement en revanche qu’on me dise : comment avez-vous osé proposer une solution différente de ce que nous considérons comme juste ? Les gens de justice, toutes professions confondues, se sentent ou se rêvent propriétaires de l’institution dans laquelle ils exercent et tout regard nouveau, toute analyse un peu audacieuse, toute tentative de changement de l’institution même au stade platonique de la simple réflexion, apparaît comme une entreprise scandaleuse. J’ai le sentiment que la justice est tentée par l’autogestion, voire par la toute-puissance.
LPA – Cela renvoie à la question de savoir si la justice doit demeurer une autorité ou devenir un pouvoir. Vous trouvez dans Montesquieu des éléments pour dire que ce n’est pas un pouvoir…
J.-Y. L. B. – Depuis bien des décennies on enseigne que Montesquieu a fondé la théorie des trois pouvoirs, ce n’est pas tout à fait exact. Montesquieu ne parle pas de pouvoir judiciaire ! Il décrit le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, et il évoque par ailleurs « la puissance de juger ». C’est vrai qu’il y a une puissance de juger, mais est-elle l’équivalent des pouvoirs politiques ? Non seulement je ne le crois pas, mais je pense que ce n’est pas souhaitable. Aujourd’hui, l’une des revendications de certains magistrats est précisément d’exercer un pouvoir politique à l’occasion de la mission de régulation sociale qui leur a été confiée par l’État.
LPA – C’est aussi la société qui réclame à la justice de se substituer aux autres pouvoirs défaillants…
J.-Y. L. B. – C’est vrai, mais je perçois une fascination des juges pour le pouvoir. De tout temps, la jurisprudence a été l’occasion de faire dire à la loi un peu plus ou un peu moins que ce qu’elle ordonnait, mais aujourd’hui l’affaiblissement de l’autorité morale du monde politique a conduit à une revalorisation de l’autorité de la justice qui fait naître de nouveaux appétits. L’idée de l’équité – notion politique par nature – légitime les cas de jurisprudence contra legem. Un exemple en a été donné avec les longues polémiques sur la prescription, réinventée par les juges au mépris des dispositions légales et finalement entérinée par le politique, qui ainsi s’incline devant la puissante alliance de l’opinion et du judiciaire. Je parle bien sûr du report du point de départ de la prescription en cas d’infraction dissimulée. Ce mouvement était tout simplement un refus d’appliquer les règles de prescription du droit positif. Le législateur a fini par se soumettre, révélant cependant au passage qu’avant qu’il ne la valide, cette interprétation était contraire à la lettre de la loi. Cette volonté de puissance se marque aussi dans les poursuites exercées contre les politiques. Je ne prétends pas qu’elles soient toujours sans fondement, mais il arrive qu’elles aboutissent à des mises hors de cause, après des années de procédure et de soupçon. Or la simple mise en cause est en soi une disqualification. Qui peut imaginer que les magistrats n’ont pas conscience de l’effet politiquement destructeur de la poursuite ?
LPA – En réalité, la justice est pauvre, comment prétendre qu’elle domine le politique alors qu’elle en dépend ?
J.-Y. L. B. – Que la justice soit pauvre, c’est vrai. Que les politiques au fil des décennies aient peut-être jugé opportun de limiter ses moyens d’action, on ne peut ni l’affirmer ni l’exclure. Cela étant, on ne saurait soutenir que l’insuffisance des moyens matériels de la justice a réussi à paralyser son action. Il y a des difficultés matérielles graves qui affectent le traitement des contentieux quotidiens, c’est indéniable, mais cette indigence n’a pas pour autant engendré une impuissance politique.
LPA – Vous vous dites opposé au syndicalisme dans la magistrature. Pas celui qui consiste à réclamer plus de moyens pour la justice mais celui par exemple qui s’exprime dans le fameux « mur des cons »…
J.-Y. L. B. – On ne peut ignorer la dimension politique de la tradition syndicale française. L’expression est connue qui fait du syndicat la courroie de transmission du parti. Or l’esprit de parti n’est pas compatible avec la fonction de magistrat. Je sais bien que certains affirment qu’ils savent dresser un mur entre leurs convictions de militant et leur mission judiciaire. Je veux bien croire à la sincérité de cette affirmation ; je suis moins sûr que cette louable intention corresponde à une réalité. L’objectivité absolue, on le sait, est un mythe. Mais ce n’est pas parce que l’objectivité ne peut être atteinte que l’on peut revendiquer le droit d’être partisan.
LPA – Vous estimez que les juges devraient être recrutés beaucoup plus tard dans la vie professionnelle…
J.-Y. L. B. – En effet. D’abord, pour une raison toute simple et évidente : l’expérience de la vie. On rencontre de jeunes juges de 25 ans ; ils sont souvent brillants, mais la qualité intellectuelle n’est pas tout. Si intelligent qu’on soit, juger les autres à 25 ans, c’est pour le moins étrange. On pourrait articuler la même critique envers l’accusation ou la défense, mais ce ne sont l’une et l’autre que des forces de proposition. Qu’un jeune procureur requiert dans un sens inopportun ce n’est pas grave, le juge est là pour rétablir une juste vision des choses. De la même façon, la défense hasardeuse ou franchement défaillante d’un avocat n’est pas une catastrophe, le juge est là pour suppléer ces carences. Mais l’insuffisance du juge conduit à une irrémédiable catastrophe… Il faut une expérience. Il faut aussi mesurer sa propre capacité à s’inscrire dans la neutralité qu’exige la fonction de juger. À 40 ans, on se connaît mieux qu’à 25 ! On sait si l’on est capable d’une vision détachée du monde ou si cette équanimité sera un effort insurmontable. Je suis également partisan de deux corps distincts de magistrats. D’ailleurs, ils le sont historiquement. Les membres du parquet étaient à l’origine les avocats du roi qui se tenaient sur ce petit morceau du prétoire qu’on appelait le parquet ; ils ne faisaient pas partie de la juridiction. Peu à peu, au-delà des intérêts de la couronne, on leur a confié la défense de l’ordre public ; ils se sont alors installés à demeure dans les juridictions au point de s’assimiler aux juges. C’est une erreur, presque une usurpation.
LPA – La nécessité d’instituer l’indépendance du parquet fait l’objet actuellement d’un large consensus. Vous êtes contre, pourquoi ?
J.-Y. L. B. – Nombreux en effet sont ceux qui la réclament à cor et à cri. Je m’interroge sur leurs motivations profondes. Est-ce le souhait d’un meilleur équilibre au sein de la justice ? Est-ce l’effet de la volonté de puissance de ceux qui la revendiquent ? Est-ce parce que le lien avec le politique serait vécu comme une absolue abomination dont il faudrait se libérer ? La force du parquet et sa légitimité trouvent leur source dans la mission que lui confie l’État. Si l’on coupe le lien entre le parquet et l’exécutif, d’où le parquet tiendra-t-il sa légitimité ? Faudra-t-il envisager une élection ? Je suis opposé à l’élection des magistrats. Pour être élu, il faut plaire et pour plaire il faut dire que l’on pense ce que la majorité pense. Or la vraie indépendance, surtout pour les magistrats, consiste souvent à se démarquer de la pensée dominante.
LPA – Comment recruter ces juges quadragénaires ?
J.-Y. L. B. – On est habitué aujourd’hui à passer des concours à 22 ans ou à peu près. Pourquoi ne soumettrait-on pas à concours, des gens de 40 ans, pour apprécier leur connaissance du droit et leur capacité à devenir juges ? Évidemment, il y a un obstacle. Dans le monde anglo-saxon, devenir juge c’est un couronnement de carrière. En France, il faudrait améliorer substantiellement la rémunération des juges pour que l’apothéose ne coïncide pas avec la gêne. Mais sur un corps de 8 000 personnes, un substantiel effort de revalorisation des traitements ne représente pas un coût insupportable pour la collectivité.
LPA – On estime actuellement à 1 500 le nombre de juges qu’il faudrait recruter pour que l’institution judiciaire puisse fonctionner normalement. Vous pensez au contraire qu’il faut en réduire le nombre. Pourquoi ?
J.-Y. L. B. – En France on a pris l’habitude, quand quelque chose ne marche pas bien, de conclure à un défaut de moyens. Tout semble soluble dans une problématique du quantitatif : il suffira d’augmenter les budgets et tout ira mieux. S’agissant de l’institution judiciaire, les crédits augmentent régulièrement sans amélioration perceptible. C’est peut-être le signe qu’il faut réfléchir à modifier l’organisation en profondeur. Cela implique de développer une autre conception du juge. Nous avons des hommes et des femmes de très haut niveau qui travaillent seuls et doivent assumer bien des tâches qui ne sont pas de leur niveau. C’est à la fois humiliant pour les personnes et absurde en termes de gestion des ressources humaines. Le juge doit devenir un chef d’équipe, entouré de collaborateurs qui prépareront des solutions juridictionnelles que le juge approuvera ou rejettera. Mais il faudra veiller à ce que les assistants ne restent pas trop longtemps pour ne pas créer une sous-catégorie de magistrats, ni remettre la décision à un autre qu’au juge en raison de la confiance qu’instituerait une trop longue collaboration au sein d’un même cabinet.
LPA – Vous défendez également dans votre livre la suppression du juge d’instruction ?
J.-Y. L. B. – Il ne reste plus qu’un dernier argument à ceux qui veulent sauver cette institution paradoxale : le juge d’instruction serait le seul recours du justiciable, via la plainte avec constitution de partie civile, si un parquet aux ordres du pouvoir décidait d’étouffer une affaire. Il faut retenir cette objection, mais le juge de l’instruction y répondrait sans difficulté. Il reste que le travail de juge d’instruction n’est pas un travail de juge, mais d’enquêteur, d’organe de poursuite, de procureur. Je ne dis pas qu’il est partial, mais il est rendu partial par sa fonction qui fait de lui un amoureux de l’explication, c’est-à-dire de la culpabilité. Un juge ça décide, ça ne soupçonne pas.
LPA – Parmi les innovations évoquées dans votre livre, vous prônez l’introduction, dans les formations de jugement, de personnes issues de l’univers qu’elles sont appelées à juger. N’est-ce pas dérangeant au regard des principes républicains de créer ce type de tribunaux « sur-mesure » ?
J.-Y. L. B. – Je pense que les juges ne connaissent pas nécessairement tous les milieux socio-professionnels. Il y a déjà des juges de proximité, c’est-à-dire des citoyens, dans les tribunaux correctionnels. On pourrait imaginer adapter le profil de ces citoyens-juges à celui des justiciables que l’on juge. Qu’est-ce qu’un chef d’entreprise ? À quelle pression est-il soumis ? Dans quelle mesure peut-on lui reprocher de ne pas avoir vu certaines choses ? C’est un autre dirigeant qui peut le dire. Montesquieu pensait que, pour que celui qui est poursuivi ait le sentiment que ceux qui le jugent n’éprouvent pas d’animosité à son endroit, il fallait qu’il soit jugé par ses pairs. C’est d’ailleurs l’idée qui justifie le jury populaire en cour d’assises. Il ne s’agit pas de rompre l’égalité républicaine, mais de renforcer la connaissance par le juge du terrain socio psychologique de celui qui comparaît. Cela peut être favorable à la personne jugée, mais aussi la desservir si précisément celui qui connaît le terrain explique au juge que les arguments de la défense ne correspondent pas à son expérience du contexte.
LPA – Autre idée nouvelle, celle de créer une cour de discipline citoyenne. De quoi s’agit-il ?
J.-Y. L. B. – Il existe un certain nombre de comportements individuels qui ne sont pas dignes d’éloge mais qui, pour autant, ne nécessitent pas une condamnation pénale. Mais, faute de disposer d’une autre sanction que celle du Code pénal, il arrive que l’on force la qualification pour mettre en marche la justice pénale et obtenir une punition. Pourquoi ne pas imaginer des réponses qui ne soient pas pénales ? C’est l’idée de cette cour de discipline qui pourrait par exemple prononcer des blâmes et classer l’affaire sous réserve de réparation des dommages éventuellement causés.
LPA – S’agissant des peines, vous prônez l’éloignement des criminels dangereux, qu’en est-il exactement ?
J.-Y. L. B. – Il fut une époque où la prison n’était qu’un passage dans l’attente de la peine réelle puis, à mesure qu’on renonçait à la torture et aux châtiments corporels – sous réserve du maintien de la peine de mort – elle est devenue la peine principale. Je pense que la prison est quelque chose d’effroyable et de destructeur des individus. Mais le poids de l’habitude nous en cache l’horreur. Nous savons aussi que certains criminels ne peuvent être libérés, même en fin de peine, sans un danger considérable pour la sécurité publique. Il y a les terroristes que la prison n’aura pas nécessairement libérés de leur aliénation idéologique, mais aussi les personnes atteintes de pathologies psychiatriques, celles dont le discernement n’aura, par définition, pas été aboli, mais dont l’état et les passages à l’acte font craindre qu’ils ne réitèrent de graves actes criminels. Comme il n’est pas concevable qu’une personne qui a fini sa peine soit maintenue en prison, on pourrait envisager de réfléchir sur une mise à l’écart dans un lieu vaste et clos, mais offrant, fût-ce de manière restreinte, la liberté d’aller et venir et de mener une vie quasi normale.
LPA – Cela nous amène au sens de la peine…
J.-Y. L. B. – Je m’interroge depuis longtemps sur le sens de la peine. La peine-rétribution, issue de la tradition chrétienne de la pénitence, n’a plus grand sens aujourd’hui. En revanche, la peine protectrice de la société, face à un personnage dangereux, me paraît essentielle. Il y a des fautes pénales uniques et isolées. À l’égard de cette criminalité accidentelle, je serais tenté de reprendre une idée provocatrice de Michel Foucault qui disait à peu près : si l’on était sûr que la personne ne va pas recommencer, il suffirait de faire croire aux autres qu’elle a été condamnée. Je veux dire par là qu’il y a deux cas extrêmes : les êtres que la prison n’amendera jamais et ceux qui sont réinsérés, ou plutôt réinsérables, avant même d’y entrer. Pour ces deux catégories, la peine n’a pas de sens. On entend dire de plus en plus souvent, notamment par les politiques, que la peine prononcée doit être effective. C’est ignorer qu’il y a une peine presque théorique, en tout cas symbolique, prononcée par le tribunal et ensuite une peine réelle, aménagée par un juge qui est en mesure de l’adapter à la personne concernée. L’individualisation de la peine est au cœur de notre système pénal, mais elle ne peut être que limitée dans un jugement. Il faut donc maintenir cette différence. Il faut aussi développer les mesures alternatives à la prison. Enfin, pour les jeunes – j’entends par jeune toute personne, même au-delà de 20 ans, qu’on peut raisonnablement espérer sortir de la délinquance – il faut mettre en place des lieux de scolarisation plus proches du pensionnat, même à discipline forte, que de la prison. En milieu carcéral, on apprend le crime, on se fait des relations qu’il vaudrait mieux ne pas avoir et on finit par sortir avec cet étrange brevet de marginalité qu’est le bulletin de levée d’écrou. Il faut inventer d’autres solutions.