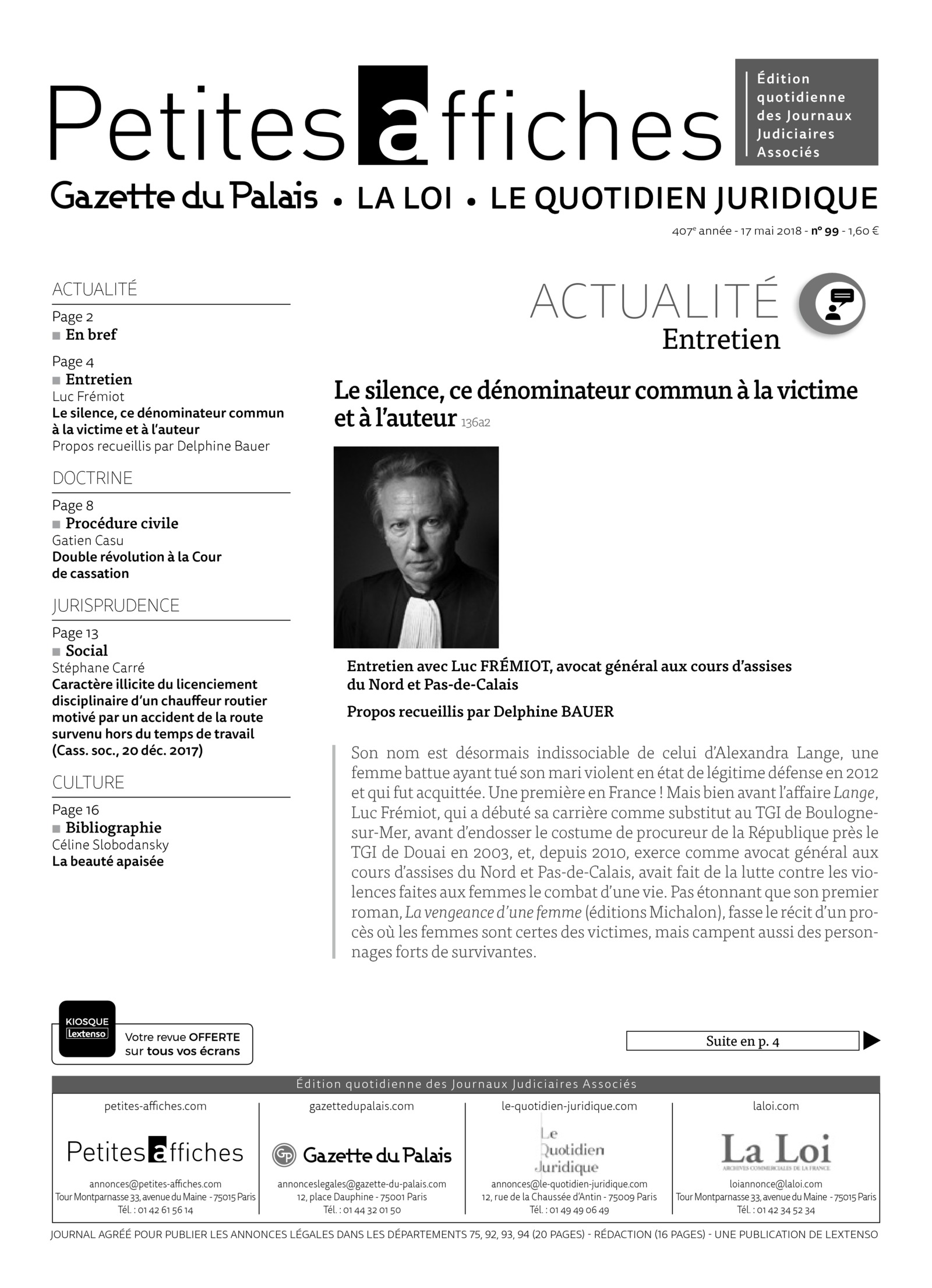Le silence, ce dénominateur commun à la victime et à l’auteur
Son nom est désormais indissociable de celui d’Alexandra Lange, une femme battue ayant tué son mari violent en état de légitime défense en 2012 et qui fut acquittée. Une première en France ! Mais bien avant l’affaire Lange, Luc Frémiot, qui a débuté sa carrière comme substitut au TGI de Boulogne-sur-Mer, avant d’endosser le costume de procureur de la République près le TGI de Douai en 2003, et, depuis 2010, exerce comme avocat général aux cours d’assises du Nord et Pas-de-Calais, avait fait de la lutte contre les violences faites aux femmes le combat d’une vie. Pas étonnant que son premier roman, La vengeance d’une femme (éditions Michalon), fasse le récit d’un procès où les femmes sont certes des victimes, mais campent aussi des personnages forts de survivantes.
Les Petites Affiches
Après une carrière de magistrat, qu’est-ce qui vous a décidé à écrire ce roman : La vengeance d’une femme, qui retrace une affaire criminelle, du passage à l’acte au procès ?
Luc Frémiot
J’ai toujours aimé écrire. Mais si j’ai décidé d’écrire ce roman c’est parce que cela correspondait vraiment à une inspiration que j’avais eue, notamment en rencontrant les personnages de cette affaire. Le roman, c’est quelque chose d’extraordinaire, parce que l’on part d’une réalité, puis la fiction prend le pas, les personnages évoluent, vous échappent, et cela devient assez prenant. La réalité constituait donc une trame, mais j’ai évidemment profondément modifié à la fois les personnalités, en fonction de mon ressenti, de ma sensibilité, de mon imagination, et certains aspects du dossier. Ce type d’affaires, je les vis journellement, puisque je ne fais plus que de la cour d’assises, je ne traite que d’affaires criminelles, et je peux vous dire qu’il y en a qui vous marquent. Il y a des choses que vous ramenez avec vous, il y a des silences, des expressions, y a des photos qui reviennent. Cette réalité que l’on décrit chaque jour est un roman du quotidien. Après il ne reste plus qu’à trouver des mots.
LPA
Que peut-on dire du rapport qu’entretient une victime avec la vengeance ?
L.F.
Je suis quelqu’un qui n’est jamais dans la distance. J’essaie d’être auprès des affaires, auprès des victimes, notamment. Cette affaire-là m’a fasciné car cette jeune femme, Lila (le personnage principal, NDLA) est un personnage de tragédie. On a d’ailleurs tous les éléments de la tragédie grecque : la violence, le silence, la haine, la vengeance. De plus, elle était enfermée dans un silence qui correspond à la situation dans laquelle se retrouvent les femmes qui font l’objet de violences, d’agressions sexuelles ou de viols. Elles sont dans l’incapacité de communiquer. Mais Lila en a fait une force. Pour elle, en tant que victime, la vengeance est légitime. C’est quelque chose qu’on ne peut pas mépriser, qu’on ne peut pas rejeter. Ensuite, c’est à la société de transposer cette vengeance pour arriver à une décision de justice. Mais la vengeance elle-même est quelque chose de très humain, et d’assez fascinant. Car dans le cas de cette jeune femme, c’est une vengeance qui est lente, qui mûrit, d’années en années, jusqu’à cette ébauche de tentative d’assassinat.
LPA
Pouvez-vous revenir sur le silence, réaction que vous développez longuement dans votre roman ?
L.F.
Cette vengeance, c’est sa libération. J’ai beaucoup développé sur le choc des silences respectifs. D’abord, celui de cette jeune femme qui refuse de livrer son intimité, ce qu’elle a subi, à des tiers, des enquêteurs, des avocats, des magistrats, des jurés, et puis, le silence de l’auteur, muré dans un silence absolu, dans la mesure où, s’il commence à exprimer des soupçons sur l’auteur, on va peut-être remonter jusqu’à lui. Et ces silences-là, on les retrouve dans toutes les affaires de violences : lorsqu’une femme est battue ou est l’objet de violences sexuelles, elle est dans un silence qui est à la fois du déni car elle ne peut pas supporter ce qu’elle a subi, l’idée qu’elle s’est trompée sur son père, son amant, son compagnon, et le silence de l’auteur, également dans un déni absolu car il ne se reconnaît pas comme violent. Et c’est un dénominateur commun, un tronc commun ce silence. C’est là aussi le thème de ce livre qui pose la question de savoir : est-ce qu’on arrivera à briser ce silence, pour arriver à un processus qui transformera une vengeance en décision de justice ?
LPA
Les deux personnages de femmes — la victime Lila et la commissaire Lydie Legendre — ont vécu des traumatismes d’enfance communs…
L.F.
Pour la commissaire Legendre, la libération de Lila, c’est la sienne d’une certaine manière. Car quand elle s’obstine dans cette enquête, ou lorsque pendant la garde à vue, elle pousse Lila à s’exprimer, c’est ce qu’elle n’a pas eu le courage de faire. Et d’une certaine manière, ce que fait Lila, c’est la libérer elle-même.
LPA
Votre façon de décrire la vie au commissariat est très cinématographique, orale, enlevée. Pourquoi ?
L.F.
J’ai voulu plonger le lecteur au cœur des différents protagonistes de cette affaire. Souvent dans les séries ou dans certains romans policiers, la phase de l’enquête est aseptisée. Moi ce qui m’intéresse, c’est la psychologie. C’est de rentrer dans la psychologie des gens, de montrer que les gens qui exercent comme enquêteurs, un métier difficile, ont également une vie à côté, avec leurs soucis, leurs qualités, qui apparaissent dans leur façon de travailler. Je crois que j’ai voulu mettre chaque lecteur au cœur de l’humain. C’est facile de faire pleurer les gens sur des tragédies contemporaines, mais si l’on ne prend pas la peine de les faire rentrer dans la psychologie de chacun, l’on passe à côté. Et l’enquête, c’est comme ça que ça se passe, avec ce genre de dialogues, où surviennent des oppositions de stratégie entre les enquêteurs qui ne sont pas les mêmes en raison de leur sensibilité, de leur passé. À ce titre, le personnage du vieux flic, de l’ancienne génération, a des comportements odieux, mais d’une certaine façon, il est d’une redoutable efficacité. Cette vie, qui est derrière, est fascinante. Je ne tiens pas l’humain à distance. Quand je suis à l’audience, je parle aux gens, aux victimes, aux accusés, j’instaure un dialogue avec eux dans mes réquisitoires, j’explique les choses. Je pense que la communication est extrêmement importante, qu’elle soit orale ou écrite. C’est à cela que je m’attache. Finalement, je parle comme j’écris et j’écris comme je parle.
LPA
Pourquoi un tel engagement contre les violences faites aux femmes ?
L.F.
D’abord, il y a une question de caractère. Je suis quelqu’un qui déteste tous les comportements machistes, je suis révolté par tout cela. J’ai d’ailleurs une meilleure communication avec les hommes qu’avec les femmes. Je suis aussi proche de la douleur, du drame. Quand j’étais jeune magistrat il m’est arrivé de vivre des situations que je n’ai jamais oubliées. Je me rappelle d’une fois où j’étais en poste à Boulogne-sur-Mer. J’ai été réveillé un matin très tôt, je suis arrivé dans un petit café de campagne, dans la brume, c’était en automne. Il y avait une salle de café, très sombre, une vieille dame qui pleurait dans cette salle. On traversait la salle, et il y avait l’habitation privée qui était là. On poussait la porte, et là, il y avait le corps d’une femme qui venait d’être abattue par son compagnon, d’une décharge de chevrotine, car elle voulait le quitter. Elle ne supportait plus ses violences. Alors quand vous entrez de plein-pied dans ce type de situation, c’est très différent que de les lire dans un dossier ou dans les journaux. Parce que vous sentez toute cette vie autour, vous voyez encore le livre ouvert sur la table de nuit, une paire de lunettes, une petite lampe allumée, et puis on se dit que c’est tellement injuste, tellement terrible qu’on se dit qu’on aimerait rattraper tout ça. Ça fait réfléchir. Et lorsque je voyais que d’une façon générale, on classait les affaires de violences d’une manière presque systématique tant qu’il n’y avait pas des certificats médicaux à rallonge, forcément lorsque j’ai été nommé procureur de la République, je me suis dit que j’allais essayer de faire changer tout cela. D’autant plus que lorsqu’on travaille sur ce genre de choses, on travaille pour l’avenir. Il ne faut pas oublier qu’il y a des enfants qui sont là, que les enfants sont à la fois des témoins, des victimes, et des otages, bien souvent, car ils se retrouvent au cœur de conflits de loyauté par rapport à leurs parents. On sait qu’il y a : un tiers des enfants qui seront de futurs auteurs, un tiers des victimes et un tiers résilients. J’ai donc voulu mener une vraie politique pénale, parce que je trouve aussi que le rôle du magistrat, c’est ça. Je suis contre cet aspect « fonctionnaire » qu’on retrouve parfois dans ce métier, où les gens se contentent de traiter les affaires qu’on leur apporte. Moi j’ai voulu changer les choses, j’ai voulu mener une politique, donner des instructions aux services de police et de gendarmerie, pour orienter les choses de manière à avoir une action, et ça a fonctionné.
LPA
Justement, quid de la formation des services de police à mieux recueillir la parole des victimes, un écueil qui est souvent formulé ?
L.F.
La formation existe. J’ai d’ailleurs organisé à l’École nationale de la magistrature — notamment en formation continue — des cessions de formation pour les magistrats, qui existent toujours aujourd’hui. Il y en a aussi dans la police et la gendarmerie. Ce qu’il faut savoir c’est que les cadres de la police et de la gendarmerie sont parfaitement au fait de la question : le problème, et c’est toujours pareil, ce sont les gens sur le terrain, qui n’ont pas forcément la psychologie ou le goût pour le faire, et puis il y a toujours ces vieux relents, dans notre société, qui est encore très patriarcale, très machiste, toujours des arrière-pensées. Chez les magistrats, les arrière-pensées, c’est la peur de se faire manipuler, avec cette idée que le couple est un sanctuaire dans lequel il ne faut pas mettre les pieds, et chez d’autres, l’idée qu’une femme habillée de façon sexy, l’a forcément « cherché ». C’est contre tout cela que je me bats. J’ai mené une lutte sur le plan juridique, qui m’a permis d’obtenir des lois qui n’existaient pas en 2003, car j’ai pu accéder à l’Assemblée nationale, au Sénat, j’ai été relayé par les médias. Mais j’essaie aussi de faire passer un message, celui de faire comprendre aux autres que l’on a tous un rôle à jouer : parce que l’on voit, qu’on écoute, et que l’on se rend compte devant les cours d’assises que l’on est face à des témoins qui sont sourds, muets et aveugles. C’est un sujet de société, c’est forcément quelque chose dans lequel on doit s’engager complètement.
LPA
Quelles avancées avez-vous initiées ? Quelles sont les pistes pour réduire ces violences ou mieux les prendre en charge ?
L.F.
Aujourd’hui, il y a une circulaire de la Chancellerie, qui préconise ce dispositif (celui d’exclure les hommes auteurs de violences de leur domicile, NDLA) qui était le mien. Mais vous avez encore malheureusement des magistrats qui ne le font pas. À mes yeux, le deuxième volet de ma politique, extrêmement important, est de s’occuper des auteurs de violence. Car si on ne s’en occupe pas, on les renvoie devant un tribunal. Ils sont condamnés et ils recommencent. Si l’on ne travaille pas sur les causes, ça ne changera jamais. Donc je milite depuis des années pour qu’au lieu d’abonder les centres d’accueil pour les victimes, qui devraient pouvoir rester chez elles, on mette un peu d’argent pour les centres d’accueil pour les auteurs de violence. Il existe aujourd’hui des stages de responsabilisation, dont ceux que j’avais mis en place avec des psychiatres et des psychologues formés au Québec, qui permettent d’avoir de bons résultats, en les amenant à réfléchir sur les modalités de leur passage à l’acte, c’est-à-dire pourquoi ils en sont arrivés là. Le but n’est pas d’éradiquer la violence — on est tous violents, à notre façon, chacun notre tour et heureusement on se maîtrise — mais de faire comprendre à ces gens-là dans quelles conditions ils deviennent violents, le plus souvent pour un motif dérisoire ! Quand on réussit à leur faire prendre conscience de cela, on arrive à travailler ! Bien sûr, cela concerne une partie de ces auteurs de violence seulement, cela ne concerne pas les individus qui sont viscéralement violents, les brutes, contre lesquelles on n’a pas de moyens particuliers. Sauf que si on les avait pris aux débuts, peut-être qu’on aurait pu faire quelque chose. C’est pour ça aussi que je dis qu’il faut intervenir dès les premières violences, parce que si on laisse les gens s’enraciner dans ce type de processus, c’est de plus en plus compliqué à gérer.
LPA
Vous dénoncez justement la non-prise au sérieux des premières alertes…
L.F.
C’est ce qui est arrivé à Alexandra Lange (elle a tenté de déposer plainte, sans être prise au sérieux par les services de police, NDLA). Et puis parallèlement à la prise en charge des auteurs, il faut prendre en charge les victimes pour les amener à retrouver leur statut de citoyennes. Il faut les mettre dans des groupes de paroles les unes et les autres, car elles sont tellement isolées… Lorsqu’elles se retrouvent avec d’autres personnes qui ont vécu les mêmes choses, bizarrement leur parole se libère.
LPA
Êtes-vous toujours en contact avec Alexandra Lange ?
L.F.
Je n’ai plus de contact avec elle. L’affaire Alexandra Lange a été pour moi un énorme coup de projecteur sur le sujet, mais je n’avais pas attendu cette affaire pour m’emparer du sujet. La vérité, c’est que quand je vois l’émotion qu’a provoqué cet acquittement, je me dis qu’il y a encore beaucoup de travail à faire. On aurait pu considérer cela comme normal mais ça n’a pas été le cas.
LPA
Pensez-vous que le contexte post-Weinstein soit favorable aux femmes victimes de violences ?
L.F.
Je suis modérément optimiste. Parce que l’opinion fonctionne de façon très étonnante, par à-coups. Lorsqu’il y a eu l’affaire Alexandra Lange, tout le monde s’est réveillé en sursaut. On n’a parlé que de cela, et l’on croyait que c’était vraiment quelque chose qui allait changer tout ce qui s’était passé avant. Bon, ça n’a pas changé grand-chose ! Puis l’opinion publique s’est assoupie à nouveau, et de nouveau, on a assisté à un réveil brutal avec l’affaire Jacqueline Sauvage. Puis cela a tourné à la foire d’empoigne car les syndicats de magistrats ont commencé à s’en mêler, en déplaçant le sujet des violences sur le droit de grâce. Puis il y a eu des débordements terribles, avec un projet de loi sur lequel j’ai exprimé mon opposition, qui consistait à dire qu’il y aurait une présomption de défense différée, c’est-à-dire exactement l’affaire Jacqueline Sauvage. Or l’affaire Sauvage, autant le résultat du jugement — une condamnation à 10 ans — est scandaleux, autant on ne peut pas acquitter une femme qui, le lendemain, va tirer sur son mari d’un coup de fusil dans le dos. Mais on doit tenir compte évidemment de ce qu’elle a subi. Cela méritait 5 ans avec sursis, et rien d’autre ! Et maintenant, avec l’affaire Weinstein, c’est le grand écart. On entend qu’il faut verbaliser les hommes qui sifflent les femmes dans la rue ! Évidemment que c’est mal de siffler une femme, mais moi je préfèrerais qu’on mette l’accent sur cette souffrance au quotidien, dont on ne s’occupe que du bout des lèvres, encore aujourd’hui.
LPA
Vous estimez qu’il n’y a pas assez de dispositifs pour prendre en charge les auteurs et travailler sur la « prévention » ?
L.F.
D’abord, il y a un véritable lobby des centres d’accueil pour femmes. Il y a beaucoup d’argent, et une vraie concurrence entre les foyers et les centres d’accueil. En revanche, ces gens-là pensent que les femmes préfèrent s’en aller du foyer. Ce qui est archi-faux ! Lorsque j’ai mené cette politique (d’exclusion des maris violents, NDLA) à Douai, je peux vous dire que les femmes étaient heureuses de rester chez elles et que partout où cela a été mis en place, cela a toujours bien fonctionné. Il existe une surdité, de la part de tous les gardes des Sceaux depuis Dominique Perben, des ministres de la Parité et des Droits des femmes. Je me rends compte qu’il y n’a rien qui change, comme s’il y avait un pas qu’ils ne veulent pas franchir, alors que c’est logique : si l’on travaille sur les causes, on a des résultats. Le président de la République actuel s’est, pour la première fois, engagé là-dessus. Avant lui, Jean-Pierre Raffarin avait déclaré les violences conjugales « grande cause nationale », en 2003 mais il n’a jamais rien fait. J’ai l’impression que Marlène Schiappa est un peu plus active, mais elle non plus ne s’oriente pas du tout sur des centres d’accueil pour les auteurs de violences. Ça marche à certains endroits, mais ce n’est pas encore généralisé.
LPA
Maintenant que vous avez débuté l’écriture de romans, en avez-vous d’autres en préparation ?
L.F.
Deux autres romans sont prêts. Je suis décidé à me lancer dans l’écriture. C’est une expérience assez fascinante, celle de la liberté. Dans le roman, on est maître des personnages et de l’intrigue et ils finissent par vous échapper. Moi, je les laisse partir. À la limite je deviens presque une plume au service de mes personnages, qui vivent leur vie, et c’est cela que j’adore. C’est un vrai souffle. Je n’aime pas être prisonnier d’un canevas. Je l’ai été trop longtemps, avec le métier que je fais, puisque je suis prisonnier des dossiers qui me sont soumis. Maintenant je m’affranchis de tout cela et je suis dans la liberté de création.