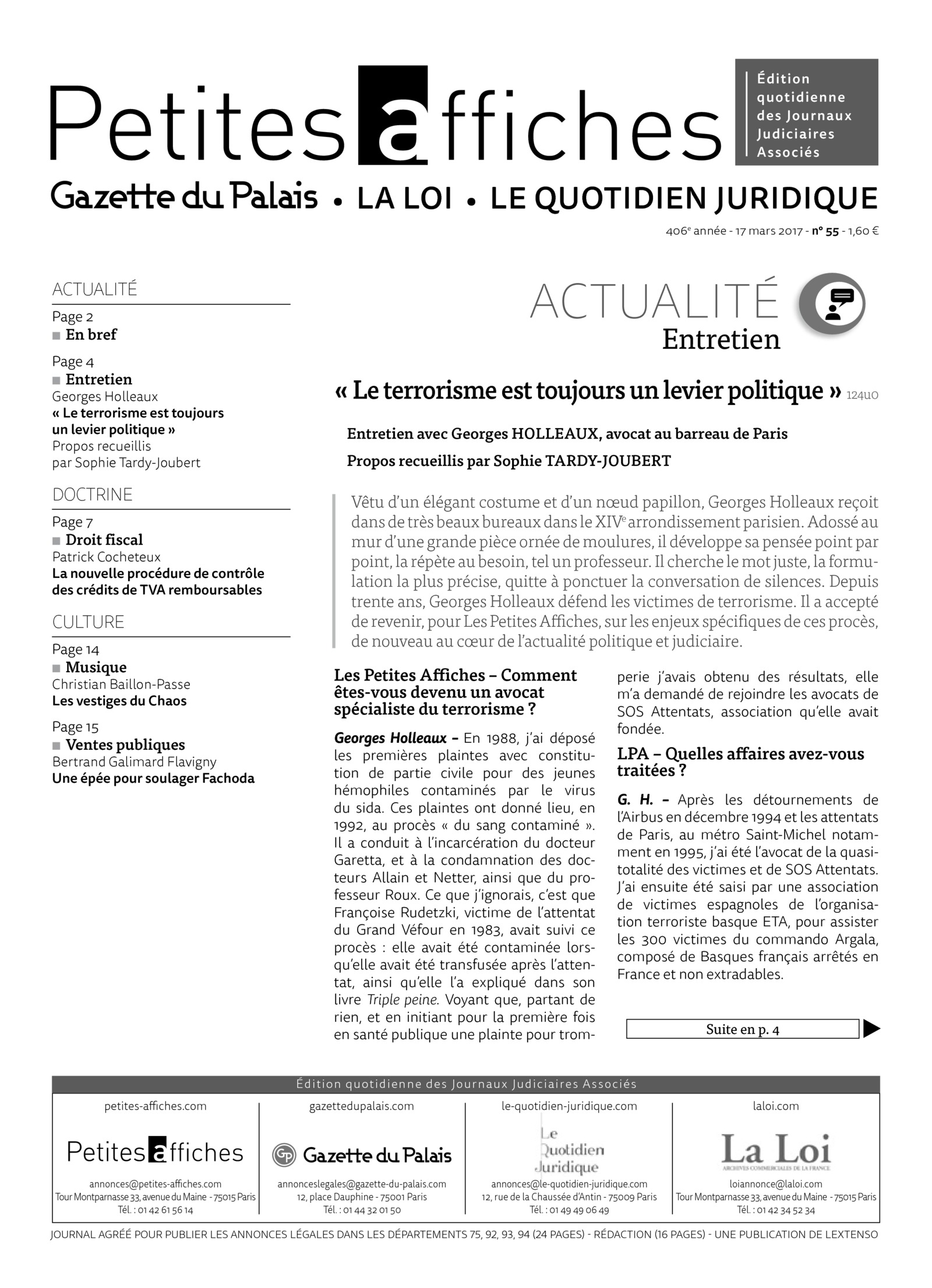« Le terrorisme est toujours un levier politique »
Vêtu d’un élégant costume et d’un nœud papillon, Georges Holleaux reçoit dans de très beaux bureaux dans le XIVe arrondissement parisien. Adossé au mur d’une grande pièce ornée de moulures, il développe sa pensée point par point, la répète au besoin, tel un professeur. Il cherche le mot juste, la formulation la plus précise, quitte à ponctuer la conversation de silences. Depuis trente ans, Georges Holleaux défend les victimes de terrorisme. Il a accepté de revenir, pour Les Petites Affiches, sur les enjeux spécifiques de ces procès, de nouveau au cœur de l’actualité politique et judiciaire.
Les Petites Affiches – Comment êtes-vous devenu un avocat spécialiste du terrorisme ?
Georges Holleaux – En 1988, j’ai déposé les premières plaintes avec constitution de partie civile pour des jeunes hémophiles contaminés par le virus du sida. Ces plaintes ont donné lieu, en 1992, au procès « du sang contaminé ». Il a conduit à l’incarcération du docteur Garetta, et à la condamnation des docteurs Allain et Netter, ainsi que du professeur Roux. Ce que j’ignorais, c’est que Françoise Rudetzki, victime de l’attentat du Grand Véfour en 1983, avait suivi ce procès : elle avait été contaminée lorsqu’elle avait été transfusée après l’attentat, ainsi qu’elle l’a expliqué dans son livre Triple peine. Voyant que, partant de rien, et en initiant pour la première fois en santé publique une plainte pour tromperie j’avais obtenu des résultats, elle m’a demandé de rejoindre les avocats de SOS Attentats, association qu’elle avait fondée.
LPA – Quelles affaires avez-vous traitées ?
G. H. – Après les détournements de l’Airbus en décembre 1994 et les attentats de Paris, au métro Saint-Michel notamment en 1995, j’ai été l’avocat de la quasi-totalité des victimes et de SOS Attentats. J’ai ensuite été saisi par une association de victimes espagnoles de l’organisation terroriste basque ETA, pour assister les 300 victimes du commando Argala, composé de Basques français arrêtés en France et non extradables. Je suis ensuite intervenu au procès de Djamel Beghal, condamné pour association de malfaiteurs terroriste, à celui de Smaïn Aït Ali Belkacem, condamné pour sa participation aux attentats de 1995 et qui avait tenté d’organiser son évasion de la centrale de Clairvaux. En fait, je n’ai pas cessé de défendre des victimes du terrorisme depuis 1995. Si je mets bout à bout le nombre de jours de procès en terrorisme dans lesquels je suis intervenu, cela représente un total de plus de deux ans d’audience.
LPA – Quelle est la particularité de ces audiences ?
G. H. – En premier lieu, ce sont des procès longs, qui durent souvent un mois, parfois plus. Le procès du commando Argala a ainsi duré sept semaines : il y avait 25 attentats à examiner, commis au long de quatorze années, ayant fait des centaines de victimes. Par ailleurs, depuis vingt ans, ces procès ont lieu devant une cour d’assises composée uniquement de magistrats professionnels. Cela modifie la rhétorique de l’audience. Il ne s’agit plus d’emporter l’intime conviction des jurés. Les juges professionnels savent se départir de leurs émotions, c’est beaucoup plus cartésien. La troisième spécificité, c’est que les accusés ont tendance à se servir de l’audience comme d’une tribune politique. Il est donc courant de voir des accusés revendiquer leur acte et leur comportement, et faire le procès de l’État qui les juge. Les « Etarras », ainsi, n’ont cessé en 1997 de prétendre justifier leurs actions criminelles en invoquant le massacre de Guernica de 1937, la dictature franquiste, alors même que l’Espagne était redevenue en 1978 une monarchie parlementaire et que les crimes reprochés avaient été commis justement entre 1978 et 1992. C’est le lieu même de la « défense de rupture ».
LPA – En quoi consiste cette défense de rupture ?
G. H. – C’est généralement une défense à double détente. Les accusés se livrent à une défense de rupture en justifiant longuement à l’audience, par un discours politique, leurs crimes qu’ils rapprochent de l’horreur supposée du régime contre lequel ils luttent. L’avocat peut les défendre ensuite en appuyant par une « défense de connivence », pour reprendre les termes de Jacques Vergès, à caractère technique classique : contester les preuves apportées. Face à cela, je travaille sur les deux plans. Il est important de répondre au confrère sur le plan technique, mais il convient également de ne pas laisser sans réponse la prétendue remise en cause faite par les accusés des juges et de l’État qui organisent leur procès.
LPA – Le terrorisme auquel nous sommes actuellement confrontés a-t-il changé de nature ?
G. H. – Le type de terrorisme a changé, en effet. La différence très importante tient au mode d’action et au caractère religieux du fanatisme. L’effectif des victimes devient considérable. De plus, dans un contexte de menace très forte, la matière factuelle du travail judiciaire n’est qu’un sous-ensemble de la matière totale de connaissance dont disposent les services de renseignements. L’élément nouveau radical, c’est évidemment le caractère suicidaire des attaques depuis quelques années. Il n’y a pas de procès possible sans accusé pour répondre des actes, car il n’existe pas de procès en diabolisation ni en canonisation dans la loi française ! Cela cause chez les victimes une inquiétude quant aux conditions de détention des survivants. À titre personnel, mon inquiétude est plutôt que les interpellations soient de plus en plus fréquemment supplantées par des « neutralisations », pour reprendre le vocabulaire des services. De ce point de vue, soulignons que s’il y a un jour un procès des attentats du 13 novembre, ce sera notamment grâce aux autorités belges qui auront interpellé vivant Salah Abdeslam. Si l’on continue de « neutraliser », au lieu d’interpeller, la démocratie reculera. La justice et le sort des victimes aussi, inévitablement. Ce recul de la démocratie serait une vraie victoire pour les terroristes car nous commencerions alors à abandonner nos valeurs.
LPA – Qu’attendent les victimes de ces procès ?
G. H. – Les victimes attendent toujours la même chose : des éléments de compréhension sur les attaques et sur le processus qui a conduit les auteurs à les commettre, le détail et la vérité des faits. Comment se fait-il que tel garçon soit devenu un terroriste ? On ne peut pas comprendre le terrorisme sans comprendre ce qui se passe dans la tête des terroristes. Si un procès d’assises ne permet jamais de faire toute la lumière, il apporte néanmoins des pans d’explication.
LPA – Quels sont les éléments de compréhension qui peuvent surgir lors d’un procès ?
G. H. – Au-delà de la psychologie des auteurs, les procès et l’instruction judiciaire permettent de mettre à jour le fonctionnement des organisations, la manipulation des auteurs par les commanditaires… Ainsi, pour les attentats de 1995, il est ressorti des instructions et des premiers procès entre 1999 et 2003 que Rachid Ramda était le donneur d’ordres et le financeur de l’attentat. Dix ans plus tard, en 2005, le Royaume-Uni a enfin accepté de l’extrader et il a été jugé devant la cour d’assises à Paris en 2007, puis en 2009 en appel. Ce fut très éclairant sur le mode de fonctionnement du GIA, avec lequel Al-Qaïda et Daech n’ont désormais plus grand-chose à voir.
LPA – Qu’est-ce que les procédures judiciaires peuvent nous apprendre du terrorisme auquel nous sommes aujourd’hui confrontés ?
G. H. – L’instruction du 13 novembre est riche d’enseignements sur l’organisation. Il ressort de manière très claire que certaines personnes organisaient les événements directement sans se mettre de sang sur les mains. L’idée que l’on avait pu avoir au début des années 2010, selon laquelle ces attaques étaient le fait de loups solitaires, vole en éclat. Que ce soit Mohamed Merah ou l’auteur de l’attentat raté du Thalys, on voit bien qu’ils ont été téléguidés, de manière plus ou moins adroite. Les modes de preuves électroniques et téléphoniques, entre autres, sont très contributifs.
LPA – Qu’y a-t-il de commun entre le terrorisme d’hier et celui d’aujourd’hui ?
G. H. – Le terrorisme n’a plus exactement le même visage, mais un des points communs et constants, entre le terrorisme des années 1980 et 1990 – qu’il émane de l’ETA ou du GIA –, et celui auquel nous sommes confrontés depuis 2012, est qu’il y a toujours une organisation qui se veut para-étatique derrière les actes commis. Les auteurs d’actes terroristes sont toujours un levier politique dans la main de quelqu’un. Encore faut-il identifier qui.
LPA – Comment voyez-vous les mesures prises pour se prémunir du terrorisme sur le territoire ?
G. H. – Elles sont à mon sens peu efficaces et porteuses d’effets pervers très gênants. L’état d’urgence décrété après les attentats du Bataclan ne sert plus à rien et n’est qu’un affichage politique. Personne ne peut dire à quoi il mène, sinon à épuiser tout le monde. Néanmoins, le sujet est devenu tabou : personne n’ose ne pas en demander le renouvellement, surtout en période électorale. D’autre part, la surveillance électronique est de plus en plus invasive, alors que rien ne montre qu’elle sert dans la même proportion à quelque chose. Cette surveillance de masse ne permet pas forcément de déjouer les plans des terroristes, qui communiquent de manière cryptée… La lutte anti-terroriste change dangereusement le visage de notre société, et déplace le curseur de nos valeurs tout aussi dangereusement. Pourtant les victimes d’attentats sont 30 fois moins nombreuses que celles tuées sur la route. Ces sujets mériteraient vraiment d’être débattus. L’histoire montre que l’on revient difficilement en arrière lorsque l’on réduit les libertés.