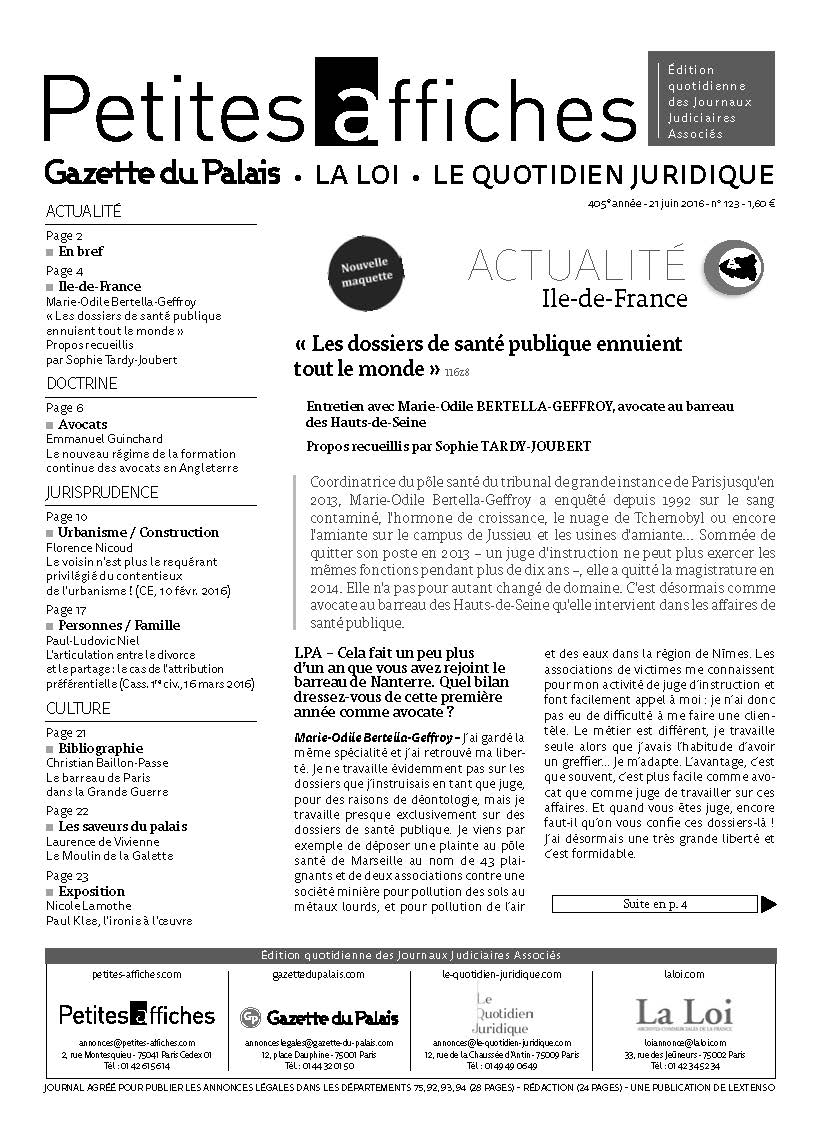« Les dossiers de santé publique ennuient tout le monde »
Coordinatrice du pôle santé du tribunal de grande instance de Paris jusqu’en 2013, Marie-Odile Bertella-Geffroy a enquêté depuis 1992 sur le sang contaminé, l’hormone de croissance, le nuage de Tchernobyl ou encore l’amiante sur le campus de Jussieu et les usines d’amiante… Sommée de quitter son poste en 2013 – un juge d’instruction ne peut plus exercer les mêmes fonctions pendant plus de dix ans –, elle a quitté la magistrature en 2014. Elle n’a pas pour autant changé de domaine. C’est désormais comme avocate au barreau des Hauts-de-Seine qu’elle intervient dans les affaires de santé publique.
LPA – Cela fait un peu plus d’un an que vous avez rejoint le barreau de Nanterre. Quel bilan dressez-vous de cette première année comme avocate ?
Marie-Odile Bertella-Geffroy – J’ai gardé la même spécialité et j’ai retrouvé ma liberté. Je ne travaille évidemment pas sur les dossiers que j’instruisais en tant que juge, pour des raisons de déontologie, mais je travaille presque exclusivement sur des dossiers de santé publique. Je viens par exemple de déposer une plainte au pôle santé de Marseille au nom de 43 plaignants et de deux associations contre une société minière pour pollution des sols au métaux lourds, et pour pollution de l’air et des eaux dans la région de Nîmes. Les associations de victimes me connaissent pour mon activité de juge d’instruction et font facilement appel à moi : je n’ai donc pas eu de difficulté à me faire une clientèle. Le métier est différent, je travaille seule alors que j’avais l’habitude d’avoir un greffier… Je m’adapte. L’avantage, c’est que souvent, c’est plus facile comme avocat que comme juge de travailler sur ces affaires. Et quand vous êtes juge, encore faut-il qu’on vous confie ces dossiers-là ! J’ai désormais une très grande liberté et c’est formidable.
LPA – Les affaires de santé publique ne passionnent pourtant pas les foules, dites-vous…
M.-O. B.-G. – Oui, cela dit, la situation a bien évolué depuis 1992, époque où ont éclaté les affaires du sang contaminé et de l’hormone de croissance… Je me suis alors retrouvée à être la spécialiste de ces affaires car personne n’avait envie de s’y plonger. À l’époque, cela n’intéressait vraiment personne et il n’y avait aucune spécialisation dans ce domaine. C’est pour cela que j’ai demandé la création d’un pôle santé, que j’ai mis de longues années à obtenir. Il existe aujourd’hui ; son activité se répartit entre Paris, qui traite les trois quarts des affaires, et Marseille qui traite le quart restant selon leurs compétences territoriales. Avant la création de ce pôle, je m’occupais aussi des affaires courantes de drogues, de viols, de crimes. C’était une charge de travail considérable, sans moyens suffisants.
Par ailleurs, il existe aussi depuis quelques années des masters spécialisés en droit de la santé. Cela montre que les choses commencent à bouger.
LPA – D’où vient ce désintérêt pour les affaires de santé publique ?
M.-O. B.-G. – Les juges d’instruction s’intéressent en général davantage aux crimes organisés, aux hold-up, aux affaires de sang. Dans ces affaires de santé publique, le travail peut sembler fastidieux. Il s’agit de catastrophes dont les effets ne sont pas visibles immédiatement, car les délais d’incubation sont lents (cancers, sida, maladie de Creutzfeld Jakob)… il faut donc rechercher des documents très anciens. Il est de plus difficile de mettre en évidence le lien de causalité entre les imprudences et les négligences qui ont eu lieu et les dommages constatés. Pour cela, il faut mener un vrai travail d’archiviste pour prouver que les décisions administratives ou industrielles n’ont pas été prises à temps alors même que l’on avait connaissance des dangers. Même avec les moyens d’enquête d’un juge d’instruction (réquisitions, perquisitions, commissions rogatoires), c’est difficile. D’autre part, les affaires de santé publique ne sont pas toujours considérées comme des affaires pénales. C’est un peu la même chose que pour les délits financiers… Cela reste délicat, pour un certain nombre de magistrats, de condamner des cols blancs.
LPA – En quoi consiste le travail d’archiviste que vous évoquez ?
M.-O. B.-G. – C’est un travail de collecte de documents assez proche de celui d’un historien. Il faut parfois remonter loin dans le temps. Prenons l’exemple de l’amiante : l’alerte avait été lancée dès 1905. J’ai retrouvé la lettre d’un médecin inspecteur du travail de Normandie qui écrivait très explicitement que les femmes qui filaient alors l’amiante dans une usine du Calvados mourraient prématurément. Mais les industriels se sont mis d’accord dès 1971 lors d’une réunion internationale à Londres pour que l’amiante soit interdit le plus tard possible. IIs ont bien réussi : on est un des pays européens à avoir interdit l’amiante le plus tard, en janvier 1996. Retrouver ces documents-clé est un travail de fourmi. On m’a parfois reproché ma lenteur, mais il faut être conscient que c’est une tâche colossale, et que je l’ai menée avec très peu de moyens, même au pôle santé créé à Paris fin 2003.
LPA – Est-il possible d’avoir des preuves de culpabilité dans les affaires de santé ?
M.-O. B.-G. – Ce n’est pas évident pour toutes les affaires. Ce qu’on cherche, ce sont des négligences et des imprudences ayant entraîné des dommages (maladies ou décès), alors qu’il y avait des moyens de les éviter. Prenez l’exemple de Tchernobyl : il n’y a pas de signature nucléaire du cancer de la thyroïde. Il y a eu de tels cancers avant et après Tchernobyl, c’est donc très difficile d’établir un lien de cause à effet, sans compter la rareté, en France, d’établissement à l’époque de registres de ce cancer par départements. Pour le sang contaminé en revanche, l’instruction a pu prouver pour les parties civiles transfusées et hémophiles l’origine et le moment de la contamination, et il est clair que les décisions qui s’imposaient pour les protéger n’ont sciemment pas été prises à temps. On savait qu’il fallait des produits chauffés pour les hémophiles et qu’il fallait des tests pour les transfusés. Or, on a attendu six mois pour que les produits soient chauffés pour les hémophiles, alors qu’on connaissait le danger et le moyen de l’éviter ; et on a attendu trois mois pour que les tests sanguins soient mis en place pour les transfusés. Ce retard de l’obligation des tests s’explique par des raisons commerciales : les tests américains Abott étaient prêts à être vendus en France mais le gouvernement français voulait privilégier l’institut Pasteur, qui lui n’était pas prêt… Ce n’est pas une interprétation que je fais : c’est indiqué expressément dans le compte rendu de la réunion interministérielle de l’époque en mai 1985, retrouvé à l’instruction.
LPA – Pourquoi est-ce si important, pour vous, que ces affaires soient jugées au pénal ?
M.-O. B.-G. – Le pénal a des pouvoirs d’investigation qui peuvent être mis au service de la santé publique. Mais en France, on préfère seulement indemniser les gens. À chaque fois qu’il y a une affaire de santé publique, on met en place un fonds d’indemnisation des victimes. C’est très bien, mais pour les victimes, ce n’est pas suffisant. On leur dit, en somme : « Vous serez indemnisé, ne cherchez plus à comprendre ce qui s’est passé ». Évidemment, cela ne leur convient pas : les victimes ont en général besoin de savoir et comprendre ce qui est arrivé « pour que ça ne recommence plus ».
LPA – Quelles sont les autres difficultés auxquelles vous étiez confrontées comme magistrat ?
M.-O. B.-G. – Les dossiers de santé publique ennuient tout le monde. Ils n’étaient généralement pas ouverts par le parquet. Aucun des dossiers que j’ai traités, même l’amiante, n’avait été ouvert par le parquet, mais par constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, directement, ou après classement sans suite. J’ai donc été nommée comme juge à chacun de mes dossiers par ce doyen des juges d’instructions. Cela veut dire que j’instruisais contre le parquet, ce qui est évidemment un mauvais début… Le manque d’indépendance du parquet est un vrai problème : la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme plusieurs fois à ce sujet sans qu’une véritable réforme soit menée. Nous sommes parmi les derniers en Europe à ne pas avoir un parquet indépendant, ça ne pourra pas durer éternellement.
LPA – Et ce manque d’indépendance a-t-il des conséquences sur les affaires de santé publique ? Sont-elles jugées différemment chez nos voisins ?
M.-O. B.-G. – Oui. Le procès d’Eternit, producteur d’amiante qui a sévi en France et en Italie, est emblématique de ces divergences. En Italie, la justice est indépendante du pouvoir politique : personne ne peut empêcher un procureur italien d’aller au bout d’un dossier. Le procureur de Turin, qui a ses propres moyens, avait formé une équipe de vingt enquêteurs, experts, et magistrats, mobilisés pendant trois ans, et a pu le clore dans ce laps de temps. Deux condamnations ont été décidées aux assises, dont dix-huit ans et vingt ans de réclusion contre deux PDG d’Eternit Italie. En France, je n’avais que peu d’enquêteurs, et un parquet hostile face à moi. Pour les mêmes faits, les mêmes PDG mis en examen dans les mêmes usines Eternit, vous avez un chef d’entreprise condamné à dix-huit ans d’un côté, et rien de l’autre…
LPA – Y a-t-il d’autres réformes à mener ?
M.-O. B.-G. – On manque en France d’experts judiciaires dans le domaine de la santé, notamment de toxico-chimistes ou d’épidémiologistes. Beaucoup d’experts judiciaires démissionnent, car la justice règle très en retard leurs honoraires. Cela les contraint à faire ces expertises en dehors de leur travail professionnel, ce qui est une lourde charge, et donc beaucoup abandonnent. Cette pénurie d’experts complique le travail des juges. Il faudrait instituer une Haute autorité de l’expertise, qui créerait un statut des experts (non judiciaires), avec un contrôle de leurs liens d’intérêts, comme c’est le cas dans d’autres pays européens. Il faudrait également un statut des lanceurs d’alerte avec un contrôle et une protection. Ce n’est pas le cas aujourd’hui : la loi de 2013 les a institués mais aucun décret d’application n’a encore été pris en 2016. Il faudrait aussi un statut du lobbyiste qui n’existe pas à ce jour en France. Enfin, la vraie réforme serait l’indépendance de la justice, pour qu’elle soit sans lien avec le politique, comme c’est le cas en Italie et dans de nombreux pays européens. J’espère voir un jour notre Constitution modifiée dans ce sens.