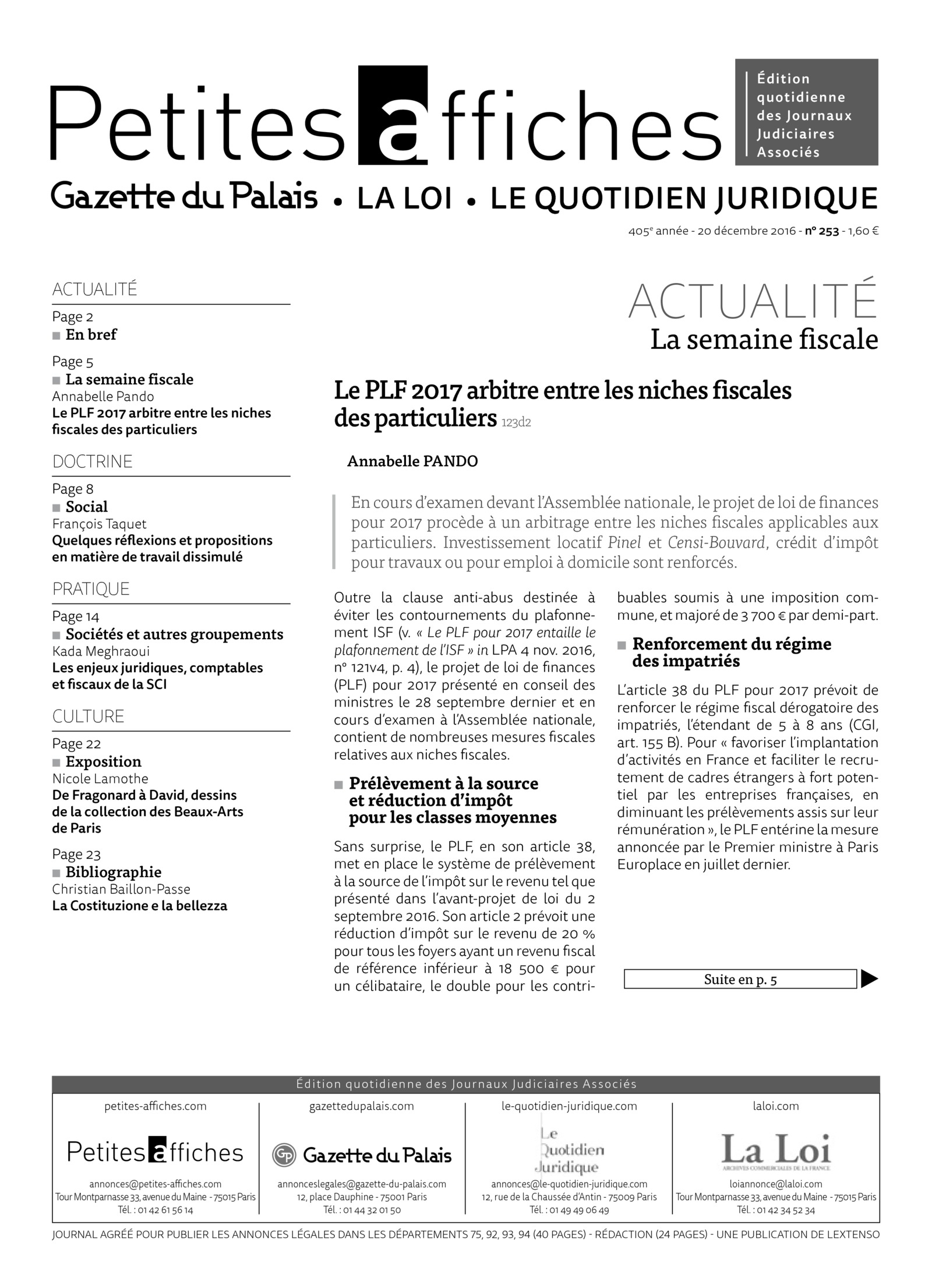Quelques réflexions et propositions en matière de travail dissimulé
Les dispositions légales de lutte contre le travail dissimulé sont compliquées, redoutables et souvent démesurés… Et ce constat paraît d’autant plus inquiétant que le législateur a banalisé la notion de travail dissimulé. Il est donc indispensable de revoir l’arsenal de sanctions actuellement en vigueur. Quelques pistes de réformes peuvent être proposées.
Le non-spécialiste en matière sociale ne peut être que frappé par le dispositif impressionnant mis en œuvre par les pouvoirs publics pour lutter contre le travail illégal. C’est que la lutte contre le travail illégal est une priorité gouvernementale qui s’est traduite notamment par le lancement d’un Plan national d’action 2004-2005 et une intensification des contrôles par les services de l’État et les organismes de protection sociale. Rappelons rapidement que le travail illégal, défini à l’article L. 8211-1 du Code du travail, concerne les infractions suivantes : le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main-d’œuvre, l’emploi d’étranger sans titre de travail, les cumuls irréguliers d’emplois, la fraude aux revenus de remplacement. Le travail dissimulé1 constitue donc un élément du travail illégal. Pratiquement, il recouvre deux types de situations : la dissimulation d’activité qui concerne les travailleurs indépendants qui se soustraient intentionnellement à leurs obligations d’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou encore aux déclarations devant être faites auprès des organismes de protection sociale (dont l’Urssaf) ou à l’administration fiscale2 et la dissimulation de salariés (absence de déclaration préalable à l’embauche ou de bulletin de paie ou de déclaration relative aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement ou de l’administration fiscale, étant entendu que la mention intentionnelle sur le bulletin de salaire d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli peut également constituer une dissimulation d’emploi salarié3. La lutte contre le travail dissimulé est assurée par les inspecteurs du recouvrement des Urssaf ainsi que par plusieurs administrations de l’État : inspection du travail, gendarmerie, police, impôts, douanes… Aux termes de l’article L. 8271-8 du Code du travail, les infractions sont constatées au moyen de procès-verbaux, transmis, aux fins de poursuites pénales, au procureur de la République. Sans vouloir sombrer dans une étude des statistiques, force est de constater que les chiffres relatifs à la lutte contre le travail dissimulé sont impressionnants. Ainsi, en 2015, le montant des redressements Urssaf lié au travail dissimulé a augmenté de 13 % par rapport à l’année précédente4. Finalement ce souci des pouvoirs publics de lutter contre ce « fléau social » qu’est le travail dissimulé devrait satisfaire les citoyens responsables. En effet, ce travail souterrain génère au moins un triple préjudice : préjudice pour les organismes de recouvrement en raison des considérables pertes de recettes sociales qui en découlent, préjudice pour les travailleurs qui ne peuvent prétendre à des droits à assurance vieillesse sur des sommes qui n’ont pas données lieu à cotisations sociales, préjudice enfin pour l’économie puisque le travail dissimulé fausse nécessairement le jeu de la concurrence. Au final, on pourrait même s’interroger sur l’opportunité d’un article visant à formuler des remarques et des propositions sur les textes existants.
Notre propos ne vise pas ici à faire un article sur le travail dissimulé5. Il se limitera à faire quelques constats et à formuler quelques propositions en la matière, essentiellement dans les rapports entre les entreprises et les Urssaf.
I – Un arsenal législatif compliqué, redoutable et souvent démesuré
Une première constatation est relative au nombre de textes promulgués depuis 1997. On ne compte plus en effet le nombre de lois et décrets qui se sont empilés en la matière6 à tel point que l’étude du sujet est devenue ardue voire incompréhensive même pour les professionnels les plus avertis7. Que l’on est loin de l’affirmation de Montesquieu suivant laquelle « ceux qui ont un génie assez étendu pour donner des lois à leur nation doivent faire de certaines attentions sur la manière de les former. Elles doivent être simples et ne doivent point être subtiles. Elles ne sont point un art de logique mais la raison simple d’un père de famille »8 !
La deuxième remarque a trait au champ d’application de la notion de travail dissimulé. En effet, on constate depuis un certain nombre d’années que sous couvert d’une nécessaire lutte contre le travail dissimulé, le législateur n’a eu de cesse de banaliser cette notion9. L’exemple le plus frappant est celui de l’article L. 8221-5, 2°, suivant lequel est réputé travail dissimulé le fait de « se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ». Lorsque l’on sait les difficultés d’application de la législation en matière de durée du travail, on se dit que beaucoup d’entreprises entrent dans le champ d’application du travail dissimulé sans même le savoir10.
La troisième observation est liée aux sanctions. Lesdites sanctions peuvent être pénales11. De plus, l’employeur ne pourra se voir remettre l’attestation marchés publics12 ainsi que les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ainsi que l’attestation de vigilance13, étant ainsi condamné à une mort certaine. On notera également qu’un décret n° 2015-1327 du 21 octobre 2015 pris en application de la loi Savary n° 2014-790 du 10 juillet 2014 prévoit une peine complémentaire à celle du travail illégal : la diffusion sur un site internet dédié du ministère du Travail de la liste des entreprises condamnées pour une période maximale de deux ans14. En outre, s’agissant de la sécurité sociale, on notera les pouvoirs sans cesse accrus des Urssaf, qui sont en première ligne dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Ainsi, on remarquera que le travail dissimulé entraîne le retrait des mesures de réduction et d’exonération de cotisations de sécurité sociale15. Qui plus est, en cas de travail dissimulé, on relève que les droits du cotisant se restreignent singulièrement16. Ainsi, dans le cadre d’une vérification en présence de travail dissimulé, un avis de contrôle (mentionnant l’existence de la Charte du cotisant vérifié qui définit les droits et devoirs des parties pendant la vérification) n’a pas à être remis au cotisant17. Si dans le cadre général, les agents de contrôle sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant18, le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 dans le cadre du contrôle Urssaf assouplit cette règle en précisant que « la signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition »19. En outre, les majorations de retard sont portées à 25 % en cas de travail dissimulé20, sans possibilité d’obtenir de remise21. Dans le cadre du droit du travail et lors de la rupture de la relation de travail, le salarié dont l’employeur a dissimulé l’emploi a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire22 ; cette indemnité forfaitaire est due quel que soit le mode de rupture de la relation de travail. Dans un arrêt rendu le 6 février 201323, la chambre sociale de la Cour de cassation a même considéré qu’au regard de la nature de sanction civile de l’indemnité forfaitaire mentionnée ci-dessus, le cumul de cette indemnité était également possible avec l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement24. Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l’application des dispositions du Code du travail relatives à la lutte contre le travail dissimulé, en faveur d’un salarié, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé25.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que cet arsenal redoutable, rapidement résumé, ne peut que laisser le juriste dubitatif. En effet, outre le fait que les sanctions paraissent démesurées, on relèvera que quelle que soit la gravité de la faute (montages complexes pour des groupes internationaux ou simple paiement répété d’heures supplémentaires en primes exceptionnelles pour une PME), la sanction est identique, ce qui constitue un non-sens… D’une part, parce que bien souvent, le travail dissimulé qui atteint les petites entreprises, concerne des employeurs de bonne foi, peu au fait de la loi et qui ne comprennent pas les motifs de redressement. D’autre part, parce qu’il paraît pour le moins téméraire de ne pas individualiser les sanctions en tenant compte de la bonne foi du cotisant. Une réforme s’impose donc.
II – Quelques pistes de réforme nécessaire
Sans doute est-il banal d’affirmer qu’une sanction doit être comprise par l’auteur de l’infraction car, dans le cas contraire, elle ne remplirait pas sa fonction. Or, en l’espèce, faute de tenir compte de la bonne foi du cotisant qui permettrait d’individualiser la sanction, cette dernière n’atteint pas son objectif. Qu’il nous soit donc permis de proposer quelques solutions.
Donner la faculté à l’agent chargé du contrôle de l’Urssaf d’individualiser la sanction en tenant compte de la bonne foi du cotisant. Étrangement, cette faculté n’est pas prévue dans ce type de situation où règne le principe de l’uniformité des sanctions26. Et pourtant, l’ACOSS elle-même reconnaît plusieurs types de fraudes, en relevant une gradation : la fraude de faible intensité, notamment liée aux activités saisonnières, détournements de l’entraide familiale ou du bénévolat, dévoiements du statut de l’autoentrepreneur, les situations usuelles de travail dissimulé dont l’infraction caractérisée relève de la minoration d’heures, la dissimulation partielle ou totale d’activité et/ou de salariés et enfin, la fraude majeure pouvant, par la complexité du mécanisme, être liée à des enjeux financiers élevés et/ou une dimension internationale27. Qui plus est, on notera que le rapport rédigé par les députés Bernard Gérard et Marc Goua proposaient d’« adapter une sanction proportionnelle à la nature de l’erreur constatée »28. Il paraît donc urgent, nécessaire et de bon sens, de laisser aux agents de contrôle de l’Urssaf un pouvoir de graduer les sanctions en fonction du type de fraude commise29.
Revoir la possibilité de requalification du travail indépendant en salariat. Ce point n’est pas neutre lorsque l’on constate le développement de nouvelles formes de travail parfois incitées par les pouvoirs publics. Ainsi en est-il de l’essor du statut d’autoentrepreneur ou encore de l’économie collaborative. Il serait pour le moins malsain que le législateur cherche à accroître ces différentes formes d’activité en omettant de donner aux intéressés la sécurité juridique indispensable. Certes, on invoquera que la loi n° 94-126 du 11 février 1994 a donné la possibilité aux travailleurs indépendants concernés d’interroger l’Urssaf sur leur assujettissement dans le cadre de la procédure de rescrit30. Cependant, on sait que cette procédure fonctionne mal31 et n’est pas sécurisante pour le cotisant32. Diverses tentatives ont été faites, au milieu d’une architecture de sécurité sociale complexe, afin d’éviter des paiements de doubles cotisations ou des requalifications de relations contractuelles en salariat33. Pourtant, jusqu’à présent les mesures incitatives visant à simplifier et sécuriser les relations entre l’assujetti et les différentes caisses, se sont révélées vaines34. Sans doute serait-il indispensable de renforcer la sécurité des cotisants en garantissant qu’une affiliation effectuée de bonne foi ne puisse être remise en cause par une Urssaf pour le passé mais uniquement pour l’avenir !
Renforcer le dialogue et la procédure contradictoire. Devant une définition du travail dissimulé aussi vaste et un arsenal répressif aussi développé, il convient de veiller scrupuleusement au respect de la procédure contradictoire voire à amplifier les garanties des cotisants. Or, force est de constater depuis plusieurs années que le législateur, voire les pouvoirs publics, n’ont eu de cesse que de restreindre les garanties des personnes concernées au nom de la lutte contre le travail dissimulé. Ainsi par exemple, une vérification Urssaf est précédée d’un avis de contrôle, sauf en cas de travail dissimulé. Si l’exclusion de l’avis de contrôle se comprend aisément, en revanche, l’absence d’information relative à la Charte du cotisant contrôlé (qui énonce les droits et devoirs des parties) est plus difficilement compréhensible. Est à ce à dire que dans le cadre d’un « travail dissimulé » le cotisant a ses droits amoindris35 ? De même, si l’article L. 8271-6-1 du Code du travail, relatif au travail dissimulé, précise de manière générale que les agents de contrôle « sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, on est étonné que l’article R. 243-59 II, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale36 restreigne ce principe en cas de vérification Urssaf en précisant que « la signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition ». De la même manière, il paraîtrait cohérent, dans le cadre de la procédure contradictoire, que les procès-verbaux établis par les inspecteurs du recouvrement soient également envoyés pour information au cotisant37. Quant au donneur d’ordre, on sait que l’article L. 8222-2 du Code du travail prévoit que s’il ne procède pas aux vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du Code du travail, il est tenu solidairement responsable avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé « au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ». Le Conseil constitutionnel38 a écarté les griefs tirés du principe d’égalité devant la justice et de la méconnaissance de la garantie des droits sous la réserve que le donneur d’ordre puisse contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu. Toutefois, il serait souhaitable que la transparence soit de mise et que le donneur d’ordre puisse disposer du procès-verbal établissant l’infraction de travail dissimulé ainsi que de l’ensemble des informations (fournies par l’Urssaf) permettant d’assurer sa défense.
Préciser le rôle du Comité des abus de droit. La notion d’abus de droit et l’existence d’un comité de l’abus de droit fiscal existe dans le Livre des procédures fiscales39. Le législateur a transposé ces dispositions en matière de sécurité sociale40. Suivant l’article L. 243-7-2, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, les actes constitutifs d’un abus de droit sont :
-
soit ceux qui ont un caractère fictif ;
-
soit ceux qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En effet, suivant le même article, les organismes de recouvrement sont en droit de restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse. Les exemples en la matière sont nombreux. Ainsi en serait-il en cas de requalification par une Urssaf de la situation d’auto-entrepreneur ou d’agent commercial en salarié.
La procédure prévue par le législateur est pour le moins complexe41. Trois idées essentielles doivent cependant être dégagées :
-
la décision de mettre en œuvre la procédure d’abus de droit est prise par le directeur de l’organisme ;
-
le directeur de l’organisme doit contresigner la lettre d’observations ;
-
le document doit mentionner au cotisant la possibilité de saisir le comité des abus de droit et les délais impartis.
Le problème est que bien souvent, l’Urssaf ne fait pas référence à la notion d’abus de droit afin de ne pas compliquer la procédure. Ainsi que l’a soutenu Thierry Romand, « la procédure des abus de droit présente une certaine complexité qui conduit fréquemment les Urssaf à invoquer “implicitement” un abus de droit sans pour autant déclencher la procédure afférente »42 Et à l’auteur d’ajouter que « la réticence d’une Urssaf à déclencher la procédure de répression des abus de droit est lourde de conséquence pour le cotisant qui peut se voir redresser sur la base d’un mécanisme licite tout en étant privé des garanties attachées à cette procédure ». Certes, peu de jurisprudence existe à ce jour en matière de sécurité sociale43. Toutefois, le parallèle est aisé avec la fiscalité. Et la jurisprudence administrative a décidé que lorsque l’Administration se place implicitement sur le terrain de l’abus de droit, sans indiquer expressément au contribuable, avant la mise en recouvrement de l’imposition, que le redressement a pour fondement l’article L. 64 du LPF, l’intéressé est privé de la garantie tenant à la faculté de provoquer la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit. Il y a lieu, par conséquent, de prononcer la décharge des redressements fondés sur l’opération litigieuse sans examen du bien-fondé de la position de l’Administration44. Sans doute serait-il nécessaire de clarifier et de simplifier les possibilités de saisine de ce Comité45.
Revoir les cas d’exclusion de l’attestation de marché public ou de l’attestation de vigilance. Les Urssaf disposent d’un véritable droit de vie et de mort vis-à-vis des entreprises au travers de ces deux attestations46. Sans doute serait-il utile de lister les situations graves dans lesquelles les organismes de recouvrement pourraient se dispenser de la délivrance de ces documents47.
Ainsi, au terme de ce bref panorama, force est de constater l’iniquité de l’arsenal législatif relatif au travail dissimulé. Sans doute, après la profusion des textes votés en la matière, serait-il utile de réfléchir sur des modifications permettant de trouver un équilibre entre les droits des agents de contrôle, le respect de la procédure contradictoire, la mise en œuvre des sanctions. C’est simplement dans ces conditions que la sanction pourra être comprise par l’auteur de l’infraction.
Notes de bas de pages
-
1.
On notera que la notion de travail dissimulé a été introduite par la L. n° 97-210, 11 mars 1997, relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal.
-
2.
C. trav., art. L. 8221-3.
-
3.
C. trav., art. L. 8221-5.
-
4.
Soit 463 millions d’euros (v. Rapp. ACOSS 2016, « Le contrôle et la lutte contre la fraude au prélèvement social »). On notera qu’en 2014, les redressements liés au travail dissimulé avaient déjà augmenté de 25 % par rapport à 2013.
-
5.
Bien des études traitent cette question de manière complète. V. Molla S., « Travail dissimulé », JCl. Travail Traité, fasc. 17-40 ; Cerf-Hollender A., « Travail dissimulé », Rép. Dalloz.
-
6.
Chaque loi, chaque décret traitant de près ou de loin du droit du travail, de la protection sociale ou encore du droit des affaires se doit aujourd’hui d’avoir un chapitre ou section relatif à la lutte contre le travail dissimulé. Ainsi en est-il de la L. n° 2005-882, 2 août 2005, en faveur des petites ou moyennes entreprises ou de toutes les lois de financement de la sécurité sociale votées chaque année, ou des lois de « simplification du droit » : L. n° 2009-526, 12 mai 2009 ; L. n° 2011-525, 17 mai 2011 ; L. n° 2012-387, 22 mars 2012), sans compter les lois relatives à l’immigration, ainsi que les décrets de toutes sortes (v. pour ex. D. n° 2016-941, 8 juill. 2016, relatif au renforcement des droits des cotisants). L’auteur du présent article s’est refusé à compter le nombre de textes participant à cette boulimie législative.
-
7.
On relèvera que certains auteurs n’ont pas hésité à parler de « surenchère législative » : v. Nivelles V., JSL 2015, n° 399/400.
-
8.
Montesquieu, De l’Esprit des lois.
-
9.
D’aucuns ont estimé que la notion de travail dissimulé avait été « banalisée » au fil du temps, qu’elle était devenue une notion « attrape-tout » qui permettait d’inclure tout type d’irrégularité sans prendre en compte la réalité de l’intention frauduleuse. D’autres soutiennent que plus de 80 % des employeurs pratiqueraient le travail dissimulé sans le savoir, à la manière de Monsieur Jourdain, dans le Bourgeois gentilhomme de Molière, qui disait de la prose sans en avoir conscience.
-
10.
Ainsi, le fait pour un employeur de payer des heures supplémentaires en primes exceptionnelles (situation que l’on relève fréquemment dans les TPE…) peut rentrer dans la définition du travail dissimulé (même si l’Urssaf ne subit aucun préjudice puisque les cotisations et contributions sont payées sur les salaires). Certes, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué (Cass. soc., 4 mars 2003, n° 00-46906 ; Cass. soc., 22 juin 2011, n° 09-42151). Toutefois, l’appréciation du caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. soc., 14 oct. 2015, n° 14-12193 ; v. égal. CA Toulouse, ch. 3, 30 août 2016, n° 16/00872 : lorsqu’il procède au constat de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement d’une Urssaf qui a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi ne nécessite pas d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur). De même, le fait de verser de prétendus frais kilométriques alors qu’il s’agissait en réalité d’un complément de rémunération du salarié caractérise la dissimulation d’une partie du salaire et dès lors le travail dissimulé (Cass. soc., 9 avr. 2015, n° 13-26817). On notera également que dans certaines hypothèses, le bénévolat pourrait être qualifié de travail dissimulé : v. pour ex. : Cass. 2e civ., 20 sept. 2005, n° 03-30592. V. sur ce point : Guichaoua H., « La frontière entre l’activité professionnelle et le bénévolat », Le Droit ouvrier, avr. 2013, p. 229 et s.). Qui plus est, on relèvera toute la jurisprudence relative aux « faux travailleurs indépendants » (v. ainsi : Cass. crim., 15 déc. 2015, n° 14-85638 ; Cass. 2e civ., 7 juill. 2016, n° 15-16110 : requalification en contrat de travail de « faux » autoentrepreneurs ; Cass. 2e civ., 28 mai 2014, n° 12-21397 : requalification en salaire de commissions versées à des négociateurs immobiliers).
-
11.
Pour les personnes physiques : emprisonnement de trois ans et amende de 45 000 € ; en cas d’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (C. trav., art. L. 8224-2) ; pour les personnes morales : amende de 225 000 € (C. trav., art. L. 8224-5), administratives (refus d’aides publiques pendant une durée maximale de cinq ans : C. trav., art. D. 8272-3 ; C. trav., art. D. 8272-4 ; remboursement des aides publiques versées au cours des douze mois précédant l’établissement du procès-verbal de constatation de l’infraction : C. trav., art. D. 8272-5 ; C. trav., art. D. 8272-6 ; possibilité pour l’autorité administrative d’« ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois » : C. trav., art. L. 8272-2.
-
12.
Aux termes de l’article 46-I du Code des marchés publics, le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 du Code du travail.
-
13.
CSS, art. L. 243-15 ; C. trav., art. L. 8222-1 ; C. trav., art. D. 8222-5.
-
14.
Certains auteurs ont estimé qu’il s’agissait ici de « la peine de trop » puisque cette diffusion peut intervenir alors qu’aucune décision judiciaire définitive n’a été rendue (Nivelles V., JSL 2015, n° 399/400).
-
15.
La LFSS 2017 a étendu cette sanction aux autres infractions constitutives du travail illégal (marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, emploi d’étranger non autorisé à travailler).
-
16.
Et pourquoi le cotisant, soupçonné de travail dissimulé, voit-il ainsi ses droits restreints ?
-
17.
CSS, art. R. 243-59. V. en ce sens : CA Paris, 6-12, 13 juin 2013, n° 12/05731 ; CA Paris, 6-12, 16 janv. 2014, n° 12/07494 ; CA Toulouse, ch. soc. 4, sect. 2, 5 déc. 2014, n° 12/06889. De même, on relèvera que la transaction prévue à l’article L. 243-6-5 du Code de la sécurité sociale n’est pas envisageable en cas de travail dissimulé. De même, la limitation de la durée du contrôle à trois mois pour les TPE n’est pas applicable dans cette hypothèse (CSS, art. L. 243-13).
-
18.
V. C. trav., art. L. 8271-6-1 ; v. égal. Cass. 2e civ., 9 oct. 2014, n° 13-19493 : « Les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues » ; v. dans le même sens : CA Rennes, ch. 9, 17 avr. 2013, n° 12/05614.
-
19.
CSS, art. R. 243-59, II, al. 5.
-
20.
CSS, art. L. 243-7-6. En outre, et dès lors qu’un procès-verbal de travail illégal a été établi et que la situation et le comportement de l’entreprise ou de ses dirigeants mettent en péril le recouvrement des cotisations dissimulées, l’inspecteur du recouvrement peut dresser un procès-verbal de flagrance sociale comportant l’évaluation du montant des cotisations dissimulées (L. n° 2011-1906, 21 déc. 2011, art. 128 ; CSS, art. L. 243-7-4, modifié par la LFSS 2017). Ce document est signé par l’inspecteur et permet à l’Urssaf de procéder en cas de travail illégal, et de manière très rapide, à des saisies conservatoires, sans autorisation préalable du juge.
-
21.
CSS, art. R. 243-20 – Faut-il rappeler également qu’un classement sans suite au pénal sur des infractions relatives à du travail dissimulé ne fait pas obstacle à un redressement de cotisations (CA Bourges, ch. soc., 25 janv. 2013, n° 12/00018 ; CA Nancy, ch. soc., 22 mai 2013, n° 12/02392) ? Or, dans 80 % des cas, les procès-verbaux transmis par l’Urssaf au procureur de la République sont classés sans suite (conformément au principe d’opportunité des poursuites)… ce qui n’empêche pas l’Urssaf de poursuivre la procédure.
-
22.
C. trav., art. L. 8223-1.
-
23.
Cass. soc., 6 févr. 2013, n° 11-23738.
-
24.
Auparavant un tel cumul n’était pas possible, la Cour de cassation considérant que seule la plus élevée de ces deux indemnités devait être allouée au salarié.
-
25.
C. trav., art. L. 8223-4. Et la boulimie du législateur ne semble pas connaître de fin puisque la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 comporte encore des dispositions visant à durcir l’arsenal existant. On notera avec intérêt que les sites officiels (notamment celui de l’Urssaf) peinent à être à jour des évolutions légales !
-
26.
Alors que ladite faculté existe par exemple en matière d’obstacle à contrôle, l’article L. 243-12-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant que « pour fixer le montant de la pénalité, le directeur de l’organisme prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ».
-
27.
V. ACOSS, Direction de la statistique, des études et de la prévision, Évaluation de l’évasion sociale, 4 avr. 2016. Cependant, on notera en outre que seules les circulaires instructions du ministre chargé de la Sécurité sociale (CSS, art. L. 243-6-2) sont opposables aux Urssaf, ce qui exclut les notes de l’ACOSS qui sont dépourvues de force obligatoire et qui ne peuvent être de nature à restreindre les droits des Urssaf.
-
28.
Pour un nouveau mode de relations Urssaf/entreprises, avr. 2015. V. notre article : « Quarante-quatre propositions pour améliorer les relations Urssaf-entreprises », JCP E 2015, 1303.
-
29.
On ne saurait en effet mettre toutes les infractions de travail dissimulé sur le même plan. Le bon sens requiert que l’on individualise en la matière les sanctions. Est-il ainsi cohérent que les mesures édictées par le Code de la sécurité sociale pour lutter contre le travail dissimulé frappent uniformément les entreprises qui recrutent des dizaines de travailleurs sans être déclarés et les employeurs qui paient des heures supplémentaires à leurs salariés sous forme de primes (auquel cas l’Urssaf ne subit pas de préjudice quant aux cotisations versées). On relèvera également que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a créé un « droit à l’erreur » pour les employeurs de bonne foi en matière de protection sociale complémentaire (CSS, art. L. 133-4-8) et de négociation annuelle des salaires en introduisant un système de proportionnalité des sanctions (C. trav., art. L. 2242-5-1). Pourquoi ce système ne pourrait-il pas être étendu à l’hypothèse de travail dissimulé en permettant ainsi aux inspecteurs de tenir compte de la bonne foi de la personne en infraction, de distinguer le fraudeur et l’imprudent ?
-
30.
CSS, art. L. 311-11.
-
31.
V. Ali Mohamed F., Les droits de l’employeur cotisant dans ses relations avec l’Urssaf : opposabilité de la doctrine et application du rescrit en matière sociale, mémoire pour le diplôme de master recherche Droit social 2005/2006, université de Nantes, p. 37 et s.
-
32.
Ainsi, que veut dire une activité qui place le cotisant « dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre » ? En outre, que faut-il entendre par des conditions d’exercice d’activité « substantiellement modifiées » ?
-
33.
On imagine dans ce cas la procédure courtelinesque et kafkaïenne à la fois, qui devra être menée par le travailleur indépendant requalifié en salarié et qui souhaite récupérer le montant des cotisations indûment versées.
-
34.
Une des dernières tentatives a été celle de la sénatrice Pascale Gruny (amendement n° 218 rect. sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016) : « Toutefois aucun redressement ne peut être effectué au titre d’un assujettissement effectué à tort auprès d’un organisme de sécurité sociale dès lors que l’affiliation de l’intéressé a été faite de bonne foi et que l’organisme ne l’a pas remise en cause ».
-
35.
Alors que nous avons vu précédemment que la définition du travail dissimulé était particulièrement large, ne serait-il pas envisageable, par exemple, de remettre la Charte lors du contrôle ?
-
36.
Issu du D. n° 2016-941, 8 juill. 2016 ; v. notes 13 et 14.
-
37.
Ainsi, le refus de l’Urssaf de transmettre le procès-verbal de travail dissimulé ne saurait constituer une atteinte au principe du contradictoire en l’espèce. En effet, le procès-verbal litigieux tend à l’information du ministère public en vue d’éventuelles poursuites pénales. En conséquence, une violation du principe du contradictoire ne saurait être retenue par l’effet de l’absence de communication du procès-verbal dressé pour infractions de travail dissimulé (CA Rennes, ch. 9, 20 févr. 2013, n° 12/01698). La non-communication par l’Urssaf du procès-verbal que cette dernière a dressé, au titre de l’infraction de travail dissimulé, ne peut être un motif d’annulation, tant du contrôle lié à l’application de la législation en matière de sécurité sociale, que du redressement subséquent (CA Aix-en-Provence, ch. 14, 27 sept. 2012, n° 11/13415). De même, les dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n’imposent aucunement à l’Urssaf d’adresser à la personne contrôlée la copie des procès-verbaux établis par les services de police (CA Versailles, ch. 5, 6 nov. 2014, n° 13/02151).
-
38.
Cons. const., 31 juill. 2015, n° 2015-479 QPC.
-
39.
LPF, art. L. 64, issu de la L. n° 2008-1443, 30 déc. 2008.
-
40.
L. n° 2009-526, 12 mai 2009, art. 75 (tant pour le régime général que pour le régime agricole). Les dispositions légales ont été complétées par le décret n° 2011-41 du 10 janvier 2011 qui fixe la composition du Comité des abus de droit et précise les règles applicables à la procédure de répression des abus de droit, tant pour le régime général que pour le régime des salariés agricoles. L’arrêté du 22 décembre 2011 (JO, 12 janv. 2012, p. 601) a nommé les membres du Comité.
-
41.
Selon l’article R. 243-60-3, I, la décision de mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit est prise par le directeur de l’organisme de recouvrement, qui contresigne à cet effet la lettre d’observations remise ou envoyée au cotisant suite au contrôle. Ce document mentionne la possibilité pour le cotisant de saisir le Comité des abus de droit et les délais impartis pour ce faire. Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d’observations pour demander à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (MNC) que le litige soit soumis à l’avis du Comité des abus de droit. En résumé, le cotisant n’a pas la faculté de saisir directement le Comité des abus de droit, mais doit s’adresser à la MNC qui saisira le Comité des demandes recevables. S’il formule dans ce délai des observations à ce document, il dispose à nouveau d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’organisme de recouvrement à ces observations (CSS, art. R. 243-60-3, II). Dans un délai de trente jours, la mission nationale de contrôle et d’audit saisit le Comité des demandes recevables et avertit l’organisme (CSS, art. R. 243-60-3, III). Devant le Comité, l’organisme de recouvrement et le cotisant sont invités à produire leurs observations dans un délai de trente jours (CSS, art. R. 243-60-3, IV). L’avis du Comité est certes dépourvu de force obligatoire, mais est cependant doté d’une grande portée pratique. Si les organismes de recouvrement ne se conforment pas à l’avis du Comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification (CSS, art. L. 243-7-2, al. 2). En cas d’avis favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant (CSS, art. L. 243-7-2, al. 2).
-
42.
Les Échos Business, 7 juill. 2014.
-
43.
V. toutefois CA Rennes, ch. 9, 15 juin 2016, n° 15/01830 : le recours à la procédure d’abus de droit emportant pénalité ne constitue pour l’Urssaf qu’une simple faculté dès lors qu’elle estime réunies les conditions de l’abus de droit nécessitant la caractérisation notamment d’un élément intentionnel de la part de son auteur. En l’espèce, l’Urssaf n’avait nullement retenu comme réunies les conditions de l’abus de droit, n’avait pas eu recours à la procédure d’abus de droit et à la pénalité de 20 % qui y est attachée, ayant uniquement procédé à un redressement au simple constat que les indemnités forfaitaires de repas devaient être réintégrées dans l’assiette de cotisations. La société ne pouvait donc se prévaloir d’une atteinte à ses droits et garanties, avec notamment mise en œuvre d’une contestation devant le Comité des abus de droit, prévue à l’article L. 243-7-2.
-
44.
CAA Nancy, 21 déc. 2000, n° 00NC00375, n° 96-2140 ; CAA Lyon, 2 mars 2006, n° 13LY01383, n° 01-1962.
-
45.
Et en ce sens, on peut espérer que toute tentative de requalification de contrat en contrat de travail entre dans son champ d’application.
-
46.
V. notes 12 et 13. Ces pouvoirs exorbitants introduisent une véritable présomption de culpabilité avant même que les juges ne se soient éventuellement prononcés.
-
47.
D’aucuns vont même plus loin en soutenant que les Urssaf devraient continuer à délivrer ces attestations dès lors que l’entreprise conteste devant le juge le principe même de l’infraction pour travail dissimulé.